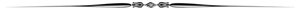Dahin ! Dahin !
Là où mûrissent les oranges.
Parodie de Goethe
Les eaux étant trop basses, les bateaux ne circulaient pas sur la Mologa en été et en automne ; pour se rendre à Moscou, il fallait faire un détour par Vologda. Avec mon compagnon P., nous nous mîmes en route, tard le soir et, à trois heures du matin, prîmes place dans une draisine et partîmes par un segment encore inachevé du tronçon ferroviaire Vesyegonsk-Souda. Puis, nous montâmes à bord d’une locomotive qui nous amena à l’aube du 18/31 août à une station de la voie Petrograd-Vologda-Souda. Outre nous deux et le mécanicien, il y avait avec nous un quatrième homme, ouvrier sans doute. Le mécanicien, un gars tapageur, désinvolte et bavard, nous racontait qu’il lui arrivait souvent de transporter des bolcheviks de haut rang. En citant leurs noms, il les couvrait des pires insultes. « Il y a quelques jours encore, j’ai du transporter un de ces… (un mot très grossier) haut-placés. » Était-ce un genre d’opposition politique ou simplement un comportement de voyou ? C’est difficile à dire, peut-être un peu des deux. Le train en provenance de Petrograd arriva à neuf heures du matin avec plusieurs heures de retard, et nous parvînmes à Vologda aux environs de midi. Grâce à nos ordres de mission, nous pûmes prendre place en première classe. Notre wagon était bondé. Nous dûmes rester debout dans le couloir avec nos bagages pendant tout le trajet… Parmi les nombreux soldats de l’Armée rouge qui voyageaient dans notre wagon, mon attention fut retenue par un jeune officier à l’air aristocratique, portant avec élégance un uniforme de l’Armée rouge et une casquette à étoile rouge. Son visage était triste, il était assis dans le couloir sur ses valises luxueuses et regardait droit devant lui, perdu dans ses pensées. Il me rappelait une connaissance à Petrograd, et j’étais sur le point de le saluer, mais comme je n’étais pas certain, j’hésitai. C’était assez risqué ; je ne savais pas ce qu’il faisait dans l’Armée rouge et peut-être était-il vraiment passé du côté des bolcheviks. De son côté, il s’obstinait à m’ignorer et regardait fixement devant lui, alors que je me tenais juste à côté de lui. Des années plus tard, à Paris, je croisai son père (si cet officier rouge était vraiment la personne que je connaissais) et lui racontai cette rencontre. Le « père » me dit que son fils avait effectivement été appelé dans l’Armée rouge alors qu’il se trouvait à Petrograd, et qu’il avait rejoint le front à peu près au moment que j’évoquais. De nombreuses années s’étaient écoulées, et son fils n’avait plus jamais donné de nouvelles. Ma rencontre avec lui — si c’était bien de lui qu’il s’agissait — était la dernière chose que son père sut de lui.
À Vologda, il fallait prendre le train de Moscou, pour lequel on ne pouvait acheter de billets que sur autorisation. Nous dûmes nous adresser à une administration « tchékiste » qui occupait dans la gare un bâtiment à part. C’était le Service des laissez-passer auprès de l’État-major de la 6e Armée rouge, qui était déployée sur le front d’Arkhangelsk. Un type en uniforme (ils étaient deux dans le service) examina mes papiers et, l’air renfrogné, me remit un laissez-passer pour Moscou. Ce bout de papier allait beaucoup me servir. Nous avions quelques heures devant nous avant le départ du train. Je sortis faire un tour en ville. J’en garde un vague souvenir de vieilles églises, d’un marché sur une grande place. Des petits garçons couraient ça et là, proposant des allumettes par lots de cinq (!), en criant. « Voilà des allumettes ! Qui veut des allumettes ? » Il est intéressant de noter que les bolcheviks avaient rebaptisé cette place en « Place de la lutte contre la spéculation ». C’est ce que proclamait une plaque murale visiblement récente. Mais je ne vis aucun signe de lutte contre la spéculation, qui était florissante sur cette place. Et c’était tant mieux pour la population, pensai-je.
Vers cinq heures, nous prîmes place à bord du train Vologda-Iaroslavl-Moscou. Nous montâmes dans un wagon de privilégiés, cependant assez inhabituel. C’était sans doute une ancienne voiture-restaurant, qui n’était pas divisée en compartiments mais comportait une salle commune où étaient disposées des chaises, sur lesquelles nous nous assîmes. Pour dormir, c’était assez inconfortable. Il y avait beaucoup de monde, mais personne n’était resté debout. Parmi les passagers, l’on distinguait un groupe de six à huit jeunes officiers rouges, à peine sortis de leur école militaire. Ils avaient tous été sur le front nord, et se rendaient maintenant soit en permission, soit sur un autre front. À ma grande déception (il faut bien l’avouer), ils faisaient plutôt bonne impression. C’étaient de jeunes gars d’origine paysanne ou ouvrière, aux visages vraiment russes, ce qui était rare parmi les Rouges, habillés avec soin, ils étaient résolument polis et discrets. On voyait qu’ils étaient drôlement contents d’être officiers, d’être devenus « quelqu’un ». Leur niveau culturel était bien sûr très bas, primitif, on leur avait farci la tête de slogans bolcheviques mélangés à un peu de patriotisme (ils racontaient avec plaisir qu’ils avaient battu les Anglais près de Mezen, et qu’ils en avaient même capturé quelques-uns). Ils bavardèrent avec moi de fort bonne grâce, très aimablement, ils n’avaient pas la moindre idée de mes intentions. Je fus assailli de pensées moroses. il ne serait pas si simple de venir à bout de l’Armée rouge. Ceux-là vont vraiment se battre ! Et en même temps, je fus pris d’une sorte de pitié pour eux. comment ces bons Russes avaient-ils pu se laisser embobiner par les bolcheviks ?
Plus nous approchions de Moscou, et plus il y avait de monde sur les quais des gares, mais on ne laissait personne entrer dans notre wagon, car nous étions des privilégiés. Alors que j’étais sorti une minute sur le quai de la gare d’Aleksandrov, une connaissance de Moscou me héla dans la foule. Il me regardait avec étonnement, se demandant ce que je faisais ici. Sans doute, pensait-il que j’étais parti depuis longtemps rejoindre les Blancs. Et moi, je le regardais avec méfiance, ne sachant pas quelles étaient ses relations avec les « camarades ». J’étais très ennuyé que l’on m’ait reconnu alors que j’étais en route vers le front. En fait, nous ne nous dîmes rien de concret, ne révélâmes pas nos projets et je laissai inassouvie la curiosité de mon interlocuteur qui, de son côté, n’osa pas m’interroger plus avant.
Le 19 août/1 septembre dans l’après-midi, nous atteignîmes Moscou sans encombre. De la gare Iaroslavski, je dus marcher à pied jusqu’à la rue Koudrinaya-Sadovaya (18), où j’allais être hébergé par des cousins qui, depuis, ont émigré en Occident. Il y avait bien des tramways, mais ils étaient pleins à craquer, et il eût été impossible d’y monter avec des bagages. Moyennant une petite somme d’argent, nous déposâmes nos affaires sur un attelage qui allait dans notre direction, nous-mêmes marchant à côté. À cette époque, il y avait encore peu de camions automobiles à Moscou et le recours aux attelages était prédominant. La maison où je devais dormir était en partie réquisitionnée par les représentants de notre chantier ferroviaire. Cela allait beaucoup nous faciliter les démarches administratives à venir. Je ne me souviens pas bien de toutes les administrations qu’il nous fallut visiter pour obtenir les papiers nécessaires à notre départ mais, dans l’ensemble, cela se passa comme suit. Le lundi 21 août/3 septembre, munis de documents officiels complémentaires délivrés par notre administration ferroviaire, qui confirmaient qu’il nous était indispensable d’embaucher des menuisiers, nous nous rendîmes, avec mon compagnon P., au bureau qui délivrait les billets de train pour les voyages en service commandé. Nous demandâmes des billets pour Dmitriev sur la ligne Briansk-Lvov. On nous répondit qu’il fallait préalablement obtenir une autorisation du Tsoupvoso (Direction centrale des liaisons militaires). Nous y allâmes. Le Tsoupvoso occupait un grand immeuble, dans le quartier de l’Arbat, me semble-t-il. On contrôla nos papiers à l’entrée, puis nous prîmes l’ascenseur et pénétrâmes dans une pièce où était accrochée une grande carte avec les lignes de front. Je la détaillai avec intérêt (sans en avoir l’air, bien sûr), mais n’en tirai rien de nouveau par rapport aux communiqués officiels. Je me souviens que les positions des Rouges et des Blancs dans le secteur de la percée de Voltchansk-Koupiansk étaient indiquées en traits épais (19).
Pour autant que je me souvienne, nous n’eûmes pas de difficultés à obtenir le papier que nous étions venus chercher.
En sortant de l’immeuble, je fus à nouveau saisi de mélancolie. quelle administration imposante ! Et quel avantage de pouvoir diriger de façon centralisée toutes les liaisons militaires ! Pouvait-on en dire autant des Blancs ? Non vraiment, nos adversaires n’étaient plus les Gardes rouges de 1917! Nous pouvions maintenant prendre nos billets. Mais là, survint un contretemps inattendu. Les employés nous dirent que nos billets n’étaient pas prêts, qu’on ne pouvait pas les émettre sur-le-champ. « Revenez demain ou même après-demain ! » Cela n’arrangeait absolument pas mes affaires. Mon ordre de mission était valable pour une destination précise qui se trouvait, en ce moment, être relativement proche de la ligne de front. Mais la situation évoluait chaque jour, Denikine pouvait avancer ou reculer, et alors mon projet de passage chez les Blancs serait grandement compromis. Je ne pouvais pas perdre une seule journée. Il va sans dire que je ne leur fis pas part de ces arguments, mais je me mis à leur expliquer avec insistance, en haussant le ton, que l’administration ferroviaire qui m’envoyait poursuivait des objectifs hautement stratégiques, que ce pont devait être construit dans les plus brefs délais et que le moindre contretemps était inadmissible, qu’ils porteraient la responsabilité de mon retard. Mon discours fit son effet. Nos billets furent émis et délivrés sur-le-champ.
Ce succès m’ayant donné des ailes, je me dirigeai avec mon compagnon vers la dernière — et la plus effrayante — des administrations qu’il nous fallait voir. le Service des laissez-passer de la Tcheka pour les zones de front. Peu de temps auparavant, un décret avait été publié par le Sovnarkom (20) instaurant une zone de front d’une largeur de cent cinquante verstes le long de la ligne de front. L’état d’urgence y était déclaré, et l’entrée n’y était autorisée qu’aux personnes détentrices de laissez-passer spéciaux délivrés par la Tcheka. Les contrevenants étaient passibles des peines applicables en temps de guerre. Au Tsoupvoso, on m’avait dit que Dmitriev, notre lieu de destination, se trouvait à l’intérieur de la zone de front. Nous dûmes donc, non sans effroi, nous rendre place de la Loubianka. Nous savions que la Tcheka y avait son siège, mais nous ignorions quel immeuble elle occupait exactement. Grâce à Dieu, je n’avais encore jamais eu affaire à cet organisme. Sur la place, nous demandâmes à un milicien où se trouvait la Tcheka. Sans un mot, il nous montra du doigt un grand immeuble qui donnait sur la place, celui de la compagnie d’assurance Rossia. Nous y pénétrâmes. Il n’y avait pas de vigile à l’entrée, et personne ne nous demanda rien. Nous fîmes quelques pas et gravîmes les quelques marches d’un large escalier de pierre. Nous atteignîmes un palier sur lequel se dressait une sorte de comptoir assez haut, derrière lequel deux hommes étaient assis. « Qu’est-ce qu’il vous faut ? », demanda l’un d’eux quand nous nous fûmes approchés du comptoir. — « Nous avons besoin d’un laissez-passer pour la zone de front. » — « Vos papiers ! » dit le tchékiste. Après les avoir examinés, il nous les rendit en disant. « Ce n’est pas ici, c’est dans la Section d’émission des laissez-passer, dans un autre bâtiment, non loin d’ici. »
Nous ressortîmes et nous dirigeâmes vers le bâtiment indiqué. C’était un hôtel particulier, si mes souvenirs sont bons. Cette fois, il y avait un vigile armé à l’entrée, mais il ne nous posa aucune question. Nous entrâmes dans une salle pleine de gens, apparemment venus, comme nous, chercher des laissez-passer. Derrière un comptoir étaient assis deux hommes. le premier était un Letton chauve d’une cinquantaine d’années qui parlait bien le russe mais avec fort un accent étranger. Le second était un jeune juif au visage très typé, d’allure cultivée. Je me mis à leur expliquer notre situation. « Présentez-nous une attestation de la bourse du travail de Moscou certifiant qu’il n’y a pas de menuisiers spécialisés à Moscou », dit le Letton. Il fallut expliquer à cet idiot que l’administration ferroviaire ne se serait pas mise à envoyer des gens à l’autre bout du pays s’il était possible de trouver des menuisiers à Moscou, que les menuisiers que nous comptions embaucher avaient déjà travaillé à la construction d’un pont, qu’ils connaissaient leur affaire, etc. Par chance, les documents complémentaires que l’on m’avait fournis à Moscou comportaient des précisions à ce sujet. Le tchékiste n’insista pas sur sa bourse du travail, posa encore une question absurde dont je ne me souviens plus et finit par céder. « Remplissez ce formulaire », dit-il. Le formulaire contenait des questions assez détaillées sur les occupations du demandeur avant la Révolution, sa profession actuelle, son niveau d’études, son lieu et sa date de naissance, son adresse à Moscou, les raisons du voyage, etc. Mais la question la plus désagréable, celle des origines sociales, en d’autres termes celle sur vos parents, n’était pas posée. Il n’était pas très compliqué pour moi de remplir ce formulaire. À toutes les questions sur ma profession et mes activités passées ou présentes, je répondis. étudiant, études.
Le formulaire devait être rempli sans ratures, sous les yeux attentifs des tchékistes qui nous surveillaient. Une fois les formulaires remplis, nous les tendîmes au Letton, qui les regarda et dit. « Venez après-demain, dans l’après-midi. » Nous nous mîmes à parlementer pour obtenir nos laissez-passer dans de meilleurs délais, recourûmes à nouveau à l’argument de l’extrême urgence de notre entreprise, mais l’homme fut inébranlable. « Revenez dans deux jours. » Il fallut se résigner à attendre. « Mais ils seront prêts après-demain, c’est sûr ? », demandai-je. « Oui, sûrement », répondit-il.
Ce délai de deux jours m’était désagréable au plus haut point. Les dernières nouvelles du front n’étaient pas bonnes. Les troupes du général Denikine avaient reculé, juste à l’endroit du front qui m’intéressait. Elles avaient abandonné Rylsk et Korenevo, s’étaient éloignées de Lgov et s’étaient repliées sur Soumam et Soudje en direction de Kharkov. Je craignais qu’elles ne s’éloignent encore plus de l’endroit de ma mission. Moscou, cependant, vivait encore dans l’attente de l’arrivée imminente des Blancs. Ma tante (21) m’apporta de son travail La Résurrection de la Russie, une feuille de choux ronéotypée clandestinement. On pouvait y lire des comptes rendus manifestement exagérés des avancées victorieuses des Blancs, on y annonçait par exemple les prises de Briansk et de Koursk. Jamais les Blancs ne prirent Briansk, et Koursk ne fut prise que plus tard. D’autre part, même si je m’abstenais de voir qui que ce soit et ne faisais part de mes projets à personne, mon arrivée à Moscou et mon intention de traverser le front ne pouvaient rester bien longtemps secrètes. Ainsi, un de mes cousins vint me voir pour me prier de l’emmener chez les Blancs. Afin d’éviter son incorporation dans l’Armée rouge, il était entré dans une école d’intendance militaire, mais son départ pour le front était maintenant imminent. À vrai dire, l’Armée blanche ne l’intéressait pas tant que cela (il n’était pas très belliqueux de nature) mais voulait surtout éviter l’incorporation et, par la même occasion, quitter la Russie soviétique. Je lui dis que je n’étais pas en mesure de l’aider car, sans documents soviétiques, on ne pouvait pénétrer dans la zone de front, et que je ne pouvais lui procurer ces documents, ayant obtenu les miens avec la plus grande peine. « Qu’as-tu à craindre d’être envoyé au front ? », ajoutai-je. « De là, tu pourras aisément passer chez les Blancs ! » — « J’ai peur qu’on ne me croie pas. On me prendra pour un communiste et on me fusillera. Va donc prouver que tu n’es pas un agent double ! » Bien sûr, mon cousin n’était pas homme à me dénoncer, mais il était très déplaisant que la rumeur de mon départ se répande dans tout Moscou. De plus, la Tcheka (le service des laissez-passer) connaissait mon adresse de Moscou, pouvait se renseigner et en apprendre de belles sur mon compte. En un mot, j’étais pressé de partir.
Deux jours plus tard, à l’heure dite, nous nous présentâmes à la Tcheka pour prendre nos laissez-passer. Il n’y avait plus de vigile à l’entrée et la maison en général donnait une impression de bouleversement, il y avait toute sorte d’objets et de papiers éparpillés sur le sol… Dans la salle, nous trouvâmes le Letton et le juif derrière le comptoir, mais il n’y avait plus ni demandeurs, ni autres tchékistes. Je demandai nos laissez-passer au Letton. « Aujourd’hui, en raison de notre déménagement dans de nouveaux locaux, répondit-il, nous ne pouvons pas délivrer de laissez-passer. Ils ne sont pas prêts. Vous les aurez demain, rue Tchernychevski. » J’explosai. Encore un contretemps ! « Mais enfin, vous aviez promis que je les aurais aujourd’hui ! » — « C’est tout à fait impossible, nous déménageons. » Hors de moi, me souvenant comment j’avais réussi à obtenir nos billets de train deux jours auparavant, je m’adressai à mon compagnon P., en grommelant dans ma barbe, mais de façon à être entendu de tous. « C’est du pur sabotage ! » L’effet produit fut cependant inattendu. Le Letton bondit de sa chaise et, rouge comme une écrevisse, demanda au tchékiste juif assis à coté de lui. « Vous avez entendu ce qu’il a dit ? » — « Oui », répondit l’autre avec un sourire glaçant. Le Letton frappa de la main sur le comptoir et dit. « Je vous arrête pour outrage envers un collaborateur de la Tcheka. » Et il quitta la pièce en courant.
Nous restâmes tous les deux en compagnie du tchékiste juif, dans un silence pesant. Les événements prenaient mauvaise tournure. Quelques minutes plus tard, le Letton revint et me dit. « Vous avez de la chance, en raison du déménagement, notre fusilier soviétique (c’est-à-dire le vigile de l’entrée) n’est pas là. Sinon, on vous aurait fait passer l’envie d’insulter les collaborateurs de la Tcheka ! » Afin de clore cet incident à la fois stupide et dangereux, je crus bon d’ajouter que j’étais sorti de mes gonds, que notre mission était réellement urgente et que ce contretemps m’avait contrarié. En réponse à cela, le Letton me tint tout un discours, avec son accent étranger, m’expliquant qu’exiger des choses impossibles était une attitude de petit-bourgeois et qu’en tant que personne éduquée je me devais de le comprendre. J’étais sur le point de lui répondre qu’au contraire, demander l’impossible, c’était du romantisme, alors que les petits-bourgeois se contentaient d’accepter la réalité, mais je préférai me taire. Le principal était de sortir des griffes de la Tcheka !
En repensant maintenant à cet épisode dangereux et effrayant, je ne parviens pas à comprendre si le Letton avait vraiment l’intention de m’arrêter ou s’il a joué la comédie pour me faire peur. L’absence de fusilier ressemble plus à un prétexte qu’à une raison pour changer sa décision. Il aurait fort bien pu m’arrêter sans l’aide d’un fusilier. Il avait probablement réfléchi et pensé que retenir un homme qui avait une mission urgente à accomplir pouvait avoir des conséquences désagréables pour lui. J’avais eu la chance de passer pour quelqu’un d’important.
Le lendemain, vers onze heures, nous étions dans les nouveaux locaux du Service des laissez-passer de la Tcheka, rue Tchernychevski (près de la rue Tverskaïa). Encore un ancien hôtel particulier de belles dimensions. Dans la salle d’attente, il y avait beaucoup de gens qui attendaient leurs laissez-passer, mais nous ne vîmes ni le Letton et ni le juif, nos tchékistes de la veille. À leur place, il y avait dune dizaine d’employées, des jeunes femmes qui étaient toutes jolies et élégantes, mais aux visages durs et au ton d’une insolence assez incommodante. Elles parlaient aux demandeurs de façon brusque, grossière même. « Voyez-vous ça ! Monsieur veut voyager, et nous, il faut qu’on se dépêche ! », dit l’une d’elles à sa voisine, l’un des demandeurs ayant insisté pour que son laissez-passer lui soit délivré dans les meilleurs délais. Instruit par l’expérience, je ne fis pas de même et me contentai de dire. « On m’a demandé de venir à onze heures. Mon laissez-passer est-il prêt ? » — « Attendez là, on vous appellera », répondit la tchékiste. C’était une réponse très déplaisante. si l’on m’appelait, pensai-je, cela signifiait que l’on allait m’interroger, examiner mon cas, etc. C’était mauvais signe ! Mais une demi-heure plus tard, un tchékiste en veste de cuir entra dans la salle et se mit à lire la liste des personnes qui avaient obtenu leur laissez-passer. Nos noms étaient sur la liste. Je m’approchai et me nommai. Le tchékiste, sans poser de questions, me tendit mon laissez-passer. Il y était indiqué que le camarade Krivochéiev était autorisé, pour raisons de service, à se rendre dans la zone de front de la province de Koursk pour un mois. C’était signé et tamponné par le service de la Tcheka. Grâce à Dieu, tout allait bien, j’avais réussi à tromper ces tchékistes. Il ne restait plus qu’à prendre le train pour le sud.
Mais des trains en direction de Briansk, il n’y en aurait pas avant vingt-quatre heures, nous dit-on. Nous attendîmes donc jusqu’au lendemain. Je procédai à mes derniers préparatifs de départ. J’avais une valise de cuir de très bonne qualité (trop bonne qualité, j’allais en faire l’expérience), et un sac contenant entre autres du linge et un pantalon, mais pas de vêtements chauds. À Moscou, l’automne ne faisait que commencer (à Vesyegonsk on y était en plein, les feuilles avaient déjà complètement jauni), le temps était ensoleillé, dans la journée il faisait tout simplement chaud. Je me disais que j’aurais rejoint les Blancs bien avant l’arrivée du froid, et que là-bas, on me fournirait tout ce dont j’aurais besoin. Alors à quoi bon s’encombrer de bagages ? Ce raisonnement ne devait se vérifier que sur un point. même si j’avais eu plus de bagages, jamais je n’aurais réussi à garder mes valises jusque chez les Blancs !
Ma tante me donna pour la route deux mille roubles-Kerenski (22) qu’elle cousit à l’intérieur de mes bretelles par précaution. Les roubles-Kerenski avaient plus de valeur que la monnaie soviétique, et avaient l’avantage d’être en circulation même dans les zones d’occupation blanche. Ma tante m’offrit aussi une médaille représentant la sainte martyre Barbara. « Mets-la, me dit-elle, sinon, si tu te retrouves chez les cosaques, ils te prendront pour un sans-Christ et te fusilleront ! » (j’avais perdu ma croix de baptême en or peu auparavant et, dans les conditions de vie soviétique, il n’était pas facile de s’en procurer une nouvelle). N’étant pas très pratiquant à l’époque, je ne savais pas que la sainte martyre Barbara protégeait contre la mort violente, mais maintenant je crois fermement que c’est par son intercession que le Seigneur me sauva de la mort à cette époque. Pendant mon périple vers le front, et ensuite encore, il m’arriva de lui adresser des prières de mon cru.
Ainsi, le 24 août/6 septembre vers trois heures, après un séjour de cinq jours à Moscou, P. et moi, nous nous rendîmes avec nos valises à la gare de Briansk (23). Autour du convoi composé de wagons de marchandises et d’un wagon de troisième classe, c’était la cohue. Naturellement, ceux qui tentaient de monter dans le wagon de passagers étaient nombreux, mais ils étaient repoussés par deux commissaires en vestes « classiques » de cuir noir, armés de révolvers. Ils glapissaient d’une manière tout à fait hystérique sur cette foule de petites gens. Le wagon de passagers était réservé aux communistes « privilégiés », aux fonctionnaires soviétiques en mission, etc. Nous leur montrâmes nos papiers, et les commissaires nous laissèrent immédiatement passer. Le wagon était plein de passagers avec leurs bagages, mais nous trouvâmes tout de même une place assise dans un des compartiments.
Le train partit vers six heures du soir. Le lendemain vers midi, nous arrivâmes à Briansk, d’où le même train continuait (sans correspondance) vers Dmitriev-Lgov sur une ligne à voie unique. Dès avant Briansk, nous avions croisé un train blindé qui remontait vers le nord. Je m’étais réjoui de cette première hirondelle qui annonçait la proximité du front. Il y avait toutes sortes de gens dans le wagon, mais c’étaient surtout des « camarades » de rangs hiérarchiques variés. Des conversations se nouèrent. Je m’efforçais de rester sur ma réserve, et bien entendu ne parlai à personne du but véritable de mon voyage. Les « camarades » me prenaient pour un des leurs. Je me souviens de deux d’entre eux qui me racontèrent qu’ils occupaient des postes à responsabilité dans une ville de district de la province d’Ekaterinoslav (24), et qu’ils avaient dû fuir à l’approche de Denikine. L’un d’entre eux était commissaire au ravitaillement. C’était un partisan convaincu de la réglementation totale de la vie économique, du monopole d’État sur toutes les relations commerciales, du rationnement, etc. Selon lui, le marché libre et la spéculation étaient la source de tous les maux. « Nous avions construit tout un appareil de commerce étatique et éliminé la spéculation. Et voilà Denikine qui arrive, et qui réduit tous nos efforts à néant », disait-il. — « Mais comment fonctionnait votre appareil ? » lui demandai-je. « N’y avait-il aucun problème de ravitaillement ? » — « Malheureusement, si. Notre appareil fonctionnait mal », avoua-t-il. « Tous les produits avaient disparu. Mais c’est parce que nous n’avons pas eu le temps d’arranger ça. Et puis, les spéculateurs nous mettaient des bâtons dans les roues. » L’autre « habitant d’Ekaterinoslav » ressemblait plutôt à un tchékiste. « Où allez-vous, demandai-je, l’Ukraine n’est-elle pas presque entièrement aux mains des Blancs ? » — « On m’envoie mettre sur pied des unités de partisans à l’arrière des Blancs. » — « Mais n’est-il pas très difficile de traverser le front ? » demandai-je. Cette question m’intéressait particulièrement. — « Tout seul, c’est difficile, mais avec l’aide des nôtres sur le front, c’est très simple. Les armées connaissent parfaitement la ligne de front, et savent prédire les mouvements des troupes. » Et il se mit à raconter comment il allait organiser ses unités de partisans. « Notre commandement tient beaucoup aux mouvements de partisans et à l’espionnage à l’arrière du front ennemi. »
Pendant ce temps, mon compagnon de route P. était plongé dans une conversation très animée avec ses voisins qui l’écoutaient bouche bée. Il était en train de raconter comment, en 1916, il avait participé à la répression de l’émeute des « Sartes » (c’est ainsi qu’on les appelait avant la Révolution). Il s’agit d’un fait historique peu connu. en 1916, quand le gouvernement du tsar décréta la mobilisation des populations indigènes du Turkestan (qui, jusque-là, étaient exemptées de service militaire), ces indigènes se révoltèrent et égorgèrent près de trois mille colons russes. Bien entendu, l’armée écrasa cette révolte dans le sang. Et voilà que mon compagnon P. s’était mis à raconter qu’à cette époque, il travaillait sur la voie ferrée du Turkestan et, comme il connaissait bien la région, il avait guidé l’armée dans les villages de montagne, lui indiquant les endroits où on avait massacré des Russes. Il racontait les représailles que l’armée avait fait subir aux populations indigènes. J’étais horrifié en l’écoutant parler et lui donnai quelques coups de pied pour essayer de le faire taire. J’étais convaincu que les « camarades » qui composaient son auditoire allaient se jeter sur lui et l’arrêter comme bourreau tsariste, contre-révolutionnaire, qui écrasait les révoltes « anti-tsaristes » des peuples minoritaires. Mais il n’en fut rien ! À mon grand étonnement, les « camarades » étaient captivés par son récit, et l’écoutaient avec approbation et sympathie.
Une fois seul avec P., je lui demandai. « Pourquoi leur avez-vous raconté cela ? On aurait pu vous arrêter pour avoir participé à une expédition punitive sous l’ancien régime. Et on m’aurait arrêté aussi par la même occasion. Soyez plus prudent à l’avenir. » P. parut très surpris. « Mais qu’ai-je dit de mal ? Ces Sartes, ils ont tué des Russes. » Apparemment, les « camarades » raisonnaient de la même manière. Il est intéressant de noter que dans toutes ces conversations de train, personne ne mentionnait jamais les événements du front.
À partir de Briansk, la proximité du front et de la guerre commença de se faire sentir. La gare de Briansk, où notre train resta deux heures à l’arrêt, était occupée par des soldats de l’Armée rouge, de cent cinquante à deux cents hommes. Les cantiniers étaient en train de leur distribuer leur repas. La plupart des soldats étaient assis par terre sur le quai et mangeaient à même leurs gamelles. D’autres déambulaient dans la gare. On ne voyait pas d’officiers. Ensuite on les rassembla, et ils embarquèrent dans un convoi militaire qui partait vers le front. Ils avaient l’air assez peu disciplinés. Après Briansk, il y eut un contrôle des billets. Comme j’avais un billet de service, le contrôleur demanda à voir mon passeport. Bien entendu, je n’en avais pas ; je lui montrai mon ordre de mission, mon laissez-passer de la Tcheka et mon permis de séjour délivré par l’université de Moscou (unique pièce d’identité en ma possession, en dehors de mes documents de voyage). Mais le contrôleur ne fut pas satisfait. « Il me faut un document avec photographie. C’est une nouvelle règle. Il y a des gens qui utilisent des billets de service qui ne sont pas à leur nom. » J’eus les plus grandes peines du monde à me défaire de ce fonctionnaire zélé. De quelles photographies parlait-il ? Où les aurais-je prises, alors que tout était fermé, et même la Tcheka n’en demandait pas ? De toute façon, il n’était pas très dangereux ; ce n’était pas un tchékiste.
La nuit tombait. Nous entrâmes en gare de Deriugino, dernière station avant Dmitriev. Cette fois, c’est un militaire qui monta dans le wagon, accompagné d’un soldat de l’Armée rouge qui avait un fusil à l’épaule. Le militaire tenait à la main une lanterne. Notre wagon était très peu éclairé, quant aux wagons de marchandises, ils ne l’étaient pas du tout (d’ailleurs, je me rendis compte par la suite qu’on ne les contrôlait quasiment pas). Ils se mirent à contrôler nos laissez-passer. Nous entrions en zone de front. Le militaire examina longuement mes papiers à la lumière de sa lanterne (il semblait lire avec difficulté). Puis il me les rendit sans un mot et poursuivit sa progression dans le wagon.
- En réalité la rue Sadovo-Koudrinskaya (NdT).
- En août 1919, un effectif assez important de l’Armée rouge, composé notamment de troupes transférées du front sibérien, réussit à percer profondément le front des Blancs dans la région Valouïki-Koupiansk-Voltchansk, à la jonction des Armées du Don et des Volontaires, et à menacer Kharkov. Les Rouges parvinrent à trente verstes de Kharkov, mais essuyèrent une défaite et leur offensive fut réduite à néant.
- Acronyme de « Soviet des commissaires du peuple ». Appellation du gouvernement soviétique de 1917 à 1946 (NdR).
- Voir « Chapitre 1. Les journées de février 1917 à Petrograd », n. 10 (NdR).
- Billets émis par le Gouvernement provisoire dirigé par le socialiste A. Kerenski (juillet-novembre 1917) (NdR).
- Aujourd’hui, gare de Kiev (NdR).
- Rebaptisée « Dniepropetrovsk » à l’époque soviétique (NdR).