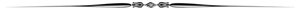On m’attrapa, on m’arrêta,
On voulut voir mon passeport,
Je ne suis pas cadet, je ne suis pas soviétique,
Je suis commissaire des coqs
Chansonnette de l’époque de la guerre civile
Le matin, notre train arriva à Lgov. Il y avait trois stations Lgov. Lgov 1, Lgov 2 et Lgov 3. Il fallait que je descende à la troisième, puisque c’est de là que partait la ligne Korenevo-Kiev, c’est aussi là que se trouvait la gare principale. J’y étais bien descendu lors mon premier voyage, mais la deuxième fois, je me trompai et descendis prématurément à Lgov 1, où l’on me dit que jusqu’à Lgov 3, il y avait trois verstes, et qu’aucun train n’y allait pour l’instant. Il fallait donc faire le trajet à pied, heureusement que je n’avais plus mes bagages. Je rejoignis donc la route qui passait non loin de la voie ferrée, mais un obstacle imprévu surgit. J’avais devant moi un fossé que la route franchissait au moyen d’un petit pont. Je m’en approchai, pensant le traverser, quand je fus interpellé par un soldat de l’Armée rouge, un grand blond au visage russe, qui montait la garde. « Le mot de passe ? », me dit-il. Je me mis à lui expliquer que, par erreur, j’étais descendu du train trop tôt, que je devais aller à Lgov 3, que j’avais un ordre de mission, etc. « Le mot de passe ? », répéta le garde, et comme j’étais incapable de le lui donner, il déclara. « On ne passe pas. Ce sont les ordres. » Et il cessa toute conversation. Que pouvais-je faire ? Ayant un peu réfléchi, je m’écartai de cinquante sagènes (35) vers la gauche, et d’un bond, franchis le fossé sous les yeux du garde. Je craignais que celui-ci ne m’arrête, mais il ne fit aucunement attention à moi. C’était un appelé typique de l’Armée rouge, indifférent à tout, qui exécutait les ordres mais refusait de prendre la moindre initiative. Un vrai soldat bolchevique ne se serait jamais comporté de la sorte.
Je poursuivis ma route et atteignis bientôt la gare de Lgov 3. D’après des bribes de conversations de soldats et cheminots que j’y surpris, je compris que la situation sur le front avait connu un brusque revirement. Les Blancs étaient passés à l’offensive (36) ! Il y avait de la tension et de l’inquiétude dans l’air. Pourtant, le train de Korenevo partait à l’heure habituelle. Je le pris, cette fois sans passer chez le « camarade Kahn », auprès de qui, quatre jours auparavant, j’avais sollicité un laissez-passer. Je ne voulais pas me rappeler à son souvenir, et en cas de besoin je pouvais toujours présenter au contrôle le laissez-passer de la dernière fois. Je montai à nouveau dans un wagon de marchandises découvert. Il y avait peu de monde, des paysannes comme d’habitude. Deux passagers se distinguaient des autres. un jeune soldat et un militaire plus âgé, corpulent, le type même du sous-officier d’avant la Révolution, devenu maintenant tchékiste, ou du moins quelqu’un qui avait des liens étroits avec l’un des services de la « gendarmerie rouge » ou des « organes de sécurité », comme on dit de nos jours. Le convoi s’ébranla vers onze heures de matin. Le temps s’était éclairci, c’était de nouveau une belle journée ensoleillée d’automne. Vers une heure de l’après-midi, alors que nous approchions de Korenevo, nous entendîmes soudain à gauche, au sud de la voie ferrée, les tirs assourdis d’une salve d’artillerie. On se battait à dix ou quinze verstes de nous, et la canonnade dura un certain temps. Je fus pris d’une grande joie en entendant ces sons pour la première fois de ma vie, et me sentis plein d’espoir. le front n’était pas loin, les Blancs avançaient, la libération était proche ! Bien sûr, je ressentais aussi un sentiment d’inquiétude et de peur. La canonnade eut un effet spectaculaire sur le soldat et le « sous-officier ». Ils se recroquevillèrent tous les deux, le visage alarmé. Ils se mirent à parler avec animation de ce qui était en train de se passer, ils disaient. « Encore une offensive des Blancs. Pas moyen d’en venir à bout. Apparemment, on est mal organisés, il y a des traîtres un peu partout », ou — pour reprendre les mots du « sous-officier » — des « vendus ». Et il regardait dans ma direction avec une certaine animosité.
Une heure plus tard, nous arrivâmes à Korenevo. Les coups de canon avaient cessé. La gare de Korenevo était pleine de convois de marchandises qui occupaient les voies de garage. « Ils préparent l’évacuation », me dis-je. Dans la gare, il y avait un certain nombre de soldats. J’échafaudai immédiatement un plan d’action. il ne fallait aller nulle part, ne traverser aucun front, mais attendre ici, à Korenevo, l’arrivée des Blancs. Selon toute vraisemblance, ils seraient là d’ici deux ou trois jours. Je dormirais la nuit dans les wagons de marchandises vides, il y en avait tant ! En cas de contrôle, je montrerais mes papiers. Et je n’irais pas me faire enregistrer, même si c’était contraire au règlement en vigueur dans la zone de front. Mon grand problème, c’était la nourriture. À la rigueur, si je ne réussissais pas à m’en procurer, je pouvais jeûner quelques jours. Bien sûr, tout cela était assez risqué, je pouvais être arrêté en tant que personne suspecte se trouvant à Korenevo sans raison valable, mais c’était tout de même moins risqué que de traverser la ligne de front (37).
Afin de passer le temps, et pour éviter de trop me montrer à la gare, je sortis faire un tour dans la localité. Revenu à la gare, je versai dans ma gamelle de l’eau chaude de la bouilloire qui se trouvait à notre disposition. L’eau n’avait pas encore bouilli, et l’on me mit en garde. « N’en bois pas, tu vas être malade ! », mais je passai outre, et ne tombai pas malade. Quelqu’un me donna un morceau de pain, mais globalement, personne ne fit attention à moi.
Vers quatre heures, changement de situation. On entend de nouveau le canon tonner au sud de Korenevo, il semble s’être rapproché depuis ce matin. On a l’impression que ce sont des pièces d’artillerie lourde. À la gare, c’est l’inquiétude chez les « camarades » rouges. Parmi eux, il y a un groupe de trente à cinquante « Koubanais rouges » comme on les appelle. Je parlerai beaucoup d’eux dans la suite de mon récit, et me bornerai à dire pour l’instant que c’était une compagnie d’élite de cavalerie de l’Armée rouge, la seule qui combattait réellement, et dont on disait que le front tout entier reposait sur elle. À vrai dire, il y avait peu de vrais habitants du Kouban dans cette brigade de Koubanais rouges. Les recrues en étaient majoritairement originaires des provinces de Kharkov et de Poltava. C’étaient de vrais brigands, toute la population souffrait et se plaignait de leur cruauté et leur violence. Parmi eux, sans aucun doute, il y avait un fort pourcentage de repris de justice. Ils étaient très différents des simples appelés de l’Armée rouge qui étaient souvent de braves garçons, pas bolcheviks pour deux sous (38). Mais je reviendrai à tout cela plus tard. Pour l’heure, les « Koubanais » étaient massés sur le quai de la gare, et discutaient avec animation de la situation. J’essayai d’entendre ce qu’ils disaient. Bien entendu, leurs propos étaient ponctués des jurons blasphématoires les plus grossiers. « Ils tirent à l’arme lourde ! Ça tonne plus fort que le bon Dieu ! » Sur leurs visages on pouvait lire un mélange d’excitation et préoccupation, et ils disaient, ou plus exactement beuglaient. « Il paraît que les Blancs ont pris les canons de douze pouces de leurs navires de guerre à Sébastopol, pour les envoyer sur le front. Et les nôtres détalent comme des lapins, ils n’essaient même pas de les arrêter. On est entourés de vendus. » — « Ils n’y a rien à dire, ajoute un autre, les Blancs se battent bien. Mais ils sont peu nombreux. Si les nôtres se battaient comme eux, on les aurait écrasés depuis belle lurette. » C’était agréable à entendre (39).
À la nuit tombante, la canonnade cessa, et les « Koubanais » avaient disparu. Je pénétrai dans le bâtiment de la gare, et m’assis sur un banc dans l’ancienne salle du buffet. La salle où je me trouvais fut bientôt envahie de nouveaux arrivants, ils étaient cent cinquante environ. C’étaient des habitants du coin que les Rouges venaient juste de recruter, des paysans pour la plupart. Ils étaient en civil, tenaient des petits baluchons dans les mains. Ils s’étaient présentés à l’appel, et on les envoyait se battre ailleurs. L’un d’eux s’assit à côté de moi, et se mit à me raconter que pendant la guerre contre l’Allemagne il avait été appelé, et avait fait son service dans un convoi de bains à vapeur. Il avait un certificat. Il voulait même me le montrer pour que je l’aide à trouver de nouveau une place dans un convoi de bains, car il s’y connaissait bien. Il me prenait manifestement pour un chef bolchevik. Je lui dis que je ne pouvais rien pour lui, et pensai tout bas. « Quelle idée de te présenter à l’appel des bolcheviks ! Tu aurais mieux fait de rester chez toi, car il va y avoir un tel bain que tu ne t’en réjouiras pas ! » En fait, j’éprouvais un sentiment d’amertume à constater qu’une telle quantité de gens avaient répondu à l’appel de l’Armée rouge, et à les voir si tranquilles, si soumis. Pour éviter toute autre conversation, je quittai le bâtiment et partis chercher, dans la nuit tombante, un coin pour dormir dans un wagon de marchandises sur les voies de garage du fond, pas trop près de la gare. C’est sans difficulté que j’en trouvai un parmi les nombreux convois qui étaient stationnés là. Je grimpai dans le wagon, tirai la porte derrière moi, et m’allongeai sur la paille. Il faisait chaud, j’enlevai ma vareuse et m’endormis profondément jusqu’au matin.
Quand je me réveillai, il faisait déjà clair. La lumière s’infiltrait dans le wagon par la porte mal fermée. C’était le matin du 2/15 septembre. Par habitude, machinalement, je plongeai la main dans la poche intérieure droite de ma vareuse où je conservais mon portefeuille avec mes papiers. Je dis. « par habitude », parce que je vérifiais régulièrement la présence de mon portefeuille, et que j’aimais bien relire mes papiers. Cela me rassurait, me donnait une impression de sécurité. À mon grand étonnement, la poche était vide. Le portefeuille qui contenait mes papiers avait disparu ! Je me dis qu’il avait dû tomber de ma poche au moment où j’avais enlevé ma vareuse pour m’en faire un oreiller. À tâtons, je le cherchai à l’endroit où j’avais posé ma tête, mais il n’y avait rien. C’était impossible, il n’avait pas pu disparaître ! Je l’avais encore la veille au soir en m’endormant, je m’en souvenais parfaitement, et je n’avais pas quitté le wagon depuis. Je me sentais gagné par la panique. Je commençai une fouille obstinée. Plus de dix fois, je vérifiai mes poches, tâtonnai dans le coin où j’avais dormi, fouillai tout le wagon. Rien ! Je me sentais gagné par le désespoir, mais la raison l’emportait. c’était impossible, je n’étais pas sorti du wagon, personne n’y était entré, et d’ailleurs comment aurait-on pu voler un portefeuille que je portais sur moi ! Ça m’aurait réveillé ! Non, il n’avait pas pu disparaître ainsi, il fallait continuer à chercher !
Et je recommençai à chercher. Je fouillai à nouveau le wagon, puis en sortis, et me mis à scruter le sol autour et en dessous du wagon, même si c’était absurde. À une dizaine de sagènes, il y avait un trou, je jetai un coup d’œil au fond de ce trou, même si cela semblait idiot. Comment mon portefeuille aurait-il atterri là, puisque je n’étais pas sorti du wagon ? Non loin de là, il y avait deux hommes, des cheminots apparemment, qui travaillaient. Je leur demandai s’ils n’avaient pas trouvé un portefeuille, car j’avais perdu le mien. Ils me regardèrent avec étonnement. Je revins à mon wagon, repris mes recherches qui restèrent vaines. Plus d’une heure s’écoula ainsi. Cela avait beau être absurde et invraisemblable, il me fallut me rendre à l’évidence. mon portefeuille avait disparu. Mais que faire maintenant ? Il fallait entreprendre quelque chose, sans perdre de temps. Cela changeait tous mes plans. Je me mis à réfléchir. La solution la plus raisonnable aurait consisté à me rendre à la gare, et déclarer la perte de mes papiers à l’antenne ferroviaire de la Tcheka. En faisant cela, je ne risquais probablement pas grand-chose, on me placerait sans doute en garde-à-vue et on m’enverrait à l’arrière pour vérifier mon identité. Et si l’on n’y découvrait pas qui j’étais réellement, et quelles étaient mes véritables intentions, on me libérerait très certainement. Mais cela revenait pour moi à capituler, car j’aurais été contraint de renoncer à traverser le front, alors que j’étais si près du but. Et pour une raison stupide. la perte d’un portefeuille ! Quelle honte !
Sans papiers, cependant, il ne m’était plus possible d’attendre les Blancs à Korenevo comme j’en avais eu l’intention. Les Blancs pouvaient n’arriver que d’ici quelques jours, dans cet intervalle il était hautement probable que quelqu’un demande à voir mes papiers, et comme je n’en avais plus, cela se terminerait très mal pour moi. Je ne voyais qu’une possibilité (acceptable en conscience). quitter immédiatement Korenevo en direction du front et tenter de le traverser, à pied. C’était une décision insensée, mais je ne voyais pas d’autre solution. Plus tard, avec l’expérience, je compris qu’il aurait certainement été plus sage d’attendre à Korenevo le soir en me cachant dans un des wagons et tenter de nuit l’approche du front. Mais cela aussi aurait comporté une part de risque. il n’était pas si facile de quitter la localité de Korenevo même la nuit. Il y avait des patrouilles partout et on était en plein couvre-feu. Je ne pouvais plus rester sans rien faire. J’étais à bout de nerfs.
Ainsi, c’est vers midi que je sortis de Korenevo. Je traversai sans encombre cette petite ville avec ses maisonnettes, ses jardins et ses haies et continuai vers le sud-ouest en direction de Snagost, le gros hameau d’où nous parvenait hier le son du canon. C’était une journée chaude et ensoleillée. J’étais parfaitement conscient du danger qu’il y avait à marcher ainsi à découvert et sans papiers en direction du front. Je rattrapai sur la route un soldat sur une charrette. Il allait à Soudja (la route y bifurquait depuis celle de Snagost) et proposa de m’y déposer. Je refusai sous prétexte que ce n’était pas ma direction. Je n’avais pas envie de me lier à lui, même si ce garçon était aimable, gai, et manifestement me prenait pour un des siens. Vers deux heures de l’après-midi, j’entrai dans le hameau de Snagost du district de Rylsk de la province de Koursk, à douze verstes de Korenevo. J’en remontai la longue rue centrale, sans rencontrer personne. De cette rue en partait une autre, perpendiculaire à la première, bordée de maisons elle aussi.
Près de la maison qui faisait le coin de la rue où je me trouvais, je vis un groupe de gens, certains debout, d’autres assis. Je suis myope, j’avais cassé mes lunettes pendant mon voyage, et je ne parvenais pas à distinguer qui étaient ces gens massés au loin. Presque arrivé à leur hauteur, je pris la rue de gauche en évitant de regarder dans leur direction (selon ce principe dit « de l’autruche ». si je ne les regarde pas, ils ne me verront pas non plus). Ils me laissèrent passer devant eux et tourner à gauche, mais soudain j’entendis une voix qui criait dans mon dos. « Eh, camarade, attends un peu ! » Je m’arrêtai. « Où vas-tu ? » — « À Glouchkovo », répondis-je. C’était le nom du hameau (et de la gare) suivant, plus loin vers le sud-ouest. J’avais vu cela sur ma carte que j’avais encore, car je ne l’avais pas mise dans la même poche que mon portefeuille. « À Glouchkovo ? » dit le soldat d’un air entendu. « Et tu sais ce qui se passe à Glouchkovo ? » — « Non », répondis-je. Il semblait savoir que le front et les Blancs (40) y étaient. Le soldat poursuivit son interrogatoire. « Que vas-tu faire à Glouchkovo ? » — « Chercher du sel, dis-je, mais si on n’a pas le droit d’y aller, je n’irai pas. » J’avais dit « chercher du sel », parce qu’il aurait été absurde, en l’absence de papiers, de mentionner mon ordre de mission. Alors que le sel, tout le monde venait en chercher, justement dans cette région. Et le sel, c’était une chose plus facile à comprendre pour des gens simples qu’une mission. « Du sel ! Voyez-vous ça ! », insista le Rouge, « et des papiers, tu en as ? » — « Oui », mentis-je d’un ton assuré. — « Eh bien, montre-les ! » Je portai ma main à la poche de ma vareuse, dans l’espoir chimérique que mon portefeuille s’y trouverait, mais bien entendu, elle était vide. « Je les ai perdus », fus-je obligé de constater, et je souris bêtement. — « Perdus ! » s’exclama le soldat, « eh bien, tu vas nous suivre ! » Et toute cette bande m’entraîna dans la maison, où elle me fit subir un interrogatoire.
C’étaient ces fameux « Koubanais rouges » dont j’avais vu un détachement la veille à la gare de Korenevo. Cette fois, ils étaient trente. Ils étaient dans un état d’agitation extrême, certains d’entre eux étaient déchaînés. « Tu es avec Denikine, criaient-ils, tu es un officier, un espion, on va te fusiller. » Je me défendais comme je pouvais. « Je ne suis pas officier, je n’ai que dix-neuf ans. » — « Qu’est-ce qui nous prouve que tu as dix-neuf ans ? Pourquoi pas vingt-six ? » — « Je te connais, tu es le fils d’un propriétaire terrien de Lébédine ! », criait un autre. — « Je n’ai jamais mis les pieds à Lébédine. » — « Je t’avais remarqué hier à la gare, et je m’étais déjà dit. Celui-là, c’est un gars de Denikine. » — « Pourquoi ne m’as-tu pas demandé mes papiers à ce moment-là ? C’est d’autres qui en sont chargés là-bas ? » — « Je t’ai vu approcher tout à l’heure dans la rue, criait un autre, et j’ai dit. Regardez, voilà un gars de Denikine qui arrive ! » Un des principaux arguments prouvant que j’étais un espion, c’était ma carte. Puisque j’avais une carte, j’étais un espion, il n’y avait pas besoin de chercher plus loin. C’était clair. Bien que je tentai, de répliquer que mes documents avaient disparu ou m’avaient été volés, rien n’y faisait. « Pourquoi as-tu une carte, si tu n’es pas un espion et es en mission ? », demandaient-ils. En vain, tentai-je de me défendre en montrant que ma carte était neuve, libellée selon l’orthographe soviétique, achetée à Dmitriev, et que je me l’étais procurée afin de m’orienter dans la région et éviter de tomber chez les Blancs par erreur. Ils ne me croyaient pas ; quant à mes arguments, ils ne les convainquaient pas ou cela dépassait leur niveau intellectuel. Je me mis à expliquer que j’avais eu un ordre de mission et un laissez-passer de la Tcheka, mais cela ne leur fit aucun effet. Il était inutile de discuter avec eux, et je dis. « Vous n’êtes pas compétents pour régler mon cas. Envoyez-moi à l’arrière, là on tirera mon cas au clair, on verra si je suis vraiment en mission ou si je suis un espion. Mais je refuse de discuter avec vous ! » J’avais dit cela pour me débarrasser de ces gens déchaînés et leur montrer que je ne craignais pas une enquête poussée. Mais mes paroles eurent l’effet contraire. Ce fut une nouvelle explosion de colère. Un grand cosaque aux traits épais, en pantalon à bandes rouges sur les côtés, frappa du poing sur la table, et hurla. « Voilà, maintenant c’est sûr, c’est bien un gars de Denikine. C’est eux qui ne veulent pas nous parler ! On va te tuer ! » L’affaire prenait mauvaise tournure.
Je ne sais pas comment cela se serait terminé, mais à ce moment se produisit quelque chose d’inattendu. On me demanda si j’avais de l’argent. J’aurais pu mentir, puisque ma tante avait cousu mon argent à l’intérieur de mes bretelles, et qu’ils ne l’y auraient probablement pas trouvé. Mais je me dis que si jamais ils le trouvaient, cela ne ferait qu’aggraver mon cas. Ils me demanderaient pourquoi j’avais menti. C’est pourquoi, j’avouai avoir près de deux mille roubles, cousus à l’intérieur de mes bretelles. J’ôtai ma vareuse (par la tête), ils arrachèrent mes bretelles, déchirèrent les coutures et se mirent à compter l’argent. Nouveaux commentaires. « Eh, il a amassé des roubles-Kerenski. Ça veut dire qu’il voulait rejoindre les Blancs. Et il ne voulait pas qu’on voie l’argent ! » — « Mais c’est moi qui vous l’ai montré ! » — « Et tu crois qu’on ne l’aurait pas trouvé, nous-mêmes ? » dirent les Koubanais avec prétention. « Sais-tu combien de pièces d’or on a récolté, cachées dans des talonnettes ? » Je me mis à renfiler ma vareuse, quand soudain, j’en vis tomber mon portefeuille qui roula sur le sol !
Je compris tout. Quand, au petit matin, dans le wagon, j’avais remis la vareuse qui m’avait servi d’oreiller pendant la nuit, mon portefeuille était allé se coincer, allez savoir comment, dans mon dos, sous la vareuse. Je ne l’avais pas senti se loger là, et comme ma vareuse était étroite, il était resté là sans tomber. Il était petit et mou, c’est pourquoi je ne l’avais pas remarqué. Paniqué, je l’avais cherché partout, mais pas une seconde il ne m’était venu à l’idée d’enlever ma vareuse. Et le voilà qui faisait sa réapparition au moment précis où j’en avais besoin, pour me sauver la vie. « Voilà mes papiers », dis-je en leur tendant mon portefeuille. Les Rouges se précipitèrent dessus pour les lire. Ils étaient malheureusement presque illettrés, et avaient les plus grandes peines à comprendre ce qui y était écrit. Néanmoins, l’effet produit fut concluant. Tout ce que j’avais dit à propos de mon ordre de mission, de mon laissez-passer de la Tcheka, était confirmé. Apparemment, les Koubanais rouges étaient maintenant divisés en deux camps. On continuait de crier. « Tu avais caché ses papiers, tu voulais nous tromper ! » — « Pourquoi les aurais-je cachés, dis-je, dans quel but ? » L’un d’eux voulut prendre la montre que j’avais au poignet, mais un autre l’en empêcha. « Non, tu n’as pas le droit, rends-la-lui ! Trotski a publié un décret qui interdit de tuer les prisonniers ou de confisquer leurs affaires. » On me rendit ma montre. Cependant, le Koubanais aux traits épais me fit signe de le suivre dans la rue, me montra du doigt un break attelé et me dit. « Allons faire un tour ! » — « D’accord », dis-je avec une certaine dose de bravade, pour lui montrer que je n’avais peur de rien. Mais un autre m’arrêta. « Tu te rends pas compte ? Il va t’emmener dans les marécages, et te coupera la tête d’un coup de sabre. Ça ne lui coûte rien, et ça ne serait pas la première fois. » Puis, s’adressant au Koubanais aux traits marqués. « Fiche le camp. Qu’est-ce que tu fais ici ? » L’autre obéit, et disparut sur son break.
Pendant mon interrogatoire, au moment le plus inattendu, Cyrille Dioubine, le président du soviet de district de Snagost, avait fait son entrée. C’était un homme de quarante-cinq ans environ, de grande taille, la barbe courte, portant des bottes montantes. Il était accompagné de deux miliciens de la localité. Leur présence eut un effet modérateur sur les Koubanais, qui étaient d’ailleurs pressés et avaient déjà perdu suffisamment de temps avec moi, alors qu’ils avaient l’ordre de se rendre quelque part de façon urgente. Ils me remirent avec entrain entre les mains de Dioubine et de ses miliciens, ainsi que tous mes papiers et l’argent qui m’avait été confisqué, et se retirèrent. « Ils voulaient me tuer », dis-je à Dioubine. « N’ayez pas peur, répondit-il, ils sont partis, et la milice ne vous fera pas de mal. » — « Qu’allez-vous faire de moi ? » — « Nous allons vous transférer afin de procéder à des vérifications. » Un milicien m’emmena. Nous passâmes à coté de l’église du village. Un bâtiment blanc, de style empire, d’une taille démesurée pour un village (41). J’ai envie de faire un signe de croix, mais je n’osai pas, je ne voulais pas qu’ils comprennent qui j’étais. À ce moment-là, au sud-ouest, on entendit quelques instants, le bruit d’une canonnade. C’était la première de la journée, mais elle semblait s’être encore rapprochée depuis la veille. Elle devait être à cinq verstes. Le milicien eut l’air inquiet. « Dans de telles circonstances, ce n’est pas étonnant qu’on vous ait arrêté », dit-il et il me fit entrer dans le local de la milice du district.
- Ancienne unité de mesure russe. 1 sagène = 2,133 mètres (NdR).
- Et en effet le 30 août, c’est-à-dire deux jours auparavant, l’Armée des Volontaires avait entamé sa dernière grande offensive sur Moscou, offensive qui devait se solder au bout d’un mois par la prise d’Orel. La division Drozdovsky, en marchant sur Rylsk et Dmitriev, prit Soudja le 3 septembre, et Lgov le 7 septembre. Voir V. KRAVTCHENKO, Drozdovtsy ot Yass do Gallipoli [Les Drozdoviens de Iasi à Gallipoli], t. I, Munich, 1973, p. 281.
- En réalité, les Blancs ne devaient prendre Korenevo que quatre jours plus tard. Il aurait été extrêmement dangereux de rester aussi longtemps à la gare. Je me serais immédiatement fait repérer.
- Je n’écris dans mes Mémoires que ce que j’ai personnellement vu et entendu en 1919 des « Koubanais rouges », il s’agit de mes observations à leur sujet. Je voudrais cependant ajouter quelques précisions historiques. Ce régiment avait été formé à l’automne 1918 par l’essaoul du Kouban, V. M. Primakov, et s’était d’abord battu contre Petlioura. Ce n’est que plus tard qu’il devait prendre officiellement le nom de « Brigade des cosaques écarlates », même si la population de la zone de front ne les appelait que « Koubanais rouges » (je n’ai jamais entendu utiliser le terme « cosaques écarlates »). En été 1919, on les transféra sur le front contre Denikine, et ils combattirent dans la région de Tchernigov. À partir de septembre, ils furent incorporés en tant que brigade dans la 14e, et pendant un temps dans la 13e armée soviétique (sous le commandement d’Egorov, Ouborevitch, Gittis) dans le district Korenevo-Rylsk-Dmitriev-Dmitrovsk. Primakov, d’après les récits de ceux qui l’ont connu, était un aventurier, un « paysan rusé », et selon la 2e édition de la Grande Encyclopédie soviétique, un « héros de la guerre civile ». Dans les années trente, il fut le bras droit du commandant en chef du district militaire de Leningrad, en qualité de commandant de corps, puis il fut envoyé en mission de renseignements dans l’Allemagne d’Hitler et, comme presque tous les anciens commandants rouges du front méridional, fut fusillé sur ordre de Staline le 12 juin 1937, avec Toukhatchevski, Ouborevitch et Iakir. Primakov était marié à Lily Brik. Pendant la guerre civile, la presse soviétique chantait les louanges des « Koubanais rouges » et leurs « exploits héroïques ». Voir par exemple, dans la Pravda du 22 novembre 1919, l’article d’une certaine Raïssa Avarkh. « Je chante la folie des téméraires ! » dans lequel elle écrit. « Doucement (?), sans se faire remarquer (!), ils accomplissent la noble tâche de libérer le peuple. » Le général A. V. Tourkoul en donne une image quelque peu différente. « Nous haïssions mortellement la Division écarlate. Nous la haïssions, non parce qu’elle sillonnait l’arrière de nos fronts ou qu’elle avait récemment anéanti notre 2e régiment, mais pour ses mensonges envers la population civile pacifique. afin de démasquer les opposants aux soviets, les Écarlates — cette racaille de forçats — revêtaient nos uniformes… Nous haïssions les Écarlates. Entre eux et nous, c’était une lutte sans merci. » (A. V. TOURKOUL, Dorzdovtsy v ogne. Kartiny grazhdanskoï voïny 1918-1920 gg. [Les drozdoviens au feu. Images de la guerre civile, 1918-1920], 2e éd., Munich, 1948, p. 119-120). Le lecteur pourra se rendre compte, en lisant la suite de mon récit, que cette brigade était détestée non seulement par les populations civiles, mais aussi et tout autant par de nombreux soldats appelés de l’Armée rouge qui les considéraient comme des « voyous », des « brigands » et des « animaux ». Quoi qu’il en soit, il faut reconnaître à la « brigade écarlate » du « camarade Primakov » un rôle déterminant, aux côtés des Lettons, dans l’inversion du rapport de force en faveur des Rouges, lors de la bataille, en automne, contre la division Drozdovsky dans la région de Briansk, puis de Lgov. Suite à cette bataille, Primakov fut décoré, le 13/26 novembre, de l’ordre du Drapeau rouge.
- Les historiens soviétiques n’ont pas pu nier la qualité de combattants de l’Armée des Volontaires. « Au combat, certains détachements et unités de l’Armée des Volontaires étaient d’un assez haut niveau, grâce à la présence dans leurs rangs d’un certain nombre d’officiers de l’armée impériale qui haïssaient le pouvoir soviétique d’une façon fanatique. À partir de l’été 1919, cependant, suite aux pertes subies et à l’enrôlement massif de paysans ou même de prisonniers de l’Armée rouge, ce niveau de compétence militaire chuta fortement » (Voir Bolchaïa sovietskaïa entsyklopedia [Grande Encyclopédie soviétique], 3e éd.. « Denikinschina » [Denikinerie]). J’ajoute que l’indication. « à partir de l’été 1919 » est, selon moi, inexacte. Si l’on en croit les propos — que j’ai cités — des « Koubanais rouges » début septembre, je dirais plutôt « à partir d’octobre ».
- Effectivement, la gare de Gloukhovo était à ce moment précis occupée par un bataillon du 3e régiment de Kornilov, à l’aide de deux trains blindés. C’est de ces trains que venait probablement la canonnade que j’avais entendue la veille de la gare de Korenevo (voir LEVITOV, Kornilovskyi oudarnyi polk [Le régiment de choc de Kornilov], Paris, 1974, p. 317).
- Snagost est l’ancien domaine des princes Bariatynski, reçu par l’un de leurs ancêtres en récompense des services rendus en combattant Stenka Razine au XVIIe siècle. Un autre Bariatynski fut, au XIXe siècle, gouverneur général du Caucase. Ce sont les Bariatynski qui avaient fait construire l’église de Snagost. Mais j’appris tout cela bien plus tard, à l’époque je n’étais au courant de l’existence d’aucun domaine. J’avais d’autres préoccupations, et je ne posai pas de questions à ce propos.