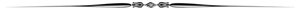Le 5 novembre 1976.
À Mgr Juvénal, métropolite de Toula et de Belev, président du Département des relations extérieures du patriarcat de Moscou1.
Éminence,
Durant notre rencontre à Moscou en août dernier lors de la session de la Commission de dialogue théologique entre les orthodoxes et les anglicans2, vous m’avez demandé d’exprimer mon opinion à propos des thèmes de la future conférence [préconciliaire] panorthodoxe3. […]
La question [qui se pose]est celle de l’utilité de la convocation d’un concile panorthodoxe et non œcuménique, non parce que nous n’aurions pas le droit de convoquer un concile œcuménique sans les catholiques (c’est absurde, car l’Église orthodoxe n’a pas perdu sa plénitude4), mais parce que nous n’y sommes pas prêts et qu’il n’y a pour cela aucune nécessité théologique. Ce n’est que l’avenir qui pourradéterminer si ce concile est œcuménique ou est un « brigandage5 ». La question de la convocation même d’un concile panorthodoxe est actuellement compliquée et discutable. Je ne parle même pas du manque desmoyens financiers ainsi que des conditions sociopolitiques favorables, nécessaires à la convocation d’un « vrai » concile, c’est-à-dire d’un concile auquel assisterait la plénitude de l’épiscopat de toutes les Églises autocéphales,et qui siégerait suffisamment de temps pour étudier sereinement etdiscuter les questions à l’ordre du jour (dont l’étude préalable par des commissions de chaque Église ne peut aucunement remplacer leur discussion collective par le plérôme orthodoxe). En outre, il n’est pas certain que les résolutions théologiques seront d’un niveau convenable et pourront acquérir une autorité semblable à celle des décisions des anciens conciles. Et si c’est le cas, pourquoi donc prendre des résolutions théologiques qui perdront ensuite leur sens ? La seule question théologique dont devrait s’occuper le futur concile est la reconnaissance en tant que VIIIeœcuménique du concile de 879-880 sous le pape Jean VIII et le patriarche Photius, auquel toute l’Église — tant orientale qu’occidentale — était représentée pour la dernière fois, et oùle Symbole de Nicée-Constantinople fut proclamé en commun sans le Filioque6. Il convient aussi d’accorder une reconnaissance panorthodoxe aux conciles de Constantinople de 1341 et de 1351 qui approuvèrent la doctrine théologique de saint Grégoire Palamas7, insuffisamment ancréeencore dans la conscience de nombreux orthodoxes.
Mais s’il n’est pas nécessaire que le concile s’occupe de problèmes purement théologiques, il est indispensable et même urgent de discuter et de résoudre des questions en matière ecclésiastico-pratique. À ce genre de problèmes appartiennent celui de l’autocéphalie et celui des orthodoxes habitant en dispersion (diaspora), i.e. hors des frontières canoniques des Églises autocéphales, telles qu’elles furent établies tout au long de l’histoire. Ces questions se sont envenimées ces derniers temps, depuis que le patriarcat de Moscou a accordé le statut d’autocéphalie à l’Église orthodoxe en Amérique8, ce que le patriarcat de Constantinople n’a pas reconnu. La question de la diaspora est devenue importante à cause de l’apparition en masse de millions d’orthodoxes sur des territoires « en-dehors des autocéphalies »,en raison des émigrations du XXe siècle et de la conversion d’Occidentaux à l’orthodoxie. Ainsi, l’Orthodoxie s’est morcelée en plusieurs juridictions sur un seul et même territoire, ce qui mène à un chaos juridictionnel total. Tout cela cause un tort immense à l’Église orthodoxe. Ces difficultés ne peuvent en aucun cas être résolues par la simple transmission de l’autorité sur la diaspora et du droit de création de nouvelles autocéphalies à un unique patriarcat, concrètement au patriarcat de Constantinople qui, seul, prétend à un tel monopole. Une telle position manque de fondements canoniques et historiques.En outre, l’expérience des dernières décennies a montré que le patriarcat de Constantinople n’étaitpas en état — dans sa situation actuelle en tout cas — de diriger efficacement et utilement pour l’ensemble de l’Orthodoxie les affaires panorthodoxes. En partie, à cause du manque de fidèles et de cadres compétents,maisplus encore, à cause de son caractère national.Les intérêts panorthodoxes sont ainsi fréquemment mis au second plan par rapport aux intérêts grecs, dont l’exemple marquant est le refus par Constantinople de reconnaître l’autocéphalie américaine. Un obstacle encore plus importantà la reconnaissancede laplace exclusive du patriarcat de Constantinople dans les affaires panorthodoxes et la direction de la diaspora, est sa dépendance politique et financière du gouvernement turc d’un côté et du gouvernement grec de l’autre. Certes, on pourrait soulever de telles objections à l’égard de presque tous les autres patriarcats ou Églises autocéphales,mais aucun d’entre eux ne prétend à une juridiction universelle et au monopole du pouvoir sur la diaspora.
On pourrait trouver une solution en réorganisant radicalement lepatriarcat de Constantinople,par la création auprès de lui d’un Synode panorthodoxe permanent de représentants de toutes les Églises autocéphales. Ce Synode pourrait siéger, disons, à Chambésy ou ailleurs hors de Turquie sous la présidence d’un représentant du patriarcat de Constantinople, et gérer les affaires de nature panorthodoxe, tandis que les questions touchant à la vie intérieure de l’Église de Constantinople continueraient, comme auparavant, à être abordées par son propre Synode avec son patriarche en tête. Le Synode de Constantinople continueraitégalement à élire son patriarche comme évêque de l’Église locale. Une telle solution aurait une importance considérable non seulement par la mise en ordre du chaos juridictionnel dans la diaspora orthodoxe et la reconstitution de son unité, mais aussi, plus fondamentalement, par la création d’un centre panorthodoxede coordination et d’information mutuelle, de décisions fraternelles et d’actions communes dans les questions d’intérêt panorthodoxe,ce qui est d’une importance vitale pour l’Orthodoxie dans le monde contemporain. Mais il ne faut pas oublier que la réalisation pratique de tout cela paraît extrêmement difficile pour différentes raisons ecclésiales et extérieures à la vie de l’Église.
Toutefois, le premier pas indispensable pour résoudre les problèmes dans les relations interorthodoxes et, en général, dans l’ordre des affaires ecclésiales, est la reconnaissance, par le futur concile, des autocéphalies dernièrement créées ainsi que de l’antique autocéphalie de l’Église de Géorgie. J’estime nécessaire de le rappeler ici, car le patriarcat de Constantinople a eu à l’égard de celle-ci une politique contradictoire et incohérente. Tantôt (dans les années 1930, quand l’Église géorgienne était en rupture avec le patriarcat de Moscou), il la reconnaissait comme autocéphale ;tantôt, quand elle s’est réconciliée avec le patriarcat de Moscou, il ne la reconnaissait pas du tout (et ne l’invitait pas aux conférences panorthodoxes). Ensuite, l’Église de Constantinople l’a reconnue comme autonome (par rapport à quelle Église ?) et a accordé à cette Église très ancienne qui a reçu son autocéphalie du patriarche d’Antioche au VIIIe siècle et est devenue patriarcale au XIe siècle, une des dernières places dans la hiérarchie des Églises autocéphales9.Il est nécessaire de confirmer l’autocéphalie des Églises polonaise et tchécoslovaque, car la position du patriarcat de Constantinople était également incohérente et tendait à considérer ces Églises comme autonomes10.Mais avant tout, il faut que le patriarcat de Constantinople reconnaisse l’autocéphalie de l’Église orthodoxe en Amérique : c’est, peut-être, la question centrale et essentielle du concile, et s’il se trouvait qu’à la conférence panorthodoxe, les Grecs étaient absolument opposés à l’autocéphalie américaine, il vaudraitpeut-être mieux ne jamais convoquer le concile. Certes, des difficultés particulières sont liées à l’autocéphalie en Amérique : les orthodoxes de différentes nationalités vivant sur le territoire des États-Unis ont leurs propres organisations ecclésiales, et les Grecs sont même plus nombreux que les orthodoxes d’origine russe. C’est pourquoi, la résolution de cette situation peut être trouvée par un accord entre les patriarcats de Constantinople et de Moscou dont le but serait d’unir les deux Églises d’Amérique en une seule Église autocéphale. Car il est difficile de compter sur une simple adhésion des Grecs.La question d’autonomie de l’Église au Japon11 est moins difficile : on ne peut protester contre cette autonomie et elle doit être approuvée au concile.
La seule solution envisageable du chaos juridictionnel en Europe occidentale est la création d’une Église autocéphale.Certains estiment cependant qu’à cause d’une maturité insuffisante, d’un petit nombre de fidèles, de l’enracinement incomplet de l’Orthodoxie dans la vie locale ouest-européenne, il vaudrait mieux se limiter d’abord à une autonomie, en éloignant une proclamation d’autocéphalie à unavenir plus lointain. Nous ne pouvons approuver cet approche, parce qu’une autonomie ne peut être conçuequ’au sein d’une Église autocéphale ou d’un patriarcat, dans la juridiction duquel l’Église autonome subsiste.Or, c’est le patriarcat de Constantinople, avec ses prétentions à la primauté et au pouvoir sur la diaspora, qui deviendra inévitablement une telle instance. Toute autre décision est irréaliste : il ne faut même pas en parler. Mais cette juridiction de Constantinople, même indirecte, est inacceptable pour les fidèles de l’Église orthodoxe russe qui se trouvent dans la dispersion en Europe occidentale, parce que nous savons bien ce qu’est la domination desGrecs.Je dirai même plus : mieux vaut un chaos juridictionnel que notre dépendance des Grecs ! C’est mieux non seulement pour les Russes, mais aussi pour toute personne occidentale, car tous nous voyons quels obstacles sont créés par les Grecs au renforcement et à la mission de l’Orthodoxie en Occident (leur attitude envers la mission orthodoxe oscille entre indifférence totale et hostilité foncière).Concernant les Russes, nous sommes prêts à nous joindre, pour le bien de l’Orthodoxie, à une future Église autocéphale même si cela affaiblit nos liens avec notre Église-Mère, mais nous n’entrerons jamais dans une « autonomie grecque » quelconque.Ce qui reste encore envisageable est d’essayer de s’entendre avec l’archevêché de Mgr Georges à Paris (l’Exarchat pour les paroisses russes du patriarcat de Constantinople)et de créer une autonomie particulière ou un exarchat avec une autonomie élargie sous la juridiction du patriarcat de Moscou (plutôt nominale, il faut le souligner), auquel pourrait se joindre notre Exarchat du patriarche [de Moscou] en Europe occidentale. Cette région métropolitaine autonome ne prétendrait pas à un monopole juridictionnel en Europe occidentale et pourrait devenir une étape préparatoire à la future autocéphalie.
En ce qui concerne la question de savoir qui peut accorder l’autocéphalie (le concile panorthodoxe ou l’Église-Mère), les deux procédures peuvent être justifiées par des arguments canoniques et historiques. Je ne me rappelle pas que les conciles œcuméniques, sauf le IIIe qui a accordé l’autocéphalie à l’Église de Chypre, se soient occupés des questions d’autocéphalie et en aient accordé une à qui que ce soit. Le chemin le plus habituel est l’octroi de l’autocéphalie par l’Église-Mère, comme, par exemple, par le patriarcat d’Antioche à l’Église de Géorgie, par le patriarcat de Constantinople à l’Église russe et par le patriarcat de Moscou à l’Église en Amérique. L’une et l’autre méthode sont acceptables : il ne faut pas les opposer, les circonstances et le bien de l’Église déterminent laquelle choisir. Il est évidemment souhaitable que l’autocéphalie accordée par une Église-Mère soit confirmée par la suite par le concile panorthodoxe, la conférence panorthodoxe ou tout autre organecomparable, et ce, pour l’unité de l’Église et l’amour fraternel mutuel. Une seule chose est inadmissible : la prétention d’une Église(que ce soit celle de Constantinople et toute autre Église autocéphale)à avoir le droit exceptionnel d’accorder l’autocéphalie. De telles prétentions papistes sont étrangères à l’esprit de l’Orthodoxie.
Si je me rappelle bien, deux questions sont encore à l’ordre du jour de la conférence panorthodoxe : la possibilité de remariage pour le clergé12 et les changements (dans le sens d’une atténuation) des règles du jeûne dans l’Église orthodoxe. Je le regrette beaucoup, parce que le fait même de poser et de discuter de telles questions porte ombrage au concile aux yeux de l’opinion publique orthodoxe, notamment sur la Sainte montagne de l’Athos (or, le Mont Athos est le cœur de l’Orthodoxie)13. Quant au premier point, je dirai brièvement que le remariage du clergé contrevient àla parole de Dieu (pas seulement auxcanons). L’apôtre Paul écrit : l’évêque doit être « mari d’une seule femme » (1Tim 3, 2) (dans la terminologie de l’époque, le terme « évêque » était employé aussi pour les presbytres). Aucune raison d’ordre pratique ne peut engager l’Église orthodoxe à prendre des décisions contrairesaux Saintes Écritures. Si nous prenions ce chemin, je crains même que nous n’arrivionsà la reconnaissance du clergé féminin. Le mariage unique du clergé possède un sens théologique profond, je n’ai pas besoin de m’approfondir davantage ici à ce sujet, le professeur Troïtsky a bien écrit là-dessus14. Pour ce qui concerne la pratique ecclésiale, une certaine « économie » est possible, mais assez limitée.
Encore plus inadmissibles apparaissent toute sorte de tentatives de changement ou d’affaiblissement des règles du jeûne établies par les saints Pères. Ces règles qui remontent à l’époque apostolique (cf.par exemple, le passage dans la Didachè, œuvre du Ier siècle,sur le jeûne le mercredi et le vendredi comme particularité des chrétiens), bien qu’elles aient changé et se soient développéesdurant la période patristique, ont formé un ensemblecomplexe et harmonieusement proportionné, étroitement lié aux aspects liturgiques et à la piété de la vie orthodoxe, dont il constitue l’un des principes fondamentaux. Il est vrai que les orthodoxes contemporains gardent moins le jeûne, mais au moins ils comprennent qu’ils commettent un péché, et les pères spirituels, voyant leur pénitence, pardonnent avec condescendance à leur faiblesse […]. Penser que si nous assouplissions les règles du jeûne, les orthodoxes les observeront mieux, est tout aussi naïf. C’est plutôt le contraire : si les règles patristiques ne sont pas suivies, nos décisions seront d’autant plus négligées. D’autre part, la triste expérience de l’Église catholique romaine qui s’est montrée trop indulgente dans le domaine du jeûne, ou plutôt l’a supprimé quasi-totalement, non seulement n’a attiré personne, mais a en mené beaucoup à quitter l’Église (comme, par exemple, en Amérique où la suppression du jeûne du vendredi — particularité qui distinguait les catholiques des protestants — a eu pour conséquence une brusque chute de la fréquentation des offices catholiques). Le concile panorthodoxe ne doit pas supprimer les jeûnes, mais appeler les fidèles à les observer plus fermement.
Voilà ce que je peux écrire en réponse à votre demande. Ce n’est pas une recherche de théologie ni de droit canonique, mais juste certaines réflexions qui me sont venues en tête. […]
Je demande vos prières et reste vôtre dans l’amour en Christ,
+ Basile,
Archevêque de Bruxelles et de Belgique.
1Lettre dactylographiée, Archives Archevêque Basile, Bruxelles. Traduit du russe par Dimitri Garmonov, pour « Messager » de l’Eglise orthodoxe russe № 25,avril-juin 2014, France.
2Cf. K. Ware & C. Davey(éd.), Anglican Orthodox Dialogue: The Moscow Agreed Statement, SPCK, Londres, 1977.
3 Théologien renommé, l’archevêque Basile Krivochéine de Bruxelles et de Belgique (1900-1985) représenta l’Église orthodoxe russe lors des conférences préconciliaires panorthodoxes de Rhodes I (1961), II (1963) et III (1964) et de Chambésy-Genève (1968). Cf. notamment Archevêque Basile Krivochéine, Mémoire des deux mondes. De la révolution à l’Église captive, Paris, Éditions du Cerf, 2010, p. 298-311.
4L’archevêque Basile développera cette opinion dans son étude sur ” Les textes symboliques dans l’Église orthodoxe «, Dieu, l’homme, l’Église. Lecture des Pères, Paris, Éditions du Cerf, 2010, p. 123.
5Est ici visé le » deuxième ” concile d’Éphèse de 449, que l’Église rejeta et qualifia de ” brigandage ” (latrocinium), selon la formule du pape Léon 1er.
6Cf. F. Dvornik, Le schisme de Photius : histoire et légende,Paris, Éditions du Cerf, 1950 ; Archevêque BasileKrivochéine,” Les textes symboliques dans l’Église orthodoxe «, p. 129-131.
7Archevêque BasileKrivochéine, « Les textes symboliques dans l’Eglise orthodoxe », p. 133-137.
9 Le patriarcat de Constantinople a reconnu l’Église de Géorgiecomme autocéphale en 1990, en la considérant comme 9e dans l’ordre des patriarcats.
10L’Église orthodoxe de Pologne avait été reconnue comme autocéphale par le patriarcat de Constantinople en 1924 et par celui de Moscou en 1948. L’Église orthodoxe des Terres tchèques et de la Slovaquie (anciennement de Tchécoslovaquie) avait été reconnue comme autocéphale par l’Église russe en 1951 et par le patriarcat de Constantinople en 1998.
11L’Église orthodoxe du Japon a été reconnue comme autonome par l’Église russe en 1970, mais pas par le patriarcat de Constantinople.
12 Selon les règles de l’Église orthodoxe, sont admissibles au sacerdoce les hommes célibataires ou mariés une seule fois. Par conséquent, tant l’ordination de divorcés que le (re)mariage de clercs est interdit.
13Cf.Archevêque Basile Krivochéine, « Le Mont Athos dans la vie spirituelle de l’Église orthodoxe », Buisson ardent. Cahiers Saint-Silouane l’Athonite, 20 (2014) (à paraître) ; S. Model, » Mgr Basile et le Mont Athos “, Messager de l’Église orthodoxe russe, 15 (2009), p. 16-20.
14Cf. S.V. Troïtsky [célèbre canoniste orthodoxe du XXe siècle], Khristianskayafilosofiabraka La Philosophie chrétienne du mariage], Paris, 1933.


La conférence panorthodoxe de Rhodes (24 septembre — 1er octobre 1961) inclut la section suivante au programme des travaux du préconcile panorthodoxe à venir :
1) textes faisant autorité dans l’Église orthodoxe ;
2) textes ayant une autorité relative ;
3) textes ayant une autorité auxiliaire ;
4) établissement et publication d’une Confession de foi orthodoxe unique.
La question des textes symboliques, celle de leur place et de leur importance dans la théologie et la conscience orthodoxes en général, n’est pas neuve dans notre Église. Habituellement, il est vrai, cette question portait sur ce qu’on appelle les « livres symboliques »: y a-t-il de tels « livres » dans l’Église orthodoxe et celle-ci leur reconnaît-elle une importance spéciale ? Or, les personnes ayant composé la section ci-dessus évitent, consciemment sans doute, le terme contesté de « livres ». À la place, ils emploient l’expression « textes symboliques ». Le choix de ce terme a été fait, on peut le supposer, non sans l’influence des travaux du professeur de théologie dogmatique et morale à la faculté théologique d’Athènes, Jean Karmiris (1903-1992), qui a beaucoup travaillé à l’étude des documents dogmatiques de l’Église orthodoxe, particulièrement de l’Église grecque, tant ancienne que moderne (après la chute de Byzance). L’attention du professeur Karmiris a été particulièrement attirée par les textes orthodoxes polémiques des XVIe-XVIIIe siècles dirigés contre les confessions occidentales. le catholicisme romain et le protestantisme, ainsi que par la question de l’influence exercée par ces confessions hétérodoxes sur la théologie orthodoxe .
Le fruit de ces longues recherches scientifiques fut un ouvrage important en deux volumes (plus de mille pages en tout) publié par J. Karmiris en grec sous le titre de Monuments dogmatiques et symboliques de l’Église orthodoxe catholique. Comme nous le voyons, le professeur Karmiris évite l’expression « livres symboliques » ; il la remplace par « mémoriaux (μνημεῖα) dogmatiques et symboliques », évitant ainsi les associations théologiques spécifiquement liées au terme de « livres symboliques » et élargissant du même coup l’objet de son étude. en plus des confessions polémiques des XVIe-XVIIIe siècles auxquelles on applique généralement le terme de « livres symboliques », le professeur Karmiris inclut dans son ouvrage une série d’autres documents de l’Église orthodoxe qui, d’une façon ou d’une autre, expriment sa foi et son enseignement — symboles de foi de l’Église ancienne, décisions dogmatiques des conciles œcuméniques et des conciles locaux entérinés par les conciles œcuméniques, les conciles hésychastes du XIVe siècle, des messages patriarcaux, etc.
Nous devons tenir compte de tout cela pour comprendre correctement la section du programme du préconcile sur les « textes symboliques », ainsi que sa terminologie. C’est la raison pour laquelle nous avons pensé indispensable de nous arrêter aussi longuement sur les travaux du professeur Karmiris au début de notre exposé.
I — C’est donc en accord avec la pensée des auteurs du programme du préconcile que nous entendrons par textes symboliques dans l’Église orthodoxe tous les monuments orthodoxes dogmatiques, exprimant, au nom de l’Église, sa foi et son enseignement théologique.
Au préconcile à venir et au concile œcuménique qui le suivra, s’il plaît à Dieu, incombera donc la tâche d’éclaircir ce qui, parmi les nombreux textes dogmatiques, peut être considéré comme un texte symbolique exprimant la foi et l’enseignement de l’Église, l’attitude que l’Église doit adopter envers ce texte, son degré d’autorité et son caractère obligatoire. Il va de soi qu’aucune question particulière ne se pose au sujet des monuments dogmatiques de l’Église ancienne. son Symbole de Foi (Credo), élaboré et confirmé par les Ier et IIe Conciles œcuméniques, fixé dans sa forme immuable par les conciles œcuméniques qui suivirent, les décisions dogmatiques des sept conciles œcuméniques en général et au sujet des décisions dogmatiques des conciles locaux antiques qui furent confirmées par le VIe Concile œcuménique (plus exactement par la deuxième règle du concile in Trullo de 691-692, considéré comme le prolongement des Ve et VIe Conciles). Il est hors de doute que les décisions dogmatiques (ὅροι) des conciles œcuméniques possèdent dans l’orthodoxie une autorité incontestable et irrévocable, bien qu’on puisse admettre que ces décisions pourront être complétées et explicitées davantage par des conciles œcuméniques à venir, s’ils sont convoqués, de même que jadis les conciles œcuméniques complétaient les décisions des conciles qui les avaient précédés. Ainsi, le IIe Concile compléta et modifia même le texte du Symbole de Foi du Ier Concile, les Ve et VIe Conciles complétèrent et précisèrent les décisions christologiques des IIIe et IVe Conciles. Mais la question se pose surtout sur le caractère et le degré d’autorité des décisions des conciles locaux et d’autres monuments dogmatiques qui ne furent pas confirmées par des conciles œcuméniques, qu’ils remontent à l’époque de ceux-ci ou à des temps plus récents, comme c’est le cas le plus souvent. Dans ce contexte, on pose parfois la question sur le droit même de l’Église orthodoxe d’élaborer et d’approuver des décisions dogmatiques après l’époque des conciles œcuméniques. Certains contestent ce droit, soit qu’ils nient tout développement dogmatique dans l’Église, soit qu’ils ne reconnaissent celui-ci que dans l’Église ancienne, considérant le nombre même de sept conciles œcuméniques comme sacré et définitif, soit enfin que l’Église orthodoxe catholique a soi-disant cessé d’être l’Église universelle après la défection du patriarcat de Rome et n’a pas le droit ni ne peut, seule, sans Rome, convoquer des conciles œcuméniques .
Nous ne pouvons partager ces opinions. L’Église orthodoxe nie, certes, l’idée du développement dogmatique dans le sens où l’entend la théologie catholique-romaine la plus récente (depuis le cardinal Newman) qui s’efforce de justifier les dogmes romains nouveaux qui ne sont contenus ni dans l’Écriture Sainte, ni dans les écrits des Pères anciens (comme par exemple le Filioque, l’infaillibilité du pape, l’Immaculée conception, etc.) en affirmant que le contenu même de la foi et de la révélation s’accroît dans le courant de l’histoire ecclésiastique ; ce qui au début n’aurait eu qu’une forme embryonnaire et n’aurait existé dans l’Écriture et la Tradition que sous forme d’allusions obscures, ce dont l’Église n’avait pas encore pris conscience, se révèle et se manifeste par la suite, se formulant dans la conscience ecclésiale. L’Église orthodoxe n’admet pas l’idée d’un tel développement ou évolution du contenu même de la foi et de la révélation. Elle reconnaît cependant que les vérités de la foi, immuables par leur contenu et leur « volume » — puisque « la foi [a été] transmise aux saints une fois pour toutes » (Jude 3) — sont formulées dans l’Église graduellement et précisées dans des concepts et des termes. C’est là un fait historique incontestable, reconnu même par les théologiens orthodoxes les plus conservateurs, tel que le métropolite Macaire (Boulgakov, 1816-1882). Il suffit, pour le confirmer, d’indiquer l’introduction graduelle dans l’usage ecclésial d’expressions théologiques fondamentales qui ne se rencontrent pas dans la Sainte Écriture. Ainsi le mot « catholique » (pour désigner l’Église — καθολικὴ Ἐκκλησία) se rencontre pour la première fois chez saint Ignace d’Antioche (Épître aux Smyrniotes, 8, 2) vers l’an 110, le mot « Trinité » (Τριάς) pour la première fois chez saint Théophile d’Antioche (Livre à Autolycus, 2, 15) vers l’an 180, l’expression Θεοτόκος (« Mère de Dieu ») pour la première fois dans les sources écrites chez Hippolyte de Rome et chez Origène dans la première moitié du IIIe siècle, quoique son emploi populaire soit plus ancien. Les mots « orthodoxe », « orthodoxie » (ὀρθόδοξος, ὀρθοδοξία) sont d’une origine encore plus tardive. on les rencontre pour la première fois chez Méthode d’Olympe au début du IVe siècle. Inutile de parler du terme ὁμοούσιος (« consubstantiel »), dont l’histoire est si intéressante. Figurant pour la première fois chez les gnostiques (Valentin et autres, au IIe siècle), ce terme fut rejeté par l’Église dans le sens que lui donnait l’hérétique Paul de Samosate, au concile d’Antioche en 270, mais admis et confirmé au concile de Nicée en 325, dans son sens orthodoxe. Généralement, une telle introduction dans l’usage théologique de termes nouveaux ou une façon nouvelle de formuler les dogmes était une réponse à l’apparition d’hérésies qui dénaturaient la foi et la tradition de l’Église. On ne peut, toutefois, y voir une règle. Des formules nouvelles étaient parfois provoquées par des besoins internes des orthodoxes eux-mêmes de préciser leur foi et leur piété. Ainsi, on peut penser que l’expression « Mère de Dieu » apparut dans des milieux populaires d’Alexandrie qui exprimaient ainsi leur vénération de la Vierge et leur foi dans l’incarnation.
De même est dépourvue de fondement l’opinion « pieuse » et très répandue selon laquelle seule l’Église ancienne des sept conciles œcuméniques possédait la puissance de la grâce de définir les vérités de la foi, alors que plus tard elle perdit ce don. Malgré son conservatisme apparent, cette opinion fait inconsciemment écho à l’enseignement protestant sur la « corruption » et la « chute » de l’Église historique « constantinienne », opposée dans le protestantisme à l’Église primitive, apostolique. Mais l’Église orthodoxe est consciente d’être la continuatrice authentique et non diminuée de l’ancienne Église des apôtres et des Pères, ou plus exactement d’être cette même Église apostolique et patristique à notre époque et de posséder toute la plénitude des dons du Saint Esprit jusqu’à la consommation des siècles. Rappelons ici avec quelle force cette plénitude des dons de l’Esprit Saint possédée par l’Église, même de nos jours, fut enseignée par le grand écrivain spirituel des Xe-XIe siècles, saint Syméon le Nouveau Théologien. Il allait jusqu’à considérer comme la plus grande de toutes les hérésies l’opinion répandue en son temps selon laquelle l’Église aurait perdu maintenant la plénitude de la grâce qu’elle avait possédée aux temps apostoliques. Il avait en vue, il est vrai, avant tout le don de la sainteté et de la contemplation ; mais la grâce est, selon l’enseignement de l’Église orthodoxe, une force divine unique, tous les dons de l’Esprit Saint sont liés les uns aux autres et demeurent sans altération dans l’Église selon la promesse du Christ. Et, d’ailleurs, comment fixer la limite historique à partir de laquelle la période de déclin commencerait dans l’Église ? Serait-ce le ΙIe siècle — moment où le canon néotestamentaire fut défini, comme le pensent les protestants ? Le Ve siècle — période post-chalcédonienne, ainsi que de nombreux anglicans semblent le croire ? Ou bien la fin de la période des conciles œcuméniques, comme le pensent de nombreux orthodoxes qui nient la possibilité de convoquer un nouveau concile œcuménique ? Ils croient qu’il ne peut y avoir que sept conciles parce que sept est un nombre sacré. À titre de preuve, ils citent certains passages de la liturgie consacrée au VIIe Concile œcuménique où ce nombre sept des conciles est comparé à celui des dons du Saint Esprit, etc. Mais une argumentation, pour ne pas dire une rhétorique semblable, avait déjà été appliquée autrefois pour défendre l’autorité du IVe Concile œcuménique contre les attaques des monophysites. On disait qu’il devait y avoir quatre conciles car ce nombre est sacré, étant celui des Évangiles, des fleuves du paradis, etc. Il y a eu sept conciles œcuméniques, mais l’Église n’a jamais décrété que ce nombre était définitif et qu’il n’y en aurait plus.
Moins acceptable encore est l’opinion selon laquelle l’Église orthodoxe catholique n’aurait pas le droit de convoquer des conciles œcuméniques seule, après la défection du patriarcat de Rome et sans la participation de celui-ci. L’Église du Christ ne s’est pas divisée parce que Rome l’a quittée. Quelque pénible, voire même tragique, qu’ait été cette défection, elle n’a pas amoindri la plénitude de la vérité et de la grâce dans l’Église, de même que la défection non moins pénible et tragique des nestoriens et des monophysites n’avait pas amoindri cette plénitude dans l’Église ancienne. L’Église orthodoxe a toujours conscience de son identité avec l’Église ancienne, l’Église une, sainte, catholique et apostolique dont parle le Credo. Elle conserve donc jusqu’à nos jours, dans sa plénitude, le droit de convoquer des conciles œcuméniques et d’y prendre des décisions dogmatiques. Ceci d’autant plus que même avant la défection de Rome, aucun des conciles œcuméniques n’a été convoqué par les papes de Rome ni même sur leur initiative ; aucun d’eux n’eut lieu à Rome et à aucun les légats du pape n’avaient assumé la présidence, tout en étant les premiers à signer les actes conciliaires, ayant la primauté d’honneur .
Il est donc incontestable qu’après la période des sept conciles œcuméniques, l’Église orthodoxe a conservé le droit d’énoncer des jugements dogmatiques et de promulguer des définitions en précisant et en formulant son enseignement théologique. L’histoire ecclésiastique nous montre, d’ailleurs, que c’est ainsi que l’Église orthodoxe agissait effectivement tout au long des siècles. Toutefois, puisqu’au cours de toute cette période historique, pour des raisons dont nous ne parlerons pas ici car cela nous entraînerait hors des cadres de cet exposé, aucun concile œcuménique ne fut convoqué ou, plutôt, aucun concile ne fut reconnu par l’ensemble de l’Église comme œcuménique, toutes ces définitions ecclésiastiques locales, ces confessions de foi, ces messages, etc., tous ces « textes symboliques » comme on les appelle, sont privés d’autorité indiscutable et d’une reconnaissance ecclésiastique générale, n’ayant pas été examinés ni approuvés par l’Église dans son ensemble à un concile œcuménique. En effet, seul un tel concile, étant une expression de toute l’Église catholique universelle, possède, de par les promesses faites par le Seigneur à son Église, en vertu de la grâce préservée dans l’épiscopat par la succession apostolique, le don d’énoncer dans le domaine de la foi des décisions infaillibles et autoritaires, le concile œcuménique pouvant conférer ce caractère d’infaillibilité et d’autorité à des définitions théologiques et des décisions d’instances ecclésiastiques moins élevées, celles des conciles locaux, des patriarches et des évêques. Une des tâches qui incombera au concile œcuménique à venir sera donc le choix parmi le grand nombre des décisions théologiques de la période « post-conciliaire », de celles qui peuvent être considérées comme exprimant entièrement l’enseignement orthodoxe à l’exemple des documents dogmatiques anciens, reconnus par les sept conciles œcuméniques. Si la conscience conciliaire reconnaît la nécessité d’un tel choix, le critère suivant lequel il pourrait être fait peut être envisagé à peu près comme suit :
1) L’identité (quant à leur fond) des textes dogmatiques examinés avec l’enseignement de l’Écriture, des conciles œcuméniques et des Saints Pères. L’Église est la gardienne de « la foi [qui a été] transmise aux saints une fois pour toutes » (Jude, 3). C’est par les paroles. « En marchant dans les traces des Saints Pères… » que les Pères du IVe Concile œcuménique (Chalcédoine) commencent leur célèbre définition sur la foi (ὅρος). C’est cette voie que devra suivre également la théologie orthodoxe authentique. La fidélité aux Pères est sa caractéristique essentielle. Ceci non seulement parce que ce sont les Pères anciens, bien que le témoignage de l’ancienneté ait toujours son prix, mais parce que leurs œuvres expriment réellement la foi de l’Église, qu’avaient prédite les prophètes, que le Christ avait enseignée par sa parole et par ses actes, que les apôtres avaient prêchée dans la force de l’Esprit Saint, que les conciles avaient définie, et les Pères explicitée. « Telle est la foi des apôtres, telle est la foi des Pères, telle est la foi orthodoxe, telle est la foi qui soutient l’univers . » C’est précisément cette foi que doit immanquablement exprimer toute confession ou définition orthodoxe.
2) Tout « texte symbolique » digne d’être confirmé en tant qu’expression de la foi de l’Église et revêtu de son autorité doit être orthodoxe, non seulement dans son fond, mais aussi dans la façon dont il est formulé ; par la manière dont il est exprimé et fondé, il doit être à la hauteur de la théologie patristique. En effet, les Saints Pères furent non seulement des confesseurs de la vraie foi, mais aussi de grands théologiens, de fins penseurs, des contemplateurs des profondeurs de l’Esprit et des mystères divins. Des textes décadents dont la forme est ratée, dont le contenu est exprimé en termes impropres pour la tradition orthodoxe, des textes pauvres quant à la pensée théologique ne sauraient prétendre à être reconnus en tant qu’expression de l’orthodoxie à l’égal des confessions anciennes qui exprimaient la haute théologie des Pères.
3) Enfin, les textes nouveaux, tout en exprimant la foi immuable de l’Église, « transmise une fois pour toutes aux saints », ne doivent pas être une simple répétition des définitions dogmatiques adoptées, car alors leur formulation et leur proclamation perdent leur raison d’être. Ces textes doivent fournir des réponses identiques en esprit mais nouvelles par leur forme, aux erreurs apparues récemment, aux questions spirituelles, aux difficultés ; ils doivent préciser et compléter ce qui jadis n’avait pas été dit suffisamment ou ce qui avait été exprimé avec une clarté insuffisante, les questions elles-mêmes n’étant pas encore, à cette époque, suffisamment mûres et éclaircies dans la conscience ecclésiale, ou bien les fausses doctrines auxquelles il s’agissait d’opposer l’enseignement ecclésial n’existant pas encore. Seuls des textes symboliques fidèles à l’esprit de l’orthodoxie, suffisamment parfaits dans leur forme et leur pensée théologique, traitant de questions nouvelles, peuvent être choisis et soumis à l’approbation du concile œcuménique à venir pour y être proclamés et revêtus de l’autorité de l’Église.
II — De ces considérations théologiques préliminaires d’un caractère général, nous pouvons passer maintenant à une étude concrète, par ordre historique, des plus importants documents symboliques de l’Église orthodoxe catholique.
Nous essaierons en même temps de définir notre attitude envers ces textes suivant le programme du préconcile qui propose de les classer dans l’ordre de leur degré d’autorité et leur caractère obligatoire (les textes faisant autorité, ceux ayant une autorité relative et ceux dont l’autorité est auxiliaire). Il va de soi que nous considérons uniquement les textes qui ne furent pas établis ni approuvés lors des sept conciles œcuméniques.
L’époque qui précéda les conciles œcuméniques nous a laissé le plus ancien monument dogmatique, le Symbole de saint Grégoire de Néocésarée que celui-ci composa vers 260-265. Incontestablement orthodoxe par son contenu, quoiqu’exprimé plutôt dans des termes philosophiques propres à un disciple d’Origène que dans des expressions bibliques propres aux symboles de l’Église, le Symbole en question exprime davantage la foi personnelle de saint Grégoire le Thaumaturge que l’enseignement de l’Église de Néocésarée. Il était bien connu des Pères du IVe siècle, en particulier de saint Athanase d’Alexandrie, et fut utilisé par eux dans leur polémique contre les ariens, car il exprimait clairement la foi dans l’incréé des Personnes de la Sainte Trinité. Néanmoins, les Pères des conciles œcuméniques ne crurent pas nécessaire de se référer à ce Symbole dans les actes conciliaires ni de l’inclure dans leurs décisions en le reconnaissant comme Symbole officiel de l’Église parallèlement à celui de Nicée-Constantinople.
On peut supposer que c’était en raison de son caractère personnel, mais surtout la conviction des Pères que le Symbole de Nicée-Constantinople était et devait demeurer unique dans l’Église, immuable et ne pouvant être remplacé par nul texte, même si ce texte ne devait rien contenir de contraire à l’orthodoxie. Telle doit être aussi, pensons-nous, notre attitude envers le Symbole de saint Grégoire le Thaumaturge, quoi qu’en pense le métropolite Macaire (Boulgakov) qui lui confère la même autorité qu’aux confessions de foi des conciles œcuméniques. Nous devons beaucoup apprécier et aimer le Symbole de saint Grégoire — monument ancien et remarquable par son contenu et sa forme, exprimant sa foi et la nôtre —, mais nous ne devons pas lui attribuer la valeur d’une confession de foi possédant une autorité ecclésiale générale qu’il n’a jamais eue.
Pour la période même des conciles œcuméniques, nous possédons deux monuments dogmatiques relativement anciens, inconnus toutefois de ces conciles. L’attitude de l’Église orthodoxe envers ces textes est comprise par beaucoup de façons différentes. Il s’agit du Symbole dit « des apôtres »et de celui de saint Athanase d’Alexandrie. En ce qui concerne le premier, même s’il contient des éléments anciens remontant à la prédication apostolique (comme d’ailleurs tous les symboles anciens), il n’est en réalité qu’une modification tardive du symbole baptismal de l’Église de Rome des IIIe-Ve siècles. À l’origine, sa langue était le latin. Son texte actuel, formé au plus tôt aux VIe-VIIe siècles en Occident, demeura tout à fait inconnu à l’Orient orthodoxe quoiqu’il ait été traduit en grec ultérieurement. Il a toujours été un symbole local, particulier, surtout baptismal et jamais les représentants de l’Occident n’avaient tenté de le citer ou de s’y référer au cours des conciles œcuméniques. Ce fut au pseudo-concile de Ferrare-Florence (en 1439-1440) que pour la première fois les Latins tentèrent de s’appuyer sur ce texte pour esquiver la question du Filioque. (Comme on le sait, l’article concernant l’Esprit Saint dans le Symbole des apôtres se borne aux paroles. Credo in Spiritum Sanctum, sans rien dire sur sa procession). Ils se heurtèrent à la résistance de saint Marc d’Éphèse qui déclara que ce symbole était inconnu de l’Église. En ce qui concerne le symbole dit de saint Athanase, connu également par les premières paroles de son texte original latin. Quicumque vult , le lieu et le moment de son apparition sont, sans doute, toujours discutés par les historiens de l’Église ; cependant il ne saurait certainement être question de son appartenance à saint Athanase. Tout est contre une telle attribution. le texte latin original, le fait que ce symbole était inconnu en Orient, que sa terminologie n’est pas athanasienne, que l’expression classique d’Athanase ὁμοούσιος ne s’y trouve pas, que sa christologie est plus tardive, qu’il n’y a aucune référence à ce symbole dans les œuvres d’Athanase et, enfin, le fait que lui-même était un adversaire résolu de la composition de tout symbole autre que celui de Nicée. Il ne se serait pas contredit lui-même en composant son propre symbole. Ce qu’il y a de plus probable, c’est que le symbole pseudo-athanasien a été composé en latin aux VIe-VIIe siècles, en Gaule méridionale ; son texte définitif ne fut établi que vers le IXe siècle. L’enseignement sur la Sainte Trinité y est exposé dans l’esprit de saint Augustin avec le primat de la nature sur les hypostases qui lui est propre. le « commencement » n’y est pas le Père, comme dans le Symbole de Nicée et les autres symboles anciens, selon la théologie de tous les Pères grecs, mais le Dieu un dans la Trinité, la « monarchie » du Père, source et cause unique, y étant manifestement diminuée. Toute cette théologie typiquement augustinienne donna naissance au Filioque pour aboutir ensuite chez Thomas d’Aquin à l’identification entre l’essence et l’énergie dans la divinité. En effet, le texte latin du symbole pseudo-athanasien qui existe actuellement contient l’enseignement sur la procession de l’Esprit Saint du Père et du Fils, quoique sans employer l’expression Filioque. « Spiritus Sanctus a Patre et Filio… procedens. » Ce Symbole, mentionné pour la première fois en Occident en 660 au concile d’Autun, finit par y être d’un emploi général vers le IXe siècle. Il demeura toutefois complètement inconnu à l’Orient orthodoxe. Pour la première fois, on l’y rencontre aux IXe-XIe siècles, lorsque les Latins s’appuyèrent sur ce texte dans leurs discussions avec les Grecs orthodoxes au sujet du Filioque. Ceci eut lieu dans la discussion bien connue entre les moines grecs et les bénédictins latins à propos du Filioque au mont des Oliviers, en 807-808, et à Constantinople, en 1054, au temps du cardinal Humbert. Ce furent aussi les Latins qui traduisirent au XIIIe siècle le Symbole pseudo-athanasien en langue grecque, à des fins polémiques. D’autres traductions grecques apparurent d’ailleurs peu après, faites par des orthodoxes, d’où les mots et Filio étaient exclus.
Ainsi « corrigé », ce symbole connut une certaine diffusion et autorité dans la théologie orthodoxe. Sa traduction slavonne (sans et Filio, bien entendu !) fut même introduite, depuis l’époque de Syméon de Polotsk, dans le texte imprimé du psautier liturgique (Slédovannaya Psaltyr) et le texte grec, à la fin du XIXe siècle, dans l’Horologion (ὡρολόγιον) grec. Les toute dernières éditions de celui-ci ne le retiennent d’ailleurs plus. L’opinion suivante, exprimée par le métropolite Macaire, illustre l’importance qu’avait le symbole pseudo-athanasien dans la théologie russe du XIXe siècle. « Vers cette même époque, apparut un symbole appelé Symbole d’Athanase… Quoi qu’il n’ait pas été composé lors des conciles œcuméniques, il était adopté et respecté par toute l’Église . » Un peu plus loin il recommande, parallèlement au Symbole de Nicée-Constantinople et aux confessions de foi des conciles œcuméniques, le Symbole « connu sous le nom de saint Athanase d’Alexandrie, accepté et respecté par toute l’Église », comme un fondement sûr de la théologie. Cette affirmation est inexacte matériellement. l’Église orthodoxe catholique n’a jamais nulle part exprimé son jugement sur le symbole pseudo-athanasien, ni accepté celui-ci. Le professeur J. Karmiris exprime son attitude envers ce symbole, de même qu’envers celui qu’on appelle « des apôtres », avec plus de circonspection. Sans défendre leur authenticité, et tout en reconnaissant entièrement leur origine occidentale, il considère utile cependant de reconnaître officiellement les deux symboles, sinon à l’égal de celui de Nicée-Constantinople, du moins comme des documents dogmatiques anciens et vénérés, ne contenant rien de contradictoire à la foi orthodoxe (une fois le et Filio exclu, évidemment). Une telle reconnaissance de ces documents, ne serait-ce qu’en qualité de sources secondaires de la doctrine de la foi, aurait, selon le professeur Karmiris, une signification positive œcuménique à notre époque, précisément en raison de leur provenance occidentale .
Il est difficile, toutefois, d’accepter l’utilité et le bien-fondé d’une telle reconnaissance. En effet, le Symbole dit « des apôtres », sans contenir d’éléments contraires à la foi, est manifestement insuffisant pour être reconnu comme un symbole officiel de l’Église. Sa reconnaissance, même partielle, nuirait au caractère unique et immuable du Symbole de Nicée-Constantinople, seul fondement de tous pourparlers œcuméniques. L’Église ne rejette pas le symbole « des apôtres ». Ainsi que l’a bien dit saint Marc d’Éphèse, elle ne le connaît simplement pas. Il n’y a aucune raison de modifier cette attitude. Ceci d’autant plus que de nos jours également, il existe une tendance à l’utiliser pour esquiver la question du Filioque (parmi les anglicans surtout où le symbole « apostolique » jouit d’une assez grande popularité). Il serait encore plus erroné de conférer, par quelque acte ecclésial, une importance officielle et générale au symbole pseudo-athanasien. Il est vrai qu’en éliminant et Filio (qui peut-être d’ailleurs ne figurait pas dans le texte original), ainsi que l’ont fait ses traducteurs grecs et slaves, on n’y trouverait plus rien qui contredise directement la foi orthodoxe. Sa partie christologique exprime même bien, et avec exactitude, l’enseignement orthodoxe post-chalcédonien. Toutefois, sa triadologie est marquée de caractères augustiniens qui, par la suite, devaient donner naissance à une série d’erreurs. C’est pourquoi le symbole pseudo-athanasien ne saurait aucunement être proclamé comme un modèle et une source de l’enseignement orthodoxe, ne serait-ce que secondaire. Il est donc souhaitable que ce symbole ne soit plus inclus dans les livres liturgiques russes, où il fut introduit sans aucune décision ecclésiastique à l’époque où les influences latines étaient très importantes. Nous devrions suivre l’exemple de nos frères grecs qui ont cessé d’inclure ce texte dans leur Horologion.
III — Passons maintenant à la période qui suivit celle des sept conciles œcuméniques.
Il nous faut, avant tout, nous arrêter au concile convoqué à Constantinople en 879-880 pendant le pontificat du patriarche Photius et du pape Jean VIII. Tant par sa composition que par le caractère de ses décisions, ce concile porte tous les caractères d’un concile œcuménique. Les cinq patriarcats composant l’Église de cette époque y étaient représentés, y compris le patriarcat de Rome, de sorte que ce concile fut le dernier qui ait été commun à l’Église d’Orient et à celle d’Occident. Ses participants étaient au nombre de 383, c’était donc le plus grand concile après celui de Chalcédoine. Il fut convoqué en tant que concile œcuménique et, dans ses actes, s’intitule « grand et œcuménique concile ». Il ne fut pas, il est vrai, reconnu officiellement par l’Église comme œcuménique parce qu’une telle reconnaissance avait lieu généralement au concile suivant et qu’il n’y en eut plus ensuite. Toutefois, une série de personnalités ecclésiastiques l’appelèrent « huitième concile œcuménique ». Ce furent, par exemple, le célèbre canoniste du XIIe siècle, Théodore Balsamon, Nil de Thessalonique (XIVe siècle), Nil de Rhodes (XIVe siècle), Syméon de Thessalonique (XVe siècle), saint Marc d’Éphèse, Gennade Scholarios, Dosithée de Jérusalem (XVIIe siècle), etc. Ainsi que l’a montré le professeur Dvornik dans son œuvre fameuse Le Schisme de Photius et ainsi que cela est admis à présent par la science historique, même catholique-romaine, le concile de 879-880 fut considéré également en Occident jusqu’au XIIe siècle comme le huitième concile œcuménique. Il n’y eut jamais de rejet de ce concile par le pape Jean VIII, ni aucun « second schisme photien » (c’est-à-dire aucune rupture entre Photius et Jean VIII). Tout cela, ce sont des légendes inventées par les ennemis de Photius ; elles ne furent admises en Occident qu’au XIIe siècle lorsque, les prétentions des papes à une juridiction universelle croissant constamment, les canonistes romains se mirent à considérer comme huitième concile œcuménique, non celui de 879-880, mais le conciliabule anti-photien de 870. Les travaux du concile de 879-880 sont aussi revêtus d’un caractère œcuménique. Tout comme les conciles œcuméniques, il adopta une série de décisions de caractère dogmatico-canonique.
1) Il proclama immuable le texte du Credo sans le Filioque et jeta l’anathème sur tous ceux qui y apporteraient des modifications. « Ainsi, décide le concile, quiconque, arrivé au degré extrême de la folie, aura l’audace d’exposer un autre symbole […] qui ajoutera ou qui enlèvera quoi que ce soit au Symbole qui nous a été transmis par le saint concile œcuménique de Nicée […] qu’il soit anathème . » Cette décision est d’autant plus significative que le Filioque était, à cette époque, déjà introduit dans le Symbole à maints endroits en Occident, et qu’en Bulgarie les missionnaires latins insistaient sur son insertion. Les légats du pape ne firent aucune objection à cette décision du concile.
2) Ce concile reconnut le second concile de Nicée (anti-iconoclaste) de 786-787 comme VIIe Concile œcuménique.
3) Il établit les relations avec l’Église de Rome et reconnut la légitimité du patriarcat de Photius, condamnant ainsi indirectement l’intervention anti-canonique des papes Nicolas Ier et Hadrien II dans les affaires de l’Église de Constantinople.
4) Ce concile délimita le pouvoir des patriarcats de Rome et de Constantinople ; il rejeta les prétentions de l’évêque de Rome à un pouvoir juridictionnel en Orient, ne lui ayant pas reconnu le droit de recevoir dans sa juridiction ni d’acquitter par son propre pouvoir les clercs condamnés en Orient (de même que, vice-versa, l’Orient ne devait pas recevoir les clercs condamnés en Occident). Ce qui est particulièrement important, le concile interdit en même temps toute modification future de la situation canonique de l’évêque de Rome.
Telles sont les décisions dogmatico-canoniques du concile de Constantinople de 879-880. Comme texte symbolique de l’Église orthodoxe, l’importance des décisions prises à ce concile est incontestable. Il apparaît très désirable que le concile œcuménique à venir proclame le concile constantinopolitain de 879-880 qui formula ces décisions — VIIIe Concile œcuménique. En effet, il l’était par sa composition et comme ayant exprimé la foi que l’Église tout entière gardait depuis toujours concernant le Credo ainsi que les droits de l’évêque de Rome, en rapport avec les questions de l’addition du Filioque et des prétentions des papes à une juridiction universelle qui apparurent alors. De cette façon, les décisions de ce concile, en tant qu’œcuménique, seraient revêtues d’une autorité incontestable et générale et le concile œcuménique à venir pourrait être appelé le IXe. La décision de proclamer œcuménique le concile de 879-880, bien comprise, pourrait avoir une signification œcuménique positive et même servir de base au dialogue avec les catholiques romains. Notre unité avec Rome dans les conciles œcuméniques ne serait-elle pas ainsi prolongée d’une centaine d’années (le temps séparant les VIIe et VIIIe Conciles) et n’aurions-nous pas en commun avec l’Occident non plus sept, mais huit conciles œcuméniques ? Ceci à condition que Rome consente à reconnaître à nouveau le concile de 879-880 comme œcuménique, comme elle l’avait déjà fait jadis en la personne du pape Jean VIII. Espérons que la science historique catholique-romaine contemporaine l’aidera à le faire. Parmi les conciles locaux ultérieurs ayant proclamé des décisions dogmatiques, notons ceux de Constantinople convoqués pendant le règne de Manuel Comnène en 1156 et 1157. Ils étudièrent des questions eucharistiques et les divergences dans la compréhension des dernières paroles de la prière précédant immédiatement le Cherubikon. « C’est toi qui offres et qui es offert », en s’intéressant notamment à qui était offert le sacrifice eucharistique. à Dieu le Père ou à toute la Sainte Trinité ? Deux patriarches, Constantin IV de Constantinople et Nicolas de Jérusalem, participèrent au premier de ces conciles avec vingt-quatre évêques ; au second, ce furent également deux patriarches, Luc Chrysobergès de Constantinople et Jean de Jérusalem, les archevêques de Bulgarie et de Chypre et trente-cinq évêques. C’était le premier concile de l’Église orthodoxe à étudier spécialement la doctrine de l’Eucharistie (si l’on ne compte pas le concile in Trullo qui la mentionne dans ses canons 23, 32 et 101, de manière néanmoins indirecte et sous un aspect plutôt rituel). Il enseigne d’une façon très précise que l’Eucharistie est non seulement un souvenir de sacrifice mais aussi un sacrifice, et que ce sacrifice est le même que celui offert sur la croix. Comme il est dit dans les anathèmes conciliaires. « À ceux qui ne comprennent pas correctement le mot « souvenir » et qui osent dire qu’il renouvelle le sacrifice de son corps et de son sang en idée et en image […] et qui, par conséquent, introduisent l’idée qu’il s’agit d’un autre sacrifice que celui qui a été accompli dès le commencement […], anathème. »
La décision du concile approfondit et précise notre compréhension de l’œuvre rédemptrice du Dieu-Homme Jésus Christ et son rapport avec les Personnes de la Sainte Trinité. Il est très important que la théologie du concile, fidèle à celle des Pères, mais ne craignant pas d’éclaircir des questions nouvelles, s’appuie aussi dans ses décisions sur des textes liturgiques ; elle affirme par là leur importance en tant que sources de la théologie ecclésiale. Le fait que ces décisions furent introduites dans les anathèmes et les proclamations de « mémoire éternelle » du dimanche de l’orthodoxie montre que l’Église a adopté les définitions dogmatiques de ce concile. Ces anathématisations étaient proclamées dans l’Église russe jusqu’en 1766, lorsque l’ancien « rite de l’orthodoxie » fut remplacé par un autre qui ne mentionnait plus le nom des différents hérétiques et hérésies, mais les remplaçait par d’autres anathèmes d’un caractère plus général. Dans l’Église grecque, ces anathèmes continuent d’être prononcés jusqu’à nos jours, ainsi que cela apparaît dans le texte du Triode grec. Néanmoins, la conscience de la grande importance des décisions dogmatiques des conciles de 1156-1157 s’est à peu près perdue dans notre théologie scolaire. les recueils des textes symboliques de l’Église orthodoxe les omettent ou ne les mentionnent qu’ « en passant ». Ceci s’explique en partie par le fait que les auteurs de ces recueils s’intéressent surtout aux textes dirigés contre les confessions occidentales. le catholicisme-romain et le protestantisme ; or, les décisions du concile de 1156-1157 sont dirigées contre des erreurs apparues au sein de l’Église byzantine, quoique non sans une certaine influence occidentale, peut-on croire. On ne peut toutefois considérer comme correcte cette attitude limitative envers les textes symboliques. Des décisions ecclésiastiques adoptées contre des erreurs « internes » peuvent avoir une importance non moindre et parfois plus grande que des décisions concernant les confessions occidentales. C’est pour cela que les décisions dogmatiques des conciles de 1156 et 1157 doivent avoir la place qu’elles méritent parmi les textes symboliques de l’Église orthodoxe, étant une expression authentique de sa foi et de son enseignement dans les questions eucharistiques.
On peut en dire autant et même plus concernant les conciles dits « hésychastes » qui eurent lieu à Constantinople en 1341, 1347 et 1351. Du point de vue formel, ces conciles (même le plus grand d’entre eux, celui de 1351) n’étaient pas œcuméniques. En fait, l’épiscopat de l’Église de Constantinople était presque seul à y être représenté ; ils comptaient en tout de vingt à cinquante évêques à en juger par le nombre des signatures sous les Actes conciliaires, certaines de ces signatures ayant même été ajoutées plus tard par les évêques locaux dans leur diocèse. Le patriarche de Jérusalem, Lazare, était, il est vrai, présent au concile de 1347; le représentant du patriarche d’Antioche, Ignace, et le métropolite Arsène de Tyr, au concile de 1351. Cependant il vaut mieux ne pas parler de ce dernier. il eut une conduite honteuse, se rangea du côté des adversaires de saint Grégoire Palamas et quitta le concile avant sa fin. Il fit même une déclaration écrite, contestant le droit du patriarcat de Constantinople de décider de questions dogmatiques seul, sans les autres patriarcats. Malgré cela, le patriarche Ignace d’Antioche signa bientôt les Actes de ce concile , de même que le patriarche de Jérusalem, Lazare. Les Églises de Bulgarie et de Serbie, déjà indépendantes à cette époque, ne participèrent pas à ces conciles. Mais, dès 1360, le concile de Trnovo de l’Église bulgare confirmait les décisions du concile constantinopolitain de 1351; le métropolite de Moscou, saint Alexis, en fit de même lorsqu’il fut confirmé dans sa qualité de métropolite à Constantinople en 1354. Le concile de 1351 finit bientôt par acquérir une telle autorité que le célèbre écrivain et canoniste du XIVe siècle, Nil, métropolite de Rhodes, alla jusqu’à l’appeler « IXe Concile œcuménique » dans son ouvrage Histoire brève des conciles œcuméniques (le VIIIe, pour lui, était celui de 879-880, comme nous l’avons vu). Du point de vue formel, il est difficile de partager son avis, puisque l’Église orthodoxe n’y fut pas représentée dans sa plénitude. Néanmoins, en substance, étant donné le caractère des décisions dogmatiques qui y furent prises, les conciles constantinopolitains du XIVe siècle, surtout celui de 1351, comptent parmi les plus importants dans l’Église orthodoxe ; ils ne le cèdent en importance qu’aux anciens conciles œcuméniques. Fidèles à la tradition orthodoxe, marchant dans les traces des Pères et étant en même temps à la hauteur de la théologie patristique, ils continuèrent, précisèrent sur de nombreux points et formulèrent, pour la première fois, conciliairement bien des aspects de l’enseignement théologique de l’Église, surtout dans les questions concernant la vie spirituelle, la grâce et la déification de l’homme. Ils donnèrent un fondement théologique à la possibilité de la participation de l’homme à la divinité, à son union à elle, sans aucunement tomber dans une confusion panthéiste du créateur et de la créature. (C’est le sens de leur doctrine sur la grâce incréée et sur le caractère incompréhensible et inaccessible de la nature divine.) Du point de vue théologique, le concile de 1351 est une continuation, par son enseignement sur les actions et les énergies divines, du VIe Concile œcuménique. C’est sur l’enseignement de celui-ci concernant les deux actions ou énergies du Christ, humaine et divine, créée et incréée, enseignement formulé dans les actes du VIe Concile , que le concile de 1351 fonde son enseignement sur le caractère incréé des énergies divines. La distinction « qui sied à Dieu » entre la nature et l’énergie divine ; la simplicité de Dieu qui demeure inviolée par cette distinction incompréhensible ; le nom de « divinité » appliqué également à l’énergie ; la doctrine sur Dieu comme source de ses actes et, dans ce sens, supérieur à ses énergies ; la participation à Dieu selon l’énergie, mais non selon l’essence. telles sont les thèses principales adoptées par le concile de 1351. Il convient d’ajouter que le concile de 1341 a donné une approbation et la reconnaissance ecclésiastique à la « Prière de Jésus » en tant qu’exprimant l’esprit authentique de la piété orthodoxe non pour les seuls moines, mais pour tous les chrétiens .
Parmi les documents approuvés par le concile de 1351, il faut mentionner tout particulièrement la Confession de foi de saint Grégoire Palamas qui exprime, sous une forme concise et parfaite, l’enseignement ecclésial sur toutes les questions théologiques fondamentales, tant anciennes (y compris celle de la procession du Saint Esprit) que celles qui étaient pour la première fois abordées au concile. La triadologie orthodoxe y est exprimée avec beaucoup de vigueur et d’une façon toute traditionnelle du point de vue biblique et patristique. En comparant cette profession de foi de saint Grégoire Palamas au Symbole pseudo-athanasien, la supériorité du premier document frappe toute conscience orthodoxe. Il convient d’ajouter aux textes théologiques de cette période le célèbre Tome hagioritique de 1339 composé par saint Grégoire Palamas et signé par les anciens et les higoumènes du mont Athos (parmi ces signatures, il y a des signatures serbes, géorgiennes et syriennes). À strictement parler, ce document ne peut être considéré comme un acte conciliaire, puisque aucun de ses signataires, sauf l’évêque de la petite ville de Hiérissos proche du mont Athos, n’était revêtu de la dignité épiscopale. Au moins trois d’entre eux, il est vrai, l’obtinrent par la suite. saint Grégoire Palamas, archevêque de Thessalonique, Calliste et Philothée, futurs patriarches de Constantinople. Mais quoi qu’il en soit, le concile de 1347 approuva le contenu du Tome hagioritique qui devint une source importante des décisions conciliaires qui suivirent ; ainsi ce document acquit la valeur d’un texte symbolique important. Les anathèmes et les proclamations de « mémoire éternelle » introduits dans le Triode par le patriarche Calliste en 1352 (c’est-à-dire un an après le concile) ont certainement aussi une importance dogmatique. On y formula sous une forme brève les thèses théologiques fondamentales des décisions des conciles « hésychastes » du XIVe siècle. Cela signifiait une reconnaissance liturgique par l’Église de ces conciles et leur conférait une haute autorité dogmatique. Malgré tout cela, ces décisions théologiques conciliaires, sans avoir, certes, été jamais reniées par l’Église orthodoxe (en dépit des insinuations de certains polémistes catholiques-romains), ont été en fait presque oubliées dans la théologie scolaire des siècles qui suivirent (XVIe-XVIIe, et en particulier au cours du XIXe siècle). Celle-ci tomba sous l’influence de la scholastique latine ou des idées protestantes et traversa une période de décadence. Si on s’intéressait tout de même aux « querelles hésychastes » et aux conciles du XIVe siècle, ce n’était pas pour leur essence, leur contenu théologique, mais surtout en tant qu’épisode de la lutte contre les Latins avec leurs tentatives de s’immiscer dans les affaires de l’Église byzantine. Cette attitude envers les « querelles hésychastes » est particulièrement propre aux théologiens grecs. Même le professeur Karmiris, qui a droit à notre reconnaissance puisqu’il a été le premier à insérer les actes des conciles de 1341-1351 dans son recueil de textes symboliques de l’Église orthodoxe, croit utile d’expliquer cette insertion non par leur portée essentielle, mais par le fait qu’ « indirectement ils sont dirigés contre l’Église latine ». Une telle attitude est certainement unilatérale et insuffisante. Il est certain qu’en définitive la doctrine de saint Grégoire Palamas sur la distinction entre l’essence et les énergies en Dieu est incompatible avec le système de Thomas d’Aquin qui identifie essence et action divines et considère la grâce non comme une énergie incréée de Dieu, mais comme un don créé. Puisque le système théologique et philosophique thomiste était, jusqu’à ces derniers temps au moins, élevé dans l’Église catholique-romaine presque à la dignité de dogme, les décisions conciliaires du XIVe siècle peuvent être considérées comme ayant un caractère anti-romain. Toutefois, elles n’étaient pas dirigées directement contre les Latins ; sauf en ce qui concerne la procession de l’Esprit Saint dans la Confession de saint Grégoire Palamas, elles ne touchaient pas aux questions litigieuses entre les Églises orthodoxe et catholique-romaine. Les discussions théologiques du XIVe siècle furent le résultat d’un choc entre divers courants au sein même de l’Église byzantine. Ce n’est qu’au cours de la seconde période des discussions que les adversaires de saint Grégoire Palamas utilisèrent des arguments provenant de l’arsenal philosophique du thomisme qui, vers cette époque, commençait à être connu à Byzance. Les décisions des conciles de 1341-1351 peuvent donc être considérées comme un fruit naturel du développement théologique de l’Église orthodoxe elle-même, et non comme le résultat de sa rencontre avec le monde hétérodoxe et ses problèmes étrangers à l’orthodoxie, comme ce fut le cas pour les Confessions du XVIIe siècle, notamment celles de Pierre (Moghila) et de Dosithée. Toutefois, étant donné que la théologie de saint Grégoire Palamas était provisoirement tombée dans l’oubli dans l’Église orthodoxe et qu’elle n’a commencé à éveiller l’intérêt qu’au XXe siècle, il est indispensable de définir, par un acte officiel du concile œcuménique à venir, l’attitude de l’Église dans son ensemble envers les décisions des conciles du XIVe siècle ; il faut confirmer leur importance et les reconnaître comme égales ou semblables aux décisions dogmatiques des conciles œcuméniques anciens.
Un autre texte symbolique important de la période byzantine tardive est la profession de foi de saint Marc d’Éphèse au pseudo-concile de Ferrare-Florence de 1439-1440. Saint Marc développa plus en détail son contenu dans son encyclique à tous les chrétiens orthodoxes qu’il écrivit après le concile, dans l’île de Lemnos en 1440-1441. L’Église orthodoxe catholique rejette, certes, avec raison, le concile de Ferrare-Florence et le compte au nombre des pseudo-conciles. Mais elle vénère profondément les paroles dignes d’un confesseur qu’y prononça saint Marc d’Éphèse et y voit une expression de sa foi et de sa doctrine, revêtue de son autorité. C’est l’orthodoxie elle-même qui parla par la bouche de saint Marc à Florence. D’ailleurs, par son contenu, cette profession de foi exprime, sous une forme brève, mais combien éclatante et précise, les croyances fondamentales de notre Église, surtout dans les questions qui nous séparent de Rome (la procession du Saint Esprit, le primat du pape, etc.).
Le tout sans polémique superflue, de sorte qu’un exposé positif des vérités de la foi occupe nettement la première place. Voici pourquoi donc, cette confession de foi doit être également comptée au nombre des textes symboliques fondamentaux de l’Église orthodoxe…
* Publié dans le Messager de l’exarchat du patriarche russe en Europe occidentale, n° 48 (1964), p. 197-217; n° 49 (1965), p. 10-23; n° 50 (1965), p. 71-82.
- Un exemple caractéristique. l’article du professeur P. P. PONOMAREV et de V. A. KÉRENSKY, « Les livres symboliques en général et, plus particulièrement, ceux de l’Église orthodoxe » (en russe) dans l’Encyclopédie théologique, Saint-Pétersbourg, 1911, t. XII, col. 1-107.
- Il étudie la question des influences hétérodoxes dans les Confessions du XVIIe siècle dans son ouvrage. Ἑτερόδοξοι ἐπιδράσεις ἐπὶ τὰς ὁμολογίας τοῦ ΙΖ’ αἰῶνος [Influences hétérodoxes sur les confessions du XVIIe siècle], paru dans la revue Νέα Σιὼν, n° 29 (1947), p. 40-49, 68-83, 175-186, 235-242; n° 30 (1948), p. 45-50, 111-120, 167-174, 226-231, 280-288; n° 31 (1949), p. 33-40; n° 32 (1950), p. 1-10.
- J. KARMIRIS, Τὰ Δογματικὰ καὶ Συμβολικὰ μνημεῖα τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας [Monuments dogmatiques et symboliques de l’Église orthodoxe catholique], Athènes, t. I, 1952 (19612) ; t. II, 1953. Voir la recension de cet ouvrage par le professeur archiprêtre Georges FLOROVSKY dans Saint-Vladimir’s Seminary Quarterly, n°1 (1953), p. 59-61.
- Cette opinion a été formulée par le théologien orthodoxe grec N. NISSIOTIS dans son article « Ιs the Vatican Council Really Ecumenical ? », paru dans The Ecumenical Review, n° 18 (1964), p. 378-394.
- Un tel enseignement sur le « développement des dogmes » fut, pour la première fois, exposé par le Cardinal J. H. NEWMAN (1801-1890) dans son traité Essay on the Development of Christian Doctrine paru en 1845 (18782), aussitôt après sa conversion de l’anglicanisme au catholicisme romain. Newman voulait, par sa théorie du développement dogmatique, expliquer comment certains dogmes catholiques romains inconnus de l’Église ancienne étaient devenus acceptables pour lui. La doctrine du « développement des dogmes » fut adoptée depuis par la théologie catholique romaine dans son ensemble, théologie qui était jusqu’alors restée fidèle, du moins en théorie, au principe de saint Vincent de Lérins selon lequel l’Église acceptait « quod semper, quod ubique, quod ab omnibus creditum est ». Ainsi que l’a remarqué avec justesse M. Henry Chadwick, théologien anglican contemporain bien connu, la doctrine du « développement des dogmes » a littéralement tiré la théologie catholique romaine de l’impasse où l’avait entraînée au XIXe siècle le conflit entre la science historique de l’Église et son système dogmatique dans les questions telles que la primauté romaine, l’infaillibilité du pape, etc. Il n’était plus nécessaire de prouver l’existence de ces croyances dans l’Église dès le début ; il suffisait désormais d’affirmer qu’il y avait à leur sujet des « allusions » dont l’Église prit ultérieurement conscience et qu’elle explicita dans le processus du « développement dogmatique ». Le point de vue orthodoxe sur cette doctrine est bien présenté dans l’article de l’archimandrite PIERRE (L’HUILLIER), « La conception orthodoxe du dogme », dans le Messager de l’exarchat du patriarche russe en Europe occidentale, n° 20 (1954), p. 238-245.
- « Cela ne veut pas dire toutefois, écrit-il après avoir rejeté la doctrine romaine sur le développement des dogmes, qu’après la fin des conciles œcuméniques l’explicitation des dogmes s’est terminée dans l’Église orthodoxe. Elle ne s’est pas terminée parce que ne se sont pas terminées non plus les erreurs et les hérésies » (Métropolite MACAIRE (BOULGAKOV), Théologie dogmatique orthodoxe [en russe]), Saint-Pétersbourg, 18683, t. I, p. 18).
- HIPPOLYTUS, De benedictione Jacobi, 1, TU 381 (1911), p. 13, 7; ORIGÈNE, Selecta in Dt 22, 23 (PG 13, col. 813 C). Voir également le mot « Θεοτόκος » dans G. W. H. LAMPE (éd.), A Patristic Greek Lexicon, Oxford, Clarendon Press, 1964, fascicule 3.
- Voir plus particulièrement sa Catéchèse 29 (SYMÉON LE NOUVEAU THÉOLOGIEN, Catéchèses, t. III, Paris, Éd. du Cerf, coll. « Sources chrétiennes », n° 113, 1965, p. 165-192).
- Le professeur Oscar Cullmann représente ces idées d’une façon quelque peu inattendue dans la théologie protestante contemporaine. Il considère qu’à partir du moment où l’Église avait fixé le canon des livres du Nouveau Testament, elle avait perdu la faculté de déterminer et de commenter le contenu de la tradition sacrée, qu’elle avait, autrement dit, commis une sorte de « suicide spirituel ». Voir O. CULLMANN, La Tradition. Problème exégétique, historique et théologique, coll. « Cahiers théologiques », n° 33, Neuchâtel et Paris, Éd. Delachaux, 1953. Voir également Y. CONGAR, La Tradition et les traditions, t. I. Essai historique, Paris, Fayard, 1960, p. 53-57.
- C’est cela sans doute qui explique le fait que, dans les collèges et les facultés de théologie anglicans, l’enseignement de l’histoire ecclésiastique s’interrompt après le concile de Chalcédoine. Ce qui suit est « évidemment » une période de décadence dont il ne vaut pas la peine de parler aux étudiants. L’histoire ecclésiastique est reprise par la période de la Réforme lorsque l’Église connut ce que l’anglicanisme considère comme une « renaissance ».
- Un exemple caractéristique de pareille comparaison entre quatre conciles et quatre Évangiles se trouve dans la vie des saints Théodose et Sabbas de Palestine. Cyrille de Scythopolis relate l’épisode suivant dans sa vie de saint Sabbas (la meilleure édition est celle d’Eduard Schwarz, Kyrillos von Skythopolis, TU 49 [1939], 2) en opposition à l’empereur Anastase, enclin au monophysisme, qui essayait de forcer l’Église de Jérusalem de renier le concile de Chalcédoine. Le patriarche Jean convoqua à Jérusalem à la fin de l’année 516 une « réunion de protestation » ; près de dix mille moines avec à leur tête saints Théodose et Sabbas, vinrent à cette réunion de tous les coins de la Palestine. Le patriarche Jean avec les saints Théodose et Sabbas s’adressèrent à l’assistance en l’exhortant à la fidélité au concile de Chalcédoine. Après cela, saint Théodose s’écria. « Celui qui n’accepte pas quatre conciles, de même que quatre Évangiles, qu’il soit anathème » (loc. cit., p. 152, 4-5). On peut rencontrer la même comparaison des quatre conciles aux quatre Évangiles dans la lettre adressée par les moines palestiniens à l’empereur Anastase au début de l’année 517. Ils écrivent que « tous les habitants de cette Terre Sainte vénèrent les quatre saints conciles honorés par le caractère évangélique [εὐαγγελικῷ χαρακτῆρι τετιμημένας] » (ibid., p. 155, 18-19). Ils poursuivent en expliquant que ces quatre conciles « ne se distinguent entre eux que par des paroles et non par leur puissance, parce qu’ils sont une image des Évangiles divinement inspirés » (ibid., p. 155, 22-24).
- Voir « L’autorité et l’infaillibilité des conciles œcuméniques », p. XX-XX (NdR).
- « Office du Synodikon » (dimanche de l’orthodoxie), Grand Euchologe et Arkhiératikon, Parme, Éd. Diaconie apostolique, 1992, p. 732 (NdR).
- PG 10, col. 983-988.
- Métropolite MACAIRE (BOULGAKOV), Théologie dogmatique orthodoxe, op. cit., p. 20.
- Le texte. KARMIRIS, op. cit., t. I, p. 46-47; DENZINGER, Symboles et Définitions de la foi catholique, Paris, Éd. du Cerf, 1996, § 10-30, p. 5-13.
- Voir J. QUASTEN, Initiation aux Pères de l’Église, vol. 1, Paris, Éd. du Cerf, 1955, p. 29-36; J. N. D. KELLY, Early Christian Creeds, Londres, 1963, p. 368-434; J. KARMIRIS, op. cit., p. 34-46.
- Sylvestre SYROPOULOS, Vera historia unionis non verae inter Graecos et Latinos, La Haye, Éd. Creyghton, 1660, p. 150; J. KARMIRIS, op. cit., p. 50; Métropolite MACAIRE (BOULGAKOV), op. cit., p. 15, n. 29.
- Texte (latin et grec) dans J. KARMIRIS, op. cit., p. 101-102; DENZINGER, loc. cit., § 46-47, p. 17.
- S’y réfèrent, par exemple, la Confession orthodoxe de Pierre (Moghila) (1, 10, 17) ; la Confession de Mitrophane Critopoulos (1) ; le concile de Constantinople de 1722, etc.
- Métropolite MACAIRE (BOULGAKOV), op. cit., p. 17.
- Ibid., p. 21.
- J. KARMIRIS, op. cit., p. 95-101.
- Sur ce concile, voir. J. KARMIRIS, op. cit., p. 261-267, qui donne également les décisions du concile.
- « Ὅρος τῆς μεγάλης καὶ οἰκουμενικῆς συνόδου », MANSI (CC 17, p. 516-517) ; J. KARMIRIS, op. cit., p. 268.
- Francis DVORNIK, Le Schisme de Photius. Histoire et légende, Paris, Éd. du Cerf, coll. « Unam Sanctam », n° 19, 1950.
- Ibid., p. 385-422.
- J. KARMIRIS, op. cit., p. 264.
- Sur ce concile, voir l’article du hiéromoine PAUL (TCHÉRÉMOUKHINE), « Le Concile constantinopolitain de 1157 et Nicolas, évêque de Méthone » (en russe), dans Bogoslovskie Trudy, n° 1, Moscou, 1959, p. 87-109.
- Voir Triode de carême, Parme, Éd. Diaconie apostolique, 19933, p. 173.
- Ainsi J. Karmiris omet de mentionner ce concile et ses décisions dans son édition des monuments symboliques ; il ne le mentionne que dans une note en parlant de l’édition du Synodikon du dimanche de l’orthodoxie (loc. cit., p. 414, n. 2).
- Les textes de leurs décisions dans J. KARMIRIS, op. cit., p. 354-416.
- Pour les détails concernant ces conciles, voir J. KARMIRIS, op. cit., p. 348-354 et J. MEYENDORFF, Introduction à l’étude de Grégoire Palamas, Paris, Éd. du Seuil, 1959, p. 77-94, p. 129-130 et p. 141-153.
- J. MEYENDORFF, op. cit., p. 146.
- Ibid., p. 151-152.
- Voir Métropolite NIL DE RHODES, Διήγησις συνοπτικὴ περὶ τῶν ἁγίων καὶ οἰκουμενικῶν συνόδον. Σύνταγμα τῶν θείων καὶ ἱερῶν κανόνων [Histoire brève des saints conciles œcuméniques. Ensemble des saints canons sacrés], Athènes, 1852, p. 389-395. Également. MANSI 25, p. 1148-1149.
- « Nous croyons en vérité que lui-même [Jésus Christ], étant un, possède deux énergies (ἐνεργείας) naturelles, divine et humaine, incréée et créée, en tant que Dieu véritable et parfait et homme véritable et parfait », dans J. KARMIRIS, op. cit., p. 382. Dans sa doctrine sur l’ « énergie » divine du Christ, le VIe Concile œcuménique suivait saint Maxime le Confesseur qui écrivait, dans sa polémique contre les monothélètes. « Il est impossible qu’une seule et même énergie soit simultanément divine et humaine, incréée et créée » (MAXIME LE CONFESSEUR, Opuscula théologica, PG 91, col. 117 A).
- Le concile de 1341 condamne Barlaam pour ses attaques « contre la prière habituelle des moines, ou plus exactement de tous les chrétiens. « Seigneur Jésus Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi » » (voir J. KARMIRIS, op. cit., p. 362; PG 150, col. 688 D). Ailleurs, ce même concile s’exprime ainsi. « Bienheureux celui qui, méditant constamment ce Nom glorieux, a Dieu qui habite en lui » (ibid., p. 365; PG 150, col. 691 B). Sont également condamnés les écrits de Barlaam « contre les moines et leur prière par laquelle ils méditent et qu’ils récitent souvent » (ibid., p. 365; PG 150, col. 691 D). Quant au concile de 1347, il confirme que « la piété de Palamas et des moines » est « infaillible et commune en vérité à tous les chrétiens » (ibid., p. 368).
- Voici ce qu’écrit à son sujet le métropolite Macaire (Boulgakov). « Nous ne pouvons passer sous silence ici quelques brefs essais apparus […] dans l’Église orthodoxe de faire un exposé général des dogmes » (op. cit., p. 51). Il mentionne plus loin la Confession de saint Grégoire Palamas (le métropolite Macaire ne l’appelle jamais « saint » !). Texte grec dans. PG 151, col. 763-768, trad. fr.. « Profession de la foi orthodoxe exposée par le saint métropolite de Thessalonique Grégoire Palamas », Messager de l’exarchat du patriarche russe en Europe occidentale, n°81-82, 1973, p. 3-7. Voir KARMIRIS, op. cit., p. 407-410. Voir H. SCHAEDER, « Das Glaubensbekenntnis des Gregor Palamas. Seine theologische und kirchenpolitische Bedeutung » dans Θεολογία, 27(1956), p. 283-294.
- PG 150, col. 1225-1236.
- Et non Philothée, comme l’affirmait par erreur Mercati ; voir J. MEYENDORFF, op. cit., p. 350-351.
- Voir les Actes du concile dans J. KARMIRIS, op. cit., p. 371.
- À titre d’exemple, on peut indiquer l’ouvrage bien connu de Grégoire PAPAMICHAÏL, Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, Ἀρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης [Saint Grégoire Palamas, archevêque de Thessalonique], Alexandrie, 1911, entièrement écrit de ce point de vue. Le professeur Papamichaïl, ainsi qu’il le dit lui-même, n’a pas l’intention d’approfondir l’aspect dogmatique des « querelles hésychastes » ; il se borne à une description historique des événements.
- J. KARMIRIS, op. cit., p. 26 et 30.
- Ce sont surtout les polémistes catholiques-romains de la vieille école, Jugie et Guichardon, qui s’efforçaient de prouver l’incompatibilité de la doctrine de saint Grégoire Palamas avec le thomisme et, par là, son « hérésie » manifeste. Ce sujet est traité en détail dans mon étude. « La doctrine ascétique et théologique de saint Grégoire Palamas », p. XX-XX.
- PG 160, col. 16-204; J. KARMIRIS, op. cit., p. 422-425.
- Patrologia Orientalis 17, col. 449-459; J. KARMIRIS, op. cit., p. 421-429.
Suite « Dieu, l’homme, l’Église » Lecture des Pères Par Basile Krivochéine Les Éditions du « CERF » Paru en. Décembre 2010, 302 pages

L’Église orthodoxe catholique ne se considère pas seulement comme l’Église d’Orient ni ne croit être une simple partie de l’Église catholique. Elle se proclame l’Église une, sainte, catholique et apostolique du Credo dans toute sa plénitude et unicité. Mais du point de vue historique, après la séparation de divers groupes nationaux orientaux (non grecs dans leur majorité) du corps de l’Église en raison des dissensions christologiques (aux V-VIe s.) et surtout après la rupture avec l’Occident à la suite des différences doctrinales sur la procession du Saint Esprit (Filioque) et des prétentions toujours croissantes de Rome à la primauté et l’infaillibilité (autour du XIe s.), l’Église orthodoxe a été pratiquement limitée à l’Orient chrétien ou, plus exactement, au monde byzantin avec sa tradition et sa culture chrétiennes surtout hellénistiques. L’extension de l’orthodoxie par la suite parmi les peuples slaves, malgré son importance historique, ne changea pas essentiellement cette situation culturelle. Il est donc naturel que cet arrière-fond hellénistique donna, du moins extérieurement, sa forme à la vie spirituelle de l’Église orthodoxe, en sorte qu’on peut parler, avec une certaine exactitude historique, de spiritualité chrétienne orientale, voire byzantine, en tant qu’expression de la vie religieuse de l’Église orthodoxe catholique. Cette spiritualité se développa et prit forme surtout au cours de la période dite patristique ; ce modèle patristique grec de spiritualité se maintient dans l’Église orthodoxe jusqu’à nos jours, dans toute la vitalité et tout le dynamisme d’une tradition vivante, tout comme, dans le domaine de la théologie dogmatique, s’y maintient la tradition des Pères anciens de l’Église (1).
Dans le courant traditionnel de la spiritualité orthodoxe (passée et présente), nous pouvons discerner deux aspects distincts, voire deux pôles de piété ecclésiale. L’un d’eux peut être caractérisé comme sacramentel et liturgique, l’autre comme mystique et dévotionnel. Tous les deux ont une place importante dans la spiritualité orthodoxe ; ignorer ou minimiser l’un ou l’autre aboutirait à une image historiquement inexacte et faussée de la vie religieuse des chrétiens d’Orient. Il se peut qu’il y ait parfois une certaine tension entre les deux attitudes spirituelles, mais il n’y a jamais de contradiction ou d’exclusion. L’attitude sacramentelle et liturgique est naturellement plus corporative, l’attitude mystique et dévotionnelle plus individuelle. Cette dernière, toutefois, a également sa place dans le corps de l’Église dans son ensemble et présuppose la réalité de la vie liturgique et sacramentelle. On peut dire, même, que l’attitude mystique et dévotionnelle consiste surtout dans une appropriation ou acquisition personnelle, un approfondissement conscient et une expérience de la grâce divine reçue dans les sacrements.
Ce sont les sacrements qui constituent la source et la base de la vie religieuse d’un chrétien orthodoxe (2). Ce sont les sacrements du baptême, de la chrismation et de l’eucharistie qui sont particulièrement importants ; ils peuvent être considérés, dans leur ensemble, comme un mystère unique et trine de l’initiation chrétienne, ainsi que le souligne le plus grand théologien sacramentaire de l’Église orthodoxe, Nicolas Cabasilas (XIVe s.). « Le baptême est une naissance ; la chrismation a en nous valeur d’activité et de mouvement [spirituels] ; le pain de vie et le breuvage de l’eucharistie sont une vraie nourriture et une vraie boisson (3). » Et il ajoute. « Être baptisé, c’est donc naître selon le Christ ; c’est, pour des gens qui ne sont pas, recevoir d’être et de subsister (4). »
En tant que début d’une vie nouvelle, le baptême est aussi appelé « illumination » et, en tant que purification du péché, c’est un bain. Il est toutefois, essentiellement, notre mort avec le Christ et notre résurrection à une vie nouvelle avec lui. Symboliquement, cela s’accomplit, au cours du baptême, par notre immersion dans l’eau et une remontée des profondeurs, comme le sacrement est toujours célébré dans l’Église orthodoxe catholique. Et c’est précisément parce que l’Église orthodoxe croit que le baptême est une mort réelle et une réelle résurrection avec le Christ que son symbolisme sacramentel exprime une réalité spirituelle ; c’est à cause de cette réalité spirituelle qu’elle ne peut accepter un autre rite baptismal qui ne serait pas basé sur cette représentation de la remontée de l’eau baptismale.
La chrismation ou l’onction suit immédiatement le baptême et ne doit pas être confondue avec la confirmation, telle qu’elle existe à présent en Occident (séparée du baptême par un long laps de temps). La chrismation n’est pas une confirmation du baptême ; elle est son complément qui donne au chrétien nouveau-né le sceau de l’Esprit et la faculté d’une croissance spirituelle. C’est pourquoi ce sacrement doit être suivi par la sainte communion — participation au mystère du corps et du sang divins — qui, seule, fait de nous de vrais chrétiens et membres du corps de l’Église. C’est pourquoi la communion de petits enfants (très vite après leur baptême et leur chrismation) est un des traits les plus caractéristiques de la vie religieuse orthodoxe. L’Église orthodoxe peut admettre que le baptême soit remis, dans certaines circonstances, jusqu’à l’âge adulte (ce qui arrivait souvent dans l’Église ancienne), mais il lui apparaît comme parfaitement incompréhensible que des enfants baptisés soient privés, pendant de longues années, de la participation à la divine eucharistie qui est la vie éternelle et le Christ lui-même présent dans son corps véritable et son sang précieux. « Laissez les petits enfants venir à moi et ne le leur interdisez pas » (Mc 10, 14), dit notre Seigneur et l’Église orthodoxe obéit fidèlement à ces paroles du Christ et à l’usage de l’Église ancienne en insistant sur une communion fréquente des bébés (5).
La divine eucharistie est, pour tout chrétien orthodoxe, le plus grand sacrement, le sacrement central de l’Église. L’importance que lui attribue la foi orthodoxe est bien exprimée par l’auteur inconnu du Ve s. qui écrivit les Areopagitica et qui dit que, parmi tous les sacrements de l’Église, seule l’eucharistie est appelée au sens propre du terme « communion » (κοινωνία) et « assemblée » (σύναξις). Ceci non seulement parce qu’elle assemble et unit tous les fidèles avec le Christ, mais aussi parce qu’elle rassemble en elle et unit tous les autres sacrements et les parfait tous (6). C’est pourquoi il l’appelle « le sacrement des sacrements » (7), voyant en elle l’unique sacrement réellement parfait et suffisant en lui-même. Bien avant lui, saint Ignace d’Antioche († 110) parlait déjà de la divine eucharistie comme d’un « médicament d’immortalité » ou d’un antidote contre la mort, afin que nous vivions à jamais en Jésus Christ (8). Suivant l’expression de Nicolas Cabasilas. « C’est pourquoi ce sacrement [l’eucharistie] est le dernier parce qu’il est impossible d’aller plus loin que lui ou d’y ajouter quoi que ce soit (9). » Il explique de la façon suivante son action sur nous. « Lorsque [le Christ] nous amène à [sa] table et nous donne à consommer son corps, il change complètement l’initié et le transforme en son propre état. Et la terre n’est plus terre lorsqu’elle reçoit la forme royale, mais elle est déjà le corps du Roi (10). » L’importance de l’eucharistie dans la vie religieuse orthodoxe est aussi illustrée par le fait que seule la messe, où s’accomplit la consécration des saints dons et où la communion prend place, est appelée « liturgie » par le peuple orthodoxe. Ce terme ne s’applique à aucun autre service d’église (vêpres, matines, etc.).
La liturgie est essentiellement une commémoration et une participation à la mort et à la résurrection de notre Seigneur. Toutefois, la liturgie orthodoxe n’isole pas ces événements centraux de l’ensemble de l’économie divine néotestamentaire. L’action liturgique embrasse et nous fait participer à l’incarnation, à la prédication du royaume, à l’entrée dans Jérusalem, à la crucifixion, à la résurrection, à la Pentecôte et au second avènement. Un tel ensemble d’éléments de la commémoration liturgique confère à la liturgie chrétienne orientale (toute centrée qu’elle est sur la personne de notre Seigneur et son sacrifice sur la croix) un caractère eschatologique et pneumatologique exprimé avec tant de relief par l’invocation de l’Esprit Saint (épiclèse) qui accomplit par son pouvoir vivificateur et créateur le changement du pain et du vin en le vrai corps et le sang précieux du Verbe incarné. L’épiclèse est, très certainement, le point culminant de la consécration des saints dons, quoiqu’il ne soit pas facile ni entièrement conforme à la conception orthodoxe d’isoler tel moment particulier dans l’unité dynamique de la liturgie. La présence réelle de notre Seigneur dans son corps et son sang véritables et notre communion à lui en eux sont toujours comprises dans le « contexte » de l’action liturgique eucharistique, comme faisant partie de l’économie divine (incarnation-croix-résurrection) dans son ensemble. C’est pourquoi les fidèles orthodoxes vénèrent et adorent notre Dieu et Sauveur dans son corps et son sang divins au cours de la célébration eucharistique ; mais il serait étranger, voire incompréhensible, à la piété orthodoxe de faire des saintes espèces l’objet d’une vénération extra-eucharistique et extra-liturgique.
Les saints dons ne sont préservés dans les églises orthodoxes que pour la communion des malades exclusivement, et non comme un objet d’adoration particulière. Une telle adoration extra-liturgique apparaît à la piété orthodoxe comme teintée d’une certaine tendance « nestorienne », comme une sorte de culte de l’humanité du Christ considérée comme une personne séparée. Cette même foi « chalcédonienne » de l’Église en un seul Christ, vrai Dieu et vrai homme, s’exprime par l’emploi dans l’eucharistie de pain levé qui représente la plénitude de l’humanité du Christ qui assuma dans sa personne divine et unit à lui la nature humaine tout entière. l’esprit, l’âme et le corps. L’usage liturgique antique de verser de l’eau chaude (zéon) dans le calice après la consécration exprime la foi de l’Église en l’identité des éléments eucharistiques avec le corps et le sang du Christ ressuscité, de sorte que nous communions au sang vivant et chaud du Christ ressuscité qui, même dans son tombeau, n’était pas séparé de sa divinité. De plus, le caractère universel, catholique de la communion en tant que sacrement de l’ « assemblée » est souligné par l’admission de tous. prêtres, fidèles, enfants, au même calice et par la communion de tous aux deux espèces.
La liturgie orthodoxe, telle qu’elle s’est développée et a pris forme dans la période byzantine, avec sa structure élaborée, son action dramatique, son symbolisme, les hymnes liturgiques, les images sacrées, le chant, les vêtements, etc., constitue certainement, du point de vue purement historique, une des plus grandes créations du génie humain dans le domaine de l’art sacré. Elle continue la liturgie du Temple hébreu et de la synagogue et, en même temps, elle conserve quelque chose de la forme et de l’esprit de la tragédie grecque et de l’art hellénistique en général. Toutefois, adopter une attitude esthétique et émotionnelle envers la liturgie orthodoxe serait complètement fausser son sens. En effet, cette liturgie souligne avec force le moment théologique et dogmatique, voire même intellectuel, qui lui donne son cadre et constitue son fondement et son contenu. Le mystère indicible de la présence divine est exprimé dans la liturgie par des symboles, actions ou paroles sacrées, ainsi qu’il convient à la religion du Verbe incarné. En conséquence, la liturgie orthodoxe, si saturée d’éléments bibliques et théologiques, évite, dans le développement de son action, toute interruption par des pauses ou intervalles de silence dans le chant et la récitation ; ils ne s’accorderaient pas avec son caractère dogmatique et corporatif. (À cela, il n’y a qu’une seule exception, bien justifiée. la procession avec les espèces consacrées au cours de la liturgie des présanctifiés en carême qui s’accomplit en silence.) Pour cette même raison, toute sorte de musique instrumentale à l’église est rejetée. expression sans paroles, elle est émotionnelle et non dogmatique, ce qui ne permettrait pas aux fidèles de concentrer leur attention sur les paroles des prières. Tous les hymnes de l’Église orthodoxe sont profondément théologiques et saturés de sentences bibliques. Ils expriment les idées chrétiennes les plus profondes sur l’incarnation de Dieu, sur la rédemption et la déification de l’homme. Il en va de même pour leur équivalent visible, les icônes.
Conformément au caractère théologique de la liturgie byzantine, la prédication en constitue une partie essentielle. Le sermon appartient plus exactement à la liturgie des catéchumènes (la première partie, plus didactique que sacramentelle, de la liturgie orthodoxe) et suit immédiatement la lecture de l’Épître et de l’Évangile, expliquant généralement l’Écriture que les fidèles viennent d’entendre, ou la fête célébrée. L’amour du peuple orthodoxe authentique pour la prédication est tel que saint Jean Chrysostome (354-407) était même obligé de réprimander ceux de ses contemporains qui venaient à l’église pour l’entendre prêcher et partaient aussitôt après, disant qu’ils pouvaient prier à la maison, mais ne pouvaient y entendre la prédication et l’enseignement (11). « Tu te trompes toi-même, homme ! », dit-il, « Si tu peux en effet prier à la maison, tu ne saurais prier de la même façon qu’à l’église, où se trouvent un si grand nombre de pères spirituels et où une clameur unanime monte vers Dieu. » Il explique ensuite la différence entre la prière liturgique corporative et la prière privée. « Quand tu invoques le Seigneur dans ton particulier, tu n’es pas exaucé aussi bien que lorsque tu le fais en compagnie de tes frères. Il y a ici quelque chose de plus, à savoir l’accord des esprits et des voix, le lien de la charité et les prières des prêtres (12). » Il souligne la présence sacramentelle du Christ dans l’Eucharistie qui rend la conduite de ses auditeurs particulièrement erronée. « Lorsqu’un homme parle, qui n’est comme vous qu’un serviteur de Dieu, un grand empressement, une intense hâte se manifestent ; on se pousse les uns les autres et l’on reste jusqu’à la fin ; au contraire lorsque le Christ doit paraître au cours des mystères sacrés, l’église est vide et déserte (13). » Saint Jean Chrysostome formule ainsi la conception orthodoxe du lien entre la prédication et la prière. « D’ailleurs de quelle utilité serait une homélie, si la prière n’y était pas jointe ? La prière vient en premier lieu, et la parole ne fait que la suivre (14). »
La vie liturgique de l’Église trouve son expression dans le calendrier ecclésiastique avec ses fêtes et ses périodes de jeûne. Une participation active et consciente de l’ensemble des fidèles aux grands événements liturgiques est typique de la piété chrétienne orientale. C’est par là que notre vie quotidienne est sanctifiée et intégrée dans la vie de l’Église. C’est certainement Pâques qui est le centre de l’année ecclésiastique, la fête de loin la plus grande de toutes tant dans la vie liturgique que dans la vie des gens. Elle est précédée par le carême au cours duquel tout le style des offices ecclésiastiques change entièrement, et par la semaine sainte. Ce sont surtout les trois derniers jours de cette semaine qui éveillent, par leurs services merveilleux, les sentiments religieux et les pensées pieuses de tout vrai chrétien. le jeudi saint où est commémorée l’institution de l’eucharistie et où sont lues les douze leçons de l’Évangile relatant la passion de notre Seigneur ; le vendredi saint avec sa célébration symbolique de la descente de la croix et de l’ensevelissement du Christ ; le samedi saint, « le sabbat béni entre tous », le jour du silence et du repos, où le Fils unique de Dieu repose dans son tombeau, comme Dieu après la création, après ses grandes actions, avant son plus grand exploit, la victoire sur la mort et l’enfer, sa glorieuse résurrection. La nuit pascale où la liturgie est célébrée à minuit, immédiatement après les matines et où tous les fidèles sont appelés à participer à la table, au « veau gras », selon la parole de saint Jean Chrysostome dans son homélie pascale lue à l’église, constitue réellement le point culminant de toute la semaine. C’est une véritable préfiguration de la résurrection des morts, ainsi que l’exprime avec tant de beauté saint Jean Damascène († 749) dans son canon pascal. « Ô cette nuit vraiment sacrée et toute-fêtée, nuit salvatrice et lumineuse, dans laquelle la lumière intemporelle nous illumina tous corporellement du tombeau, nuit annonciatrice du jour radieux de la résurrection (15). » La semaine sainte et Pâques ont une telle prédominance dans la piété du peuple orthodoxe que l’on peut dire que la vie liturgique de toute l’année est surtout une attente de la semaine sainte, de la nuit de la résurrection, de Pâques. Noël a aussi une grande importance dans la vie spirituelle du chrétien d’Orient, vie enracinée dans la réalité de l’Incarnation divine, ainsi que l’exprime avec tant de profondeur et d’audace saint Athanase d’Alexandrie (IVe s.). « Car il [Dieu] s’est lui-même fait homme, pour que nous soyons faits Dieu (16). » Historiquement, Noël se développa de la fête de l’épiphanie ou théophanie, dont elle fut séparée à la fin du IVe siècle. L’épiphanie (6 janvier) n’est pas, dans l’Église orthodoxe, la fête des rois mages venus d’Orient (on les célèbre quelques jours après la Nativité), mais celle du baptême du Christ dans le Jourdain et de la manifestation, au cours de ce baptême, de la Sainte Trinité (par la voix du Père, le Christ lui-même et la colombe de l’Esprit Saint). C’est aussi la fête de l’institution de notre baptême, et celle de la consécration des eaux par le Christ. C’est pourquoi, l’Église orthodoxe jusqu’à ce jour bénit et consacre solennellement les eaux le jour de l’épiphanie (une des plus grandes fêtes de l’année). Ainsi, l’Église orthodoxe exprime sa foi en la sanctification du monde matériel par l’incarnation et en sa transfiguration eschatologique à venir. Une autre grande fête du calendrier orthodoxe a une signification analogue. c’est la transfiguration de notre Seigneur, importante également en tant que fondement théologique de l’illumination mystique de l’homme dans son union avec Dieu. Les fêtes consacrées à la sainte Mère de Dieu, surtout l’annonciation et la dormition (assomption), si importantes dans la piété chrétienne d’Orient, confèrent à l’attitude spirituelle orthodoxe un certain caractère particulier en soulignant, à travers la figure de la Vierge Marie, la libre participation (συνεργεία) de la race humaine au grand miracle de l’amour divin, à l’Incarnation et à la déification finale de l’être humain en elle. En effet, tout en étant un être humain comme nous tous, elle devint, par la grâce de Dieu, un « lien entre la nature créée et la nature incréée », ainsi que l’exprime le grand théologien du XIVe siècle, saint Grégoire Palamas (17), contrairement à l’idée romaine de l’ « immaculée conception » que les orthodoxes rejettent comme une intervention « mécanique » de Dieu dans le processus du salut.
Quelle est la fréquence de la sainte communion chez les chrétiens orthodoxes et quelle attitude la piété orthodoxe adopte-t-elle envers une communion fréquente ? On peut y observer deux tendances. L’une souligne plutôt la nécessité d’une préparation adéquate par le jeûne, l’abstinence, la participation à tous les offices et surtout par la confession, ce qui réduit la réception de la sainte communion à plusieurs fois par an. Un autre point de vue insiste plutôt sur l’importance de la sainte communion et sa fréquente réception pour la vie spirituelle, sans considérer une longue préparation (ni même la confession) comme une condition nécessaire pour être admis à la sainte eucharistie. Il faut dire que, parlant généralement, cette dernière tendance est plus conforme à l’usage de l’Église ancienne et à l’enseignement des Pères. Après une grande baisse de la fréquence de la communion à une période tardive (dans les Églises orthodoxes sous la domination turque et dans la Russie impériale), où la plupart des fidèles communiaient une fois par an, en Carême, l’usage ancien se répand rapidement parmi le peuple orthodoxe, surtout en Grèce et en Russie. C’est là un mouvement authentiquement orthodoxe inauguré au XVIIIe siècle, par les moines du Mont Athos, Macaire de Corinthe et Nicodème l’Hagiorite (18). Une communion quotidienne des laïcs semblerait, toutefois, à beaucoup d’orthodoxes, irréalisable et même spirituellement dangereuse. Ainsi que nous l’avons déjà souligné, la sainte Communion fait partie de la liturgie et ne peut en être séparée. Or, la liturgie ne saurait, avec toute sa richesse théologique, être réduite à un bref office de quelques minutes ni transformée en « messe basse ». La nécessité de la préparation ne peut non plus être entièrement éliminée… C’est pourquoi il serait peut-être juste de dire (sans aucune intention de dogmatiser) que la sainte communion, à des intervalles variant d’une semaine à un mois, pourrait être considérée comme normale pour un laïc ayant une vie ecclésiastique active (c’est-à-dire une participation régulière aux services liturgiques tous les dimanches et fêtes). Toutefois, du point de vue de la spiritualité orthodoxe, ce qui importe, ce n’est pas la fréquence de la communion, mais la façon dont on la reçoit. Je veux dire dans un esprit d’humilité et de componction « avec crainte de Dieu, foi et amour », comme le dit le prêtre à chaque service eucharistique. Dans cet ordre d’idées les paroles frappantes du grand mystique byzantin, saint Syméon le Nouveau Théologien (949-1022) viennent à l’esprit. « Frère, ne communie jamais sans larmes. » À titre d’explication, il ajoute. « Au contraire, celui qui […] passe toute sa vie dans les gémissements et les larmes, il est digne, tout à fait digne, et pas seulement un jour de fête mais chaque jour, et si j’ose dire dès le début de son repentir et de sa conversion, de venir prendre part à ces divins mystères (19). »
Ces paroles de saint Syméon attirent notre attention sur un autre aspect important de la spiritualité orthodoxe. l’aspect personnel et dévotionnel ou ascético-mystique, comme nous l’avons déjà nommé. La vie liturgique et sacramentelle de l’Église et tout particulièrement la divine Eucharistie est sans aucun doute la source et la base de la vie chrétienne en général ; toutefois, la grâce des sacrements doit être appropriée personnellement par un libre effort ascétique et son action doit être consciemment ressentie dans une vision mystique de Dieu et dans l’union avec lui. Il n’y a rien de magique, ni de purement passif dans l’attitude orthodoxe vis-à-vis des sacrements. La spiritualité patristique (par exemple saint Jean Chrysostome ou les Homélies spirituelles attribuées à saint Macaire d’Égypte) insiste sur le fait que le libre arbitre humain ne fut pas complètement perdu après la chute, sur la collaboration (συνεργεία) de l’homme avec Dieu dans l’acte du salut compris surtout comme la participation à la vie divine (θέωσις), sur le caractère conscient des états spirituels éprouvés au cours de notre vie terrestre « en un sentiment total de certitude » (saint Diadoque de Photicé, Ve s.) (20). Du point de vue historique, cet aspect de la spiritualité dérive surtout de l’ancien monachisme chrétien d’Orient ; toutefois, son importance et sa valeur sont, dans l’Église orthodoxe, plus permanentes et plus générales parce que la vie monastique du type contemplatif est également un des aspects essentiels de la vie religieuse de l’Église d’Orient (sans, bien entendu, la représenter dans sa totalité).
Nous allons noter ici quelques traits caractéristiques de la spiritualité orthodoxe, telle qu’elle a été exprimée à l’époque patristique et telle qu’elle existe essentiellement jusqu’à nos jours. Il y a tout d’abord la préférence de l’introspection et de la contemplation à l’activité. C’est aussi la conception d’une vie contemplative et retirée du monde comme supérieure à l’immixtion dans les relations humaines. Ces deux traits sont certainement typiques des attitudes spirituelles du chrétien d’Orient. Au niveau purement ascétique, cette tendance correspond plutôt à l’idée que l’approfondissement en soi permet à l’homme d’acquérir une plus grande connaissance de lui-même et de ses péchés, une croissance spirituelle. Une histoire monastique ancienne illustre très bien cette attitude. Il y est dit que trois amis souhaitant servir Dieu choisirent des genres de vie différents. L’un d’eux s’efforça d’apporter la paix à des hommes qui luttaient l’un contre l’autre. L’autre visita des malades. Le troisième s’éloigna dans le désert afin de mener une vie de quiétude spirituelle et lutter spirituellement, comme l’ont fait les Pères. Après bien des efforts et beaucoup de désappointements, les deux premiers décidèrent d’aller trouver l’ascète dans le désert afin d’apprendre s’il avait eu plus de succès dans sa voie spirituelle. Lorsqu’ils le trouvèrent, ils lui demandèrent ce que la quiétude spirituelle (hésychia) lui avait donné. Au lieu de répondre, l’ascète versa de l’eau dans un bol et leur dit. « Regardez cette eau avec attention. » Or, l’eau était trouble et ils ne pouvaient rien voir. Après quelque temps, l’ascète leur dit à nouveau. « Regardez encore cette eau avec attention. » L’eau, entre-temps, s’était calmée et lorsqu’ils la regardèrent avec attention, ils y virent leur propre visage, comme dans un miroir. Alors l’ascète leur dit. « Quiconque vit parmi les hommes est comme cela. il ne voit pas ses propres péchés à cause du trouble. Mais lorsqu’il va en un lieu désert, loin du monde, ses sens s’apaisent. C’est alors qu’il voit ses propres défauts et, s’il le veut, il s’en libère avec l’aide de la grâce de Dieu (21). » Mais ce penchant vers une vie contemplative et cette idée de la connaissance de soi comme une voie menant à la connaissance de Dieu et à l’union avec lui ne sont pas une simple adaptation des conceptions philosophiques de la Grèce antique (renouvelées et développées par Plotin) ; ce sont là des traits d’inspiration spécifiquement chrétienne, fondés surtout sur la doctrine biblique de l’homme créé à l’image et à la ressemblance de Dieu. Cette image, défigurée et obscurcie, mais non complètement perdue dans la chute, est restaurée par le Christ dans le baptême et le but de la lutte spirituelle est précisément de la re-purifier de la souillure des péchés et des passions qui la cachent et l’obscurcissent. Lorsque nous atteignons cela par la grâce de l’Esprit Saint, nous voyons clairement l’image divine en nous et, en elle et par elle, son archétype divin à la ressemblance duquel nous sommes créés. Telles sont les idées fondamentales de la doctrine spirituelle du grand mystique et Père de l’Église, saint Grégoire de Nysse († 394). « Celui qui se voit lui-même, dit-il, voit en lui le Désirable… » et, « en regardant dans sa propre pureté, il perçoit dans l’image l’archétype (22). » Il poursuit. « Si, par conséquent, par une vie de zèle et d’attention, tu laves la crasse qui recouvre ton cœur, la beauté semblable à celle de Dieu t’illuminera (23). » En effet, « celui qui a purifié son propre cœur des penchants passionnels, perçoit dans sa propre beauté l’image de la nature divine (24) ». La vision mystique de Dieu est manifestement le but de la vie contemplative. Toutefois, à un niveau supérieur, cette vie devient une vie active, parce que les personnes ayant reçu les dons suprêmes de la grâce et sentant que le Christ vit en elles ne peuvent dissimuler le trésor et sentent que leur mission est de proclamer au monde la grandeur de l’amour divin. « Comment en effet pourrions-nous taire, écrit par exemple saint Syméon le Nouveau Théologien, des bienfaits tels que les siens, ou enfouir avec ingratitude, comme de mauvais serviteurs oublieux, le talent qui nous a été donné ? […] Ce que j’ai vu et connu en fait et par expérience des merveilles de Dieu, je ne me résigne pas à n’en point parler, mais j’en témoigne devant tous les autres comme en présence de Dieu, disant à haute voix. « Courez tous avant que la mort ne vous ferme la porte de la pénitence […] mettez tous vos soins à posséder au-dedans de vous, de façon consciente, le Royaume des cieux, et ne partez pas d’ici les mains vides » (25). » Cet « apostolat du mysticisme » est un des traits les plus saillants de la vie spirituelle des chrétiens d’Orient à ces meilleures périodes (26).
L’ascèse est certainement un des traits caractéristiques de la spiritualité orthodoxe traditionnelle. C’est tout d’abord une expression de notre volonté libre, de notre désir de lutter contre le mal en nous, de nous purifier et d’être ainsi rendus dignes de voir Dieu. Il ne s’agit en aucun sens de lutter contre le corps, mais d’une lutte contre les passions qui ne font pas partie de la vraie nature de l’homme. Tous les efforts corporels ascétiques, tout en étant des moyens indispensables de la lutte spirituelle, ne sont jamais considérés en eux-mêmes comme des vertus ; ils sont opposés aux attitudes spirituelles intérieures (l’attention, la garde du cœur, la prière) qui ont une valeur supérieure. La conception orthodoxe est très bien exprimée par le moine égyptien Agathon. « On demanda à […] abba Agathon, peut-on lire dans les Apophtegmes des Pères, « Lequel est le meilleur, la peine corporelle ou la vigilance intérieure ? » Il répondit. « L’homme ressemble à un arbre. la peine corporelle en est le feuillage et la vigilance intérieure le fruit ; puisque, selon ce qui est écrit, tout arbre ne produisant pas de bon fruit est coupé et jeté au feu (Mt 7, 19), il est clair que tout notre soin est relatif aux fruits, c’est-à-dire à la garde de l’esprit. Mais il y aussi besoin de la protection et de l’ornement des feuilles qui sont la peine corporelle (27). » Par tel effort corporel, l’homme tout entier, esprit, âme et corps, participe à la vie religieuse et est sanctifié. Cette idée est fortement soulignée dans la spiritualité chrétienne d’Orient, conformément à la conception patristique de l’homme comme un tout, en sorte que l’image divine en lui est non seulement dans son esprit, mais dans toute sa personne, spirituelle et corporelle (28).
Ce qui importe dans la vie spirituelle, ce n’est pas d’acquérir telle ou telle vertu morale, mais de suivre le Christ, de s’approprier son esprit, de façon à être comme lui, à lui ressembler spirituellement. L’ascèse orthodoxe, loin d’être une morale abstraite, est essentiellement christocentrique. « Dans le siècle à venir, écrit saint Syméon le Nouveau Théologien, au chrétien ne sera pas demandé s’il a renoncé au monde, s’il a distribué ses richesses aux pauvres, s’il a beaucoup jeûné, veillé et pleuré, ou s’il a accompli quelque autre bien que ce soit dans la vie présente ; mais il sera interrogé avec insistance s’il a acquis une ressemblance au Christ, telle qu’un fils au père… Car les gardiens des portes du Royaume céleste ne peuvent les ouvrir pour permettre l’entrée à un chrétien que s’ils lui voient une ressemblance avec le Christ comme celle d’un fils avec son père (29). »
La prière est sans aucun doute la partie essentielle et la plus importante de la vie spirituelle orthodoxe. De même que tout ce qui fait la spiritualité orthodoxe, elle a son aspect humain et son aspect divin. Cela est tout à fait naturel parce que la prière est essentiellement « la conversation et l’union de l’homme avec Dieu », un dialogue, suivant l’expression de saint Jean Climaque (VIIIe s.) (30). Dans son aspect humain, c’est « la montée vers Dieu de notre esprit » (Évagre, † 399) (31). C’est donc toujours un effort et un dur labeur, de sorte qu’il « n’y a pas d’autre travail pénible comme de prier Dieu » suivant l’expression d’un des anciens Pères du desert (32). Elle doit par conséquent être apprise et de nombreux livres ont été écrits par les auteurs spirituels chrétiens d’Orient en commençant par Clément d’Alexandrie et jusqu’aux temps modernes sur « l’art des arts, la science des sciences » qu’est la prière considérée dans son aspect humain. De nombreux écrits sur ce thème, datant du IVe au XVIe siècle, ont été collectés par les moines du Mont Athos au XVIIIe siècle et compilés pour former le recueil sur la prière, bien connu sous le nom de Philocalie, qui eut une profonde influence sur la vie spirituelle dans bien des pays orthodoxes, en particulier en Russie (33). Dans ses états supérieurs, la prière devient spirituelle ou mentale. Comme telle, elle se distingue de la prière orale ou chantée (psalmodiée) ; ces dernières ne sont pas rejetées, mais plutôt considérées comme préparatoires. La prière mentale est opposée à toute espèce de prière imaginative. Le refus de la prière imaginative et l’exclusion de toute imagination de notre esprit au cours de la prière, et la nécessité de concentrer notre esprit sur les paroles de la prière afin de ne pas lui permettre d’errer, ce sont là les traits les plus saillants et les plus constants de l’enseignement chrétien d’Orient sur la prière. Il le distingue nettement de toutes les écoles de spiritualité occidentales, surtout postérieures à la Réforme, caractérisées par leur inclinaison vers la méditation imaginative. « Quand tu pris, ne t’imagine pas la présence du divin en toi, dit Évagre, ne laisse pas ton esprit se soumettre à une quelconque figuration. aborde l’immatérielle en immatériel et tu comprendras (34). » Et le grand maître de la vie monastique qu’est saint Jean Climaque écrit. « Durant la prière n’admets aucune imagination sensible, de peur de tomber dans l’égarement (35). » L’exemple le plus important de la prière spirituelle orthodoxe est certainement la prière qu’on appelle « Prière de Jésus » (Ἰησοῦ εὐχή) (36). C’est une brève prière dont le texte traditionnel est. « Seigneur Jésus Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi » — une adaptation de la prière des aveugles de Jéricho dont parle l’Évangile. Ces paroles doivent être répétées sans interruption, mentalement, l’attention concentrée dans le cœur. Dès le Ve siècle, nous trouvons chez des auteurs ascètes, comme, par exemple, saint Nil († 430) ou saint Diadoque (37), une mention précise de cette prière. Depuis, elle a pris une grande place dans la vie spirituelle orthodoxe et constitue un de ses traits les plus caractéristiques. Dans ses premières étapes, elle est plutôt ascétique. On la considère comme une arme contre les passions et les démons (« Flagelle les ennemis avec le Nom de Jésus, car il n’y a pas d’arme plus puissante au ciel et sur terre », dit saint Jean Climaque (38)). Toutefois, à des échelons supérieurs, cette prière devient une véritable prière mystique nous amenant à l’union avec Dieu et au ravissement de notre intellect par lui. Saint Grégoire le Sinaïte († 1346) l’exprime ainsi. « Le début de la prière mentale, c’est la puissance purificatrice de l’Esprit […], son échelon moyen, la puissance illuminatrice et la vision ; son aboutissement est l’extase et le ravissement de l’intellect vers Dieu (39). » L’efficacité spirituelle de la Prière de Jésus est fondée sur le fait que par une phrase brève et précise elle nous permet de concentrer toute notre attention sur la profondeur et la vérité du sentiment chrétien exprimé par ses paroles ; ceci tout particulièrement et en premier lieu parce qu’elle est centrée sur le Nom divin de Jésus, Fils de Dieu, en sorte que la prière acquiert un caractère trinitaire par le Christ. Afin d’aider la concentration de notre attention sur les paroles de la prière et dans notre cœur, une psychotechnique détaillée a été développée dans le courant des siècles par ceux qui pratiquent cette prière. (Il s’agit de la joindre au rythme de la respiration, d’une certaine position assise, etc.). Quelle que soit l’importance de ces méthodes physiques, en tant qu’elles expriment l’idée orthodoxe de la participation de l’homme tout entier à la vie spirituelle, elles ont toujours été uniquement considérées comme des moyens auxiliaires. Elles ne font pas partie de l’essentiel de la « Prière de Jésus » qui est l’union avec le Christ par son nom divin. Cette union est un don de Dieu et ne peut jamais être atteinte par les méthodes ascétiques seules. Nous arrivons maintenant à l’autre aspect de la prière, le plus important suivant la doctrine orthodoxe, l’aspect divin. La prière n’est pas seulement notre ascension vers Dieu ; elle est aussi l’abaissement de Dieu jusqu’à nous. la révélation de Dieu et sa présence en nous, son action en nous. Selon l’expression de saint Grégoire le Sinaïte qui souligne cet aspect divin objectif. « La prière est […] la certitude entière du cœur, la manifestation du baptême, l’exultation en Jésus […], le signe de la réconciliation, le sceau du Christ, un rayon du soleil spirituel. Mais quel besoin d’en dire tant ? La prière, c’est Dieu accomplissant tout en tout dans le Christ Jésus (40). »
Parmi les autres traits caractéristiques du mysticisme chrétien d’Orient, il convient de noter l’idée très répandue selon laquelle la vie éternelle commence dès la vie terrestre. Cela est lié à l’enseignement sur le caractère conscient de la vie dans la grâce, perçue à ses plus hauts échelons comme une vision de lumière et comme une illumination. Depuis l’incarnation divine les deux éons, l’actuel et celui à venir, ne sont plus séparés radicalement l’un de l’autre et un chrétien doit trouver le début de la vie éternelle ici-bas, dès sa vie terrestre, afin d’être capable d’y participer dans le siècle à venir. « La vie en Christ, écrit Nicolas Cabasilas, germe en cette existence et tire de là ses prémices ; mais elle s’accomplit dans le futur, une fois que nous sommes parvenus à ce jour-là. Cette existence ne peut pas l’introduire dans l’âme des hommes de façon accomplie, non plus que l’existence future si elle n’en tire pas d’ici-bas les prémices (41). » Cette vie éternelle en Christ, l’action de la grâce et l’habitation de Dieu en nous, qui commencent dès la vie terrestre, ne peuvent être cachées toujours et demeurer en nous inconsciemment. Nous devons plutôt les ressentir pendant notre vie terrestre « avec toute la sensation et la plénitude de la certitude », ainsi que le soulignent si souvent les auteurs spirituels de l’Église orthodoxe (42). C’est ici également que nous commençons à voir le Christ. « Efforçons-nous, dit par exemple saint Syméon le Nouveau Théologien, tant que nous sommes en vie, de le voir et de le contempler. Car si nous sommes jugés dignes de le voir sensiblement ici-bas, nous ne mourrons pas […]. Non n’attendons pas l’avenir pour le voir, mais dès maintenant luttons pour le contempler (43). » Ceci n’est toutefois pas une vision imaginative ; les grands mystiques chrétiens d’Orient le décrivent plutôt comme une vision suprasensible de la lumière divine et une illumination. Cette vision de la lumière occupe une place à un tel point centrale dans la vie spirituelle orthodoxe que le mysticisme chrétien d’Orient a pu être désigné comme un « mysticisme de la lumière ». Cette assertion ne doit cependant n’être acceptée qu’avec certaines qualifications. en effet, les mystiques chrétiens d’Orient (particulièrement saint Grégoire de Nysse) parlent non seulement de la lumière divine, mais aussi de la ténèbre divine en tant qu’un des événements mystiques suprêmes. Pourtant, la ténèbre divine ne s’oppose pas à la lumière divine ; elle est plutôt comprise comme l’expression suprême de celle-ci, comme « une ténèbre supra-lumineuse » (saint Grégoire Palamas) lorsque l’esprit est aveuglé par l’excès de lumière. « On voit le rayon, mais le soleil nous aveugle » explique saint Syméon (44). Et, d’ailleurs, ce n’est pas la vision de la lumière comme telle qui constitue en elle-même le sommet de l’expérience mystique, c’est la communion personnelle et la rencontre avec le Christ, qui se révèle lui-même dans notre cœur par l’Esprit Saint (45). Cette révélation est vécue et vue spirituellement comme une lumière ; mais les descriptions mettent l’accent non tant sur cette lumière que sur le Christ lui-même, qui se révèle au-dedans de nous. Ainsi le mysticisme orthodoxe, dans ses expressions les plus élevées, est essentiellement christocentrique. La lumière étant comprise comme la gloire divine éternelle de la Sainte Trinité — gloire qui a été vue par les apôtres dans le Christ au moment de sa transfiguration —, le mysticisme orthodoxe, fondé sur la vision de cette lumière incréée de la gloire trinitaire révélée en Christ, conserve un caractère trine sans que pour autant ses traits christocentriques s’en trouvent estompés.
Nous touchons ici le fondement théologique du mysticisme orthodoxe et son rapport avec la vie liturgique de l’Église. Les mystiques chrétiens d’Orient, par leur refus absolu de l’imagination dans l’approche du divin, par leur pratique de la prière intérieure perpétuelle, et de la Prière de Jésus en particulier, par la doctrine de la lumière divine et de la vision du Christ dès cette vie, semblent avoir adopté des voies bien différentes de la piété liturgique ordinaire qui, elle, met l’accent sur le culte corporel, les prières orales et les hymnes, la vénération des saintes icônes et la sanctification sacramentelle. Une opposition qui, ici, est toutefois plus apparente que réelle. Il s’agit plutôt de la dialectique de l’Esprit qui « souffle où il veut » et inspire tout dans l’Église, l’amenant à l’unité par la diversité. En effet, le mysticisme orthodoxe est essentiellement un phénomène ecclésial. La vie spirituelle personnelle se comprend toujours comme une partie de notre vie surnaturelle, dans le Corps du Christ qu’est sa sainte Église. L’éloignement du « monde » n’est jamais compris comme une séparation de l’Église et la concentration intérieure orthodoxe n’est pas un « approfondissement » solitaire de l’homme naturel mais une redécouverte de l’image de Dieu en nous, restaurée par le baptême et enfouie à nouveau par nos péchés et nos passions. C’est « une manifestation du baptême », dit saint Grégoire le Sinaïte dans sa définition de la prière intérieure déjà citée. L’eucharistie occupe une place centrale dans les écrits de saint Syméon le Nouveau Théologien, le plus grand des mystiques de l’Église orthodoxe. Cette certitude que la vie éternelle commence dès la vie terrestre et n’appartient pas exclusivement au siècle à venir, constitue l’attitude fondamentale tant de la liturgie orthodoxe que de la spiritualité mystique. La foi en la Trinité et en l’incarnation, ainsi que la totalité de l’enseignement dogmatique de l’Église sur Dieu et l’homme dans leurs rapports réciproques, est le fondement de toute la vie spirituelle orthodoxe et de son expérience mystique. Séparées de cette base théologique, elles se vident de leur sens et deviennent incompréhensibles. Un lien essentiel et intime entre l’orthodoxie dogmatique et une vie spirituelle saine a toujours été ressenti et enseigné par les grands représentants de la spiritualité chrétienne d’Orient (46).
Pour terminer, je voudrais illustrer mon article par le récit suivant, très caractéristique, emprunté aux Dits des Pères du désert.
On disait d’abba Agathon que certains vinrent le trouver ayant entendu dire qu’il avait beaucoup de discernement. Et voulant éprouver s’il se mettait en colère, ils lui disent. « Est-ce toi Agathon ? Nous avons entendu dire de toi que tu es fornicateur et orgueilleux. » Il dit. « Oui, c’est bien vrai. » Ils lui dirent encore. « Es-tu cet Agathon qui raconte des niaiseries et qui médit ? ». Il dit. « C’est moi. » Et à nouveau ils lui dirent. « Est-ce toi Agathon l’hérétique ? » Il répondit. « Je ne suis pas hérétique. » Alors ils lui demandèrent. « Dis-nous pourquoi tu as accepté tout ce que nous te disions, mais cette dernière parole tu ne l’as pas supportée. » Il leur dit. « Les premières accusations, je me les fais à moi-même, car cela est utile à mon âme ; mais m’entendre traiter d’hérétique, c’est une séparation de mon Dieu, et je ne veux pas être séparé de mon Dieu. » En l’entendant parler, ils admirèrent son discernement et s’en retournèrent édifiés (47)…
* Publié dans Le Messager de l’exarchat du patriarche russe en Europe occidentale, n° 53 (1966), p. 14-29.
- Il faut toutefois se souvenir que le monde byzantin avait hérité et amalgamé avec la tradition hellénistique de base bien des éléments orientaux importants. Cela s’applique surtout à la vie spirituelle, où certaines institutions essentielles comme, par exemple, le monachisme, ont une origine plutôt copte et syriaque que grecque. Et, même après la séparation des chrétiens orientaux (nestoriens, monophysites, etc.), les « frontières » spirituelles de l’orthodoxie avec l’Orient demeurèrent toujours plus floues et indéterminées qu’avec l’Occident après le schisme de 1054.
- Je ne me propose pas ici de traiter systématiquement des sacrements du point de vue dogmatique ; je ne parle que de leur place dans la vie spirituelle.
- NICOLAS CABASILAS, La Vie en Christ, II, 5, 2-5, Paris, Éd. du Cerf, coll. « Sources chrétiennes » n° 355, 1989, p. 137.
- Ibid., II, 8, 3-5, p. 139.
- Sur la communion des petits enfants dans l’Église ancienne, voir CYPRIEN, De lapsis, 25 (CSEL 3, 1, p. 255) et Const. apostol., VIII, 13, 14, Paris, Éd. du Cerf, coll. « Sources chrétiennes » n° 336, 1987, p. 209-211.
- DENYS L’ARÉOPAGITE, De ecclesiastica hierarchia, III, 1 (PG 3, col. 424 C).
- Ibid.
- Éphésiens, 20, 2.
- NICOLAS CABASILAS, La Vie en Christ, IV, 3, 3-5, loc. cit., p. 265.
- Ibid., IV, 2, 8-11, p. 264-265.
- JEAN CHRYSOSTOME, Homélie III, 382-386, dans Sur l’incompréhensibilité de Dieu, Paris, Éd. du Cerf, coll. « Sources chrétiennes » n° 28bis, 20003, p. 219.
- Homélie III, 386-390, loc. cit., p. 219
- Homélie III, 363-366, loc. cit., p. 217.
- Homélie III, 394-396, loc. cit., p. 219.
- In Domenicam Paschae (PG 96, col. 841 D).
- ATHANASE D’ALEXANDRIE, Sur l’incarnation du Verbe, LIV, 3, Paris, Éd. du Cerf, coll. « Sources chrétiennes » n° 199, 1973, p. 459.
- Homélie XXXVII, « Homilia in Dormitionem Beatae Mariae Virginis » (PG 151, col. 472 B).
- Voir à ce sujet un article intéressant (en grec moderne) de J. VERITIS, « Le mouvement rééducateur de Colyvades », dans Aktines, n° 6 (1943), Athènes, p. 99-110.
- Cat. IV, 613-617 dans Catéchèses, t. I, Paris, Éd. du Cerf, coll. « Sources chrétiennes » n°96, 1963, p. 365.
- DIADOQUE DE PHOTICÉ, Cent chapitres gnostiques (Cent chapitres sur la perfection spirituelle), Paris, Éd. du Cerf, coll. « Sources chrétiennes » n° 5bis, 1955, XL, 15, p. 108; XLIV, 2, p. 111; LXVIII, 7, p. 129; XC, 21, p. 150; XC, 12, p. 151; XCI, 10, p. 152; XCIV, 15, p. 156; XCIV, 18, p. 157.
- Extraits des Dits des Anciens (Pères du désert) dans la collection du XIe siècle faite par Paul au monastère du Christ Évergète, nommé habituellement « Evergetinos », édité à Venise (1783), § 1-13, p. 75.
- De beatitudinibus, 6 (PG 44, col. 1272 B).
- Ibid. (col. 1272 A).
- Ibid. (col. 1269 C).
- Cat., XXXIV, 23-77 dans Catéchèses, t. III, Paris, Éd. du Cerf, coll. « Sources chrétiennes » n°113, 1965, p. 273-279.
- On peut, à titre d’exemple de cet « apostolat du mysticisme », citer le mouvement hésychaste du XIVe siècle qui prit naissance sur le Mont Athos et de là s’étendit sur tout le monde orthodoxe.
- « Le discernement », X, 13, dans Les Apophtegmes des Pères. Collection systématique, t. II, Jean-Claude Guy (éd.), Paris, Éd. du Cerf, coll. « Sources chrétiennes » n° 474, 2003, p. 23.
- Ces idées sur l’image divine dans l’homme ont été développées en particulier par saint Grégoire Palamas, voir ses Capita, 38-39 (PG 150, col. 1145 D-1148 B).
- Discours XVII. Texte grec non publié (Or. 12 dans l’édition en latin des 33 discours, voir PG 120, col. 366-373).
- Saint JEAN CLIMAQUE, L’Échelle du paradis, XXVIII, 1, trad. P. Deseille, Éd. de l’Abbaye de Bellefontaine, coll. « Spiritualité orientale », n°24, 1997, 20072, p. 318.
- EVAGRE, Sur la prière, 35, dans De la prière à la perfection, Paris, Éd. Migne, coll. « Les pères dans la foi », 1992, p. 79.
- Les Apophtegmes des Pères, X, 2, loc. cit., p. 209.
- Le lecteur français se rapportera à la Philocalie des Pères neptiques, traduite par Jacques Touraille et présentée par Olivier Clément (Paris, DDB/J.-C. Lattès, 1995, 2 vol.) ou à la Petite Philocalie de la prière du cœur, traduite et présentée par Jean Gouillard (Paris, Éd. du Seuil, 1979). L’influence de la Philocalie en Russie au XIXe siècle est bien illustrée par un livre attachant. Les Récits d’un pèlerin russe (Paris, Éd. du Seuil, 1999).
- EVAGRE, Sur la prière, 66, loc. cit., p. 86.
- Saint JEAN CLIMAQUE, L’Échelle du paradis, XXVIII, 45, loc. cit., p. 325.
- C’est saint Jean Climaque qui, le premier, emploie ce terme technique de « Prière de Jésus » dans L’Échelle du paradis, XV, 52, loc. cit., p. 197. Voir B. KRIVOCHÉINE, « Date du texte traditionnel de la Prière de Jésus », Messager de l’exarchat du patriarche russe en Europe occidentale, n°7/8 (1951), p. 55-59.
- Abba NILUS, Epistola, III, 278 (PG 79, 521 B) ; DIADOQUE DE PHOTICÉ, Cent chapitres gnostiques, loc. cit., XXXI, XXXII, LIX, LXI et passim.
- L’Échelle du paradis, XXI, 7, loc. cit., p. 222.
- Capita per acrostichidem, CXI (PG 150, col. 1277 C).
- Ibid., CXIII (PG 150, col. 1277 D-1280 A).
- NICOLAS CABASILAS, La Vie en Christ, I, 1, 1-5, p. 75.
- Voir la n. 21.
- Cat., II, 422-426 dans Catéchèses, t. I, loc. cit., p. 277.
- Hymn. XLI, éd. Dionysios ZAGORAIOS, Smyrne, 1886, 2e partie, p. 62.
- Sur l’importance d’une telle révélation du Christ dans la vie mystique de saint Syméon le Nouveau Théologien, voir ses Catéchèses, t. I, loc. cit., Introduction, p. 26-27.
- Le meilleur fondement théologique de l’expérience mystique orthodoxe se trouve dans les écrits de saint Grégoire Palamas (1296-1359). Il a su faire la synthèse des courants principaux de la spiritualité chrétienne d’Orient et le lien avec la doctrine dogmatique de l’Église.
- « Le discernement », X, 12, dans Les Apophtegmes des Pères, t. II, loc. cit., p. 21.
Suite « Dieu, l’homme, l’Église » Lecture des Pères Par Basile Krivochéine Les Éditions du « CERF » Paru en. Décembre 2010, 302 pages

« L’Esprit (1) souffle où il veut », dit notre Seigneur dans son entretien avec Nicodème, « tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d’où il vient ni où il va » (Jn 3, 8). L’Esprit donne la liberté, comme l’atteste vigoureusement saint Paul. « Où est l’Esprit du Seigneur, là est la liberté » (2 Co 3, 17). Et l’apôtre nous exhorte à ne pas éteindre l’Esprit (1 Th 5, 19), mais à tenir bon et à ne pas se remettre sous le joug de l’esclavage (Ga 5, 1), car nous n’avons pas reçu « un esprit d’esclaves pour retomber dans la crainte… mais un Esprit de fils adoptifs qui nous fait nous écrier. « Abba ! Père ! » » (Rm 8, 15). « C’est pour que nous restions libres que le Christ nous a libérés » (Ga 5, 1).
Cependant le même apôtre, qui n’admet point que sa liberté relève du jugement d’une conscience étrangère (1 Co 10, 29), n’invoque plus cette liberté personnelle quand il écrit aux Galates pour les mettre en garde contre ceux « qui veulent bouleverser l’Évangile du Christ ». « Eh bien ! Si nous-même, si un ange venu du ciel vous annonçait un évangile différent de celui que nous avons prêché, qu’il soit anathème ! » (Ga 1, 7-8). Conscient que c’est Dieu lui-même qui, dès le sein maternel, l’a mis à part et par sa grâce daigna révéler en lui son Fils (Ga 1, 15-16), Paul décide néanmoins « à la suite d’une révélation » de monter à Jérusalem pour exposer aux autres apôtres l’Évangile qu’il prêchait « de peur de courir ou d’avoir couru pour rien » (Ga 2, 2). Une autorité, l’Évangile reçu ou les autres apôtres, plus haute que sa liberté de prêcher, était donc admise par saint Paul et ceci en vertu d’une révélation. D’ailleurs, dans tous ses écrits, il distingue son opinion personnelle, valable certainement parce qu’il croyait bien « avoir l’Esprit de Dieu » (1 Co 7, 40), de ce qui lui aurait été révélé comme un commandement du Seigneur (1 Co 7, 25).
On peut donc dire que, malgré les affirmations de certains théologiens orthodoxes et catholiques-romains, l’idée de l’autorité, que cela soit de l’Écriture ou de l’Église, est bien biblique. Cette autorité a son fondement dans la personne du Christ à qui, en sa qualité de Verbe incarné et chef de l’Église, tout a été donné au ciel et sur la terre après sa résurrection (Mt 28, 18). Et les évangélistes soulignent qu’« il parlait avec autorité » (Lc 4, 32) et qu’il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes et les pharisiens (Mt 7, 29). Les paroles de Jésus sont distinguées ici des paroles purement humaines par leur origine divine et l’efficacité qui en résulte. Notons que le mot grec ἐξουσία, employé dans tous ces passages, peut à la fois signifier « autorité », « puissance » et « pouvoir ». Ce pouvoir est transmis par le Christ à ses apôtres avec le commandement de continuer fidèlement l’enseignement du Christ. « Allez donc, de toutes les nations faites des disciples […] leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit » (Mt 28, 19-20). « Qui vous écoute m’écoute, qui vous rejette me rejette et qui me rejette rejette celui qui m’a envoyé » (Lc 10, 16). Et la présence du Christ parmi ses disciples est le gage de l’authenticité de cet enseignement apostolique (Mt 28, 20).
Cette autorité n’est pas quelque chose d’extérieur, imposée à notre conscience comme une loi, bien que dans sa manifestation historique dans la vie de l’Église elle semble parfois acquérir de pareils traits. C’est une autorité spirituelle, exercée en Esprit et par l’Esprit et, comme l’écrit saint Paul cité plus haut, où est l’Esprit, est la liberté. L’Esprit pénètre l’homme jusqu’au plus profond de son être, il scrute tout, même les profondeurs divines. Lui seul connaît ce que l’homme a de plus secret et, également, nous fait « connaître les dons gracieux que Dieu nous a faits » (1 Co 2, 10-12). Ainsi, ils deviennent nôtres, nous appartiennent et ne sont pas imposés de l’extérieur. On peut donc dire qu’à l’opposé de l’homme psychique qui n’accueille pas ce qui est de l’Esprit de Dieu, car il ne le connaît pas, l’homme spirituel juge de tout et ne relève lui-même du jugement de personne car c’est par l’Esprit qui est en lui qu’il juge (1 Co 2, 14-15). Plus encore, c’est l’Esprit qui nous rend conscients de notre filiation divine, d’être des enfants de Dieu. « L’Esprit en personne, comme l’écrit saint Paul, se joint à notre esprit pour attester que nous sommes enfants de Dieu » (Rm 8, 16). C’est l’Esprit qui nous révèle la divinité du Christ et donc sa seigneurie et son autorité, car nul ne peut dire « Jésus est Seigneur » que sous l’action de l’Esprit Saint (1 Co 12, 3).
Il faut noter aussi que cette action du Saint Esprit, bien que s’adressant à l’homme dans tout ce qu’il a de plus personnel et intérieur, a aussi un aspect communautaire et ecclésial qui la complète. C’est ainsi que l’Esprit Saint enseigne les apôtres (Lc 12, 12), parle en eux (Mt 10, 20), complète même ce que le Christ leur a appris (Jn 14, 26) et leur annonce les choses à venir (Jn 16, 13). C’est un Esprit de sagesse et de révélation (Ep 1, 17), comme il est l’Esprit de vérité (Jn 14, 17; 15, 26; 16, 13). Le Saint Esprit donne sa force aux apôtres en descendant sur eux (Ac 1, 8), ils décident ensemble avec lui (Ac 15, 28). C’est l’Esprit Saint qui institue les évêques pour paître l’Église de Dieu (Ac 20, 28). Il parle aux Églises et demande d’être écouté (Ap 2, 7). Le mensonge à l’Esprit Saint est puni par la mort (Ac 5, 3-5) et le blasphème contre lui ne sera remis ni en ce monde ni dans l’autre (Mt 12, 31-32). Libérateur et autoritaire, inspirateur et enseignant, il est « donné à ceux qui obéissent » à Dieu (Ac 5, 32). C’est un esprit d’unité (Ep 4, 3), d’obéissance et d’ordre, « car Dieu n’est pas un Dieu de désordre, mais de paix » (1 Co 14, 33). Enfin, c’est par l’Esprit que le Christ nous a donné que nous reconnaissons que nous demeurons en lui et lui en nous (1 Jn 4, 13).
Un problème se pose cependant. comment pouvons-nous savoir si c’est vraiment le Saint Esprit qui parle en nous ou dans nos frères et comment distinguer son action de celle de l’erreur ? Quelle est donc l’autorité des énoncés qui se présentent comme venant de l’Esprit ? L’apôtre Jean insiste beaucoup sur l’importance d’un pareil examen. « Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s’ils viennent de Dieu, car beaucoup de faux prophètes sont venus dans le monde » (1 Jn 4, 1). À ceci, on pourrait répondre que c’est à ses fruits qu’on juge l’arbre et reconnaît les prophètes, selon la parole du Seigneur (Mt 7, 15-20). Et saint Paul, dans son épître aux Galates, nous parle de ces fruits de l’Esprit qui sont « charité, joie, paix, longanimité, serviabilité, bonté, confiance dans les autres, douceur, maîtrise de soi » (Ga 5, 22-23). Et il ajoute. « Contre de telles choses, il n’y a pas de loi » (Ga 5, 23) en nous enseignant que des critères juridiques ou extérieurs ne sont pas suffisants pour discerner les activités de l’Esprit puisqu’il s’agit de choses intérieures, qu’elles soient personnelles ou ecclésiales. Le Saint Esprit, comme nous l’avons vu, est un Esprit d’ordre, d’obéissance filiale et de paix et c’est ce qui le distingue de l’esprit de l’erreur. Il est avant tout sainteté et charité qui est le signe distinctif des vrais disciples du Christ (Jn 13, 35).
Le critère fondamental de distinction des esprits, tel que l’expose l’apôtre Jean dans son épître, est cependant christologique. C’est la confession de l’incarnation du Verbe de Dieu et de tout ce que ceci implique. « À ceci, reconnaissez l’Esprit de Dieu. tout esprit qui confesse Jésus Christ venu dans la chair est de Dieu ; et tout esprit qui ne confesse pas Jésus Christ n’est pas de Dieu. c’est là l’esprit de l’Antichrist. […] C’est à quoi nous reconnaissons l’esprit de la vérité et l’esprit de l’erreur » (1 Jn 4, 2-6). Ou, comme le Christ le dit à ses disciples. « Lorsque viendra le Paraclet que je vous enverrai d’auprès du Père, l’Esprit de vérité, qui vient du Père, il me rendra témoignage » (Jn 15, 26). Ce témoignage de la divinité et de l’incarnation du Fils constitue donc un rôle caractéristique de l’Esprit de vérité et acquiert toute sa valeur du fait que l’Esprit, qui provient du Père, ne dépend pas du Fils quant à son origine. Ceci nous amène à examiner s’il y a une autorité du Saint Esprit distincte ou indépendante de celle du Fils et quelle serait alors leur relation.
On peut dire évidemment que le Fils et le Saint Esprit sont des révélations du Père qui est leur source commune. Les deux bras de Dieu, comme dit saint Irénée (2). Ainsi, le Fils monogène, qui est dans le sein du Père, nous fait connaître Dieu que personne n’a jamais vu (Jn 1, 18). Et c’est par le Père que lui a été donné tout pouvoir au ciel et sur la terre (Mt 28, 18) ainsi que le pouvoir de faire le jugement parce qu’il est le Fils de l’homme (Jn 5, 27), c’est-à-dire le Christ, Verbe incarné. L’Esprit Saint, qui provient du Père, est envoyé au monde par le Fils de la part du Père (Jn 15, 26) pour témoigner du Christ et nous conduire à la plénitude de la vérité (Jn 16, 13). Il n’est pas subordonné au Fils, comme provenant du Père, mais son action est coordonnée avec celle du Fils car les deux entendent ce que leur dit le Père (Jn 5, 30) et l’Esprit ne parle pas de lui-même, mais dit tout ce qu’il entend et nous annonce les choses à venir (Jn 16, 13). Et puisque tout ce qu’a le Père est au Christ, on peut dire, selon les paroles de notre Seigneur, que c’est de lui qu’il reçoit pour nous l’annoncer (Jn 16, 15). Mystérieuse unité dans la diversité des activités que l’Église orthodoxe, fidèle à la tradition des anciens pères, n’a jamais voulu trop rationaliser.
C’est dans ces perspectives d’activités trinitaires qu’il faut examiner les problèmes de l’autorité et de ses sources dans l’Évangile et la place qu’y tient le Saint Esprit en particulier. Faute de quoi, on tombe facilement dans l’erreur et la contradiction. soit, on oppose l’action du Saint Esprit à celle du Fils, soit, au contraire, on subordonne celle-ci à celle-là. Dans le premier cas, c’est une opposition entre autorité et liberté qu’on affirme, dont le Fils et le Saint Esprit sont considérés comme sources réciproques ; dans le second, c’est pratiquement une négation de tout élément charismatique et prophétique dans l’Église au profit d’un juridisme hiérarchique institutionnalisé. Ces deux points de vue sont évidemment erronés. D’abord, il est inexact d’établir une opposition entre le Fils et l’Esprit comme principes d’autorité et de liberté. Le Christ, étant la Vérité (Jn 14, 6), nous affranchit et donne la liberté réelle (Jn 8, 32-36) et, de son côté, le Saint Esprit est un esprit d’ordre, d’obéissance et d’unité. C’est par lui que le dépôt de la foi est gardé dans l’Église (2 Th 1, 14). Sans s’opposer au Fils, il parfait néanmoins son action en nous et révèle sa divinité. Cette fonction révélatrice et prophétique est propre au Saint Esprit et pose d’une manière particulière le problème de l’autorité dans l’Église. Le prophétisme ne la nie pas, l’Écriture nous montre que l’Esprit est lui aussi autoritaire, mais cette autorité s’exerce dans l’Esprit d’une manière plus intérieure et plus difficile à déterminer, plus encore à institutionnaliser. Rappelons-nous que les conciles œcuméniques qui détiennent l’autorité suprême dans l’Église ne furent jamais considérés comme des institutions ecclésiastiques permanentes, mais comme des événements prophétiques extraordinaires (3). L’Esprit de vérité donne à l’Église dans son ensemble une autorité infaillible, mais il n’y institutionnalise pas un organe infaillible. Il suscite aux moments de crise des personnages saints, qu’ils soient évêques, comme Athanase d’Alexandrie (ca. 299-373), ou simples moines, comme Maxime le Confesseur (580-662), pour défendre contre vents et marées la vérité menacée ou pour renouveler la vie spirituelle. Et c’est avec autorité que ces champions de la foi ou rénovateurs spirituels parlent et agissent. Mais étant aussi Esprit d’ordre et de paix, c’est par l’ensemble des successeurs des apôtres qui ont reçu l’Esprit Saint à la Pentecôte que le Saint Esprit dirige l’Église. Et il leur confie son autorité (Ac 15, 28). Tout ceci, évidemment, en union profonde avec le Christ de qui il prend du bien (Jn 16, 15), sur qui il repose (4) (Mt 12, 18; Jn 1, 33) et de qui il est inséparable dans sa procession du Père, source de toute autorité.
* Publié dans le Messager de l’exarchat du patriarche russe en Europe occidentale, n° 68 (1969), p. 205-209.
- En grec (πνεῦμά), comme en hébreu (ruah), le mot signifie « esprit » et « vent » (NdR).
- IRENEE DE LYON, Contre les hérésies, IV, 20, 1, t. II, Paris, Éd. du Cerf, coll. « Sources chrétiennes » n° 100, 1965, p. 626-627 (NdR).
- Voir « L’autorité et l’infaillibilité des conciles œcuméniques », p. XX-XX (NdR).
- Le « repos de l’Esprit sur le Christ » — c’est-à-dire la présence de l’Esprit dans le Fils, révélée lors du baptême dans le Jourdain et confirmée par Jésus lui-même (Lc 4, 18.21) — est la formulation traditionnelle orthodoxe du mode de relation du Christ à l’Esprit Saint. Due à saint Jean Damascène, la formule fut reprise par saint Grégoire Palamas et dans la célébration liturgique byzantine (aux grandes vêpres de la Pentecôte) (Voir B. BOBRINSKOY, Le Mystère de la Trinité, Paris, Éd. du Cerf, 1996, p. 104-105 et p. 303; J. LISON, L’Esprit répandu. La pneumatologie de Grégoire Palamas, Paris, Éd. du Cerf, 1994, p. 36) (NdR).
Suite « Dieu, l’homme, l’Église » Lecture des Pères Par Basile Krivochéine Les Éditions du « CERF » Paru en. Décembre 2010, 302 pages

Dès l’abord, il faut noter que pour la conscience orthodoxe et, en conséquence, pour la théologie orthodoxe, de même que pour la vie liturgique orthodoxe où celles-ci s’expriment, il est impossible de séparer l’œuvre salvatrice du Christ sur la croix et dans la résurrection de l’ensemble de son œuvre de salut. Cette œuvre de salut, en tant qu’expression de l’amour divin pour l’homme — lequel, bien qu’il fût déchu et se soit détourné de Dieu, reste cependant sa créature, faite à son image et à sa ressemblance — est une dans son essence et ses moments particuliers sont étroitement liés entre eux. l’incarnation, la mort sur la croix, la résurrection, l’ascension et enfin l’envoi de l’Esprit Saint de la part du Père — ce dernier moment n’appartenant déjà plus à la vie terrestre du Sauveur. Toutefois, dans la vie liturgique de l’Église, où s’exprime sa conscience théologique, on peut distinguer deux cycles liturgiques au cours desquels sont commémorés les événements fondamentaux de notre salut. le cycle consacré à la nativité et à la théophanie, autrement dit à l’incarnation du Verbe prééternel et à sa manifestation au monde (1), et le cycle consacré à la commémoration liturgique de la mort du Christ sur la croix, de sa résurrection au troisième jour, de son ascension et de l’envoi de l’Esprit Saint (2) — événement dont nous contemplons le fruit dans la fête de tous les saints qui vient conclure ce cycle. Le centre et le moment ultime de ce second cycle, comme d’ailleurs de toute l’année liturgique (3), est sans aucun doute la fête de la sainte Pâque, la glorieuse résurrection du Christ d’entre les morts. Nous allons, par conséquent, dans cet exposé nous concentrer sur ce cycle « pascal », sans oublier cependant son lien avec le cycle de l’incarnation.
Nous devons tout d’abord souligner que, pour la conscience théologique ecclésiale orthodoxe, toute l’œuvre du Christ, en particulier sa crucifixion sur la croix et sa mort rédemptrice, est un mystère insondable et inexprimable, son sens et sa portée ne peuvent être exprimés complètement et avec exactitude dans le langage des notions humaines sans risque d’être déformés ou réduits. Pour la raison humaine non éclairée par la grâce, la croix du Seigneur restera toujours quelque chose d’inacceptable et d’abject, alors que pour nous, croyants, elle est une « puissance invincible, indestructible et divine » (grandes complies) (4). Comme l’écrit l’apôtre Paul. « Les Juifs demandent des signes et les Grecs recherchent la sagesse, mais nous, nous prêchons un Christ crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les païens, mais pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs, il est le Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu » (1 Co 1, 22-24). Cette « folie » et cette « faiblesse » de la croix sont en réalité l’expression de l’extrême sagesse et de la force de Dieu, « car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes » (1 Co 1, 25) ; et c’est pour cela même qu’il est impossible de l’exprimer dans les notions humaines, impossible de le rationaliser jusqu’au bout sans déformer ou diminuer l’insondable profondeur du mystère de la croix. Dans ce sens, une tentative caractéristique de rationaliser l’œuvre salvatrice du Christ sur la croix et dans la résurrection apparaît dans la fameuse théorie « juridique » de la rédemption formulée par Anselme de Cantorbéry et qui, depuis l’Occident, a pénétré aussi dans de nombreux manuels de théologie orthodoxes. À la base de cette théorie se trouve la notion juridique de « satisfaction » (satisfactio), selon laquelle toute infraction de la loi ne peut être réparée que par voie d’une punition correspondante à la faute. Adam par sa faute a offensé la majesté divine. N’étant pas en état, en tant qu’homme, de fournir une satisfaction correspondante à la grandeur de la faute, il devait mourir d’une mort éternelle. La justice divine l’exigeait ainsi, elle exigeait un sacrifice égal à la dignité de Dieu. L’homme, en tant que créature, ne pouvait pas fournir un tel sacrifice. Seul le Fils de Dieu, consubstantiel au Père et son égal en dignité divine, pouvait, par sa mort sur la croix, apporter à Dieu le Père un sacrifice digne de sa grandeur. En vue de cela, le Fils de Dieu est devenu homme, a assumé la nature humaine et est mort sur la croix selon son humanité, car il ne pouvait pas mourir selon sa divinité. Autrement dit, le Fils de Dieu s’est incarné afin d’être capable de mourir sur la croix. Par sa mort, il a satisfait à l’exigence de la justice divine et, par son sang, il a lavé l’offense faite par Adam à la majesté de Dieu. Enfin les mérites du Fils de Dieu sur la croix sont imputés au genre humain et réconcilient Dieu avec l’homme et avec le monde en apaisant son juste courroux.
Cette théorie de la rédemption, exprimée dans une forme extrême, ne peut être acceptée par l’Église orthodoxe. Tout d’abord, elle porte un caractère unilatéralement juridique puisque toute l’œuvre du salut de l’homme y est conçue uniquement dans des notions de loi (commandement de Dieu), de transgression de la loi, de faute qui s’ensuit et de punition du fautif qu’exige une justice abstraite. De surcroît, ces prémisses juridiques sont empreintes de conceptions nettement féodales, propres à l’Occident du Moyen Âge, selon lesquelles une offense infligée à une personne appartenant à la classe sociale supérieure ne peut être effacée que par une personne ayant la même dignité sociale (l’institution du duel se fonde sur cette idée). La notion même d’une offense de la majesté de Dieu et de la nécessité de sa réparation est étrangère à l’Écriture Sainte et à la conception patristique de la rédemption. L’idée d’une satisfaction de la justice divine est plus acceptable mais, là aussi, dans la théorie anselmienne, il est difficile d’approuver la juxtaposition de la justice de Dieu et de l’amour de Dieu, deux forces en quelque sorte antagonistes se trouvant en lutte entre elles. Nous distinguons en Dieu de multiples actions, cependant elles ne sont pas antagonistes mais manifestent l’action une de Dieu. D’autre part, la croix non plus n’est pas seulement un instrument de punition et de supplice, manifestation du courroux de Dieu, mais elle est aussi une manifestation de son amour, un symbole de victoire et une arme de paix. Elle n’est pas seulement un fait de douleur, mais aussi un fait de joie. « Par la croix la joie est venue dans le monde entier », chante la sainte Église (5), car la croix conduit à la résurrection et est inséparablement liée à elle. Ceci est absent de la théorie juridique de la rédemption, qui ne fait presque aucune place à la résurrection. Plus exactement, pour le salut du genre humain elle y serait superflue, puisque la majesté divine offensée a obtenu réparation par le moyen de la croix et s’est ainsi réconciliée avec le monde. Alors qu’en réalité, « si le Christ n’est pas ressuscité, notre prédication est vide et vide aussi votre foi. […] Vous êtes encore dans vos péchés » (1 Co 15, 14 — 17). Enfin, dans une conception juridique de la rédemption, le sens de l’incarnation se réduit à ce que celle-ci a donné la possibilité à Dieu de mourir selon l’humanité. L’idée de l’incarnation en tant qu’union de la nature divine avec la nature humaine, en tant qu’intégration de la nature humaine dans l’hypostase divine du Logos et que déification — de notre nature humaine, de sorte que nous devenons « participants de la nature divine » (2 P 1, 4) — est perdue. Ou encore, comme le dit saint Athanase d’Alexandrie. « Car il [Dieu] s’est lui-même fait homme, pour que nous soyons faits Dieu (6). » Toute cette conception ontologique du salut, propre à la patristique orthodoxe, est perdue dans la conception juridique de la rédemption, où l’homme n’est pas régénéré par la force de la croix, n’est pas lavé par le sang du Christ, mais est simplement déclaré innocent grâce aux « mérites » du Christ sur la croix, qui lui sont imputés.
Néanmoins, on ne peut pas dire que la conception juridique de l’œuvre rédemptrice du Christ soit totalement fausse. Elle est unilatérale, incomplète et contient des éléments étrangers à l’Écriture sainte et à la tradition de l’Église (satisfactio, offense de la majesté divine, etc.), mais dans le fond elle traduit, quoique souvent dans une expression déformée, l’enseignement de la révélation. Le Fils de Dieu est effectivement mort volontairement sur la croix à cause de nos péchés et nous a rachetés par son sang. « Ce sont nos souffrances qu’il a portées, s’exclame prophétiquement Isaïe, ce sont nos douleurs qu’il a supportées, […] il était transpercé à cause de nos révoltes, broyé à cause de nos perversités. la sanction, gage de paix pour nous, était sur lui, et dans ses plaies se trouvait notre guérison. […] Et le Seigneur a fait retomber sur lui la perversité de nous tous. Brutalisé, il s’humilie. […] il a porté, lui, les fautes des foules et […] pour les pécheurs, il vient s’interposer » (Is 53, 4-7.12). Le Christ, à cause de nous, a pris sur lui la malédiction du péché, afin de nous faire don de la bénédiction divine. « Le Christ a payé pour nous libérer de la malédiction de la loi, en devenant lui-même malédiction pour nous, puisqu’il est écrit. maudit quiconque est pendu au bois. Cela pour que la bénédiction d’Abraham parvienne aux païens en Jésus Christ » (Ga 3, 13-14). Cette foi de l’Église dans la puissance rédemptrice et salvatrice de la croix, s’exprime dans la prière du prêtre à la proscomédie (7). « Tu nous as rachetés de la malédiction de la loi par ton précieux sang. Cloué sur la croix et percé de la lance, tu es devenu pour les hommes la source d’immortalité, ô notre Sauveur, gloire à toi (8) ! » Dans d’autres chants liturgiques est soulignée la force régénératrice de la croix qui rétablit le dessein prééternel de Dieu à l’égard de l’homme, compromis par la transgression d’Adam.
Venez, tous les peuples, prosternons-nous devant l’arbre de bénédiction, par lequel nous vient l’éternelle justification. car celui sous l’arbre défendu séduisit notre premier père jadis s’est laissé prendre au piège de la croix ; en quelle immense chute est entraîné celui qui imposa sa tyrannie au roi de la création ! Dieu lui-même par son sang efface le venin du serpent, et l’antique malédiction à juste titre méritée est annulée par l’injuste jugement qui condamne l’innocent. Le mal causé par un arbre jadis devait trouver guérison en l’arbre de la croix, et l’impassible par sa passion, délivrer de ses propres passions celui qui fut maudit sous l’arbre défendu. Gloire à ton œuvre de salut. par elle, ô Christ notre Dieu, tu as sauvé l’univers, dans ta divine bonté et ton amour pour les homes (9) ! (Fête de l’Exaltation de la croix, stichère (10) du lucernaire (11).)
On peut dire que ce stichère présente une synthèse d’une plénitude remarquable de la doctrine patristique de la rédemption, fidèle en tout point à la Sainte Écriture. Au centre se trouve ici la notion de l’éternelle justice de Dieu, comprise cependant non dans un sens juridique de réparation de l’offense envers la majesté divine par un sacrifice correspondant à la faute, mais dans le sens du rétablissement de ce qui a été corrompu, par une action contraire, quoique analogue, du Fils de Dieu (« le mal causé par un arbre jadis devait trouver guérison en l’arbre de la croix, […] Dieu lui-même par son sang efface le venin du serpent », etc.). La parole divine souligne, évidemment, que Dieu a livré son Fils à la mort en vue du salut du monde. « Le Seigneur a fait retomber sur lui la perversité de nous tous. […] Le Seigneur a voulu le broyer par la souffrance » (Is 53, 6-10). Ou encore, comme le dit le Christ lui-même. « Dieu, en effet, a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils, son unique, pour que tout homme qui croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle » (Jn 3, 16). Non point une justice abstraite, encore moins le besoin de réparation d’une offense de la majesté, mais un amour divin qui est la force motrice de l’inconcevable mystère qu’est le sacrifice de la croix du Fils de Dieu en vue du salut du monde. « Mais en ceci Dieu prouve son amour envers nous. Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Et puisque maintenant nous sommes justifiés par son sang, à plus forte raison serons-nous sauvés par lui de la colère » (Rm 5, 8-9). Dans le mystère de la croix, comme l’écrit le métropolite Philarète de Moscou, s’est exprimé « l’amour du Père crucifiant, l’amour du Fils crucifié, l’amour de l’Esprit Saint triomphant par la force de la croix. Car c’est ainsi que Dieu a aimé le monde (12) ».
La croix, en tant qu’expression suprême de l’amour divin, est la gloire et la force de Dieu. « Maintenant le Fils de l’homme a été glorifié, et Dieu a été glorifié par lui. Dieu le glorifiera en lui-même, et c’est bientôt qu’il le glorifiera » (Jn 13, 31-32), dit le Christ à ses disciples en allant aux souffrances et à la mort. Et cette gloire de la croix, comme on le voit dans ces paroles, est une gloire trinitaire, car Dieu le Père est glorifié dans la mort du Fils sur la croix. La descente du Saint Esprit est également liée à la glorification du Christ (« Il n’y avait pas encore d’Esprit, parce que Jésus n’avait pas encore été glorifié », Jn 7, 39). Voilà pourquoi, sur le mont Thabor, quand a été manifestée la gloire divine du Christ, Moïse et Élie, « apparus en gloire » dans la transfiguration, « parlaient de son départ qui allait s’accomplir à Jérusalem » (Lc 9, 31). La croix est aussi la « puissance » du Christ qui « donne sa mesure dans la faiblesse » (2 Co 12, 9). Sur la croix sont vaincus la mort et le péché. Le Seigneur sans péché, qui n’était pas soumis à la mort parce que, de l’Esprit Saint et de la Vierge Marie, il a pris la nature humaine du premier Adam non corrompue par le péché, ayant pour nous volontairement goûté la mort, nous libère du péché et de la mort. Il faut voir cette mort « volontaire » non seulement dans le sens que le Christ n’a pas résisté à ceux qui le crucifiaient, mais aussi dans le sens qu’étant invulnérable pour la mort, il est volontairement mort sur la croix selon son humanité. Il faut souligner avec toute la force nécessaire que sur la croix a été crucifié non pas un certain homme assumé par le Fils de Dieu (homo adsumptus), mais le Fils de Dieu lui-même, le Verbe même de Dieu incarné, le Seigneur de gloire, comme l’écrit l’apôtre Paul. « car s’ils l’[la « sagesse de Dieu, mystérieuse »] avaient connue, ils n’auraient pas crucifié le Seigneur de la gloire » (1 Co 2, 8). Le Christ, Fils de Dieu, est mort évidemment non selon sa divinité, mais selon l’humanité, et l’humanité du Christ a été assumée par sa personne divine, hypostasiée en lui. Pour cela, bien que la nature divine du Christ soit demeurée a-passionnelle pendant la passion et immortelle dans sa mort, ces souffrances ont cependant été inconcevablement assumées par le Fils de Dieu lui-même. Pour cela, nous pouvons dire que le Fils prééternel de Dieu incarné a authentiquement souffert et est mort sur la croix selon l’humanité, demeurant impassible selon la divinité. Et ceci est compréhensible, car ce n’était pas la divinité qui était déchue, mais l’homme. Ce n’est pas Dieu qui avait besoin de rédemption, mais Adam et tout le genre humain. Ceci est admirablement exprimé dans le canon (13) du samedi saint. « Au genre humain, non pas à la divinité la chute d’Adam porta un coup mortel ; et si ta chair a souffert en sa terrestre condition, impassible tu demeures en ta divinité […] à l’heure de ta passion, le temple de ton corps fut détruit, mais ta divinité resta unie à ta chair. en l’une et l’autre, tu es l’Homme-Dieu, le Fils et le Verbe de Dieu (14). »
La croix est le symbole de la victoire. « Arme de la paix, victoire invincible », comme le chante la sainte Église. Symbole de la victoire sur le diable et les puissances ténébreuses du mal. « Et vous, qui étiez morts à cause de vos fautes, écrit l’apôtre Paul aux Colossiens, et l’incirconcision de votre chair, [Dieu] vous a donné la vie avec lui [le Christ]. il nous a pardonné toutes nos fautes, il a effacé le document accusateur que les commandements retournaient contre nous, il l’a fait disparaître, il l’a cloué sur la croix. Il a dépouillé les Autorités et les Pouvoirs, il les a publiquement livrés en spectacle, il les a traînés dans le cortège triomphal de la croix » (Col 2, 13-15). Ainsi devant cette arme invincible de la puissance de Dieu — la croix du Seigneur — nous nous prosternons avec joie et amour. « En ce jour, s’avance la croix du Seigneur, chante la Sainte Église, et les fidèles l’accueillent avec amour […] dans la crainte et l’allégresse, embrassons-la. crainte, à cause de nos péchés et de notre indignité, allégresse à cause du salut que procure à l’univers celui qui sur elle fut cloué, le Seigneur de miséricorde, le Christ notre Dieu » (Fête de l’Exaltation de la croix, stichère aux laudes à « Gloire,… et maintenant… ») (15). La croix est la puissance divine d’amour et de sacrifice par laquelle subsiste le monde. Elle illumine toutes les extrémités de l’univers. « Les quatre extrémités du monde sont sanctifiées, ô Christ notre Dieu, en ce jour où est exaltée ta croix à quatre branches » (Fête de l’Exaltation, stichère pour la vénération de la croix). Ceci dans le plan cosmique, et dans le plan historique et providentiel. « Croix, gardienne de tout l’univers ; croix, de l’Église le charme et la beauté, sceptre vraiment royal, qui soutient la vigueur de notre foi ; croix, le suprême effroi des légions de l’enfer ; croix, la gloire des anges dans le ciel » (exapostilaire (16) de la fête de l’Exaltation) (17). Cette puissance divine de la croix agissait dès l’origine, avant même le Golgotha. On peut dire que nous la percevons dans la création même du monde et de l’homme, dans la limitation volontaire de la divinité. La croix est inscrite dans la forme du corps humain. Dans l’Ancien Testament, nous voyons des préfigurations de la croix dans l’arbre de la vie au paradis, dans la bénédiction de Jacob, dans le bâton de Moïse, dans l’élévation cruciforme des bras de Moïse pendant le combat avec Amalek, dans le serpent d’airain, etc. Mais seulement sur le Golgotha, dans la mort volontaire sur la croix du Fils de Dieu incarné, s’est pleinement manifestée pour nous cette puissance incompréhensible et invincible de l’amour de Dieu envers l’homme, de sorte que, si en Dieu il « n’existe aucun changement, ni l’ombre d’une variation » (Jc 1, 17), pour nous cependant, « rachetés […] par le sang précieux, comme d’un agneau sans défaut et sans tache, celui du Christ, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. » (1 P 1, 18-20), le sacrifice du Christ sur la croix constitue le début d’une vie nouvelle.
Ici nous approchons du sens le plus profond et le plus mystérieux de la mort du Seigneur sur la croix. sa mort sur la croix en tant que sacrifice. Sacrifice pour qui ? Pour les hommes et pour leur salut, comme dit le Christ. « Car le Fils de l’homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude » (Mc 10, 45). « Car le Christ, notre Pâque, a été immolé » (1 Co 5, 7). Mais c’est dans l’épître aux Hébreux que le sens sacrificiel de la mort sur la croix est développé de la manière la plus complète, en tant que sacrifice du souverain prêtre offert une fois par le Christ dans l’Esprit Saint, qui nous a procuré la rédemption éternelle. « Mais le Christ est survenu, grand prêtre des biens à venir […], par son propre sang, […] il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire et […] a obtenu une libération définitive. […] Combien plus le sang du Christ qui, par l’esprit éternel, s’est offert lui-même à Dieu comme une victime sans tache, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes pour que nous rendions un culte au Dieu vivant. Voilà pourquoi il est médiateur d’une alliance nouvelle, d’un testament nouveau ; sa mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui sont appelés peuvent recevoir l’héritage éternel déjà promis » (He 9, 11-12; 14-15). L’épître aux Hébreux revient à plusieurs reprises sur ce thème du sacrifice rédempteur et purificateur, offert une fois pour toutes pour le péché. « [Le Christ] l’a fait une fois pour toutes en s’offrant lui-même » (He 7, 27). « C’est à la fin des temps, qu’il a été manifesté pour abolir le péché par propre son sacrifice » (He 9, 26-27). « Nous sommes sanctifiés par l’offrande du corps de Jésus Christ, faite une fois pour toutes » (He 10, 10). Il est important de remarquer ici que — de par la mention, un grand nombre de fois, du caractère unique du sacrifice du Christ et l’affirmation, en même temps, que le Christ est le grand prêtre du Nouveau Testament — est exprimée l’idée que la mort du Christ sur la Croix est le début de quelque chose d’absolument nouveau dans les relations de Dieu et de l’homme. Par ailleurs, l’affirmation que le Fils de Dieu s’est offert en sacrifice à Dieu le Père par l’Esprit Saint atteste le caractère trinitaire de la mort sur la croix ou, plus exactement, nous percevons là l’action de la Sainte Trinité, venant du Père et accomplie par le Fils dans le Saint Esprit.
Quelle est la nature de ce sacrifice de rédemption et d’action de grâce de l’amour divin ? À qui a-t-il été offert ? Les Pères ont beaucoup écrit et discuté, sans être toujours d’accord, sur cette question. On peut dire cependant que la doctrine ecclésiale est le mieux exprimée, dans sa forme complète, par saint Grégoire le Théologien dans son quarante-cinquième sermon pour la sainte Pâque. « À qui et pour quoi a été versé pour nous le sang précieux et illustre de Dieu, souverain sacrificateur et victime ? Car nous nous trouvions au pouvoir du malin, vendus au péché, et nous avons reçu à la place du mal la béatitude. Et si la rançon ne se paie à aucun autre qu’au ravisseur, je demande, à qui a-t-elle été payée et pour quelle raison ? Si c’est au malin, alors, hélas, quelle vexation […]. Et si c’est au Père, alors, tout d’abord, comment ? Car ce n’est pas lui qui nous avait faits prisonniers […]. Ou alors, il est évident que le Père la reçoit, lui qui n’avait pas demandé et pour qui elle n’était pas nécessaire, mais en vue du salut de l’homme et parce qu’il était indispensable que l’homme fût sanctifié par l’humanité de Dieu, pour que Dieu nous libérât du tyran, l’ayant vaincu par la force, et nous amenât à lui à travers le Fils (18). » Dans ce remarquable témoignage patristique, Grégoire de Nazianze rejette les excès de la conception juridique du salut, qu’il conçoit comme un acte libre de l’amour divin ; il met l’accent sur la puissance victorieuse de la croix et souligne avec une force particulière son mystère, son caractère ineffable et inconcevable.
L’épître aux Hébreux, parlant du sacrifice du Christ sur la croix, le lie avec sa glorification consécutive. le Christ, « après avoir offert pour les péchés un sacrifice unique, siège pour toujours à la droite de Dieu » (He 10, 12), ou bien. « renonçant à la joie qui lui revenait, endura la croix au mépris de la honte, et s’est assis à la droite du trône de Dieu » (He 12, 2). En effet, la mort du Christ sur la croix est inséparablement liée à sa résurrection, ne se conçoit pas sans elle. Elle est sa condition, le chemin vers elle. Le Christ lui-même nous l’apprend. « En vérité, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt pas, il reste seul ; si au contraire il meurt, il porte du fruit en abondance » (Jn 12, 24). Et la piété de l’Église orthodoxe réunit la vénération de la croix avec la glorification de la résurrection. « Devant ta croix nous nous prosternons, ô Maître, et nous chantons ta sainte résurrection ! » C’est justement dans la résurrection qu’est révélée la force génératrice de joie de la croix. « Venez, tous les fidèles », chantons-nous chaque dimanche aux matines, « Vénérons la sainte résurrection du Christ, car voici que par la croix la joie est venue dans le monde entire (19). » Dans la résurrection, l’œuvre salutaire du Christ, sa victoire sur la mort et sur l’enfer, s’accomplissent en acte, deviennent manifestes. Pour cela, la résurrection du Christ représente la plénitude et le moment ultime de l’économie divino-humaine qui commence avec l’incarnation et s’achève dans l’ascension. Il est vrai que déjà sur la croix, avant même sa mort, le Christ avait dit. « « Tout est achevé » et, inclinant la tête, il remit l’esprit » (Jn 19, 30), mais c’est bien parce que, ainsi que nous pouvons le comprendre, la mort et la résurrection imminentes ne faisaient plus qu’un pour lui dans l’action du salut. Voilà pourquoi la résurrection du Christ a été le contenu essentiel de la prédication apostolique, a été cette « éternelle nouvelle », selon l’expression du métropolite Philarète, que les apôtres annonçaient et que l’Église, à leur suite, annonce au monde. « Je vous ai transmis en premier lieu ce que j’avais reçu moi-même. Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures », écrit l’apôtre Paul aux Corinthiens (1 Co 15, 3-4). À l’Aréopage de même, Paul annonçait aux Athéniens « Jésus et la résurrection » (Ac 17, 18). Ainsi le Seigneur également témoigne de lui-même dans l’Apocalypse. « Je suis le Premier et le Dernier, et le Vivant ; je fus mort, et voici, je suis vivant pour les siècles des siècles, et je tiens les clés de la mort et de l’Hadès » (Ap 1, 18). La foi en la résurrection du Christ, vainqueur de la mort et de l’enfer, est à tel point centrale pour le christianisme que sans elle celui-ci devient absurdité et tromperie, comme l’atteste l’apôtre Paul. « Si le Christ n’est pas ressuscité, notre prédication est vide et vide aussi votre foi. […] Vous êtes encore dans vos péchés » (1 Co 15, 14 — 17).
L’œuvre salutaire de la résurrection commence dans le Christ lui-même, et à partir de lui s’étend au monde entier. Ayant volontairement accepté la mort, et « par la mort terrassé la mort », le Christ en triomphe par sa résurrection d’entre les morts. La divinité du Christ, qui demeure sans séparation avec le Père et le Saint Esprit, après sa mort ne se sépare pas non plus de son âme ni de son corps auquel il s’est uni dans l’incarnation, bien que son âme s’en détache. « Dans le tombeau corporellement, dans les enfers, en âme, comme Dieu, au paradis avec le larron, tu étais sur le trône avec le Père et l’Esprit, ô Christ, qui remplis tout et qu’aucun lieu ne peut contenir » (Office des heures pascales). Dans la résurrection, l’âme du Christ s’unit à nouveau avec le corps et le Christ ressuscite corporellement en tant qu’unique Dieu-homme dans la plénitude de sa divinité et de son humanité. La foi chrétienne insiste particulièrement sur le fait de la résurrection corporelle du Christ. L’idée d’une immortalité abstraite de l’âme, de même que l’idée que l’homme est un esprit incarné, voire un esprit emprisonné dans la prison qu’est le corps, sont des idées étrangères au christianisme. L’homme est créé dès l’origine comme un être spirituo-corporel complexe. Cette nature humaine spirituo-corporelle complexe, le Fils de Dieu l’a assumée dans son hypostase divine. Et le Christ ressuscite dans toute la plénitude de son humanité. C’est-à-dire, en premier lieu, corporellement, car le corps était soumis à la mort et à la corruption et c’est dans le corps qu’il fallait triompher de la corruption et de la mort. La résurrection du Christ est encore plus inconcevable que sa mort sur la croix, car si dans la mort du Christ nous ne pouvons pas saisir jusqu’au bout et exprimer dans des concepts toute la profondeur de son sens, la résurrection, elle, est inconcevable et non représentable comme telle. Pour cela, nous représentons sur les icônes la crucifixion du Seigneur, ou la descente de la croix, mais dans la tradition iconographique authentiquement orthodoxe il n’existe pas de représentation du moment même de la résurrection du Christ ; seules sont représentées sa descente victorieuse en enfer et son apparition aux femmes myrrophores. Il ne faut pas en conclure, comme le font certains, que l’Église orthodoxe ne reconnaîtrait pas le caractère historique de la résurrection du Christ et y verrait simplement une sorte d’événement dans l’éternité que nous percevons d’une manière symbolique. Pour avoir une conception juste de la résurrection du Christ, nous devons éviter de tomber dans deux extrêmes. La résurrection du Christ est certainement un fait historique concret qui a eu lieu une seule fois, en un lieu et à un moment précis. Celui qui nie cela, rejette l’Évangile, la prédication des apôtres et la foi de l’Église. Mais en même temps la résurrection du Christ n’est pas seulement un fait historique, elle est quelque chose d’infiniment plus grand, quelque chose qui a un sens supra-historique, elle est une action divine, ou plus exactement divino-humaine, créatrice et transformatrice, pas seulement histoire mais aussi métahistoire. On ne peut pas, d’autre part, réduire la réalité de la résurrection du Christ à un retournement intérieur qui aurait eu lieu dans l’âme des apôtres, ni à des visions subjectives du ressuscité exprimant cet état. Non, au troisième jour le tombeau a été trouvé vide, le corps mort est revenu à la vie et est ressuscité, comme l’ange en a fait part aux femmes. « Vous cherchez Jésus le Nazaréen, le crucifié. il est ressuscité, il n’est pas ici. Voyez l’endroit où on l’avait déposé » (Mc 16, 6). Ou bien. « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts ? Il n’est pas ici mais il est ressuscité » (Lc 24, 5-6). Et la sainte Église jusqu’à ce jour chante avec les anges. « La myrrhe convient aux morts, mais le Christ s’est montré étranger à la corruption » (samedi saint). D’autre part, la résurrection du Christ n’est pas la simple « réanimation d’un cadavre », où le mort revient à la même vie antérieure et par la suite meurt à nouveau (ce qu’ont été la résurrection de Lazare et d’autres, qui possèdent par ailleurs un sens préfiguratif et sont ainsi liées à la résurrection du Christ et à la future résurrection générale des morts), mais la résurrection est une transfiguration créatrice d’un corps psychique en un corps spirituel doué de nouvelles facultés et appartenant au siècle futur et, de ce fait seulement visible pour les yeux éclairés par la lumière de la foi. Un corps spirituel, non appesanti par la matérialité et capable de traverser les portes fermées, non pas un autre corps, mais le même qui a été crucifié et cloué sur la croix, comme le Seigneur ressuscité l’a montré à l’apôtre Thomas l’invitant à toucher sur son corps ressuscité « les marques des clous » et la plaie faite avec la lance. Et alors convaincu que celui qui lui apparaît est effectivement le Christ crucifié sur la croix, l’apôtre Thomas s’exclame. « Mon Seigneur et mon Dieu ! » (Jn 20, 28).
La résurrection du Christ est le commencement de la résurrection générale des morts, comme le montre l’apôtre Paul en 1 Co 15. L’une découle de l’autre et s’y trouve inséparablement liée. « Si les morts ne ressuscitent pas, Christ non plus n’est pas ressuscité » (1 Co 15, 16). L’apôtre Paul nous enseigne que le Christ est le second Adam et un homme céleste, par opposition au premier Adam qui a péché et qui est mort. Par sa résurrection, le Christ relève Adam déchu. « Mais non ; Christ est ressuscité des morts, prémices de ceux qui sont morts. En effet, puisque la mort est venue par un homme, c’est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. comme tous meurent en Adam, en Christ tous recevront la vie » (1 Co 15, 20-22). Par la puissance transfigurante de la résurrection du Christ, nos corps seront changés, et de psychiques qu’ils étaient, ils deviendront spirituels, et de corruptibles qu’ils étaient, ils deviendront incorruptibles, de même que le corps du Christ s’est transformé dans sa résurrection. Ce changement général du cosmos et son passage du plan d’existence matériel dans le plan spirituel — mais nullement désincarné —, ce passage de la corruption à l’incorruptibilité, est fondamental dans notre conception de la puissance de la résurrection du Christ. Ayant précisé qu’il y a « un corps psychique et un corps spirituel », l’apôtre Paul écrit. « Il en est ainsi pour la résurrection des morts. semé corruptible, on ressuscite incorruptible ; semé méprisable, on ressuscite dans la gloire; semé dans la faiblesse, on ressuscite plein de force. S’il y a un corps psychique, il y a aussi un corps spirituel. C’est ainsi qu’il est écrit. « Le premier homme, Adam, fut un animal doué de vie » (Gn 2, 7) ; le dernier Adam est un être spirituel donnant la vie. » (1 Co 15, 42-45). Malgré toutes les comparaisons avec le monde naturel (la germination du grain, etc.), la résurrection générale des morts demeure néanmoins un mystère insaisissable, et la puissance de la résurrection du Christ se manifeste pleinement dans la situation eschatologique de la « fin », quand le Christ aura vaincu tous ses ennemis et Dieu sera « tout en tous » (1 Co 15, 28). « Je vais vous faire connaître un mystère », conclut l’apôtre Paul dans son chapitre sur la résurrection des morts, « nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés, en un instant, en un clin d’œil, au son de la trompette finale. Car la trompette sonnera, les morts ressusciteront incorruptibles, et nous, nous serons transformés. Il faut, en effet, que cet être corruptible revête l’incorruptibilité, et que cet être mortel revête l’immortalité. Quand donc cet être corruptible aura revêtu l’incorruptibilité et que cet être mortel aura revêtu l’immortalité, alors se réalisera la parole de l’Écriture. « La mort a été engloutie dans la victoire » [Is 25, 8]. « Mort, où est ta victoire ? Mort, où est ton aiguillon ? » [Os 13, 14]. L’aiguillon de la mort, c’est le péché et la puissance du péché, c’est la loi. Rendons grâce à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus Christ ! » (1 Co 15, 51-57). Saint Jean Chrysostome glorifie ainsi cette victoire finale du Christ ressuscité dans son homélie pour la sainte Pâque. « Le Christ est ressuscité et tu as été terrassé. Le Christ est ressuscité et les démons sont tombés ; le Christ est ressuscité et les anges sont dans l’allégresse ; le Christ est ressuscité et voici que règne la vie ; le Christ est ressuscité et tous les morts quittent le tombeau. Oui, le Christ est ressuscité des morts, prémices de ceux qui se sont endormis (20). »
La puissance salvatrice de la résurrection du Christ, qui apparaît pleinement lors du second avènement et de la résurrection générale des morts, agit cependant dès maintenant aussi d’une manière invisible ; depuis le moment même de la résurrection du Christ, son action salvatrice, qui a son achèvement dans l’ascension quand le Fils de Dieu incarné s’assied à la droite de Dieu le Père, élève sur son trône la nature humaine qu’il a déifiée et assumée dans son hypostase et, de la part du Père, envoie le Saint Esprit qui sanctifie le monde. Cette action salvatrice édifie déjà sur la terre le commencement de la vie éternelle et prépare la résurrection des morts. La vie éternelle, comme l’écrit Nicolas Cabasilas, commence ici-bas, quoique dans sa plénitude elle ne sera révélée que dans le siècle future (21). Cette puissance de la résurrection du Christ, la puissance de la vie éternelle, se manifeste en premier lieu dans l’Église et dans ses sacrements. Dans le sacrement du baptême, par la triple immersion dans l’eau nous mourons et sommes ensevelis avec le Christ, et en sortant de l’eau nous ressuscitons avec lui. Nous devenons participants de sa mort et de sa résurrection. « Ou bien ignorez-vous que nous tous, baptisés en Jésus Christ », écrit l’apôtre Paul aux Romains, « c’est en sa mort que nous avons été baptisés ? Par le baptême, en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, nous menions nous aussi une vie nouvelle. Car si nous avons été totalement unis, assimilés à sa mort, nous le serons aussi à sa résurrection. » (Rm 6, 3-5). Dès ici-bas, nous marchons dans une vie rénovée et elle nous donne l’assurance de la résurrection au dernier jour. « Mais si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons en effet. ressuscité des morts, Christ ne meurt plus ; la mort sur lui n’a plus d’empire » (Rm 6, 8-9).
Mais cette mort-résurrection avec le Christ que réalise le baptême devient effective seulement lorsque nous mourons effectivement au péché et commençons une nouvelle vie. « De même, vous aussi », nous instruit l’apôtre Paul, « considérez que vous êtes morts au péché et vivants pour Dieu en Jésus Christ » (Rm 6, 11). Le baptême est la naissance pour la vie éternelle. « En vérité, en vérité, je te le dis. nul, s’il ne naît d’eau et d’Esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu » (Jn 3, 5). Le sacrement de l’eucharistie est également un sacrement de la mort et de la vie du Christ, et en même temps proclamation de son œuvre de salut et attente de son second avènement. « Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, jusqu’à ce qu’il vienne » (1 Co 11, 26). La communion aux saints mystères du Christ est la source et le gage de notre résurrection, comme en témoigne le Seigneur lui-même. « Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l’homme, et si vous ne buvez son sang, vous n’aurez pas en vous la vie. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. […] Celui qui mangera du pain que voici vivra pour l’éternité » (Jn 6, 53-54.58). Voilà pourquoi saint Ignace d’Antioche appelle le corps et le sang du Christ « remède d’immortalité, un antidote pour ne pas mourir (22) ».
Dans les écrits spirituels patristiques, nous trouvons également beaucoup de témoignages qui affirment que dès maintenant la puissance de la résurrection du Christ agit dans les âmes et dans les corps des saints, anticipant en eux la résurrection générale. Ainsi saint Jean Climaque, en parlant de l’acquisition de l’état a-passionnel, l’appelle « résurrection de l’âme avant la résurrection générale (23) ». Saint Macaire d’Égypte nous enseigne que « le royaume de la lumière et l’image céleste, Jésus Christ, illuminent maintenant mystiquement l’âme et règnent dans l’âme des saints ; caché aux yeux des hommes, le Christ n’est vraiment visible qu’aux yeux de l’âme, jusqu’au jour de la résurrection, où le corps lui-même sera enveloppé et glorifié par la lumière du Seigneur, lumière qui est déjà dans l’homme quant à son âme, afin que le corps lui aussi règne conjointement avec l’âme, laquelle reçoit dès à présent le royaume du Christ (24) ».
Saint Syméon le Nouveau Théologien, dans son sermon pour Pâques, dit que « le mystère de la résurrection du Christ, notre Dieu, […] sans cesse, si nous le voulons, se reproduit mystiquement en nous » et explique « comment le Christ est enseveli en nous comme en un tombeau, et comment il s’unit à nos âmes et ressuscite, en nous faisant ressusciter avec lui (25) ». « Lorsqu’en effet cela [que le Christ se montre et se fait voir pour le regard spirituel] se produit par l’Esprit, il nous ressuscite des morts, nous vivifie, et se donne lui-même à voir, tout entier, vivant en nous, lui l’immortel et impérissable (26). » Dans ces affirmations des Pères inspirés se révèle essentiellement l’aspect personnel de l’action de la résurrection du Christ, l’anticipation de la résurrection générale dans chaque homme, individuellement. Par ailleurs, leurs propos, et particulièrement les textes liturgiques orthodoxes, soulignent, à côté de cet aspect personnel, les changements créateurs (« Voici, je fais toutes choses nouvelles », Ap 21, 5) que dès maintenant la résurrection du Christ — fût-elle perceptible aux seuls yeux de la foi — opère dans l’univers visible et invisible, et qui manifestent son caractère cosmique. Ceci est vrai tout spécialement de l’office de la sainte Pâque, « fête des fêtes et solennité des solennités », composé par saint Jean Damascène en majeure partie sur la base du « Sermon pour Pâques » de saint Grégoire le Théologien. La résurrection du Christ, Pâque néo-testamentaire, y est conçue comme un passage à une vie nouvelle. « Jour de la résurrection ! Peuples, rayonnons de joie ! C’est la Pâque, la Pâque du Seigneur ! De la mort à la vie, de la terre jusqu’au ciel, le Christ notre Dieu nous conduit. chantons la victoire du Seigneur » (Canon de Pâques, première ode) (27). Le monde entier est rempli de la lumière de la résurrection du Christ. « De lumière maintenant est rempli tout l’univers, au ciel, sur terre et aux enfers ; que désormais toute la création célèbre la résurrection du Christ, notre force et notre joie » (Troisième ode) (28). La nuit pascale elle-même, avec sa solennité, est une préfiguration de la résurrection générale, elle a une profonde signification eschatologique. « Qu’elle est sainte et belle, cette nuit de notre rédemption, radieuse messagère du jour rayonnant de la résurrection, où sortant du tombeau corporellement brilla sur le monde l’éternelle clarté » (Septième ode) (29). À côté de ce caractère universel et tout englobant de la résurrection, les hymnes pascales indiquent la nécessité de notre propre participation dans les souffrances et la résurrection du Christ, afin que nous puissions aussi partager sa gloire et sa joie. « Hier, avec toi, ô Christ, j’étais enseveli », nous exclamons-nous dans la nuit pascale en répétant les paroles de saint Grégoire le Théologien, « avec toi je me réveille aujourd’hui, prenant part à la résurrection ; après les souffrances de ta crucifixion, accorde-moi de partager, Sauveur, la gloire du royaume des cieux » (Troisième ode) (30). Et enfin, la joie et la lumière de la nuit pascale ne s’arrêtent pas aux murs de l’église mais pénètrent toute notre vie par l’esprit de fraternité, d’amour et de pardon. « Jour de la résurrection ! Soyons rayonnants de lumière en cette fête, et embrassons-nous les uns les autres. Appelons « frères » même ceux qui nous haïssent. Pardonnons tout à cause de la résurrection et crions ainsi. « Le Christ est ressuscité des morts, par la mort il a vaincu la mort, à ceux qui sont dans les tombeaux il a donné la vie (31) ! » »
* Exposé présenté à la commission interorthodoxe de dialogue théologique avec les anglicans (Chambésy-Genève, 1972) et publié dans le Messager de l’exarchat du patriarche russe en Europe occidentale, n° 78-79 (1972), p. 106-120.
- Voir Catéchèse orthodoxe. Les Fêtes et la Vie de Jésus Christ, t. 1. L’incarnation, Paris, Éd. du Cerf, coll. « Orthodoxie », 1985.
- Voir Catéchèse orthodoxe. Les Fêtes et la Vie de Jésus Christ, t. 2. La résurrection, Paris, Éd. du Cerf, coll. « Orthodoxie », 1989.
- Sur l’année liturgique orthodoxe, voir UN MOINE DE L’ÉGLISE D’ORIENT, L’An de grâce du Seigneur, Paris, Éd. du Cerf, coll. « Orthodoxie », 1988.
- « Office des grandes complies », dans Livre des Heures, Éd. Fraternité orthodoxe en Europe occidentale, Colombes, 2000, p. 43.
- Stichère après l’Évangile (aux vigiles dominicales) dans « Office des matines avec grande doxologie », Livre des Heures, loc. cit., p. 138 (NdR).
- ATHANASE D’ALEXANDRIE, Sur l’incarnation du Verbe, LIV, 3, Paris, Éd. du Cerf, coll. « Sources chrétiennes » n° 199, 1973, p. 459.
- Office de la préparation des saints dons (le pain et le vin) pour la célébration eucharistique (NdR).
- La Divine Liturgie de saint Jean Chrysostome, Éd. Liturgica, Paris, 1999, p. 10.
- Le Spoutnik. Nouveau Synecdimos, Parme, Éd. Diaconie apostolique, 1997, p. 794-795.
- Verset de psaume ou strophe intercalée entre les derniers versets des psaumes aux vêpres et aux matines (NdR).
- À l’origine, moment de la journée où l’on allume les lampes ; actuellement, partie de l’office des vêpres (NdR).
- Saint PHILARETE (DROZDOV), métropolite de Moscou, Homélie pour le vendredi saint, trad. fr. dans le Messager de l’Église orthodoxe russe, n° 2 (2007), p. 17.
- Au départ, liste canonique des odes scripturaires utilisées dans la célébration des matines, puis l’ensemble de ces odes et les compositions poétiques qui s’y sont greffées (NdR).
- Ode 6 du canon. Triode de Carême, Parme, Éd. Diaconie apostolique, 19933, p. 589.
- Le Spoutnik, loc. cit., p. 803.
- Tropaire précédant les laudes après le canon des matines (NdR).
- Le Spoutnik, loc. cit., p. 802.
- GREGOIRE DE NAZIANZE, Sermon XLV, 22 (PG 36, col. 653 AB).
- Voir la n. 3 (NdR).
- La prière des Églises de rite byzantin. Nuit de Pâques, Éd. de Chevetogne, 1974, p. 39 (NdR).
- NICOLAS CABASILAS, La Vie en Christ, 1, 1-5, t. I, Paris, Éd. du Cerf, coll. « Sources chrétiennes » n° 355, 1989, p. 75.
- IGNACE D’ANTIOCHE, Lettres (Martyre de Polycarpe), « Aux Éphésiens », XX, 2, Paris, Éd. du Cerf, coll. « Sources chrétiennes » n° 10bis, 1998, p. 77.
- Sermon XXIX (PG 88, 1148 A).
- Les Homélies spirituelles de saint Macaire. Le Saint Esprit et le chrétien, II, 5, trad. P. Deseille, Éd. de l’Abbaye de Bellefontaine, coll. « Spiritualité orientale » n° 40, 1984, p. 100-101.
- Cat., XIII, 36-40, dans Catéchèses, t. II, Paris, Éd. du Cerf, coll. « Sources chrétiennes » n° 104, 1964, p. 193.
- Cat., XIII, 120-122, loc. cit., p. 201.
- Nuit de Pâques, loc. cit., p. 16.
- Nuit de Pâques, loc. cit., p. 18.
- Nuit de Pâques, loc. cit., p. 28.
- Nuit de Pâques, loc. cit., p. 18.
- Stichères de Pâques, dans Nuit de Pâques, loc. cit., p. 36.
Suite : « Dieu, l’homme, l’Église » Lecture des Pères Par Basile Krivochéine Les Éditions du « CERF » Paru en. Décembre 2010, 302 pages

I. Sources de l’autorité et de l’infaillibilité des conciles œcuméniques
Quelles sont les sources de l’autorité des conciles œcuméniques, le fondement de leur infaillibilité ? La seule réponse orthodoxe possible à cette question si importante doit être. le Christ, l’Esprit Saint, l’Église. Le Christ, le « Verbe » de Dieu, nous révélant le Père (Mt 11, 27) et étant lui-même « la voie, la vérité et la vie » (Jn 14, 6) dont le Père a dit. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé… écoutez-le » (Mt 17, 5), qui « enseign[e les foules] comme ayant autorité » (Mt 7, 29). Avant son ascension, il a promis aux apôtres de demeurer avec eux à jamais. « Je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde » (Mt 28, 20). Le Christ, en tant que chef de l’Église qui est son corps, demeure toujours avec elle par son Esprit Saint qu’il a envoyé de son Père aux apôtres. C’est ce Saint Esprit qui enseigne toute la vérité à l’Église, car il est « l’Esprit de vérité » (Jn 14, 17). « Mais quand il viendra, l’Esprit de vérité vous introduira comme un guide dans la vérité entière » (Jn 16, 13), dit le Seigneur, en promettant aux apôtres qu’ils seront conduits par l’Esprit Saint. L’Église, dont le chef est le Christ lui-même, et qui est le temple du Saint Esprit, ne peut se tromper. C’est là une croyance fondamentale de l’Église orthodoxe. Et les conciles sont l’expression suprême et la plus pleine de l’Église une, sainte, catholique et apostolique, que le Christ a « aimée », « sanctifiée », « pour se préparer une Église resplendissante, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et immaculée » (Ep 5, 25-27).
Le Christ a également béni et sanctifié la voie de la conciliarité (sobornost) en disant. « Car, là où deux ou trois se trouvent réunis en mon nom, je suis au milieu d’eux » (Mt 18, 20). Le Christ, ayant promis à Pierre que « sur cette pierre (1) je bâtirai mon Église, et les portes de l’enfer ne prévaudront point contre elle » (Mt 16, 18), lui donne le pouvoir de lier et de délier. Il donne également ce même pouvoir à tous les apôtres dans leur ensemble, conciliairement, disant. « Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur terre sera lié au ciel, et tout ce que vous délierez sur terre sera délié au ciel » (Mt 18, 18). Sous un aspect négatif, ce pouvoir suprême de l’Église de lier et de délier est ainsi formulé par le Christ. « S’il [le frère] ne veut pas les écouter, dis-le à l’Église ; que s’il n’écoute pas l’Église non plus, traite-le comme un païen et un publicain » (Mt 18, 17). Dans bien des passages du Nouveau Testament, les apôtres apparaissent comme étant investis de pouvoir par le Christ lui-même, et ces passages soulignent la nécessité de leur obéir, ainsi qu’à leurs successeurs. « Qui vous écoute m’écoute, qui vous méprise me méprise, et qui me méprise, méprise celui qui m’a envoyé » (Lc 10, 16). Les apôtres ont été revêtus de « force » lorsque l’"Esprit Saint" est descendu sur eux (Ac 1, 8). Ils ont également reçu du Seigneur le commandement d’être ses « témoins […] jusqu’aux extrémités de la terre » (Ac 1, 8). Après la Pentecôte, après que la plénitude du Saint Esprit fut sur eux et lorsque les besoins de l’Église l’exigèrent, ils ont convoqué à Jérusalem un concile (Ac 15), modèle de tous les conciles œcuméniques d’Église à venir. À ce concile, avec audace et de plein droit, les apôtres ont proclamé qu’"il a paru bon, à l’Esprit Saint et à nous" (Ac 15, 28) de décider, de trancher de la façon dont nous l’avons fait. En résumé, l’autorité et l’infaillibilité des conciles œcuméniques en tant qu’expression de l’autorité et de l’infaillibilité de l’Église dans sa plénitude ont leurs racines dans l’Écriture Sainte.
II. L’Écriture Sainte et les conciles œcuméniques
La relation entre l’Écriture Sainte et les décisions des conciles œcuméniques du point de vue de leur autorité réciproque a été largement commentée chez les anglicans, elle l’a été moins chez les orthodoxes. Pour les anglicans, il existe à cet égard un document fondamental. l’article 21 de la foi qui proclame que les décisions des conciles n’ont ni force ni autorité s’il est impossible de prouver qu’ils ont leur source dans l’Écriture Sainte (2). En d’autres termes, toute autorité en soi est refusée aux conciles. De façon générale, il semble que les anglicans reconnaissent les décisions des conciles œcuméniques du moment qu’elles ne sont pas en contradiction avec l’Écriture Sainte, sans toutefois préciser qui possède la compétence pour décider si une telle contradiction existe ou n’existe pas (un autre concile, ou chaque chrétien individuellement ?). Autrement dit, une autorité dérivée et moindre est reconnue, dans tous les cas, à certaines décisions conciliaires, en comparaison avec l’autorité de l’Écriture Sainte. Du côté orthodoxe, bien qu’il n’y a jamais eu de décision globale à ce sujet, on affirme souvent que les décisions dogmatiques des conciles œcuméniques ont une autorité et une force égales à celles de l’Écriture Sainte, car ces décisions expriment la tradition ecclésiastique authentique qui, ensemble avec l’Écriture Sainte, forment deux sources de la foi orthodoxe d’autorité égale (3).
Pareille affirmation est exacte quant à son essence, mais sa formulation peut cependant engendrer des malentendus. Premièrement, parce que ses mots sont ceux de l’enseignement du concile de Trente, plus ou moins abandonné par les catholiques-romains eux-mêmes après Vatican II, sur les deux sources de foi. Du point de vue orthodoxe, il serait plus exact de parler d’une seule source, notamment de l’unique tradition apostolique, exprimée par l’Église dans l’Écriture Sainte, les décisions des conciles, les œuvres des Saints Pères, la liturgie, etc. Ensuite — et c’est plus important —, parce qu’une telle affirmation ne tient pas suffisamment compte de la différence essentielle qui existe entre l’Écriture Sainte et les décisions des conciles. L’Écriture Sainte est une révélation divine, inspirée par le Saint Esprit qui nous révèle et nous annonce des données nouvelles sur le Dieu trine, ses grandes œuvres, accomplies pour notre salut, tandis que les conciles œcuméniques n’ont jamais prétendu fournir, par leurs décisions, des révélations sur quelque chose qui était inconnu avant eux, mais simplement une interprétation, une explication et une mise en relief inspirées de l’Écriture Sainte et de la tradition apostolique en général. C’est pour cela que la question d’une éventuelle contradiction possible entre l’Écriture Sainte et les conciles œcuméniques, du degré comparé de leur autorité, ne doit jamais se poser pour des théologiens orthodoxes.
III. Traits caractéristiques d’un concile œcuménique
Il n’est pas facile d’établir avec précision et en harmonie avec les faits historiques les critères de l’"œcuménicité" d’un concile et la manière de distinguer un concile authentique d’un concile plus restreint, soit même d’un pseudo-concile. Un concile œcuménique, cela va de soi, doit représenter la plénitude de l’Église, mais cette plénitude ne peut être comprise dans un sens géographique ou littéral, ainsi que l’histoire nous le montre. Ce n’est qu’une minorité des évêques de l’époque qui assistait aux conciles œcuméniques (près d’un dixième au concile de Nicée en 325, selon certains historiens), tandis qu’au IIe concile (à Constantinople, en 381), Rome et l’Occident en général ne furent pas du tout représentés. Inutile de dire que sa reconnaissance par l’empereur, ni même par le pape ne peut être considérée comme un facteur décisif pour qu’un concile reçoive le titre d’ « œcuménique ».
La reconnaissance par l’empereur avait plus d’importance pour l’État que pour l’Église ; une telle reconnaissance n’a pas contribué à ce que les réunions monophysites du Ve siècle ou le concile iconoclaste de 754, reconnus « œcuméniques » par les empereurs de l’époque, deviennent d’authentiques conciles œcuméniques. La reconnaissance par le pape, toute importante qu’elle ait été en tant que signe d’unanimité, fut déclarée superflue pour la reconnaissance du IIe concile œcuménique. En règle générale, la reconnaissance par l’Église détermine le fait qu’un concile soit considéré comme œcuménique. Et ceci est, sans aucun doute, le cas pour les sept conciles anciens. Deux facteurs ont une signification décisive dans ce processus de reconnaissance par l’Église. la conscience du concile, qui s’estime et se proclame comme étant œcuménique ; la reconnaissance, par le concile suivant, de l’œcuménicité du précédent, soit au contraire, le rejet des prétentions de celui-ci à l’œcuménicité.
Ainsi, par exemple, le concile de Chalcédoine (451) a rejeté les prétentions à l’œcuménicité du second concile d’Éphèse (449). Des violences, des irrégularités dans son déroulement et surtout des déviations d’ordre doctrinal furent les raisons essentielles de ce rejet. Parfois, c’est le peuple qui n’acceptait pas le nouveau concile, ainsi que cela eut lieu notamment dans le cas du pseudo-concile de Florence (1438-1439). Plus tard, le rejet fut confirmé par le concile de Constantinople de la fin du XVe siècle, bien que ce ne fut qu’un concile local. Il serait néanmoins difficile de formuler en termes canoniques une telle interférence du peuple. Nous ne pouvons qu’affirmer que les conciles œcuméniques, étant des événements charismatiques, ne peuvent être caractérisés en termes juridiques. Derrière les conciles, il y a toujours l’Église elle-même, nantie du « grand don de vérité » [μέγα χάρισμα ἀληθείας], c’est à elle qu’appartient le dernier mot dans les questions de foi.
IV. Convocation des conciles œcuméniques
Il est nécessaire de souligner le caractère charismatique extraordinaire des conciles œcuméniques, qui les différencie des conciles locaux des évêques. Ces derniers, en accord avec les saints canons (canon apostolique 37 (4) ; canon 5 du Ier concile de Nicée ; canon 19 du IVe concile œcuménique (5) ; canon 20 du concile d’Antioche (6), etc.) doivent être convoqués régulièrement et systématiquement deux fois ou — en vertu des décisions plus tardives (canon 8 du VIe concile œcuménique, canon 6 du VIIe concile œcuménique) — une fois l’an ; il n’existe par contre pas de canon qui prescrive une convocation périodique des conciles œcuméniques, et l’histoire nous montre que ces conciles se réunissaient très rarement, seulement aux moments de crises dans la vie de l’Église. Et c’est naturel. les conciles œcuméniques n’étant pas des « parlements ecclésiastiques » convoqués régulièrement et représentant juridiquement l’Église dans sa gestion et son administration, mais plutôt des réunions extraordinaires, convoquées par le Saint Esprit aux moments où la vie et le bien de toute l’Église l’exigent.
V. Immuabilité des résolutions conciliaires
Sans aucun doute possible, les décisions dogmatiques et canoniques des conciles œcuméniques sont infaillibles, elles conservent leur immuable validité et autorité et ne peuvent être abrogées ni même modifiées avec le temps ; car l’Esprit Saint, les ayant inspirées, ne peut se contredire ni se désavouer. La continuité également représente un trait caractéristique de la vie de l’Église et de sa tradition vivante. C’est particulièrement vrai en ce qui concerne les décisions théologiques des sept conciles œcuméniques. Cependant, cette immuabilité des décisions conciliaires ne doit pas être comprise dans un sens trop littéral ou formel. Ainsi, nous devons reconnaître que l’infaillibilité des conciles concerne tout particulièrement leurs décisions dogmatiques, mais non pas toutes les discussions qui ont eu lieu au cours des réunions, bien qu’il soit nécessaire de toujours tenir compte de ces discussions pour bien comprendre dans un esprit patristique, les décisions elles-mêmes (ὅροι). Qui plus est, l’histoire de l’Église — que nous ne pouvons ni ne devons ignorer — témoigne du fait que même les décisions théologiques des conciles œcuméniques (sans parler de la législation canonique) étaient modifiées, complétées, adaptées aux circonstances, abandonnées même par des conciles postérieurs qui étaient pleinement conscients qu’agissant ainsi ils « rénovaient » (ἀνανεοῦμεν) les décisions antérieures tout en demeurant fidèles à leur contenu dogmatique et spirituel. En guise d’exemple classique, citons l’acte du IIe concile œcuménique qui a retranché, dans le Symbole de foi nicéen, l’expression « c’est-à-dire de l’essence du Père » (τουτέστιν ἐκ τῆς οὐσίας τοῦ Πατρός) et « Dieu de Dieu » (Θεὸν ἐκ Θεοῦ). Si cette deuxième omission peut être expliquée par le désir d’éviter une répétition inutile, car un peu plus loin le texte dit « vrai Dieu de vrai Dieu », la première omission de « l’essence du Père » avait plutôt pour but d’éviter l’expression qui pouvait être faussement interprétée dans l’esprit sabellien et était superflue, car l’expression « consubstantiel » (ὁμοούσιος) était suffisante et avait plus de précision. En même temps, le IIe concile a essentiellement développé le Symbole de Nicée par un enseignement plus détaillé sur le Saint Esprit, l’Église, etc. Le IVe concile œcuménique a agi de même avec ses formules christologiques plus développées que l’on ne peut trouver, de manière explicite en tout cas, dans le Symbole de foi de Nicée-Constantinople.
Cette façon d’agir, chacun le sait, a rencontré une opposition opiniâtre de la part des monophysites qui dans leur conservatisme formaliste ont rejeté, du moins pendant les premières décennies après le concile de Chalcédoine, le Symbole de la foi du IIe concile œcuménique, le considérant comme une innovation arbitraire par rapport au Symbole de Nicée (« La foi des 318 Pères » était le slogan célèbre des monophysites) (7). Nous devons toutefois ajouter que le IIIe concile œcuménique a formellement interdit toute modification ultérieure du texte du Symbole de la foi (dans son canon 7). Ceci nous montre que les conciles œcuméniques ont non seulement le droit de compléter les décisions précédentes, mais également d’interdire toute modification, même textuelle, dans leur formulation.
En guise d’exemple de modification des décisions canoniques, nous pouvons citer les décisions susmentionnées du canon 8 du VIe concile œcuménique et du canon 6 du VIIe concile œcuménique sur la périodicité de convocation des conciles locaux ; au lieu de les convoquer deux fois l’an comme cela a été décidé par les conciles antérieurs (37e canon apostolique, canon 5 du Ier concile de Nicée, canon 19 du IVe concile œcuménique et canon 20 du concile d’Antioche), ils stipulent la convocation de ces conciles épiscopaux une seule fois l’an. Ils motivent leur décision par les conditions de leur époque (mauvaises routes, insuffisance de moyens pécuniaires, invasions barbares, etc.) qui rendent difficile la convocation des conciles à un rythme plus fréquent. De cette façon, ils établissent le principe suivant lequel les décisions canoniques, même promulguées par un concile œcuménique, peuvent être adaptées aux besoins de l’époque. Le VIIe concile œcuménique emploie une expression extraordinaire pour justifier une telle modification dans l’ordre canonique. « Τοῦτον οὖν τὸν κανόνα καὶ ἡμεῖς ἀνανεοῦμεν [Nous aussi, nous renouvelons ce canon]. » Nous voyons donc que, dans la conscience des Pères du VIIe concile œcuménique, leur décision n’était pas une modification d’une décision plus ancienne, mais en était un renouvellement.
Telle devrait être l’attitude orthodoxe authentique face à la question de l’autorité des conciles œcuméniques. fidélité à leurs décisions quant à leur esprit et leur contenu dogmatique ; jamais un rejet de ce qui a été adopté, mais, dans des circonstances déterminées, leur « renouvellement », leur développement, même une correction de leur formulation lorsque la conscience conciliaire le trouve nécessaire et utile. Ce n’est pas là une question d’ordre théorique, mais bien au contraire d’un ordre tout à fait pratique, maintenant que l’Église orthodoxe entreprend un dialogue théologique avec les confessions occidentales et surtout avec les Églises « monophysites » au sujet des décisions dogmatiques du concile de Chalcédoine. Ce n’est que dans la perspective susmentionnée que ces discussions ont un sens. Et, par le fait même qu’ils soient prêts de discuter la possibilité de retrouver une foi commune dans les deux formulations christologiques différentes (chalcédonienne et non chalcédonienne) (8), les théologiens orthodoxes ont reconnu qu’il était possible d’interpréter, et même de compléter l’enseignement de Chalcédoine, sans le renier. Le même raisonnement peut également être appliqué aux discussions avec les autres confessions chrétiennes. Cependant, quoi qu’il en soit, les décisions des sept conciles œcuméniques représentent toujours une autorité suprême et immuable et un trait caractéristique de l’Église orthodoxe (9) ; leur enseignement représente un tout indivisible de la vérité trinitaire et christologique.
Toutefois, dans la question des conciles nous ne devons pas prêter une signification trop particulière et sacrée au nombre de « sept », le mettant en rapport avec les sept dons de l’Esprit Saint, etc., et, par là même, lui conférer une qualité définitive, comme si on ne pouvait plus convoquer de conciles œcuméniques. (De tels essais de « sacralisation » avaient déjà été fait au Ve siècle, lorsque le nombre de « quatre » était mis en rapport avec les quatre Évangiles afin de protéger le IVe concile œcuménique contre les monophysites). De nos jours, l’Église orthodoxe possède la même plénitude de grâce qu’elle possédait aux temps anciens ; elle peut par conséquent, aujourd’hui comme avant, convoquer des conciles œcuméniques et, par la force du Saint Esprit, prendre lors de ces conciles des décisions infaillibles. D’un autre côté, il est plus difficile, pour les orthodoxes, de séparer les conciles plus récents des sept conciles anciens. Je pense notamment au concile de Constantinople des années 879-880 (confirmation du texte du Symbole de la foi sans le Filioque) et aux conciles hésychastes du XIVe siècle. Bien que formellement, ils n’aient pas encore été consacrés comme « œcuméniques », ils forment un tout organique avec les conciles œcuméniques précédents. En général, le nombre de « sept » est plutôt le minimum et non pas le maximum des conciles d’autorité et d’inspiration divines.
VI. Les Pères des conciles œcuméniques
Une question s’était posée parmi les théologiens orthodoxes. les Pères qui prennent part aux conciles œcuméniques décident-ils en tant que successeurs des apôtres ayant hérité d’eux le pouvoir de lier et de délier, ou bien agissent-ils en tant que représentants de leurs Églises locales qui possèdent la plénitude de la grâce ? La réponse correcte serait qu’ils agissent en cette qualité double simultanément. En tant que successeurs des apôtres par la lignée ininterrompue des ordinations épiscopales, les Pères œcuméniques possèdent la plénitude des dons du Saint Esprit, répandue lors de la Pentecôte, mais ils la possèdent en tant qu’évêques de leurs Églises locales, car un évêque sans Église est inconcevable. Et, de même que l’Église locale est en union avec toute l’Église, les évêques réunis ensemble au concile œcuménique y trouvent la force de parler infailliblement au nom de l’Église une, sainte, catholique et apostolique. Évidemment, ils parlent en accord avec la sagesse de l’Église, toutefois non pas en députés, responsables devant leurs électeurs, mais en tant que messagers du Christ et porteurs de l’Esprit. Ils n’expriment pas seulement les points de vue de leurs contemporains, mais l’"intelligence" de l’Église dès le début et jusqu’à l’avènement du Christ. Et nous pouvons rendre grâce à Dieu qui a « donné une telle autorité aux hommes » (Mt 9, 8)….
* Exposé présenté à la sous-commission « Autorité des conciles œcuméniques » du dialogue théologique orthodoxe-anglican à Rymnic-Vylciu (Roumanie) en 1974 et publié dans le Messager de l’exarchat du patriarche russe en Europe occidentale, n° 85-88 (1974), p. 63-70.
- Cette « pierre » est généralement interprétée par les Pères anciens non tant comme la personne même de l’apôtre que comme la « confession de foi » de celui-ci (Mt 16, 16). Voir notamment N. AFANASSIEFF, N. KOULOMZINE, J. MEYENDORFF et A. SCHMEMANN, La Primauté de Pierre dans l’Église orthodoxe, Neuchâtel, Éd. Delachaux & Niestlé, 1960, et B. BOBRINSKOY, Le Mystère de l’Église, Paris, Éd. du Cerf, 2003, p. 256-288 (NdR).
- « Wherefore things ordained by [General Councils] as necessary to salvation have neither strength nor authority, unless it may be declared that they be taken out of Holy Scripture », The Thirty Nine Articles of Religion (1563) (NdR).
- Voir, par exemple, J. KARMIRIS, Τὰ Δογματικὰ καὶ Συμβολικὰ μνημεῖα τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας [Monuments dogmatiques et symboliques de l’Église orthodoxe catholique], Athènes, 1952, t. I, p. 2.
- Voir Les Constitutions apostoliques, t. III, Paris, Éd. du Cerf, coll. « Sources chrétiennes » n° 113, 1987, p. 287 (NdR).
- Pour le texte des canons des conciles œcuméniques, voir P.-P. JOANNOU, Discipline générale antique (IVe-IXe s.). Les canons des conciles œcuméniques (IIe-IXe s. ), Rome, Grottaferrata, 1962 (NdR).
- Voir P.-P. JOANNOU, Discipline générale antique (IVe-IXe s.). Les canons des synodes particuliers, Rome, Grottaferrata, 1962 (NdR).
- Sur ce sujet, voir notamment J. MEYENDORFF, Unité de l’Empire et divisions des chrétiens. L’Église de 450 à 680, Paris, Éd. du Cerf, 1993 (NdR).
- Le dialogue théologique entre orthodoxes chalcédoniens et non chalcédoniens débuta de manière non officielle dès 1964, et de manière officielle en 1985. Il aboutit à reconnaître que les deux familles d’Églises confessent la même foi christologique, malgré des formulations différentes. Voir A. BELOPOPSKY et C. CHAILLOT (éd.), Towards Unity. The Theological Dialogue between the Orthodox Church and the Oriental Orthodox Churches, Genève, 1998 (NdR).
- Voir Mgr KALLISTOS (WARE), L’Orthodoxie. L’Église des sept conciles, Paris, Éd. du Cerf, coll. « Le Sel de la Terre », 2002 (NdR).
Suite « Dieu, l’homme, l’Église » Lecture des Pères Par Basile Krivochéine Les Éditions du « CERF » Paru en. Décembre 2010, 302 pages

J’entendis parler pour la première fois du métropolite Nicodème (Rotov) de Leningrad et Novgorod (1) (qui n’était alors qu’archimandrite) durant l’été 1959 par un de nos paroissiens d’Oxford, E. E. Lampert (chef de chœur et lecteur, qui devait par la suite occuper une chaire de russe dans une université anglaise), de retour d’un séjour à Moscou. Il m’était arrivé auparavant de tomber sur des entrefilets dans le Journal du patriarcat de Moscou qui mentionnaient le séjour et les activités de l’archimandrite Nicodème à Jérusalem où il dirigeait la Mission orthodoxe russe, mais je ne m’étais jamais particulièrement intéressé à ces informations. Et voilà qu’en rentrant de Moscou où l’avaient conduit ses activités littéraires, E. E. Lampert me raconta. « Savez-vous qu’un nouveau vice-président du Département des relations extérieures du patriarcat a été nommé aux côtés du métropolite Nicolas (Iarouchevitch) (2) ? C’est le jeune archimandrite Nicodème. Une personne désagréable et repoussante. » — « C’est l’impression qu’il vous a faite ? », lui demandai-je. — « Non, je ne l’ai pas vu personnellement, répondit Lampert, mais c’est ce qu’on dit de lui dans les milieux d’église à Moscou. »
C’est vraisemblablement dans l’entourage du métropolite Nicolas (Iarouchevitch), alors président du Département des relations extérieures, que Lampert avait entendu de tels propos, ce qui montre que le conflit était déjà latent entre les deux hommes. Toujours est-il que cette remarque de Lampert resta gravée dans mon esprit et m’inspira un préjugé défavorable envers le futur métropolite Nicodème. « Il faudra être prudent avec cet homme-là », me dis-je.
Ma première rencontre personnelle avec l’archimandrite Nicodème remonte à juin 1960 à Oxford. Je venais d’être nommé évêque de Bruxelles et de Belgique (3), après avoir séjourné un temps à Paris en tant qu’évêque auxiliaire de l’exarchat d’Europe occidentale (4). Je n’avais quasiment pas encore eu le temps de prendre en main les affaires du diocèse de Belgique, quand j’appris qu’une délégation de moines russes se rendait en Grande-Bretagne et que l’évêque Antoine de Londres (5) désirait me voir prendre part à l’accueil de ladite délégation. Je me rendis donc de Paris à Oxford où, pendant huit ans, j’avais célébré en tant qu’hiéromoine, puis archimandrite, dans la paroisse locale (6).
La délégation était composée de l’archimandrite Nicodème qui en était le chef, l’archimandrite Philarète (futur métropolite de Kiev) (7) et du hiéromoine Bartholomée (futur archevêque de Tachkent) (8) ; ils venaient en Grande-Bretagne sur l’invitation de communautés monastiques anglicanes, auxquelles ils « rendaient leur visite », puisque des moines anglicans étaient allés en Russie (9) invités par le patriarcat de Moscou. L’archimandrite Nicodème avait alors trente ans, les autres membres de la délégation étaient un peu plus âgés, mais l’archimandrite Nicodème occupait manifestement une position de commandement par rapport aux autres, ce qui était fort naturel pour un chef de délégation.
Je ne décrirai pas ici en détail les quinze jours (10) que l’archimandrite Nicodème passa en Grande-Bretagne ; cela dépasse le cadre de notre récit et par ailleurs les années en ont effacé les détails de ma mémoire ; je ne mentionnerai que quelques épisodes à caractère plus personnel. La délégation de moines arriva chez nous à Oxford le samedi 18 juin 1960. Hébergée (tout comme moi) par le monastère anglican de Cowley-Favers, elle célébra les vigiles et la liturgie dominicale dans l’église de notre patriarcat qui se trouvait dans la maison de « saint Grégoire de Nysse et de sainte Macrine » (11). Le soir pendant le dîner, alors que nous étions en comité restreint, nous eûmes une conversation à propos de l’œcuménisme. Militsa Vladimirovna, épouse du professeur à l’université d’Oxford Nicolas Mikhaïlovitch Zernov (12), demanda à l’archimandrite Nicodème ce qu’il pensait de la prière interconfessionnelle, avec les anglicans en particulier. L’archimandrite fit une réponse prudente, qui montre à quel point il devait évoluer par la suite. « Les canons de l’Église orthodoxe (13) — dit-il — interdisent toute prière conjointe avec des personnes qui n’en sont pas membres, et je m’en tiens strictement à cette règle. Aucun nouveau décret n’ayant été promulgué depuis par l’Église orthodoxe, je ne prie pas quand je me trouve dans des églises non orthodoxes. Mais ces questions concernant la prière interconfessionnelle et l’œcuménisme sont en train d’être examinées par le synode et il faut voir ce qui sera décidé. »
L’assistance ne fut pas satisfaite de cette réponse et Militsa Vladimirovna s’adressa à moi. « Et vous, Monseigneur, qu’en pensez-vous ? » — « L’apôtre Paul écrit. « Priez sans cesse (14) » », lui dis-je. « Je ne vois pas pourquoi il faudrait interrompre cette prière continuelle quand on se trouve dans une église non orthodoxe. Dans ces cas-là, cependant, j’essaie de prier par moi-même, et non avec les gens qui s’y trouvent. »
« Vous avez entendu ce qu’a dit Monseigneur, s’exclama madame Zernov, écoutez-le ! » L’archimandrite Nicodème ne me contredit pas. Il faut dire qu’il montrait du respect pour mon rang épiscopal et affichait une certaine humilité, sans renoncer pourtant à son autorité.
Le 20 juin (15) au soir, une réception fut organisée dans le jardin de la maison de Saint Grégoire de Nysse, qui attira beaucoup de monde, des Anglais en majorité, dont l’évêque Carpenter d’Oxford (16), un professeur de l’université et d’autres personnes. Les trois membres de la délégation monastique se présentèrent en russe, leur intervention étant immédiatement traduite en anglais. Ils racontèrent leurs parcours, leurs origines. L’archimandrite Nicodème, comme ses compagnons du reste, parlait avec aisance et de manière assez intéressante. Je fis part de cette remarque au professeur N. M. Zernov. « C’est vrai, me répondit-il, mais ils s’expriment dans une langue primitive, on dirait des paysans. » Il n’était pas si simple de plaire à notre paroisse académique, composée en majorité de professeurs ou d’étudiants, ni non plus aux Anglais.
Le lendemain, nos invités repartaient pour Londres. Nous nous trouvâmes confrontés à un problème de transport. En effet, l’archimandrite Nicodème avait catégoriquement refusé que les conducteurs des voitures mises à la disposition de la délégation soient des femmes. Les Anglais répondirent que c’était <…>*, il resta inflexible. L’un des hôtes dit. « Nous avons à ce sujet des instructions très strictes du patriarcat, je ne veux pas me retrouver au cœur d’un scandale, on pourrait nous prendre en photo et prétendre que nous nous promenons avec des femmes ! »
Je pense qu’une telle psychologie s’explique par une méconnaissance du mode de vie occidental et aussi, tout simplement, par les mœurs de l’Église russe à l’époque. C’était en quelque sorte du provincialisme, car l’archimandrite Nicodème venait en Occident pour la première fois. Par la suite, en tout cas, l’archimandrite Nicodème « évolua » et perdit ses préjugés négatifs sur les femmes-chauffeurs.
Je les accompagnai à Londres, dans la même voiture — si je ne me trompe — que lui et l’archimandrite Philarète. En chemin, nous parlâmes longuement de la vie religieuse en Russie, de la situation de l’Église, mais avec retenue et relativement superficiellement. Tant lui que moi évitions les sujets brûlants, moi car je ne voulais pas le mettre dans une situation gênante dès notre première rencontre, et lui suivant sa nature réservée et prudente. Entre autres, il me demanda. « Pourquoi l’évêque Antoine (de Londres) refuse-t-il avec obstination de se rendre à Moscou alors qu’il est invité par le patriarcat ? » Je répondis que l’évêque Antoine avait peur que ses paroissiens ne l’accusent de « soviétophilie » et que certains ne passent aux karlovtsiens (17). « Il ne faut pas que Mgr Antoine s’inquiète, s’exclama l’archimandrite Nicodème, une visite à Moscou ne le rendra pas bolchevique ! »
Les samedi 25 et dimanche 26 juin, Mgr Antoine, la délégation monastique et moi-même célébrâmes ensemble les vigiles et la liturgie en la cathédrale du patriarcat de Moscou à Londres, mais je ne garde aucun souvenir particulier de ces offices, hormis le fait que l’archimandrite Philarète y donna une fort belle homélie. Je ne sais pourquoi l’homélie ne fut pas dite par l’archimandrite Nicodème (chef de la délégation).
Quelques jours plus tard, la délégation monastique rentra à Moscou et je repartis pour ma part à Paris, d’où je me rendis bientôt à Bruxelles. Je ne séjournai en Belgique que peu de jours et, le 16 juillet, je m’envolai via Paris pour Moscou, où j’avais été invité par le patriarcat à l’occasion de la saint Serge (18). Pour faire un bilan de ma première rencontre avec l’archimandrite Nicodème, je peux dire qu’il me fit l’impression d’un homme intelligent et capable, raisonnablement cultivé et formé en théologie, interlocuteur intéressant. Mais jamais je n’aurais pu (alors) imaginer la carrière ecclésiastique brillante et vertigineuse qui allait être la sienne, pas plus que je ne m’attendais à son imminent sacre épiscopal. Il me semblait trop jeune pour cela. Je dois avouer que j’avais sous-estimé à l’époque ses capacités intellectuelles et même ses qualités spirituelles. À la suite de cette première rencontre, peut-on dire que s’étaient tissés entre nous des liens personnels et sincères d’amitié ? Oui et non, serais-je tenté de répondre, et cette appréciation allait rester valable pour toute la durée de nos relations, avec la simple nuance que si le « non » l’emportait alors sur le « oui », au fur et à mesure que nos relations évoluèrent, le « oui » s’imposa de plus en plus face au « non ». Jamais cependant nous ne parvînmes à un « oui » absolu.
Dès avant mon départ pour Moscou (via Paris), des nouvelles incroyables nous stupéfièrent. Pour des raisons inconnues de nous, le métropolite Nicolas (Iarouchevitch) de Kroutitsy et Kolomna, la deuxième figure de l’Église après le patriarche Alexis et dauphin notoire de ce dernier, mondialement connu pour ses activités, venait, le 21 juin 1960, d’être relevé de ses fonctions de président du Département des relations extérieures du patriarcat de Moscou, pour être remplacé par l’archimandrite Nicodème (19). Peu après, le 10 juillet 1960, ce dernier fut sacré évêque de Podolsk, auxiliaire du diocèse de Moscou. Et tout cela avait été décidé pendant qu’il se trouvait avec la délégation en Grande-Bretagne ; sa nomination à la présidence du Département des relations extérieures avait eu lieu une semaine avant son départ de Londres. Je ne saurais dire s’il était au courant de cette nomination, je suppose que oui, mais il était très discret à ce sujet et n’y fit pas la moindre allusion.
La nouvelle du départ à la retraite du métropolite Nicolas provoqua une grande inquiétude à Paris, au sein de notre exarchat. Même si la signification de ce départ et ses circonstances ne nous semblaient pas claires, nous sentions qu’il n’annonçait rien de bon pour l’Église. Ce pressentiment devait s’avérer exact. c’était le début des persécutions de l’ère Khrouchtchev, qui avaient commencé depuis six mois déjà (20), mais à Paris, nous n’en savions encore rien. La mise à la retraite du métropolite Nicolas en était un symptôme flagrant.
L’ayant déjà relaté précédemment (21) et ne souhaitant pas me répéter, je ne ferai pas ici le récit de mon séjour en Russie du 16 au 30 juillet 1960 ni de mes entrevues et conversations avec l’évêque Nicodème à cette occasion, même si les circonstances de ce séjour sont fort éclairantes pour comprendre sa personnalité.
De retour à Paris, je fis à l’exarchat un rapport détaillé de mes impressions concernant la situation de l’Église de Russie, ainsi que de mes conversations avec le métropolite Nicolas et l’évêque Nicodème. Mes informations sur les persécutions de Khrouchtchev contre l’Église, dont on ne savait pas grand-chose en Occident à l’époque, attristèrent beaucoup les membres du conseil de l’exarchat et le récit de mes entretiens avec l’évêque Nicodème ne fit que renforcer le sentiment négatif, voire hostile, que notre exarque (22) nourrissait déjà à son égard. Quant à moi, je ne pouvais pas partager entièrement ce sentiment. Bien sûr, le rôle de l’évêque Nicodème semblait avoir été assez peu sympathique car, même s’il n’avait pas pris une part active aux agissements des autorités soviétiques pour limoger Mgr Nicolas (et c’est le plus vraisemblable, puisqu’à ce moment-là, Mgr Nicodème se trouvait en Grande-Bretagne), il est incontestable qu’en acceptant de prendre la place du métropolite limogé, il avait considérablement facilité la tâche de Kouroïedov (23) et sa clique. Évidemment, Kouroïedov savait à l’avance qu’en la personne de l’évêque Nicodème il trouverait un homme plus facile à manipuler par les autorités que le métropolite Nicolas. Et, par ses critiques de la personnalité du métropolite Nicolas, l’évêque Nicodème justifiait devant l’opinion publique son limogeage. Par souci d’objectivité, il faut cependant avouer que les critiques de la personnalité et des activités du métropolite Nicolas par Mgr Nicodème contenaient une grande part de vérité.
Une nuance doit cependant être apportée ici. Le métropolite Nicolas, malgré ses faiblesses trop humaines, était un homme talentueux, cultivé, un hiérarque d’une intelligence remarquable et à la personnalité pleine de charme. Et surtout, il ne fut pas relevé de ses fonctions pour ses défauts personnels ou administratifs, mais uniquement à la demande des autorités soviétiques irritées par sa lutte contre l’athéisme et son opposition aux persécutions de Khrouchtchev.
Certes, l’évêque Nicodème tiendra la promesse qu’il m’avait faite lors de nos rencontres (24) d’être toujours bienveillant à l’égard de l’exarchat d’Europe occidentale.
Son rôle probable dans la mise à l’écart du métropolite Nicolas devait cependant peser contre lui dans nos relations.
Je rencontrai de nouveau l’évêque Nicodème en novembre 1960 à Paris, où il était venu participer au sacre de l’archimandrite Alexis (van der Mensbrugghe) en tant qu’évêque de Meudon (25). Il avait une attitude discrète et ne se faisait remarquer en rien, ce qui était somme toute assez naturel ; il n’était encore qu’évêque auxiliaire de Podolsk. Alors que nous nous trouvions dans le sanctuaire, il me dit qu’à l’automne 1961, se tiendrait sur l’île de Rhodes une conférence panorthodoxe, à laquelle je serais désigné avec lui par le patriarcat de Moscou pour représenter l’Église orthodoxe russe.
« Nous tenons beaucoup à votre participation à cette conférence, ajouta-t-il, car vous parlez bien le grec, vous connaissez les Grecs en général et vous avez longuement séjourné sur le Mont Athos. J’espère que nous pourrons collaborer fraternellement. » Je lui répondis qu’il pouvait compter sur moi, et que je ferais tout ce qui était en mon pouvoir pour le bien de l’Église.
Et, effectivement, je reçus une invitation du patriarcat à me rendre à la conférence de Rhodes (26). Aux environs du 20 septembre 1961, je pris donc l’avion de Paris pour Athènes, où je retrouvai Mgr Nicodème — élevé peu auparavant au rang d’archevêque de Iaroslavl et Rostov (27) — et les autres membres de notre délégation (l’évêque Alexis de Tallin (28), le protopresbytre Vital Borovoï (29), etc.) qui venaient d’arriver de Moscou.
Il convient de noter ici qu’A. S. Bouïevsky (30) avait préalablement téléphoné du patriarcat à notre exarque Mgr Nicolas (31) à Paris pour lui demander si j’acceptais que l’archevêque Nicodème soit placé à la tête de la délégation. Cette question se posait parce que l’archevêque Nicodème était mon cadet, non seulement au rang d’archevêque, mais aussi en tant qu’évêque, et qu’en outre, il n’était pas encore membre permanent du synode, ce qui lui aurait conféré l’aînesse. Après m’avoir consulté, notre exarque répondit en mon nom que j’acceptais tout à fait, que je recherchais aucune forme de primauté et que j’estimais même parfaitement normal que la délégation soit menée par quelqu’un qui venait directement du patriarcat et connaissait mieux que moi la situation actuelle dans l’Église russe et les décisions du Synode au sujet de la Conférence panorthodoxe. « En tout cas, ajouta Bouïevsky, l’archevêque Nicodème consultera Mgr Basile pour toute décision et n’agira qu’en accord avec lui. »
En réalité, cependant, la collaboration avec l’archevêque Nicodème allait s’avérer extrêmement difficile. Pour moi, cela s’explique dans une large mesure par l’extrême jeunesse (moins de trente-deux ans à l’époque), l’inexpérience et même l’immaturité de celui-ci. Plus tard, lors des rencontres ou des conférences panorthodoxes ultérieures, nous allions travailler en bonne collaboration. Mais pour l’heure, il ne se sentait manifestement pas très sûr dans son rôle, nouveau pour lui, de chef d’une délégation aussi importante, craignait peut-être que je ne le supplante et ne perdait pas une occasion d’affirmer son autorité. Il s’efforçait de mener seul toutes les discussions avec les Grecs, ne m’informant pas même de leur contenu. Mais sa connaissance du grec était insuffisante. Pendant son séjour à Jérusalem, il avait appris à bavarder sur les thèmes de la vie courante, mais était incapable de participer à une discussion théologique ou de comprendre un exposé de théologie (ce qu’il admettait d’ailleurs lui-même). Malgré cela, il évitait de recourir à mes services pour la traduction, ce qui m’aurait permis d’assister à ses pourparlers avec les Grecs. Il faisait donc appel à Alexeïev, l’interprète du patriarcat (32), qui ne connaissait que l’anglais et n’était pas familiarisé avec le vocabulaire théologique. Cette situation commença sur le bateau qui nous conduisait du Pirée à Rhodes. Lors de cette traversée, l’archevêque Nicodème entama des pourparlers animés avec deux « personnalités » grecques de la délégation de Constantinople, les métropolites Méliton de Chalcédoine (33) et Chrysostome (Constantinidis) de Myre (34). Alexeïev traduisait mais ni moi ni l’évêque Alexis de Tallin ne fûmes invités à participer à la conversation. À notre arrivée à Rhodes, je dis à l’archevêque Nicodème. « Monseigneur, vous menez en permanence avec les Grecs des pourparlers dont je ne suis même pas informé. C’est gênant, car je suis membre de cette délégation au même titre que vous. »
« Vous faites erreur, me répondit l’archevêque Nicodème, ce ne sont que des conversations privées, chacun a le droit d’en avoir. » Je fis part de cet échange à l’évêque Alexis qui était membre de notre délégation. Lui aussi était insatisfait du comportement de l’archevêque Nicodème. « Mais vous, Monseigneur, avez l’avantage de pouvoir exprimer votre mécontentement à Mgr Nicodème, me dit-il, tandis que moi je ne le peux pas. »
Sur ce même bateau, je fus soudain abordé par l’évêque Parthène, membre de la délégation bulgare, grand défenseur de l’orthodoxie et en même temps adversaire de l’archevêque Nicodème.
« Savez-vous qu’hier l’archevêque Nicodème a tenu devant nous [la délégation bulgare] des propos désobligeants à votre égard ? », me dit-il. « Il nous a dit qu’il fallait se méfier de vous et ne rien vous raconter car vous étiez un homme d’éducation occidentale et que vous répéteriez tout ce qui vous serait dit. » — « Cela se peut, répondis-je, mais je ne nomme jamais la source de mon information. »
Il faut dire que le comportement de l’archevêque Nicodème était fortement influencé par la présence, dans notre délégation, d’un collaborateur du Département des relations extérieures du patriarcat, un certain I. V. Varlamov, un individu déplaisant au plus haut point, un goujat. S’il n’était pas tchékiste, c’était en tout cas un agent des autorités soviétiques (35), envoyé là pour surveiller les faits et gestes de l’archevêque Nicodème et des autres membres de la délégation. Il faisait constamment la promotion du système soviétique et s’adressait à nos évêques sur un ton de commandement. Avec moi, il était correct, mais visiblement extrêmement méfiant. Quoi qu’il en soit, après ma conversation avec l’archevêque Nicodème, je décidai de ne me mêler de rien, de ne plus proposer mes services et de le laisser mener sa barque tout seul, à sa convenance.
Cette attitude porta ses fruits. l’archevêque Nicodème fut lui-même contraint de s’adresser à moi. Ainsi, lors d’une des premières sessions de la Conférence ou, plus exactement, juste avant le début de la session, il me tendit soudain un long document, composé de nombreuses pages, et me dit. « Voici les positions officielles de l’Église russe sur les questions à l’ordre du jour de la Conférence panorthodoxe. Je vais lire ce document en russe, paragraphe par paragraphe, et vous le traduirez en grec. » Bien sûr, j’aurais pu lui objecter que cela ne se fait pas de transmettre à la dernière minute un document d’une telle importance. En tant que membre de la délégation du patriarcat de Moscou, j’avais le droit d’être informé de son contenu à l’avance et me l’avoir dissimulé jusqu’à présent était incorrect. De plus, il est très difficile et pénible d’improviser la traduction d’un texte au contenu théologique aussi complexe, sans en avoir pris connaissance au préalable. Adressez-vous donc à votre interprète officiel Alexeïev, pensai-je, il traduira vers l’anglais et il se trouvera bien un Grec pour traduire de l’anglais en grec. Mais je ne commençai pas à discuter avec l’archevêque Nicodème et acceptai de l’aider à traduire le texte, me contentant de faire remarquer la difficulté d’une traduction de dernière minute. « Ne vous inquiétez pas, je suis convaincu que vous y arriverez très bien », répondit-il. Et effectivement, avec l’aide de Dieu, je réussis à tout traduire ! L’archevêque Nicodème apprécia et, par la suite, aimait à raconter que je traduisais à la perfection, étant donné que l’un des participants de la rencontre, le professeur Fotiadis de l’école de théologie de Halki (36), qui connaissait le russe et avait reçu le texte original de la déclaration, avait été surpris par l’exactitude ma traduction.
Pour ce qui est du contenu de la déclaration de l’archevêque Nicodème, tout ce qu’il dit était irréprochablement orthodoxe, il posait toute une série de questions vitales pour l’orthodoxie et défendait les intérêts de l’Église russe dans le cadre de l’unité panorthodoxe. Malheureusement, son allocution contenait aussi des passages politiques, avec les habituelles attaques polémiques contre l’impérialisme, le colonialisme, etc., émaillées d’expressions très violentes. Dans ma traduction de cette partie du discours, j’omis systématiquement ces expressions. L’archevêque Nicodème ne s’en aperçut pas, mais je l’en informai ensuite moi-même. « J’ai agi ainsi car, sans cela, votre allocution aurait produit une impression très négative. » L’archevêque Nicodème eut l’air mécontent, mais ne me dit rien. Il était assez intelligent pour comprendre que j’avais raison.
Une autre question délicate surgit lors des discussions du programme du futur concile panorthodoxe. Il y avait un point [à l’ordre du jour]. « L’athéisme et la lutte contre celui-ci. » Et un autre. « La franc-maçonnerie et notre attitude à son égard. » La question de l’athéisme et de la lutte contre celui-ci alarma beaucoup l’archevêque Nicodème et plus encore le représentant officiel du Département des relations extérieures Varlamov, qui l’interpréta de manière politique comme un prétexte pour lutter contre l’URSS et le pouvoir soviétique. C’est pourquoi l’archevêque Nicodème se mit à œuvrer énergiquement, non lors des sessions plénières de la Conférence, mais en commission, pour que cette question soit retirée du programme du concile et ne soit même pas évoquée lors des réunions plénières.
Il rencontra cependant sur ce sujet un adversaire inattendu en la personne du métropolite Élie d’Alep, futur patriarche d’Antioche (37). Ce dernier affirmait — et j’en fus personnellement témoin — que la lutte contre l’athéisme était une des principales missions de notre époque et que sa conscience épiscopale ne lui permettait pas d’accepter que cette question soit exclue du programme du futur concile. Néanmoins, l’archevêque Nicodème réussit (je ne sais comment) à convaincre le métropolite Élie, qui se tut. Il est vraisemblable que l’archevêque Nicodème lui avait expliqué qu’une discussion de la question de la lutte contre l’athéisme risquait de déclencher des répressions contre l’Église orthodoxe russe et rendrait impossible sa participation au futur concile. Ces mêmes arguments « de poids » firent probablement leur effet sur les autres membres de la Conférence et la question de l’athéisme fut rayée du programme, sans aucune discussion en assemblée plénière.
En ce qui concerne la franc-maçonnerie, « elle n’existe pas en Russie, et nous ne la connaissons pas. Étant donné qu’elle n’existe qu’en Occident, cette question n’est pas d’intérêt panorthodoxe mais seulement local, et il ne faut pas l’inscrire au programme du concile panorthodoxe. » C’est ce que dit l’archevêque Nicodème et il fut entendu. En général, il s’intéressait plus à des questions pratiques d’ecclésiologie (les juridictions, les prétentions de Constantinople, l’autocéphalie, etc.) qu’à des débats purement théologiques. C’est pourquoi, il me proposa de prendre part à la commission théologique, où l’on ne discutait d’aucune question brûlante. La conférence de presse de l’archevêque Nicodème fut un épisode caractéristique. L’inévitable Varlamov en fut l’organisateur actif. Sa « tactique » était d’une simplicité cynique. « Nous allons offrir à l’auditoire des canapés de caviar en quantité et beaucoup de vodka, nous dit-il d’une voix forte et sans se gêner, et quand ils auront bien bouffé et bien bu, on se mettra à parler. La réception n’en sera que meilleure. » Je n’assistai pas à la conférence de presse ; l’archevêque Nicodème, d’ailleurs, ne m’y avait pas spécialement invité. On me raconta qu’il avait bien parlé et qu’à chaque question, il trouvait toujours une réponse (vraie ou pas, c’était une autre affaire). Mais, quand un journaliste d’Allemagne fédérale lui demanda s’il était vrai qu’entre les patriarcats de Moscou et de Constantinople les relations étaient tendues, il répondit sèchement. « Vous posez cette question parce que vous souhaitez que ces relations soient tendues et aillent de mal en pis. Je suis navré de vous décevoir, car vous attendez en vain. Même s’il arrive que des désaccords surviennent entre nos patriarcats, nous en venons fraternellement à bout au moyen de négociations bilatérales, et nous espérons dans l’avenir parvenir à un accord complet. » De telles réponses étaient très appréciées des Grecs, qui se mirent à considérer l’archevêque Nicodème comme un « grand diplomate ».
Vers la fin de la Conférence, l’archevêque Nicodème sollicita à nouveau mon aide. Le prêtre Serge Heitz (38) qui, pour de complexes questions canoniques (39), ne parvenait pas à se faire accepter par la juridiction de Constantinople, s’était adressé à lui pour lui demander de le recevoir dans la juridiction du patriarcat de Moscou. Le père Heitz n’était pas membre de la Conférence panorthodoxe, il était venu à Rhodes spécialement pour rencontrer l’archevêque Nicodème et lui parler, ce qu’il put faire par l’intermédiaire de l’interprète Alexeïev. Mais assez rapidement, ils cessèrent de se comprendre et arrivèrent dans une impasse, car Heitz ne connaissait pas l’anglais et Alexeïev le français. Ils furent contraints de m’appeler.
Homme jeune, plein de forces et d’énergie, Mgr Nicodème courait plutôt qu’il marchait dans les couloirs et les salles où se déroulait notre Conférence et j’avais bien du mal à le suivre. Je le lui fis remarquer. « Monseigneur, ne courez pas ainsi. Pour les Grecs, c’est choquant de la part d’un hiérarque. Un hiérarque doit marcher majestueusement, lentement, avec retenue. Vous allez faire mauvaise impression ! » Mais l’archevêque Nicodème ne prêta pas attention à mes paroles. Treize ans plus tard, en juin 1973, alors qu’il venait de subir son premier infarctus, je vins le chercher à l’aéroport de Bruxelles ; il marchait si lentement que j’étais en permanence contraint de ralentir pour ne pas le devancer. Je lui rappelai notre conversation à Rhodes et comment je lui avais conseillé alors de ne pas courir. « Oui, vous aviez raison, me dit-il, et maintenant ce sont les docteurs qui m’interdisent de marcher vite. » Je voudrais aussi noter sa capacité à converser avec des personnes d’un genre tout à fait différent du sien. Il y avait à Rhodes, en tant que journaliste, un prêtre d’Amérique, le père Georges, un karlovtsien (40) fanatique, extrêmement hostile au patriarcat de Moscou en général et à l’archevêque Nicodème en particulier. Il lui demanda une entrevue en privé. Je ne sais pas ce que ce dernier lui dit mais à la fin de la conversation, le père Georges lui demanda sa bénédiction et par la suite raconta à Paris qu’en la personne de Mgr Nicodème, il avait rencontré un évêque véritable. À côté d’une telle finesse psychologique dans les contacts avec des personnes tout à fait différentes de lui, l’archevêque Nicodème manifestait, à l’époque, une certaine immaturité, ce dont témoigne l’épisode suivant.
Alors que nous nous trouvions encore sur le bateau vers Rhodes, je me rappelle que l’archevêque Nicodème et l’archimandrite Pierre (L’Huillier) — futur évêque titulaire de Chersonèse à Paris (41) —, assis sur le pont, bavardaient et riaient bruyamment. Le père Pierre se moquait de notre exarque à Paris, le métropolite Nicolas (Eremine), le dépeignant comme un homme de basse extraction, un ignorant, un « cosaque », et l’archevêque Nicodème riait à gorge déployée. Étant donné que le père Pierre ne parlait pas encore bien le russe à l’époque et que l’archevêque Nicodème ne parlait pas assez bien le grec, ils me demandèrent de faire l’interprète (j’étais assis non loin d’eux). Je me mis à traduire, mais comprenant que la conversation consistait en moqueries inadmissibles à l’endroit de notre exarque et que ces moqueries se faisaient à la cantonade, je cessai de traduire. En faisant cela, l’archevêque manifestait une absence de retenue et de sens des responsabilités, deux qualités qu’il allait acquérir par la suite à la perfection. Quant au père Pierre, il savait que ce qu’il disait allait plaire à l’archevêque Nicodème. Mais malgré tout, malgré les difficultés de notre première collaboration avec l’archevêque Nicodème, malgré son manque d’expérience et son assurance excessive, sa crainte de Varlamov qu’on lui avait adjoint, sa peur d’"échouer" aux yeux des autorités soviétiques (de perdre leur confiance) lors de sa première intervention sur la scène panorthodoxe, je suis prêt à admettre que c’est avec autorité et fermeté mais aussi avec habileté et tact qu’il défendit, à Rhodes, les intérêts de l’Église orthodoxe dans son ensemble et la dignité de l’Église russe en particulier. J’apprécie particulièrement sa résistance face aux prétentions du patriarcat de Constantinople à une primauté quasi papale, ainsi qu’aux tentatives du même patriarcat de monopoliser la préparation et la convocation du futur concile. C’était une résistance ferme sur le fond, mais souple et pleine de tact dans la forme, grâce à quoi l’unité de l’orthodoxie non seulement ne souffrit pas, mais en sortit même renforcée. Parmi les Grecs (mais pas tous), il acquit autorité et respect.
C’est à Paris, en été 1962, que je rencontrai de nouveau Mgr Nicodème, venu pour participer à une session du Comité du conseil œcuménique des Églises. S. N. Bolchakov (42), un homme aux nombreuses relations que j’avais bien connu à Oxford (où nous avions été voisins) et qui se trouvait à Paris à ce moment-là, me proposa d’organiser une rencontre entre l’archevêque Nicodème et le cardinal Tisserant (43), avec lequel Bolchakov était en très bons termes. Tisserant se trouvait alors en vacances en France, en Lorraine près de Metz, d’où il était originaire. Comme je le connaissais également, je répondis à Bolchakov que je ne désirais pas m’en mêler, ne sachant même pas si l’archevêque Nicodème accepterait une telle entrevue, cette question pouvant lui paraître délicate. Je suggérai à Bolchakov, s’il souhaitait organiser une telle rencontre, de s’adresser directement à l’archevêque Nicodème. C’est ce que fit Bolchakov et Mgr Nicodème accepta avec empressement de rencontrer le cardinal Tisserant. De fait, les travaux de la session du Comité une fois achevés, le 18 août 1962, l’archevêque Nicodème et moi, seuls, sans en parler à personne, prîmes le train pour Metz.
Nous fûmes accueillis en gare de Metz par un hiéromoine de Chevetogne, le père Théodore Strotmann (44), qui nous emmena chez des amis de Bolchakov où nous trouvâmes le cardinal Tisserant, Bolchakov lui-même ainsi que quelques autres représentants du clergé catholique. Un repas nous attendait, mais l’archevêque Nicodème, le cardinal Tisserant et moi, nous nous isolâmes d’abord dans une pièce voisine pour discuter. Bolchakov était fort mécontent de n’avoir pas été invité à participer à notre conversation. À plusieurs reprises, il frappa à notre porte ou l’entrouvrit, disant que le repas était servi et qu’on nous attendait, mais je répondais fermement. « Qu’ils attendent ! » Sans nous être concertés, nous entrâmes immédiatement dans le vif du sujet, à savoir la question de l’envoi d’observateurs au concile qui devait s’ouvrir au Vatican deux mois plus tard. L’archevêque Nicodème dit que ce problème n’avait pas encore été résolu par l’Église russe, mais qu’avant de prendre la moindre décision le patriarche et le Synode devaient connaître la nature des questions abordées par le prochain concile du Vatican. Quels en seraient le programme, les objectifs ? N’y adopterait-on pas des résolutions politiques dans l’esprit de la guerre froide qui rendraient impossible la présence de délégués de l’Église russe et les contraindraient à se retirer ? Il valait mieux, en effet, ne pas envoyer d’observateurs du tout plutôt qu’en envoyer et devoir les rappeler ensuite. Cela valait mieux pour les relations entre nos Églises. Le cardinal Tisserant répondit. « Le concile n’aura aucun caractère politique et n’entamera aucun combat contre le pouvoir soviétique. Il est vrai que je ne suis pas en mesure de garantir qu’il ne se trouvera pas, parmi les nombreux évêques et participants au concile, quelques personnes qui en feront la tentative. Nous ne pouvons pas le leur interdire, chacun est libre de s’exprimer, mais nous ferons notre possible pour les en dissuader et quoi qu’il arrive, le concile ne suivra pas cette ligne de conduite. Je vais vous donner un exemple. dans mes homélies, je ne dis jamais mot du pouvoir soviétique, du communisme ou du marxisme. En revanche, je prends souvent position contre l’athéisme. De même au concile. il sera question de l’athéisme, mais pas du pouvoir soviétique. » — « C’est votre droit le plus strict, répondit l’archevêque Nicodème, et nous ne voyons rien à y redire, bien au contraire. Ce qui nous importe, c’est que le concile n’entame pas de croisade contre le communisme et le pouvoir soviétique. Vos paroles nous rassurent sur ce point. »
L’archevêque Nicodème était manifestement satisfait, la discussion prit fin, nous repassâmes dans la pièce voisine pour déjeuner. À table, on ne parla ni du prochain concile du Vatican ni d’affaires ecclésiastiques en général et, malgré la curiosité manifeste des convives, nous ne dîmes rien du contenu de notre discussion dans la pièce voisine.
Je me souviens qu’à table l’archevêque Nicodème exprima l’opinion négative qu’il avait du clergé marié (il ne l’aimait pas), je protestai mais le cardinal Tisserant était de son avis. À ce moment-là déjà, ses sympathies catholiques commençaient à se manifester. Le jour même, l’archevêque Nicodème et moi reprîmes le train pour Paris et arrivâmes juste à temps pour le début de la vigile de la Transfiguration. Et, effectivement, à la suite de la rencontre de l’archevêque Nicodème et du cardinal Tisserant, des observateurs de l’Église orthodoxe russe (45)furent envoyés au concile du Vatican deux mois plus tard.
Ma rencontre suivante avec Mgr Nicodème, élevé peu auparavant au rang de métropolite (46), eut lieu lors de la deuxième Conférence de Rhodes, fin septembre 1963 (47). Cette fois, le métropolite Nicodème était venu seul de Moscou, sans interprète ni aucun « Varlamov ». J’étais le second représentant de l’Église russe et il n’y en avait pas d’autre. Je dois dire tout de suite que ses façons d’agir et son attitude à mon égard n’avaient rien de commun avec ce qu’elles avaient été lors de la première Conférence de Rhodes. Il me montrait tous les documents à l’avance, se concertait avec moi, me faisait participer à ses négociations avec les Grecs, même à celles qu’il appelait « privées ». Il existe une photographie où l’on nous voit assis à cinq à une table séparée, le métropolite Nicodème, le métropolite Méliton de Chalcédoine (président de la Conférence), le métropolite Justin de Iasi (48), un autre métropolite de Constantinople et moi ; nous sommes en train de discuter avec animation du programme de la Conférence. Je ne saurais expliquer précisément les raisons de ce changement d’attitude du métropolite Nicodème ; peut-être était-ce dû au fait qu’il n’était accompagné d’aucun « observateur », mais cela ne me semble pas un motif suffisant. Un changement intérieur s’était manifestement produit en lui, et plus jamais je n’eus avec lui de problèmes sérieux.
Contrairement à la première Conférence de Rhodes, la deuxième se déroula à effectifs restreints et le point principal à l’ordre du jour était la question de l’envoi d’observateurs orthodoxes au concile du Vatican qui venait de s’ouvrir. Par ailleurs, Constantinople souleva à l’improviste la question du commencement du dialogue théologique avec Rome. Sur la question des observateurs, des désaccords surgirent entre les Églises. La majorité s’était prononcée contre, mais grâce aux efforts du métropolite Nicodème, l’on trouva un compromis. Chaque Église locale se vit reconnaître le droit d’envoyer ou non des observateurs. Le métropolite Nicodème insista par ailleurs pour que les observateurs ne soient pas des évêques, la position d’observateur étant incompatible avec la dignité épiscopale. Tout cela indique que les opinions du métropolite Nicodème, à propos des catholiques romains, étaient modérées à cette époque. En ce qui concerne le dialogue théologique avec Rome, on arriva à un accord de principe mais, comme cette question ne figurait pas à l’ordre du jour de la Conférence, il fut décidé de reporter la décision à la prochaine conférence panorthodoxe, prévue l’année suivante. Cela n’alla pas sans mal. des objections furent émises par le métropolite Maxime de Lovetch (futur patriarche de Bulgarie) (49), lequel refusait de prendre une décision qui n’avait été ni discutée au préalable ni approuvée par l’Église bulgare. Il ne tenait pas en place sur son siège, faisait toutes sortes d’apartés avec le métropolite Nicodème. Mgr Nicodème lui conseillait avec insistance d’accepter la décision, soulignant qu’il ne s’agissait encore que d’un accord de principe. Il finit même par perdre patience et le métropolite Maxime céda. (Après la séance, le métropolite Nicodème me fit part de son mécontentement à propos du comportement du métropolite Maxime. « C’était gênant ! », me dit-il.)
Malheureusement, cette impression positive qu’avait produite sur moi le métropolite Nicodème et ses prises de position lors de la Conférence panorthodoxe fut gâchée par la dernière conversation que j’eus avec lui. Il se fait que pendant toute la durée de la Conférence, j’avais soigneusement évité de poser au métropolite Nicodème la moindre question sur la situation de l’Église en Russie. (Lui-même n’effleurait jamais ce sujet.) Je voulais lui éviter une situation embarrassante, pour ne pas l’obliger à mentir. À la fin de la Conférence cependant, nous fîmes ensemble le chemin vers l’aéroport d’Athènes, où nous avions chacun un avion à prendre, lui pour Moscou et moi pour Bruxelles. Nous eûmes quelques heures d’attente, sans accompagnateurs, en tête-à-tête. Soudain, de sa propre initiative et sans que je lui aie donné le moindre prétexte pour cela, le métropolite Nicodème se mit à parler de la situation de l’Église en Russie. « Je sais que, chez vous en Occident, beaucoup sont convaincus que l’Église est persécutée en Union soviétique. [On était en plein durant les répressions khrouchtchéviennes, quand les églises étaient fermées par milliers. — A. B]. En réalité, ce n’est pas cela ! Il est inexact de parler de la fermeture de paroisses. On pourrait plutôt définir ce qui est en train de se passer comme une « redistribution » ou un agrandissement des paroisses au bénéfice de la vie de l’Église. Il arrive par exemple que, dans des agglomérations de taille assez réduite, il y ait deux églises en fonctionnement, côte à côte, à quelques centaines de mètres de distance. C’est absurde ! Les paroisses se gênent entre elles, nous les réunissons donc et fermons l’une des deux églises. Il arrive aussi qu’une église qui fonctionne en pleine campagne ne soit fréquentée que par quelques croyants ou paroissiens, incapables de prendre en charge la présence d’un prêtre ou l’entretien du bâtiment. Ce sont eux qui nous demandent de fermer leur église.
La même chose peut arriver avec les séminaires. Vous avez probablement entendu dire que certains ont été fermés, eh bien, c’est uniquement parce qu’ils manquaient de séminaristes, ils étaient vides. D’ailleurs, ces séminaires avaient été ouverts pour répondre au grand manque de prêtres qui s’était fait sentir à la fin de la guerre. Mais maintenant, nous avons suffisamment de prêtres, nous n’avons donc pas besoin d’autant de séminaires. »
Jusque-là, j’avais écouté sans mot dire, mais je n’y tins plus et répondis que je ne pouvais pas croire que nous ayons une telle pléthore de clergé qu’on en fermait les séminaires, que j’avais au contraire entendu dire que certains pasteurs de l’Église avaient demandé l’ouverture de nouveaux séminaires. Je ne me souviens pas de la réponse du métropolite Nicodème, elle était peu claire. Je ne comprends toujours pas ce qui a poussé le métropolite Nicodème à me donner des informations aussi fausses sur la situation de l’Église en Russie. En admettant que des fermetures d’églises aient existé pour les raisons qu’il avait invoquées (deux églises côte à côte, ou trop peu de paroissiens), c’étaient là des cas isolés, alors qu’on assistait en réalité à la fermeture massive et forcée des paroisses, la démolition des églises (près de la moitié des églises existantes), etc. J’aurais pu comprendre que le métropolite Nicodème débite ces mensonges en public, lors d’une conférence de presse, mais pourquoi me dire des choses pareilles en tête-à-tête ? S’imaginait-il que j’allais le croire ? Une seule explication possible. à Moscou chez Kouroïedov, on lui avait donné l’ordre de le faire et il avait estimé plus « prudent » d’obéir à cette directive.
Au printemps 1964, l’archevêque Serge (Larine) (50), exarque pour l’Europe centrale, se rendit de Berlin à Paris. C’était une personnalité haute en couleur, il avait été évêque de l’Église vivante (51), avait été reçu au sein de l’église patriarcale comme simple moine, et ce n’est que plus tard qu’il avait de nouveau été intronisé évêque. Il bénéficiait de relations haut placées parmi les communistes, mais c’était un homme indépendant et bien informé. Je me trouvais alors à Paris et eus l’occasion de le voir, mais nos langues ne se délièrent (comme avec le métropolite Nicodème) qu’à l’aéroport du Bourget où nous attendions l’avion. Notre intéressante conversation en tête-à-tête se prolongea plus d’une heure. Avec une grande franchise, Mgr Serge se mit à raconter les terribles persécutions auxquelles l’Église de Russie était en butte ces dernières années, les fermetures massives d’églises, les violences, les arrestations. « Quel est le principal responsable de ces persécutions ? », demandai-je. — « C’est Khrouchtchev, répondit Mgr Serge d’un ton catégorique, c’est là son œuvre. »
Et l’archevêque Serge se mit alors à critiquer violemment Khrouchtchev, non seulement pour sa politique antireligieuse, mais pour son mode de gestion en général. « Je sais, par mes relations, qu’il y a contre lui un mécontentement généralisé, même dans les hautes sphères. Cela ne pourra continuer longtemps ainsi. Il y aura forcément du changement. » J’étais très impressionné par la façon courageuse dont s’exprimait cet archevêque « soviétique » à propos du chef du gouvernement soviétique, jamais je ne devais revoir pareille franchise. Par la suite, j’allais aussi être très impressionné de la justesse de ses prophéties par lesquelles, six mois avant que cela n’arrive, il avait prédit la chute de Khrouchtchev (52). Mais l’information la plus précieuse était pour moi sa désignation de Khrouchtchev comme principal responsable des persécutions contre l’Église. Nous comprenions parfaitement qu’il se passait quelque chose de terrible, qu’on anéantissait véritablement ce qui restait de l’Église sous le régime soviétique, mais n’avions pas une idée bien précise du rôle de Khrouchtchev en la matière, sa réputation d’acteur libéral du « dégel » et d’antistalinien brouillait les pistes. Mais Mgr Serge le désignait franchement, sans faux-semblants. Je lui en étais très reconnaissant. « Vous me dites ces choses-là, lui demandai-je encore, mais le métropolite Nicodème lui, s’étant récemment trouvé en Occident, a affirmé lors d’une interview qu’il n’y avait pas trace en Russie de persécutions contre la foi et l’Église. » — « C’est une honte !, s’écria l’archevêque Serge. Il se déshonore en agissant de la sorte ! Quand on ne peut pas la vérité, on se tait. À quoi bon donner des interviews ? Moi, je n’en donne jamais. »
Durant l’année 1964, j’eus encore à plusieurs reprises l’occasion de rencontrer Mgr Nicodème (entre-temps devenu métropolite de Leningrad et de Ladoga (53), et ensuite de Novgorod aussi (54)). Une première fois en mars, à Driebergen (Pays-Bas), où il prenait part à une conférence œcuménique ou pacifiste. Il me demanda de lui rendre visite et je vins en compagnie de l’higoumène (devenu par la suite archimandrite) Corneille (55). Lors de notre entrevue avec Mgr Nicodème, l’higoumène Corneille lui montra un journal qui publiait en exclusivité des appels lancés par les croyants d’Union soviétique au sujet de persécutions dans la province de Minsk et surtout à Potchaïev (56).
Le métropolite Nicodème parcourut rapidement le texte et perdit sa contenance et son habituelle maîtrise de soi. Il était évident qu’il n’avait jamais vu ce document auparavant. « Eh bien, il va falloir vérifier cela, bredouilla-t-il, déterminer la part de vérité et comprendre comment cela a pu passer la frontière. » Il prit le journal et s’éloigna. Quelques heures plus tard, il réapparut, parfaitement calme et dit. « Tout ceci est de la propagande antisoviétique dans l’esprit de la guerre froide, c’est probablement fabriqué de toutes pièces en Occident. C’est truffé d’inexactitudes et de mensonges, n’y accordez aucun crédit ! »
Vers la fin du mois de septembre de la même année, le patriarche Alexis accepta l’invitation de l’Église anglicane à venir en Grande-Bretagne. Il était accompagné de tout un groupe de personnalités, dont le métropolite Nicodème. Pour rencontrer le patriarche, je me rendis aussi à Londres. Ce dernier me reçut et j’eus plusieurs entretiens avec le métropolite Nicodème.
À Londres, le jour de la Théophanie (57), une procession et une bénédiction des eaux avaient été célébrées par des orthodoxes, sur la Tamise, en guise de protestation contre la persécution de l’Église en Union soviétique. Notre exarque, l’archevêque (futur métropolite) Antoine, avait présidé la célébration.
L’archiprêtre Vladimir Rodzianko (58) de l’Église de Serbie avait tenu un discours enflammé contre ces persécutions (Mgr Antoine n’avait rien dit personnellement). Cette célébration ayant été annoncée à l’avance dans les journaux, l’événement attira une grande quantité de personnes et l’affaire fit beaucoup de bruit. On comprendra aisément que cette manifestation déplut fortement aux bolcheviks qui se mirent à faire pression sur le patriarcat de Moscou pour que l’exarque Antoine soit démis de ses fonctions. Le patriarcat résista aussi longtemps qu’il put, mais finit par céder, tout en décidant de procéder « de façon digne ».
La tâche leur fut simplifiée par le fait que Mgr Antoine, malgré ses évidentes qualités personnelles en tant que pasteur et prédicateur et son talent pour attirer les gens à l’église, avait aussi de gros défauts en tant qu’administrateur (il ne répondait pas aux lettres et ne venait jamais à Paris, y négligeant les affaires de l’exarchat, ce qui avait suscité un flot de plaintes au patriarcat de Moscou). Mais en Grande-Bretagne, les affaires pastorales de Mgr Antoine étaient irréprochables et n’expliquaient pas l’insistance que mettait Kouroïedov à vouloir l’éloigner. Toujours est-il que la délégation du patriarcat menée par Sa Sainteté se mit en route pour Londres, déterminée à demander à l’archevêque Antoine de démissionner de ses fonctions d’exarque (tout en restant archevêque diocésain en Grande-Bretagne). Ayant appris cela à Genève, le père Vital Borovoï, notre représentant auprès du Conseil œcuménique des Églises, ressentit une vive inquiétude. Il monta dans l’avion du patriarche qui avait fait escale à Genève et — comme le père Borovoy me le raconta lui-même — tenta pendant toute la durée du vol de convaincre le métropolite Nicodème de ne pas exiger le départ de Mgr Antoine, car ce dernier jouissait d’une grande popularité en Occident, dans les cercles non orthodoxes et œcuméniques, sans parler des orthodoxes. Le père Vital disait que cette mise à la retraite porterait un coup énorme au patriarcat de Moscou et serait (justement !) interprétée comme de la persécution antireligieuse. « Je réussis à convaincre Mgr Nicodème et il me promit de ne pas se mêler de cette affaire, ou du moins de ne pas insister sur la nécessité du départ de Mgr Antoine », me raconta le père Vital.
Apparemment, le métropolite Nicodème tint sa promesse. La veille de son départ, le patriarche reçut, le soir, en présence du métropolite Nicodème, chacun des évêques de notre exarchat en entretien privé. Quand vint mon tour, je lui transmis une lettre de Denis Chambault, notre archimandrite de Paris (59). Sans la lire, le patriarche me dit. « Dites-moi, que s’est-il passé entre le père Denis et le métropolite Nicolas, votre ancien exarque ? Pourquoi sont-ils brouillés et refusent-ils de collaborer ? » — « Ce n’est pas seulement le cas du père Denis, répondis-je, personne ne pouvait travailler avec Mgr Nicolas. C’est un homme aux nerfs extrêmement sensibles, très soupçonneux, c’est pourquoi cela a été un véritable soulagement pour nous de le voir partir et être remplacé par Mgr Antoine. » C’était la pure vérité, mais, connaissant la situation, je voulais souligner les qualités de Mgr Antoine et lui manifester mon soutien. « Ah bon ? Mais il ne semble pourtant pas à la hauteur de ses responsabilités d’exarque ! », s’étonna le patriarche. Je répondis que Mgr Antoine n’était peut-être pas exempt de quelques défauts du point de vue administratif, qu’il ne répondait pas aux lettres et ne se rendait pas à Paris, mais que nous étions prêts à endurer cela, l’important étant qu’il était un bon pasteur et père spirituel, qu’on l’aimait et l’appréciait, au-delà même de la Grande-Bretagne.
« C’est vrai, c’est un bon prêtre de paroisse », répondit le patriarche. Tout au long de cette conversation, le métropolite Nicodème qui était présent garda le silence, ne se mêla de rien. Au sortir de chez le patriarche, je compris que la position du métropolite Antoine était sérieusement affaiblie et décidai de l’avertir de la teneur de cette conversation.
Ce n’est que le matin suivant que je le rencontrai, quand nous prîmes le thé dans sa maison où j’étais hébergé en compagnie de l’évêque Alexis (Van der Mensbrugghe). « Hier, le patriarche m’a proposé de partir à la retraite, dit soudain Mgr Antoine, et m’a demandé de préparer une lettre de démission et de la lui remettre. » Nous ressentîmes un grand choc même si, après ma conversation de la veille avec le patriarche, cette nouvelle n’avait rien pour m’étonner. Mgr Antoine nous donna quelques détails. « Le patriarche m’a reçu tard hier soir. Pendant que j’attendais mon audience, je vis s’approcher de moi Daniel Andreïevitch Ostapov (qui était officiellement secrétaire particulier du patriarche, laquais héréditaire de la famille Simansky (60), personnalité douteuse, surnommé Daniel « de toutes les Russies » ou Daniel « par qui tout a été fait » — A. B.) qui se mit à m’interroger en détail sur ma santé, sur un éventuel surmenage dans la gestion de mes affaires, me demandant si je parvenais à tout faire, si la charge d’exarque n’était pas trop lourde pour moi, etc. ». L’archevêque Antoine, par modestie, répondit que oui, sa tâche était difficile, qu’il avait du mal à tout faire, que sa santé n’était pas bonne… (mais cela ne signifiait pas qu’il renonçait à sa charge d’exarque). Après cet interrogatoire, Ostapov alla dire au patriarche que Mgr Antoine reconnaissait lui-même ne pas être à la hauteur de ses obligations et les trouvait pesantes. Quelques instants après, le patriarche appela l’archevêque Antoine et lui dit d’emblée. « J’ai entendu dire que vous ne parveniez pas à accomplir toutes vos obligations d’exarque et que vous les trouviez pesantes. Je vous propose de donner votre démission de ces fonctions pour raison de santé. Je vous demanderai d’écrire votre lettre pour demain matin et de me la remettre avant mon départ de Grande-Bretagne. »
« C’est ce que j’ai fait, j’ai rédigé ma lettre et je vais de ce pas la remettre au patriarche », dit l’archevêque Antoine en conclusion de son récit. (J’ajouterai tout de même qu’ensuite l’archevêque Antoine fut décoré de l’ordre de Saint-Vladimir de première classe (61), officiellement pour avoir organisé l’accueil de la délégation en Angleterre, mais en réalité pour lui faire « avaler la pilule » de sa retraite).
Quant à l’archiprêtre Vital Borovoï, commentant le rôle joué par D. A. Ostapov dans cette affaire, il me dit. « La façon dont a été organisée la mise à l’écart de Mgr Antoine a démontré, avec la clarté la plus aveuglante, le rôle d’Ostapov en tant qu’agent de Kouroïedov et du KGB. Ostapov a mené à bien ce que le métropolite Nicodème avait refusé de faire. »
Le séjour du patriarche à Londres fut aussi parsemé d’incidents désagréables pour le métropolite Nicodème.
Tout commença quand l’archevêque Antoine insista pour que le métropolite Nicolas (Eremine), notre ancien exarque, soit invité à l’occasion de la venue du patriarche. L’archevêque Antoine voulait ainsi « consoler » l’ex-exarque de sa mise à l’écart (il avait été retraité un an et demi auparavant), mais aussi lui donner l’occasion, comme il l’avait demandé lui-même, de rencontrer le patriarche et de lui faire part de ses griefs contre le métropolite Nicodème. Officiellement, le métropolite Nicolas fut invité par l’archevêque de Canterbury Michael Ramsay (62), qui le considérait comme une « victime des persécutions » et l’avait invité pour « contrarier » Mgr Nicodème qu’il ne pouvait pas supporter, bien que ne le connaissant pas personnellement.
Les différends entre l’archevêque Michael Ramsay et le métropolite Nicodème surgirent presque immédiatement après une intervention publique (ou une conférence de presse) durant laquelle le métropolite Nicodème avait parlé des libertés religieuses en URSS « dans les limites de la Constitution » (que signifiait cette formulation prudente ?).
En réponse à cette intervention du métropolite Nicodème, l’archevêque Michael Ramsay lui dit. « Nous ne pouvons exiger de vous que vous disiez toute la vérité en public, mais vous ne devez pas mentir de manière éhontée ! » Furieux, le métropolite Nicodème répondit d’un ton sec qu’il n’admettait pas qu’on lui fasse de telles remarques.
Durant ce séjour londonien, de tels incidents se reproduisirent à plusieurs reprises. Par exemple, lors du dîner de gala donné en l’honneur du patriarche par l’archevêque de Canterbury, le patriarche, naturellement, était assis à coté de l’archevêque Ramsay — ou peut-être face à lui —, mais la seconde place avait été attribuée non pas au métropolite Nicodème, ce qui pourtant aurait semblé de mise, mais à notre ancien exarque le métropolite Nicolas, « victime des persécutions » ! Quant au métropolite Nicodème, on l’avait placé bien plus bas, à côté de l’ambassadeur britannique à Moscou. « Nous pensions que le métropolite Nicodème serait intéressé de rencontrer notre ambassadeur à Moscou et que cela pourrait même être utile à l’Église russe, d’autant que notre ambassadeur comprend le russe, me dirent par la suite les anglicans d’un air naïf, même si nous croyons plutôt qu’il s’agissait là d’un « coup » de l’archevêque de Canterbury. »
Quoi qu’il en soit, le métropolite Nicodème fut mortellement vexé. Il s’assit certes à la place qui lui avait été indiquée, mais il prit un air renfrogné ne toucha pas à son dîner et n’adressa pas un mot à ses voisins. Cet épisode provoqua pour de longues années un sentiment hostile du métropolite Nicodème envers l’Église d’Angleterre. Je dois dire qu’après le départ à la retraite de l’archevêque de Canterbury Michael Ramsay et son remplacement par l’archevêque Coggan (63), cette hostilité envers l’Église anglicane s’adoucit beaucoup, les relations se normalisèrent pour redevenir tendues au moment où les anglicans acceptèrent l’ordination des femmes (64).
Presque immédiatement après mon voyage en Grande-Bretagne, je reçus une invitation du patriarcat pour me rendre à Moscou, où je passai quinze jours (du 5 au 20 octobre 1964). C’était mon premier voyage après un intervalle de quatre ans. La raison officielle de cette invitation était la remise d’un diplôme de docteur en théologie de l’académie de théologie de Leningrad pour ma publication du texte grec des Catéchèses de saint Syméon le Nouveau Théologien (65). Mais j’avais aussi l’impression qu’après la demande de démission de l’archevêque Antoine, le patriarcat lui cherchait un remplaçant et désirait voir dans quelle mesure je pourrais faire l’affaire. Fort de ce pressentiment, je fis tout ce qui était en mon pouvoir pour saboter ma propre candidature, car non seulement je ne voulais absolument pas être exarque, mais je désirais encore moins prendre la place du populaire Mgr Antoine, après qu’il eut été limogé ; tout le monde me l’aurait reproché.
Le lendemain de mon arrivée, je fus invité à dîner à la résidence secondaire du métropolite Nicodème près de Moscou, au lieu-dit Serebrianny Bor. C’était une grande datcha de bois construite sur une île de la Moskova, entourée d’une forêt de pins. Toute la nomenklatura soviétique y avait ses datchas et on avait autorisé le métropolite Nicodème à acquérir cette maison pour lui permettre d’y recevoir ses hôtes étrangers et les hauts responsables soviétiques ; il y habita longtemps. La maison était meublée de façon remarquable, bien qu’on y fasse constamment des travaux, démolissant l’ancien pour reconstruire du nouveau. Il y avait là une splendide collection d’icônes anciennes ! Je n’ai jamais rien vu de pareil.
Une surprise m’attendait. P. V. Makartsev, collaborateur de Kouroïedov au Conseil aux affaires religieuses (ou quelle que soit la dénomination de cet organisme à ce moment-là. comme pour la Tcheka, la dénomination changeait souvent, mais la substance ne variait pas).
Je fus étonné par cette rencontre inattendue. Nous dînâmes, le métropolite Nicodème présidant le repas, j’étais assis à sa droite, Makartsev à sa gauche, face à moi. Il avait l’air parfaitement à l’aise dans cette maison, on voyait qu’il y venait souvent. On disait qu’avec le métropolite Nicodème, ils se tutoyaient, mais je n’en fus pas témoin. On m’a également affirmé que le métropolite Nicodème le faisait boire pour obtenir ensuite des concessions au profit de l’Église ou la solution de telle ou telle question, mais je ne sais pas si c’est vrai. Cela dit, les cas où des hiérarques faisaient boire des représentants du pouvoir soviétique pour le bien de l’Église étaient monnaie courante en Union soviétique. C’était, dit-on, la méthode préférée de l’archevêque catholique-romain de Riga. Ce soir-là en tout cas, Makartsev resta parfaitement sobre. Avant le repas, on nous proposa du cognac. Comme je déteste cette boisson, je refusai. « Eh bien, Mgr Basile, votre vie en Occident vous fait oublier les traditions russes ? », fit sarcastiquement remarquer Makartsev. — « De quelle tradition parlez-vous ?, rétorquai-je. La tradition en Russie, c’est de boire de la vodka avant le repas et non du cognac. » Il y eut un moment de confusion, le métropolite Nicodème commanda, malgré mes protestations, qu’on nous apporte de la vodka, et immédiatement l’on nous en apporta de la pièce voisine. Mais je n’en bus pas, car je n’aime pas cela. Par la suite, on ne nous servit que du vin.
La conversation à table se poursuivit, d’une manière étrange, sur des thèmes « patriotiques ».
« Alors, vous avez pris un avion soviétique pour venir ? », me demanda Makartsev. — « Non », répondis-je. — « Pourquoi n’avez vous pas pris un de nos avions ? » — « Il n’y avait pas de vol avec Aeroflot ce jour-là. Si j’avais attendu d’en avoir un, je serais arrivé en retard pour les célébrations à la laure. » — « Assistez-vous aux célébrations de nos grandes fêtes nationales à l’ambassade soviétique, à la fête de la révolution d’Octobre et pour le premier mai ? Recevez-vous des invitations pour ces fêtes ? » — « Non, dis-je, on ne m’invite pas et je n’y vais pas. » — « Voulez-vous que nous écrivions pour ce que vous soyez invité ? », demanda vivement Makartsev. À ce moment, le métropolite Nicodème se mêla à la conversation. « Mgr Basile vit à l’étranger de façon permanente et il n’a absolument pas besoin de fréquenter les réceptions de l’ambassade. Cela ne causerait que du tort à notre Église là-bas, car les paroissiens en seraient indignés. Ne faites rien pour qu’il soit invité. » — « Je suppose que vos fidèles sont des émigrés de l’intelligentsia d’ancien régime ? », demanda alors Makartsev. — « Oui, répondis-je, pour la plupart d’entre eux, c’est la vieille diaspora russe. Mais il y a aussi des Belges et des Français convertis à l’orthodoxie (66). »
Notre dîner se passa ainsi, en conversations somme toute superficielles et je commençais à me demander dans quel but on m’avait fait rencontrer Makartsev quand je vis soudain le métropolite Nicodème prendre un air concentré, pensif, puis échanger un regard avec Makartsev. Enfin, après un bref moment de silence, il dit d’une voix grave (je compris immédiatement que les choses sérieuses avaient commencé). « Nous avons été extrêmement décontenancés par la demande de démission de Mgr Antoine, nous ne nous attendions vraiment pas à cela. Qu’est-ce qui a bien pu lui passer par la tête ? Il nous a fait beaucoup de peine. » Mon cœur se mit à battre plus fort ; comme nous le savons, la réalité était tout autre. Mais c’était à mon tour d’être étonné. Mgr Nicodème était-il vraiment assez naïf pour supposer que l’archevêque Antoine ne m’avait rien raconté des circonstances réelles de sa démission, de qui émanait l’initiative et comment tout avait été « bien » organisé ? Mais le métropolite Nicodème était loin d’être naïf, c’était donc une manœuvre consciente qui visait à me faire endosser et entériner la version officielle. la démission volontaire de Mgr Antoine, prise de sa propre initiative et pour raisons de santé. « Selon ce que je sais, répondis-je, c’est le patriarche qui a proposé à Mgr Antoine de donner sa démission des fonctions d’exarque. Et nous sommes tous très affligés de cette situation et de son départ. » À cet instant, Makartsev intervint dans la conversation et de concert avec le métropolite Nicodème se mit à critiquer l’archevêque Antoine dans ses fonctions d’exarque, disant qu’il négligeait les affaires courantes, ne répondait jamais à son courrier, qu’il y avait eu des plaintes contre lui, etc. « En tout cas, en Grande-Bretagne tout le monde en est très content, répondis-je, et même à Paris tout ne va pas si mal. Nous l’apprécions beaucoup en tant qu’homme et en tant qu’exarque, bien plus que son prédécesseur le métropolite Nicolas. » — « Bien entendu, celui-là, c’était un cosaque, il était plus à l’aise avec sabre à la main, qu’en célébrant la liturgie », dit Makartsev en riant. — « C’est inexact, rétorquai-je, pendant la guerre, le métropolite a été réformé pour raisons de santé et a travaillé dans l’administration à l’arrière du front. Il n’a jamais manié le sabre de sa vie. Quant à Mgr Antoine, nous apprécions ses qualités tant pastorales que personnelles. De plus, il jouit d’une large notoriété et popularité dans les milieux chrétiens occidentaux, son départ va faire grand bruit en Occident et sera considéré comme de la persécution antireligieuse. » Ce dernier argument avait visiblement produit une certaine impression sur Makartsev. Il réfléchit et demanda. « Eh bien, que devrions-nous faire, selon vous ? » — « C’est très simple, répondis-je, il suffit de refuser la démission de l’archevêque Antoine et le maintenir dans ses fonctions d’exarque. »
Nous en restâmes là. La déception était peinte sur les visages de mes interlocuteurs. Je n’avais pas répondu à leurs attentes. Ils pensaient que j’allais me joindre à eux pour critiquer l’archevêque Antoine et que j’approuverais sa mise à l’écart. Mais ma défense de Mgr Antoine les avait déçus et leur conviction que j’accepterais de collaborer avec eux s’était avérée une illusion. En un mot, ma candidature n’était plus à l’ordre du jour, cette séance d’évaluation avait été un échec, ce dont j’étais très heureux !
En fin de compte, le résultat de cette conversation s’avéra tout à fait positif pour l’archevêque Antoine. La réunion du Saint-Synode durant laquelle devait être examinée la demande de démission de l’archevêque Antoine et la nomination d’un nouvel exarque fut, comme me l’apprit le prêtre qui me servait d’accompagnateur à Moscou, simplement annulée au dernier moment. Par après, Mgr Antoine fut convoqué à Moscou, eut une entrevue avec Kouroïedov et Makartsev, et non seulement ne fut pas démis de ses fonctions d’exarque mais confirmé dans celles-ci, et même promu au rang de métropolite.
Deux jours après mon dîner chez le métropolite Nicodème, j’assistai aux célébrations de la saint Serge à la laure (67). Pendant les vigiles à la cathédrale de la Trinité, j’entrai en conversation avec un jeune hiéromoine dont j’ai oublié le nom. Il avait été hiérodiacre auprès du métropolite Nicodème. « Je l’aimais et le respectais pour ses nombreuses qualités, me dit-il, puis nous avons cessé de nous entendre. Quand je lui racontais les innombrables cas de persécutions contre les croyants, sa réaction était toujours la même. « Ils n’ont à s’en prendre qu’à eux-mêmes ! Ce sont les imbéciles qui s’attirent les coups ! » Jamais je ne l’ai entendu prononcer la moindre parole de sympathie pour les victimes de la foi, il prenait toujours la défense des persécuteurs, il les justifiait. Les croyants étaient — pour lui — toujours coupables d’avoir enfreint la loi soviétique, ou alors c’étaient des naïfs, incapables de saisir toute la complexité de la position de l’Église et de la voie qu’elle suivait dans les circonstances actuelles. J’ai fini par n’y plus tenir, j’ai rompu avec le métropolite Nicodème et j’ai quitté son service. »
Deux jours plus tard, je me rendis à Leningrad, à la séance de clôture de l’académie de théologie, pour la fête du saint apôtre Jean le Théologien (68). Le métropolite Nicodème me remit le diplôme de docteur, me donna l’accolade, prononça un chaleureux discours de bienvenue. Tout cela se déroula de manière particulièrement solennelle et majestueuse. Pour la fête de la Protection de la Mère de Dieu (69), j’étais de nouveau à la laure de la Trinité-Saint-Serge pour la séance de clôture de l’académie de théologie de Moscou. J’y rencontrai par hasard l’archevêque Hermogène (Goloubiov) de Kalouga et Borovsk (70) qui allait bientôt être mis à la retraite. Entre autres choses, je lui demandai quelle opinion il avait du métropolite Nicodème. « Il n’est pas des nôtres, me répondit Mgr Hermogène, il ne sert pas l’Église, mais l’État. Ou dans le meilleur les cas, il sert à la fois l’un et l’autre. Des comme ça, nous n’en avons pas besoin. Mais malgré tout, il vaut mieux que bien d’autres. »
À peine rentré de Moscou à Bruxelles, je dus presque immédiatement prendre l’avion pour Athènes où je retrouvai le métropolite Nicodème qui était venu pour participer, comme moi, à la troisième Consultation panorthodoxe sur l’île de Rhodes (1-15 novembre 1964) (71). Il était accompagné de l’archimandrite Philarète (notre exarque actuel) (72), ainsi que de l’évêque Élie, actuel patriarche de Géorgie (73). Pendant la Consultation, nous déjeunions à trois à une table séparée et nos conversations étaient animées. Je me souviens que la fête de la Révolution d’Octobre tomba pendant le séjour. Étant donné qu’il s’agissait d’un samedi et d’un dimanche (jours où il n’y avait pas de réunions), le métropolite Nicodème décida de se rendre à Athènes, pour assister à la réception de l’ambassade d’URSS. Il nous en informa pendant le repas. « Monseigneur, ne faites pas cela, lui dis-je, tout le monde va vous juger. On dira qu’un métropolite orthodoxe a préféré assister à une réception officielle au contact avec ses confrères. Le dimanche, outre la liturgie, il est prévu de nous emmener en bateau visiter le monastère de l’île de Symi. Ce sera intéressant pour vous et même utile à notre travail. Vous pourrez échanger avec les participants de la Conférence. » Mgr Nicodème ne répondit rien, mais ne se rendit pas à Athènes, se faisant représenter par l’un des interprètes. Alors l’évêque Élie, un homme à l’humour oriental caustique et qui aimait plaisanter, se mit à ironiser devant le métropolite Nicodème et l’archimandrite Philarète. « Comment, Mgr Basile, vous n’allez pas aux célébrations de la Révolution d’Octobre ? Quel manque de patriotisme ! Tout citoyen soviétique se doit d’assister à une telle fête ! » — « Mais je ne suis pas citoyen soviétique », répondis-je. — « Comment ? Vous n’êtes pas citoyen soviétique ? C’est impossible ! Et le patriarcat le tolère et n’exige pas que vous preniez la citoyenneté soviétique ? C’est incroyable ! » Cette tirade de l’évêque Élie était adressée sur un ton persifleur, quasi moqueur, au métropolite Nicodème. Ce dernier répondit. « Vous vous faites des idées, Mgr Basile est libre d’avoir la citoyenneté qui lui chante, cela nous est parfaitement égal. »
Je rapporterai encore un épisode, que j’ai retenu. Pendant la Conférence, des vigiles furent célébrées dans l’une des églises de Rhodes et le métropolite Nicodème y prononça une homélie courte, mais de bonne tenue, quoique teintée d’une discrète pointe de propagande soviétique. Le professeur Bratsiotis (de la faculté théologique d’Athènes) qui se tenait à mes côtés me fit remarquer, en commentant les paroles du métropolite Nicodème d’une voix suffisamment forte pour se faire entendre de notre entourage. « Khrouchtchev savait qui il envoyait ! »
Il faut préciser que Khrouchtchev était considéré à l’époque, par les Grecs, comme un libéral et un homme exceptionnel (son rôle de persécuteur de l’Eglise était alors très peu connu). C’est pourquoi les paroles de Bratsiotis devaient être interprétées comme un compliment au métropolite Nicodème ; Khrouchtchev avait apprécié ses remarquables qualités à leur juste valeur.
Je souhaiterais encore ici mentionner un autre point à propos de la conférence de Rhodes. Des années plus tard, je lus dans les journaux, une déclaration du métropolite Augustin de Kozani, de l’Église de Grèce, qui n’avait pas assisté à la conférence de Rhodes, mais affirmait que pendant toute la durée des travaux, le métropolite Nicodème avait été pendu au téléphone avec le Kremlin ; il aurait reçu ses instructions du gouvernement soviétique et rendu compte de l’avancée des travaux. Je peux certifier que c’est un mensonge. Ma chambre d’hôtel à Rhodes était voisine de celle de Mgr Nicodème et à travers la cloison (fine, malheureusement) qui nous séparait, j’entendais sans le vouloir distinctement chacune des paroles qu’il prononçait assez fort dans ses conversations avec Moscou. Pas une fois, il ne parla à une institution ou à un fonctionnaire soviétique, il appela exclusivement le Département des relations extérieures du patriarcat et ne parla qu’à des membres du clergé. Il ne demandait d’instructions à personne, mais il racontait en détail les développements des travaux de la Conférence. J’ajouterai que les représentants du patriarcat de Constantinople passaient leur temps au téléphone avec le patriarche Athénagoras et que c’est lui qui leur demanda d’accepter une solution de compromis. Sans compter qu’il y avait là, par ailleurs, de nombreux représentants du ministère grec des affaires étrangères, et que les Grecs, surtout les membres de l’Église de Grèce, se réunissaient constamment avec eux et écoutaient leurs instructions, ce qui me semble déjà moins normal.
Je me rappelle aussi qu’à Rhodes, nous fîmes la connaissance d’un politicien grec local, démocrate convaincu, qui nous fit part de ses — sincères, me semble-t-il — convictions russophiles (mais non soviétophiles). Il attaquait ouvertement le communisme, disant que c’était là un système tyrannique et barbare. Le métropolite Nicodème l’écouta sans rien dire et ne lui opposa pas le moindre argument. Le Grec en vint à parler de Venizélos (premier ministre de Grèce, 1864-1936) et de son affrontement avec le roi Constantin. « Mais qui était Venizélos ? », me demanda tout à coup le métropolite Nicodème. Il se fait qu’il n’avait jamais entendu parler ni de Venizélos, ni de Constantin. Je fus frappé d’une telle lacune, résultat d’une éducation soviétique unilatérale et de l’isolement dans lequel les gens qui habitaient là-bas se trouvaient vis-à-vis du reste du monde.
Pour en terminer avec les aspects « politiques » de la conférence de Rhodes, je raconterai encore qu’alors que nous étions déjà rentrés à Athènes et que nous quittions un matin notre hôtel en voiture, nous eûmes une surprise. À la sortie nous attendait un groupe de cinq à sept hommes assez costauds qui, nous voyant, s’écrièrent en chœur, comme des militaires. « Yia sou, Nikodime ! » (« Salut, Nicodème ! », en langue grecque démotique). C’était apparemment une manifestation organisée par les communistes locaux, à moins que ce ne fût une provocation de la police dans le but de savoir quelle serait la réaction du métropolite Nicodème. Mais celui-ci ne réagit en aucune manière, il resta impassible sur son siège, pas un muscle de son visage ne tressaillit. Nous ne reparlâmes jamais de cet incident avec lui.
La conférence de Rhodes impliquait un grand nombre de déplacements, aussi bien à l’intérieur de la ville, que lors de pèlerinages dans les environs. Nous faisions ces déplacements en voiture avec le métropolite Nicodème, ce qui me donna l’occasion d’avoir avec lui de nombreuses conversations théologiques. Il est vrai que ces conversations revenaient plutôt à une sorte d’examen que je lui faisais passer, mais il parlait volontiers, répondait de bonne grâce à mes questions et m’en posait parfois aussi. Suite à ce long « examen », je suis en mesure d’affirmer que les récits des personnes hostiles au métropolite Nicodème qui l’accusent d’être ignare en théologie, de ne pas connaître les textes liturgiques, etc. sont loin de correspondre à la réalité. Il est indéniable que le métropolite Nicodème était un homme à l’esprit plutôt pratique que théologique. Ce n’était pas un théologien érudit (ni, a fortiori, un théologien profond) comme on l’a beaucoup dit dans ses nécrologies, mais il possédait cependant une culture théologique solide et étendue, particulièrement en ce qui concerne l’ordo liturgique et le typikon, culture parfaitement suffisante pour un évêque. Un évêque n’est en effet pas un professeur, on n’a pas à en attendre des merveilles du point de vue de la théologie. Je puis ajouter qu’avec les années ses connaissances ne cessèrent de se développer et de s’étendre.
La IIIe Conférence panorthodoxe dépassa en nombre de participants toutes les conférences orthodoxes de ce type. Les travaux en furent principalement consacrés à la question du commencement d’un dialogue théologique avec les non-orthodoxes, à savoir les catholiques, les anglicans et les vieux-catholiques. Nombre de difficultés et de désaccords surgirent à ce sujet. Ce n’est que grâce à des négociations « privées », diurnes et nocturnes, parfois jusqu’au matin, qu’on arriva à les surmonter. Et, une fois encore, ce fut largement grâce à la détermination, à l’habileté diplomatique et surtout la modération du métropolite Nicodème qui pensait toujours à l’unité panorthodoxe et à la nécessité de ne pas la rompre. Suite à cela, il acquit une certaine autorité à l’échelle panorthodoxe, mais aussi au sein de notre délégation. Ainsi, alors que nous déjeunions, comme à l’accoutumée, à une table séparée, nous nous lançâmes dans une discussion au sujet de la reconnaissance du patriarcat de Moscou par les Grecs à la fin du XVIe siècle lors de conciles locaux qui s’étaient tenus à Constantinople et au sujet du cinquième rang qui lui avait alors été proposé dans l’ordre des diptyques (74). Le métropolite Nicodème exprima son regret du fait que le patriarcat de Moscou ne se soit pas vu proposer un rang plus élevé et émit l’opinion qu’à l’époque dont nous parlions, il aurait été possible d’obtenir cela. « Cela n’a pas été fait à cette époque parce que vous n’y étiez pas, dit l’archimandrite Philarète. Si vous y aviez été, vous l’auriez obtenu. »
On sentait que c’était bien là sa conviction profonde et non de la flatterie.
Je me souviens ici d’une autre conversation, bien qu’elle ne soit pas déroulée à Rhodes. Le métropolite Nicodème m’exprima un jour sa déception et son étonnement de ce que l’ancienne Russie n’avait pas réussi à prendre Constantinople et à replacer la croix sur Sainte-Sophie. « Maintenant, c’est malheureusement devenu impossible. » — « Oui, répondis-je, d’abord, ce sont les Anglais qui l’ont empêché, et la Russie n’a pas voulu entamer une grande guerre pour Constantinople, puis quand c’était devenu presque possible, la révolution y a fait obstacle. »
En quoi consistait, cependant, la popularité incontestable et de l’autorité dont jouissait le métropolite Nicodème dans le monde orthodoxe, dans les milieux œcuméniques et en Occident en général ? Car on a vu qu’au sein de l’Église russe, si son pouvoir n’était pas discuté, son autorité morale était beaucoup plus contestée. Je tenterai de répondre à cette question de façon aussi complète qu’impartiale.
La première et fondamentale raison de l’influence exercée par le métropolite Nicodème était, sans conteste, sa personnalité hors du commun, son esprit vif et très pratique. C’était une nature volontaire et un fin psychologue, un leader naturel. Il avait quelque chose d’un hypnotiseur, de nombreuses personnes étaient sensibles à son charme. Mais ce n’est pas tout. À ces traits de sa personnalité venait s’ajouter la réputation qu’il s’était faite d’homme de pouvoir, de numéro un de l’Église orthodoxe russe, bénéficiant du soutien inconditionnel du gouvernement soviétique. Ce pouvoir relevait souvent plus de la légende que de la réalité, mais cela impressionnait. Les gens aiment s’incliner devant les forts ou ceux qu’ils croient forts, surtout en Orient, dans le monde orthodoxe grec ou arabe. Enfin, il faut avouer que certaines personnes étaient favorablement disposées à son égard par ses généreux cadeaux. Où qu’il aille, il en avait toujours sur lui, qu’il distribuait à droite et à gauche ; il disposait d’importants moyens financiers, de vodka, de cognac, de « canapés de caviar » et de souvenirs de prix. Aucun autre évêque d’URSS ne disposait de tels moyens lors de ses déplacements à l’étranger. C’était là bien sûr un procédé assez primitif, mais qui donnait de bons résultats. Cela en imposait plus que cela n’achetait les faveurs des gens. En Russie, par contre, comme nous avons déjà eu l’occasion de le constater d’après les opinions à son sujet, sa popularité était bien moindre.
À la fin de la conférence de Rhodes, nous prîmes le même avion d’Athènes à Bruxelles. Pendant le voyage, il se montra loquace et se mit à me parler du patriarche Alexis ou, plutôt, à se plaindre de lui. « Nous regrettons tous beaucoup la mort prématurée du patriarche Serge. S’il avait vécu plus longtemps, il aurait beaucoup obtenu pour l’Église. Le patriarche Alexis, lui, est un homme timoré, indolent. C’est un aristocrate, un barine (75). Il considère l’Église comme un fief où il peut se comporter en seigneur, à sa convenance. Il regarde les évêques de haut, il les évite, il les traite comme des ignares. C’est curieux. Il les a élus, il les a intronisés lui-même et il les tient ensuite à l’écart. Il place ses relations aristocratiques au-dessus des rapports dans l’Église. Vous vous souvenez qu’à Londres, après un office, il a ôté sa croix de patriarche du cou et l’a donnée à l’archiprêtre Vladimir Rodzianko, bavardant longuement avec lui ? Pourtant, il avait concélébré dans le sanctuaire avec des prêtres de longue date, méritants, mais il ne leur a rien donné et ne leur a même pas adressé la parole. Or, l’archiprêtre Rodzianko n’est même pas membre de notre Église (76) ! Et tout ça pour l’unique raison que le domaine du grand-père du père Vladimir était voisin de celui du père du patriarche (77) à Nijni-Novgorod. J’étais profondément indigné ! », s’exclama le métropolite Nicodème pour conclure son récit.
Parmi les opinions que j’ai entendues sur le métropolite Nicodème, celle du père Libère Voronov (78) figure parmi les plus justes et les plus intéressantes. Le père Libère était professeur de dogmatique à l’académie de théologie de Leningrad, c’était un homme d’une intelligence incontestable et d’une grande culture théologique, qui avait passé plus de dix ans dans les camps. Il connaissait bien le métropolite Nicodème. Vers la fin du mois d’août 1966, nous voyageâmes ensemble en avion de Moscou à Belgrade pour participer au travail de la Commission panorthodoxe de préparation du dialogue avec les Anglicans (79). Comme cela arrive presque toujours en pareille circonstance, nous nous mîmes à bavarder, ce qui était assez difficile dans les conditions de vie soviétiques. Le père Libère fit du métropolite Nicodème une description largement positive, il reconnaissait ses capacités et lui savait gré de son attitude attentive vis-à-vis de l’académie de théologie, du soutien qu’il accordait toujours à ses professeurs, mais termina soudain ainsi. « Mais je vous dirais tout de même que c’est un homme impénétrable. Il est vraiment impossible à cerner ! » J’acquiesçai. À Belgrade, et dans les autres lieux de la Yougoslavie que nous visitâmes, nous fûmes, avec le père Libère, impressionnés par la situation de l’Église, bien meilleure qu’en Russie. Une procession à Belgrade dans laquelle les enfants étaient massivement presents (80), le discours hardi au peuple de l’évêque Basile au monastère de Žiča, l’ouverture de séminaires çà et là, etc. Le père Libère en particulier en était stupéfait. « Chez nous, une chose pareille serait inconcevable ! Comme la situation est différente ici ! »
Quelques temps après je me rendis en Angleterre et participai à une émission pour la BBC-Russie, lors de laquelle je racontai mes impressions de Yougoslavie. À la question. « Vous avez été en URSS de nombreuses fois et maintenant vous rentrez de Yougoslavie. Pourriez-vous faire une comparaison des situations respectives de l’Église orthodoxe dans ces pays ? », je répondis par la phrase du père Libère, sans le nommer bien entendu (je partageais d’ailleurs son opinion). « Il y a une grande différence (en faveur de la Yougoslavie). C’est sans comparaison avec l’URSS. Ce que j’ai vu en Yougoslavie en termes de liberté de l’Église est tout simplement inconcevable dans la Russie d’aujourd’hui. » Mon interview fut diffusée en Russie et le métropolite Nicodème en eut vent.
Quand, par après, nous nous rencontrâmes à Paris, il me fit des reproches, disant que je m’étais permis de faire des comparaisons et des évaluations sans bien connaître la situation de l’Église en Russie. (Mon intervention à la BBC l’irritait d’autant plus que je m’étais rendu à Belgrade en tant que chef de la délégation du Patriarcat de Moscou.) En réponse aux reproches du métropolite Nicodème, je fus contraint de lui dire. « Ce n’est pas seulement mon opinion, un autre membre de notre délégation, venu de Russie et qui en connaît bien la situation, était du même avis. » — « De qui s’agit-il exactement ? », demanda le métropolite Nicodème. Mais bien entendu, je refusai de lui donner ce renseignement, et il ne lui était pas facile de deviner de qui il s’agissait, car notre délégation était assez nombreuse. Alors le métropolite Nicodème, voyant mon entêtement et mon refus de citer des noms, changea de tactique. « Ceux qui se permettent de telles comparaisons perdent de vue une différence fondamentale entre la Yougoslavie et la Russie. En Yougoslavie, l’orthodoxie fait partie de la vie quotidienne, c’est avant tout une tradition nationale qui ne constitue pas de menace pour le pouvoir. Aussi ce dernier la tolère-t-il. Mais chez nous, l’orthodoxie, c’est une foi, une idéologie, une conception du monde, une confession qui nie les fondements même du régime. Le pouvoir sent qu’il y a là un danger pour lui, d’où son attitude plus dure envers l’Église. » Je dois admettre que la réponse du métropolite était fine et juste à sa manière, mais on y sentait une justification des répressions antireligieuses. En 1968, je rencontrai de nouveau le père Libère à Bruxelles. Il me dit d’un ton de reproche. « Pourquoi m’avez-vous trahi en racontant au métropolite Nicodème ce que je vous avais dit à Belgrade ? Je n’ai peur de rien, mais je n’ai aucun plaisir à recevoir des blâmes à cause de vous. » — « Je ne vous ai pas nommé, il ne pouvait que deviner ! » — « Oui, j’ai bien compris qu’il ne savait pas exactement de qui il s’agissait », me répondit le père Libère. Pourquoi le métropolite Nicodème avait-il mené son enquête et en avait « tiré des conclusions » ? Je ne trouve pas cela très joli. Il est vrai que tout cela n’eut aucune conséquence grave pour le père Libère, mais ce fut une leçon pour moi. Je savais désormais qu’il ne fallait pas faire entièrement confiance au métropolite Nicodème, ni se montrer trop franc avec lui.
Lui-même d’ailleurs ne se comportait jamais avec une franchise absolue avec moi. Il est vrai que lors de nos rencontres en Occident, nous parlions d’affaires aussi bien religieuses que personnelles, beaucoup plus ouvertement qu’en URSS où quelque chose nous retenait tous les deux (que ce soit la peur des microphones ou l’atmosphère pesante du système soviétique). Mais avec les années, le métropolite Nicodème avait tendance à s’ouvrir. Je me souviens, par exemple, d’une conversation remarquable que nous eûmes à Paris dans les années 1965-1967. Nous nous trouvions seuls après un dîner dans les locaux de l’exarchat. Il était près de dix heures du soir. Je ne me souviens pas du point de départ de notre conversation, mais il semble qu’il avait commencé comme à l’accoutumée par débiter ses éternelles semi-vérités sur la situation de l’Église en Russie. « On reproche souvent aux évêques de ne pas protester contre les fermetures des églises, me disait-il. Mais leur pouvoir en la matière est très limité, cela dépend bien plus des croyants, de l’activité qu’ils déploient. Or souvent, ils n’en déploient pas. Tenez, par exemple. pendant que j’étais archevêque du diocèse de Iaroslavl, on commença à y fermer les églises et les fidèles vinrent me réclamer de l’aide. Je leur dis. « Écrivez une lettre, expliquant que vous désirez conserver votre église ouverte et collectez le plus grand nombre possible de signatures. Quand vous aurez fait cela, je pourrai bien mieux vous aider. » Et que pensez-vous qu’ils firent ? Les voilà qui hésitent, qui font des manières, qui se défilent. En fin de compte, il n’y eut pas une seule signature, personne n’avait assez de courage. »
Je me mis à opposer au métropolite des exemples concrets de persécutions antireligieuses à l’intérieur du pays et des raisons pour lesquelles les fidèles avaient peur de se défendre ouvertement. « Moi aussi, je pourrais donner une interview sur la situation de l’Église chez nous, qui ferait sensation dans le monde entier », dit-il. « Mais je ne le ferai pas, car cela ne ferait aucun bien à l’Église, que du contraire. Bien plus, je sais que je peux laisser dans l’histoire mon nom entaché et cela ne m’est pas indifférent, loin de là. Mais je suis prêt à en prendre le risque pour le bien de l’Église. Il n’y a pas d’autre voie. » Nous continuâmes cette conversation jusqu’à trois heures du matin, jusqu’à ce que je dise que j’étais fatigué et que j’aille me coucher. Je me sentais plein de compassion envers lui, me disant qu’il devait souvent avoir eu la tentation de tout laisser en plan et de faire une sortie spectaculaire, car il comprenait et voyait tout ce qui se passait autour de lui. Cela dit, il ne s’agit que de suppositions de ma part. même cette nuit-là, il ne se départit jamais de son air impénétrable. Par la suite, il alla plus loin, semble-t-il. Je me souviens qu’il était à ce moment-là attaqué par la presse occidentale pour ses prises de position prosoviétiques, pour ses mensonges sur la situation de l’Église en Russie, etc. On le considérait comme un traître, on se méfiait de lui. Je le lui dis. « Et vous, avez-vous confiance en moi ? », me demanda-t-il avec dans les yeux une expression triste, émouvante même. « Oui, Monseigneur, personnellement, j’ai confiance en vous », répondis-je. Il eût été cruel de répondre autrement.
Un jour à Genève, vers l’année 1969, me semble-t-il, je rencontrai le secrétaire général du COE Visser ‘t Hooft (81). À ce propos, je me souviens d’un épisode intéressant pour caractériser le métropolite Nicodème et l’habitude soviétique qu’il avait acquise de proférer des mensonges sans nécessité aucune, sans même le remarquer et sans se souvenir des circonstances ou de l’environnement où ils étaient proférés (les déclarations publiques, elles, pouvaient trouver une justification et l’on pouvait humainement les comprendre et les pardonner). Visser ‘t Hooft me raconta que, lorsqu’il se trouvait en voyage à Odessa en 1964 à une réunion du Comité, il se rendit à Potchaïev (82) avec un groupe d’autres membres de la délégation et les moines du monastère lui transmirent leurs plaintes au sujet des persécutions dont ils étaient victimes de la part des autorités. Peu de temps après, alors que j’étais à Moscou, nous en vînmes avec le métropolite Nicodème à parler de Potchaïev. Le métropolite se mit à contester vivement l’authenticité des appels et déclarations de Potchaïev, disant qu’ils n’émanaient pas des moines. Alors je lui dis. « Visser ‘t Hooft m’a raconté que les moines les lui avaient remis en mains propres et que c’est lui qui les avait sortis d’Union soviétique. Pourquoi aurait-il du mentir ? » — « C’est impossible, me répondit le métropolite Nicodème, Visser ‘t Hooft n’a jamais mis les pieds à Potchaïev. Il est vrai que les participants de la consultation d’Odessa ont demandé de visiter Potchaïev, mais nous avons été contraints de la leur refuser, en raison de leur trop grand nombre. Aucun d’entre eux n’a visité Potchaïev. » Bien plus tard, en 1972, je rencontrai à nouveau Visser ‘t Hooft à Genève. Au dîner, je me trouvai assis à côté de lui et décidai de lui demander. « Avez-vous visité Potchaïev en 1964 après la réunion du Comité à Odessa ? » — « Bien sûr ! », répondit-il. — « Mais le métropolite Nicodème affirme que personne n’a été autorisé à y aller et que vous n’y avez jamais été. » Visser ‘t Hooft sourit et me dit. « Le métropolite Nicodème ne peut ignorer que si, malgré le souhait exprimé par tous les participants de se rendre à Potchaïev, tous n’ont pas été autorisés s’y rendre, cinq d’entre-nous y sont allés, dont moi. Le métropolite Nicodème en personne nous y a accompagnés. Je me souviens parfaitement qu’alors qu’il nous montrait le monastère et la vue sur le paysage environnant, il nous a cité un poème russe. « Ici est l’esprit russe, ici cela sent la Russie (83). » Et c’est là que les moines me remirent leurs textes, à l’insu, bien entendu, du métropolite Nicodème. Mais il ne peut avoir oublié notre visite à Potchaïev. » Il m’est difficile d’ajouter un commentaire à ce récit qui s’en passe d’ailleurs aisément. Il va sans dire que je ne doute pas un instant de la véracité des dires de Visser ‘t Hooft, d’autant qu’il aurait été difficile à un étranger d’inventer les détails d’une visite à Potchaïev.
J’ai décrit ailleurs en detail (84) le concile local de l’Église orthodoxe russe de 1971 qui élit le patriarche Pimène et le rôle qu’y joua le métropolite Nicodème. Durant la période « postconciliaire », c’est-à-dire de l’été 1971 jusqu’à la mort du métropolite Nicodème, à Rome, le 5 septembre 1978, je le rencontrai encore de nombreuses fois. Il est vrai qu’à la suite de son premier infarctus du printemps 1973, il s’était mis à voyager beaucoup moins que par le passé et s’était même vu contraint de réduire le champ de ses activités. Il démissionna de ses fonctions de président du Département des relations ecclésiastiques extérieures (85) au profit du métropolite Juvénal (86), mais sa nomination au poste d’exarque patriarcal d’Europe occidentale (87) renforça encore ses liens avec nous. C’est lui-même qui m’apprit la nouvelle de son départ du Département des relations extérieures alors qu’il était en visite à Bruxelles en juin 1973, à l’occasion d’une « conférence sociale sur la sécurité en Europe », ce qui était curieux ; il n’était pas là pour l’Église, mais comme membre de la délégation soviétique. Je ne posais aucune question au métropolite Nicodème au sujet des discussions ; de toute façon, on n’y changerait rien, on pouvait seulement être affligé. Le métropolite n’encourageait d’ailleurs pas ma curiosité. La première chose qu’il me dit lorsqu’il me vit à l’aéroport fut qu’il ne dirigeait plus le Département des relations extérieures. « Mais, se mit-il à m’expliquer avec une certaine naïveté, il ne fallait pas en conclure qu’on l’avait « rétrogradé », loin de là, on n’avait fait que répartir les tâches d’une façon différente et il continuait à tout diriger. « À qui doit-on adresser son courrier pour les affaires courantes ? », lui demandai-je. — « Au métropolite Juvénal, mais en cas d’affaire importante, à moi », répondit-il.
Comme chacun sait, c’est en février 1974 que Soljenitsyne fut expulsé de Russie soviétique. Cette décision me paraissait révoltante, mais il ne me serait jamais venu à l’idée de protester contre elle (défendre un écrivain ne fait pas partie des attributions d’un évêque), s’il n’y avait eu une circonstance particulière. Soljenitsyne avait bien d’autres défenseurs que moi, sans parler du fait que les protestations contre le pouvoir soviétique restaient toujours sans effet. Mais je fus indigné au plus profond de mon cœur de voir le métropolite Séraphim de Kroutitsy et Kolomna (88) se mêler de l’affaire et approuver, « en tant que métropolite de l’Église orthodoxe russe », l’expulsion de Soljenitsyne (89). C’est pourquoi, dans un télégramme du 17 février au patriarche Pimène, j’exprimai « en tant qu’archevêque de l’Église orthodoxe russe » la « profonde consternation » que me causait le geste du métropolite Séraphim. Je reçus quasiment au même moment une invitation du patriarcat à me rendre à Moscou. Ici, je dois donner quelques explications. lors de ma visite précédente, en octobre 1973, j’avais un visa touristique de cinq jours dont je demandai, comme d’habitude, la prolongation. « Ce sera fait, me répondit le métropolite Nicodème. Nous réglons des problèmes mondiaux, ce serait incroyable qu’on ne règle pas celui-là ! Vous l’aurez, votre prolongation. » Mais quelques jours plus tard, il vint me dire, l’air embarrassé. « On vous refuse la prolongation de votre visa. Nous avons eu le plus grand mal à vous obtenir deux jours supplémentaires sans quoi vous auriez été obligé de repartir la veille de la saint Serge. (90) Mais en compensation, vous serez invité l’année prochaine et là, personne ne pourra écourter votre séjour. Rappelez-nous en fin d’année de vous faire l’invitation. » C’est ce que je fis et je reçus fin février 1974 l’invitation précitée, datée du 20 février ; je partis à Moscou au printemps, après Pâques. Une question se posa à moi. le Département des relations extérieures était-il au courant à ce moment-là de mon télégramme au patriarche à propos de Soljenitsyne ? Les dates coïncident presque, mais à y réfléchir, il me semble qu’ils n’en savaient encore rien. Quoi qu’il en soit, je décidai d’y aller, malgré le fait que de nombreuses personnes à Bruxelles tentaient de m’en dissuader, car elles avaient peur pour moi. Au consulat soviétique, on ne fit aucune difficulté pour me délivrer le visa correspondant à l’invitation du patriarcat, on ne me posa pas la moindre question alors même que les journaux belges et français parlaient de mon télégramme.
J’arrivai à Moscou le 14 mai 1974. Je fus reçu par le métropolite Juvénal et le patriarche, je leur fournis mes explications concernant mon télégramme à propos de Soljenitsyne, et dans l’ensemble tout se passa très bien. Mais c’est avec le métropolite Nicodème, chez qui je me rendis, à son invitation, pour la fête de saint Nicolas (le 9/22 mai), que j’eus l’explication la plus longue. Nous n’en parlâmes pas immédiatement et c’est moi qui amenai la conversation sur le sujet. Mais quand nous y vînmes, nous nous mîmes rapidement à crier l’un sur l’autre. En gros, il cherchait à démontrer qu’il n’aurait pas fallu que je me mêle de l’affaire Soljenitsyne, à quoi je répondais que le métropolite Séraphim l’avait fait le premier. « D’ailleurs, continuai-je, mon intervention n’était pas politique. » — « Non, rétorqua le métropolite Nicodème. Votre intervention était très nettement une prise de position antisoviétique. » — « Est-ce donc si répréhensible ? », lui demandai-je. — « Je ne dis pas que c’est mal, répondit Mgr Nicodème, je dis seulement que vous n’auriez pas dû le faire. »
Le lendemain, c’était la saint Nicolas, fête patronale de la cathédrale Saint-Nicolas-des-Marins (91), où nous concélébrâmes tous avec les membres d’une délégation du patriarcat de Jérusalem. Nous fûmes conviés à un repas solennel après la liturgie. Le métropolite Nicodème commença par souhaiter la bienvenue à la délégation de Jérusalem, puis s’adressant à moi, il insista sur le fait que nous nous connaissions de longue date, que nous avions collaboré lors des conférences panorthodoxes, etc. Il voulait manifestement indiquer par là que, malgré les quelques points de désaccord que nous pouvions avoir, nous étions fondamentalement unis. Cela fut remarqué par l’assistance.
Il m’arriva encore plusieurs fois de m’expliquer (« affronter » serait un terme trop brutal) avec le métropolite Nicodème à propos de déclarations que j’avais faites sur la BBC, d’articles ou de commentaires que j’avais publiés dans la Pensée russe (92) ou dans le Messager de l’ACER de Nikita Struve (93), ainsi qu’à la sortie de mon livre L’année 1919 (94) où je raconte l’année que j’ai passée dans l’Armée blanche. Je m’empresse de dire ici que toutes ces « explications » avec Mgr Nicodème se terminèrent très bien pour moi, sans aucune conséquence fâcheuse, ce que j’attribue principalement à l’intelligence du métropolite et à sa bienveillance à mon égard.
À ce propos, je me rappelle la plus intéressante des conversations que j’eus avec le métropolite Nicodème, à Paris au début de 1976. « M’est-il jamais arrivé de vous condamner ou de vous critiquer pour vos déclarations ou vos articles ? me demanda-t-il. Jamais ! Prenez par exemple votre article (95) sur l’archevêque Pitirim (96). à l’exception de ce que vous y écrivez à propos du gouvernement soviétique — à ce propos je m’abstiens de commentaires —, je suis entièrement d’accord avec vous. l’Église doit en permanence chercher à toucher les couches de populations les plus larges et ne doit pas renoncer d’elle-même à exercer une influence sur la jeunesse. En ce qui concerne votre notice nécrologique (97) du métropolite Joseph d’Alma-Ata (98), je dois vous dire qu’il était mon candidat favori pour le trône de patriarche, même si cela n’a pas été possible. »
Puis nous passâmes à mon livre L’année 1919. « Vous écrivez bien, me dit le métropolite Nicodème, et je comprends parfaitement quels ont pu être vos sentiments à l’époque. Ce que je ne comprends pas, c’est le besoin que vous avez eu de prendre l’Armée blanche comme thème de vos mémoires. Pourquoi n’avez vous pas plutôt raconté de quelle façon vous êtes devenu moine sur le mont Athos ? Pourquoi n’avoir pas raconté votre enfance ? » — « Je ne suis pas Léon Tolstoï pour écrire Enfance, Adolescence, Jeunesse », répondis-je. « Je n’ai pas ce talent. Quant à l’Athos, si Dieu veut, j’aurai l’occasion d’écrire à ce sujet (99). Mon séjour dans l’Armée blanche a laissé en moi un souvenir impérissable et ce dont j’ai été témoin revêt un intérêt historique certain. » — « Non, vous écrivez bien, poursuivit Mgr Nicodème, mais vous auriez dû donner pour titre à votre livre quelque chose comme « Extraits de mes mémoires ». Sinon on peut penser qu’il s’agit là du thème central de vos intérêts. N’oubliez pas que vous occupez des fonctions à responsabilités. Pourquoi n’écrivez-vous pas plutôt sur les saints pères ? » — « J’ai déjà écrit sur les pères de l’Église et j’écrirai encore. L’année 1919 ne doit être considérée que comme une courte pause. J’avais besoin de raconter ce que j’avais sur le cœur. J’ai aussi un article intitulé « Les journées de février 1917 à Petrograd (100) ». À l’époque, j’avais même des sympathies révolutionnaires. » — « Eh bien, elles vous ont mené loin, vos sympathies ! », ironisa le métropolite Nicodème.
Cette conversation eut lieu peu de temps après l’assemblée générale du COE à Nairobi (101) au cours de laquelle des délégués protestants émirent pour la première fois une protestation contre les persécutions antireligieuses en Union soviétique. J’avais l’intention d’écrire une lettre au pasteur Potter (102), secrétaire général du COE, pour lui exprimer mon soutien et l’encourager à poursuivre son action, mais je voulais avant tout connaître la position du métropolite Nicodème à l’égard de ce type d’interventions. C’est pourquoi, sans dire un mot de mes intentions et gardant ma lettre à Potter dans ma poche, je dis au métropolite Nicodème. « Je pense que les protestations contre les persécutions antireligieuses en Russie telles qu’elles ont été exprimées à Nairobi, ainsi que les discussions en général sur la situation de l’Église peuvent être bénéfiques. » — « C’est vrai, répondit le métropolite Nicodème, mais elles ne doivent pas être faites en votre nom ni par voie de presse. Croyez-moi, Monseigneur, il y aura suffisamment d’organisations, autrement importantes et influentes que vous, pour s’en occuper. Vous ne devriez pas vous en soucier. » — « Vous pensez au COE ? » — « Oui, entre autres. » — « Mais il faut les encourager à le faire. » — « En tout cas, pas en votre nom ni par voie de presse. » Pour moi c’était très clair. Je compris les paroles du métropolite Nicodème comme un feu vert et envoyai ma lettre à Potter (103) .
Nous ne nous heurtâmes à aucune difficulté particulière de la part du métropolite Nicodème lors de la publication de notre Messager de l’exarchat d’Europe occidentale. Il ne nous soumettait à aucune censure préliminaire ni n’imposait d’approbation préalable du contenu. Il lui aurait d’ailleurs formellement été assez difficile d’intervenir de la sorte, dans la mesure où il n’était pas notre exarque et que c’était notre exarque, le métropolite Antoine de Souroge, le responsable de la publication. Il y eut cependant des désaccords avec le métropolite Nicodème à propos du Messager ; le métropolite souhaitait que son contenu soit exclusivement théologique, alors que je voulais, moi, laisser de la place à l’actualité ecclésiale et en particulier à la situation de l’Église dans la Russie contemporaine, dans un esprit bien entendu non soviétique. Ainsi, je me souviens qu’en 1963, nous publiâmes une lettre clandestinement sortie de Russie, la « Lettre ouverte au prêtre Darmanski (104) » du prêtre Jeloudkov (105) (nous la laissâmes anonyme, car nous n’en connaissions pas l’auteur). Dans le courant de l’année qui suivit, je rencontrai aux Pays-Bas le métropolite Nicodème qui me reprocha la publication de cette lettre. « Vous ne connaissez pas Jeloudkov et vous regretterez un jour de l’avoir publié. » Je répondis que la lettre était une dénonciation très forte de l’athéisme et qu’elle dépeignait de manière très vivante la lutte antireligieuse des athées contre la foi. « Vous, vous publiez et c’est moi qui prends », me répondit le métropolite Nicodème, accompagnant ses paroles d’un geste évocateur. Je n’avais pas grand-chose à répondre à un tel argument. Quant le métropolite Nicodème fut nommé exarque d’Europe occidentale, la parution du Messager devint problématique, car il exigeait que chaque numéro lui soit préalablement envoyé pour vérification. « C’est mon droit en tant qu’exarque. Le métropolite Antoine ne le faisait pas, parce qu’il ne s’intéressait pas au Messager. Moi, je m’y intéresse. » Je quittai alors la rédaction du Messager et la parution en fut suspendue. Lors de l’une de mes visites à Paris, le métropolite Nicodème me demanda une explication à ce sujet. Je lui dis qu’envoyer à chaque fois le Messager pour vérification préalable était techniquement impossible. J’étais prêt à reprendre la rédaction du Messager à une seule condition. pas un gramme de « soviétisme » ! "D’accord, me répondit-il, il n’y en aura pas. Mais je vais moi aussi vous poser une condition. pas un gramme d’"antisoviétisme" !" Une autre fois, après la publication de ma critique du livre de Roessler sur l’Église russe (106), il me dit. « Mais enfin, pourquoi publiez-vous de tels articles dans le Messager ? Et sous votre nom en plus ? Ce n’est que votre avis personnel ! Vous feriez mieux de les publier ailleurs. » Je me rangeai à son avis et me mis à publier certaines choses chez Nikita Struve, mais signées de mon nom. Et quand on me demandait pourquoi je le faisais, je répondis que puisqu’on me l’avait interdit dans notre Messager, je publiais dans le Messager de l’ACER.
Le 21 février 1974, notre exarque, le métropolite Antoine de Souroge, démissionna de ses fonctions pour raisons de santé. Étant donné que sa lettre de démission avait été écrite à peine trois jours après qu’il ait célébré dans sa cathédrale de Londres un « Te Deum de protestation » pour les dissidents en liaison avec l’expulsion de Soljenitsyne, l’opinion publique interpréta cette démission du métropolite comme un limogeage par le patriarcat de Moscou à la suite de cette « protestation ». Il n’en était pas ainsi en réalité. Contrairement à ce qui s’était passé en 1964 où Mgr Antoine avait été contraint de présenter sa démission, sa nouvelle demande avait pris le patriarcat au dépourvu et le jetait même dans l’embarras, car elle créait l’impression que le métropolite Antoine était victime de persécutions de sa part. Le métropolite Nicodème l’appréciait beaucoup en tant qu’exarque et en tant qu’homme jouissant d’une grande popularité en Occident. C’est pourquoi, il fallut attendre le 5 avril pour que le synode accède à la demande du métropolite Antoine. Quant à la nomination du nouvel exarque, elle traîna jusqu’au 3 septembre…
- Mgr Nicodème (Rotov, 1929-1978), prélat orthodoxe russe et personnalité du mouvement œcuménique. Membre, puis supérieur de la Mission orthodoxe russe à Jérusalem (1956-1958), vice-président du Département des relations extérieures du patriarcat de Moscou (1959-1960), président de ce département (1960-1972), exarque patriarcal d’Europe occidentale (1974-1978). Évêque (1960), archevêque (1961), métropolite (1963), métropolite de Leningrad et Novgorod (1967). Artisan du dialogue œcuménique, il fut membre du Comité exécutif du C. O. E. (1961-1975) et président de celui-ci (1975). Il mourut à Rome, lors d’une audience privée chez le pape Jean-Paul Ier. Voir « Une vie pour l’unité, le métropolite Nicodème », Messager de l’Église orthodoxe russe, n°11 (2008), p. 7-26.
- Voir « Chapitre 1. Le métropolite Nicolas (Iarouchevitch) », p. 175.
- Le 31 mai 1960. Sur le petit diocèse du patriarcat de Moscou en Belgique, voir Père Serge MODEL, « L’Église orthodoxe russe en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg », Messager de l’Église orthodoxe russe, n°7, Paris (2008), p. 20-23.
- De 1958 à 1960.
- Voir « Chapitre 1. Le métropolite Nicolas (Iarouchevitch) », n. 41.
- De 1951 à 1958.
- Philarète (Denissenko, né en 1935), ex-prélat orthodoxe russe. Évêque (1962), archevêque (1966) puis métropolite (1968) de Kiev et de Galicie. Fondateur (1991) d’une « Église autocéphale ukrainienne-patriarcat de Kiev » et patriarche autoproclamé de celle-ci, défroqué pour activité schismatique et excommunié.
- Mgr Bartholomée (Gondarovsky, 1927-1988), prélat orthodoxe russe. Archevêque de Tachkent et d’Asie centrale (1972-1987).
- En 1958.
- Du 14 au 29 juin 1960. Sur ce voyage, voir ARCHIMANDRITE PHILARETE (DENISSENKO), « V gostyah ou anglikanskih monakhov » [En visite chez les moines anglicans], Journal du Patriarcat de Moscou, n°8 (1960), p. 69-79.
- Propriété de l’association Fellowship of Saint Alban and Saint Sergius, qui avait pour but de favoriser les contacts entre anglicans et orthodoxes. C’est dans les locaux de la maison qu’était située l’église orthodoxe russe d’Oxford.
- Nicolas Mikhaïlovitch Zernov (1898-1980), historien, théologien et philosophe émigré russe, secrétaire de la Fellowship of Saint Alban and Saint Sergius.
- Sont ici visés notamment les canons dits « apostoliques » n° 45 et n° 65, et le canon du concile de Laodicée (364) n° 33.
- 1 Th. 5, 17.
- Et pas le dimanche 19 juin, comme indiqué dans le manuscrit original (NdT).
- Mgr Harry James Carpenter (1901-1993), prélat et théologien anglican. Évêque d’Oxford (1955-1970).
*Passage illisible dans le manuscrit original (NdT).
- Voir « Chapitre 1. Le métropolite Nicolas (Iarouchevitch) », n. 7.
- Voir « Chapitre 1. Le métropolite Nicolas (Iarouchevitch) », n. 49.
- Voir n. 3.
- Voir « Chapitre 1. Le métropolite Nicolas (Iarouchevitch) ».
- Voir « Chapitre 1. Le métropolite Nicolas (Iarouchevitch) », p. 175-194.
- Il s’agit de Mgr Nicolas (Eremine). Voir « Chapitre 1. Le métropolite Nicolas (Iarouchevitch) », n. 10.
- Voir « Chapitre 1. Le métropolite Nicolas (Iarouchevitch) », n. 53.
- Voir « Chapitre 1. Le métropolite Nicolas (Iarouchevitch) », p. 192.
- Mgr Alexis (van der Mensbrugghe, 1899-1980), prélat et théologien orthodoxe d’origine belge. Sacré le 1er novembre 1960 évêque titulaire de Meudon, auxiliaire de l’exarchat en Europe occidentale. Évêque aux États-Unis (1968), archevêque à Düsseldorf (1971).
- ARCHEVEQUE BASILE (KRIVOCHEINE), « La Conférence panorthodoxe sur l’île de Rhodes », Messager de l’Exarchat du patriarche russe en Europe occidentale, n° 40 (1961), p. 179-189.
- Mgr Nicodème fut nommé évêque d’Iaroslavl et Rostov le 23 novembre 1960 et élevé au rang d’archevêque le 16 mars 1961.
- Mgr Alexis (Ridiger, 1929-2008), prélat orthodoxe russe, patriarche de l’Église orthodoxe de Russie. Évêque de Tallin en Estonie (1961), archevêque et chancelier du patriarcat (1964), métropolite de Leningrad (1986), patriarche de Moscou et de toutes les Russies (1990-2008). Voir « Patriarche Alexis de Moscou et de toute la Russie », Messager de l’Église orthodoxe russe, n°12 (2008), p. 5-22.
- Voir « Chapitre 1. Le métropolite Nicolas (Iarouchevitch) », n. 75.
- Voir « Chapitre 1. Le métropolite Nicolas (Iarouchevitch) », n. 40.
- Mgr Nicolas (Eremine). Voir n. 23.
- À noter que le professeur Nikita Struve met en doute les fonctions d’interprète de V. Alexéïev. Voir N. STRUVE, op. cit., p. 96.
- Mgr Meliton (Hatzis, 1913-1989), prélat orthodoxe grec, proche collaborateur du patriarche Athénagoras de Constantinople. Métropolite d’Imbros et Ténédos, métropolite de Chalcédoine (1950).
- Mgr Chrysostome (Constantinidis, 1921-2006), prélat orthodoxe grec. Professeur à l’institut de théologie de Halki, métropolite de Myre (1961), métropolite d’Ephèse (1991).
- Le même individu est d’ailleurs cité, avec les mêmes « qualités », dans N. STRUVE, op. cit., p. 97.
- École de théologie du patriarcat de Constantinople, située sur l’île d’Heybeliada (près d’Istanbul). Fermée par les autorités turques en 1971.
- Mgr Élie (Muawad, ?-1979), prélat orthodoxe syrien. Patriarche de l’Église orthodoxe d’Antioche (1970-1979).
- Père Serge Heitz (1908-1998), prêtre orthodoxe d’origine allemande.
- Le père Heitz était un ancien prêtre catholique qui s’était marié.
- Voir « Chapitre 1. Le métropolite Nicolas (Iarouchevitch) », n. 7.
- Mgr Pierre (L’Huillier, 1926-2005), prélat orthodoxe d’origine française, théologien et canoniste. Évêque de l’Église orthodoxe russe à Paris (titulaire de Chersonèse) (1968), puis évêque de l’Église orthodoxe d’Amérique (1979). Archevêque (1990).
- Voir « Chapitre 1. Le métropolite Nicolas (Iarouchevitch) », n. 20.
- Mgr Eugène Tisserant (1884-1972), prélat catholique français. Préfet de la Congrégation des Églises orientales, cardinal (1936), doyen du sacré collège (1951), membre de l’Académie française (1961), participant au concile Vatican II.
- Père Théodore (Strotmann, 1911-1987), moine de Chevetogne. Sur cet épisode, voir aussi A. LAMBRECHTS, « Les contacts entre l’Église orthodoxe russe et le Monastère d’Amay-Chevetogne, 1925-2003 », dans Irénikon, revue des moines de Chevetogne, n° 76 (2003), p. 210-211.
- Il s’agira des pères Vital Borovoï et Vladimir (Kotliarov), aujourd’hui métropolite de Saint-Pétersbourg.
- Le 4 août 1963.
- Voir ARCHEVEQUE BASILE (KRIVOCHEINE), « La IIe Conférence panorthodoxe à l’île de Rhodes, 26-29 septembre 1963 », Messager de l’exarchat du patriarche russe en Europe occidentale, n°45 (1964), p. 5-25.
- Mgr Justin (Moisescu, 1910-1986), prélat orthodoxe roumain. Métropolite de Moldavie (1957), patriarche de l’Église orthodoxe roumaine (1977-1986).
- Mgr Maxime (Minkov, né en 1914), prélat orthodoxe bulgare. Métropolite de Lovetch (1960), patriarche de l’Église orthodoxe bulgare (depuis 1971).
- Mgr Serge (Larine, 1908-1967), prélat orthodoxe russe. Archevêque de Berlin (1962-64), puis d’Iaroslavl et Rostov (1964-1967).
- L’Église « vivante » ou « rénovée ». schisme créé par les autorités soviétiques au sein de l’Église orthodoxe russe dans les années 1920. Voir N. STRUVE, op. cit., p. 32-37 et Mgr KALLISTOS (WARE), L’Orthodoxie. L’Église des sept conciles, op. cit., p. 194.
- N. Khrouchtchev sera démis de toutes ses fonctions et envoyé à la retraite en octobre 1964.
- Le 9 octobre 1963.
- Le 7 octobre 1967.
- Père Corneille (Fristedt, 1902-1982), moine et prêtre orthodoxe russo-finlandais. Recteur de l’église orthodoxe russe Saint-Nicolas de Bruxelles.
- En septembre 1962, deux suppliques adressées par des chrétiens de la région de Potchaïev (Ukraine) au Conseil œcuménique des Églises et aux dirigeants de l’URSS révélèrent le détail des persécutions. La première a été publiée intégralement dans la revue française Esprit (mars 1963, p. 431-433). Voir N. STRUVE, op. cit., p. 265-269.
- Le 19 janvier 1964.
- Mgr Basile (de son nom civil Vladimir) (Rozdianko, 1915-1999), prélat orthodoxe d’origine russe (petit-fils du dernier président de la Douma d’Empire, Michel Rodzianko). Émigré, prêtre au sein de l’Église orthodoxe serbe (à Belgrade, ensuite à Londres), puis évêque de l’Église orthodoxe d’Amérique (1980-1984).
- Voir « Chapitre 1. Le métropolite Nicolas (Iarouchevitch) », n. 24.
- Famille du patriarche Alexis Ier (Simansky).
- À l’époque, plus haute distinction honorifique du patriarcat de Moscou.
- Mgr Michael Ramsay (1904-1988), prélat anglican et personnalité du mouvement œcuménique. Archevêque de Canterbury, primat de la communion anglicane (1961-1974).
- Mgr Frederick Donald Coggan (1909-2000), prélat anglican. Archevêque de Canterbury, primat de la communion anglicane (1974-1980).
- L’ordination, par l’Église anglicane, de femmes-prêtres — considérée par les orthodoxes comme contraire à la tradition bimillénaire de l’Église — a amené une crise dans le dialogue théologique orthodoxe-anglican en 1977-1978. Ce dialogue, qui a repris depuis sur un mode mineur, est en outre rendu difficile par les prises de position ultralibérales de certains Anglicans en matière de foi et de morale.
- SYMEON LE NOUVEAU THEOLOGIEN, Catéchèses (3 tomes), introd., texte critique et notes par Mgr BASILE (KRIVOCHEINE), trad. par J. PARAMELLE, s. j., coll. « Sources chrétiennes », n° 96, 104 et 113, Paris, Éd. du Cerf, 1963-1965.
- Voir Père Serge MODEL, « Une page méconnue de l’histoire de l’orthodoxie en Occident. la Mission orthodoxe belge (1963-1987) », Irénikon, revue des moines de Chevetogne, n°81(2008), p. 24-49.
- Les 7 et 8 octobre 1964.
- Le 9 octobre 1964.
- Le 14 octobre 1964.
- Mgr Hermogène (Goloubiov, 1896-1978), prélat orthodoxe russe et confesseur de la foi. Supérieur de la laure des Grottes à Kiev, prisonnier au goulag (1931 à 1939). Évêque (1953), archevêque (1956), archevêque de Kalouga et Borovsk (1963), limogé en 1964 pour s’être opposé à la soumission de l’Église aux pressions du pouvoir.
- Voir ARCHEVEQUE BASILE (KRIVOCHEINE), « La IIIe Conférence panorthodoxe de Rhodes, 1-15 novembre 1964 », Messager de l’exarchat du patriarche russe en Europe occidentale, n° 51 (1965), p. 137-161.
- Mgr Philarète (Vakhroméïev, né en 1935), prélat et théologien orthodoxe russe. Évêque (1965), recteur de l’académie de théologie de Moscou (1966-1973), archevêque de Berlin et exarque patriarcal d’Europe centrale (1973-1978), métropolite (1975), président du Département des relations extérieures (1981-1989), métropolite de Minsk, exarque patriarcal de Biélorussie (depuis 1978).
- Mgr Élie (Gudushauri-Shiolashvili, né en 1933), prélat orthodoxe géorgien. Catholicos-patriarche de l’Église orthodoxe de Géorgie (depuis 1977).
- Les conciles de Constantinople de 1591 et 1593 reconnurent à l’Église russe le rang de patriarcat, et lui octroyèrent la cinquième place dans l’ordre des diptyques (listes de commémoration), autrement dit dans l’ordre protocolaire des Églises orthodoxes.
- Voir « Chapitre 2. L’année 1919 », n. 15.
- À l’époque, le père Vladimir Rodzianko relevait de l’Église de Serbie. Voir n. 59.
- Le patriarche Alexis Ier était issu d’une famille aristocratique, tout comme le père Rodzianko.
- Père Libère Voronov (1914-1995), prêtre et théologien orthodoxe russe, confesseur de la foi (prisonnier au goulag de 1944 à 1954), professeur à l’académie de théologie de Leningrad.
- Voir ARCHEVEQUE BASILE (KRIVOCHEINE), « La Commission inter-orthodoxe pour le dialogue avec les Anglicans, Belgrade, 1-15 septembre 1966 », Messager de l’exarchat du patriarche russe en Europe occidentale, n° 58 (1967), p. 74-106.
- Selon la législation soviétique, les mineurs d’âge n’avaient pas le droit de participer aux cérémonies religieuses en URSS.
- Willem Adolf Visser ‘t Hooft (1900-1985), pasteur et théologien réformé néerlandais, pionnier du mouvement œcuménique, premier secrétaire général du Conseil œcuménique des Églises (1948-66). Au moment où l’auteur le rencontre, il n’est plus secrétaire général, mais président honoraire du COE.
- La laure de Saint-Job de Potchaïev, célèbre monastère d’Ukraine occidentale, faillit être liquidée dans les années 1960. Les persécutions réduisirent le nombre de moines de 140 (1961) à 36 (1962), sans cependant réussir à obtenir la fermeture du monastère, en raison de la défense de celui-ci par les croyants. Voir n. 57.
- Citation approximative d’Alexandre Pouchkine. « Là est l’esprit de la Russie, là on sent l’odeur de la Russie. »
- Voir « Chapitre 3. Le concile de 1971 ».
- Le 30 mai 1972.
- Mgr Juvénal (Poïarkov, né en 1935), prélat orthodoxe russe. Évêque (1965), métropolite (1972), métropolite de Kroutitsy et Kolomna (depuis 1977), président du Département des relations extérieures (1972-81), président de la Commission synodale de canonisation (depuis 1995).
- Le 3 septembre 1974.
- Mgr Séraphim (Nikitine, 1905-1979), prélat orthodoxe russe. Évêque (1962), archevêque (1968), président du Département de l’intendance du patriarcat de Moscou (1970-74), métropolite de Kroutitsy et Kolomna (1971-77).
- METROPOLITE SERAPHIM (NIKITINE) DE KROUTITSY ET KOLOMNA, « Otschepentsu — prezreniye naroda [Au renégat, le mépris du peuple] », La Pravda, Moscou, 16 février 1974.
- Le 7 octobre 1963. Voir n. 19.
- Voir « Chapitre 1. Le métropolite Nicolas (Iarouchevitch) », n. 68.
- Journal russe (antisoviétique) de Paris.
- Messager de l’Action chrétienne des étudiants russes (en russe Vestnik R. Kh. D.), revue trimestrielle russe éditée à Paris et dont le rédacteur en chef est, depuis 1970, le professeur Nikita Struve.
- Voir « Chapitre 2. L’année 1919 ».
- ARCHEVEQUE BASILE (KRIVOCHEINE), « Otvet na interviou arkhiepiskopa Pitirima (Netchaeva) agentsvu Novosti [Réponse à l’interview de l’archevêque Pitirim (Netchaïev) à l’agence Novosti] », La Pensée russe, 30 janvier 1975.
- Mgr Pitirim (Netchaïev, 1926-2005), prélat orthodoxe russe. Évêque (1963), archevêque (1971), métropolite de Volokolamsk et Iouriev (1986). Président du Département éditorial du patriarcat de Moscou et rédacteur en chef du Journal du patriarcat de Moscou (1963-94).
- ARCHEVEQUE BASILE (KRIVOCHEINE), « Pamiyat’ episcopa ispovednika. mitropolit Alma-Atinskiy i Kazakhstanskiy Iossif (Tchernov) » [En mémoire d’un évêque-confesseur. le métropolite Joseph (Tchernov) d’Alma-Ata et du Kazakhstan], La Pensée russe, 13 novembre 1975, p. 14.
- Mgr Joseph (Tchernov, 1893-1975), prélat orthodoxe russe et confesseur de la foi. Évêque (1932), archevêque (1958), métropolite d’Alma-Ata et d’Asie centrale (1968).
- Finalement, Mgr Basile n’écrivit jamais sur son séjour au Mont Athos. Pour en avoir un aperçu, il faut se référer à sa correspondance. Voir Père Serge MODEL, « Mgr Basile et le Mont Athos », Messager de l’Église orthodoxe russe, op. cit., p. 16-20.
- Voir « Chapitre 1. Les journées de février 1917 à Petrograd ».
- La IXe assemblée générale du COE eut lieu à Nairobi (Kenya), du 23 novembre au 10 décembre 1975.
- Philip Potter (né en 1921), pasteur méthodiste, secrétaire général du Conseil Œcuménique des Églises (1972-84).
- ARCHEVEQUE BASILE (KRIVOCHEINE), « Posle Nairobi. Pism’o Dr. Potteru » [Après Nairobi. Lettre au Dr. Potter], Messager de l’ACER, n° 120 (1977), p. 313.
- « Potchemu Vy porvali s religiey ? Otkrytoe pis’mo byvchemu sviachenniku Darmanskomu po povodu ego statyi « Potchemu ya porval s religiey » [Pourquoi avez-vous rompu avec la religion ? Lettre ouverte à l’ex-prêtre Darmanski à propos de son article « Pourquoi j’ai rompu avec la religion »] », Messager de l’exarchat du patriarche russe en Europe occidentale, n°42-43 (1963), p. 164-171.
- Père Serge Jeloudkov (1909-1984), prêtre et théologien orthodoxe russe, défenseur des droits de l’homme et des droits des croyants en URSS (limogé en 1960).
- ARCHEVEQUE BASILE (KRIVOCHEINE), « Retsenziya. Roman Roessler, « Kirche und Revolution in Rusland. Patriarch Tikhon und der Sowjetstaat » (Köln, 1969) », Messager de l’exarchat du patriarche russe en Europe occidentale, n° 69 (1970), p. 69-78.
SUITE : « Mémoire des deux mondes » De la révolution à l’Église captive, 528 pages
Par Basile Krivochéine Les Éditions du CERF — 2010
Préface du Métropolite Hilarion (Alfeyev) de Volokolamsk, président du département des relations extérieures du patriarcat de Moscou — Traduction du russe de Nikita Krivochéine, Serge Model, Lydia Obolensky — Présentation, révision et notes de Serge Model
La seconde partie, les mémoires d’Église, débute trente années plus tard, quand le prêtre (1951), puis l’évêque (1959) commence à participer à plusieurs conciles et congrès internationaux. Sa position d’ « exilé » de l’Église russe fait de lui un observateur précis, parfois rude, voire critique, des instances orthodoxes, mais cet infatigable et dévoué serviteur de l’Église disait et écrivait immuablement ce qu’il pensait, quelles que soient les personnes mises en cause ou les circonstances.

Le jour suivant, vendredi 28 mai, tous les évêques étaient réunis à l’occasion de l’assemblée épiscopale. Au petit déjeuner, la grande « salle de banquet » était pleine à craquer. Il y avait Mgr Pierre de Paris et l’archevêque Alexis de Düsseldorf (105). On nous apprit la mort soudaine de l’archevêque Antoine de Vilnius à l’âge de quatre-vingts ans.
À dix heures, je reçus dans ma chambre la visite du père Vsévolod Schpiller, qui me communiqua une nouvelle désagréable. l’archevêque Paul de Novossibirsk ne viendrait pas au Concile. Il lui était arrivé une chose curieuse. on lui avait ébouillanté la main, ou alors il s’était ébouillanté lui-même. Il y avait plusieurs versions des faits. Qu’en penser. était-ce le hasard, était-ce voulu ? Je ne me permettrai pas d’en juger, aujourd’hui encore. Mais je fus d’autant plus déçu de ce que je venais d’apprendre que c’était lui, parmi tous les évêques résidant en Russie, qui semblait le plus susceptible de me soutenir — moi et ceux qui pensaient comme moi —,de prendre aussi la parole contre le vote à main levée et surtout contre les décrets de 1961. Puis, le père Vsévolod me dit que chez Kouroïedov, c’était « la panique ». Il avait donné sa parole aux autorités que le Concile se déroulerait sans heurts, mais il se rendait compte maintenant que de nombreux évêques étaient en désaccord. Cela signifiait que Kouroïedov surveillait tout et « écoutait » attentivement.
Une fois le père Vsévolod parti, le père Vladimir Esipenko, mon accompagnateur, passa me voir. Il me demanda de descendre aux environs de trois heures à la sortie ouest de l’hôtel, d’où les évêques seraient conduits en voiture par groupes au monastère de Novodievitchi, lieu de l’assemblée épiscopale. Nous nous mîmes à bavarder et j’appris que le père Esipenko avait travaillé auprès de l’archevêque Paul à Novossibirsk. Il m’en dit du bien. Il pensait bien sûr que Pimène serait élu patriarche, et que c’était une bonne chose, mais il préférait Nicodème. « Si vous saviez l’homme remarquable que c’est, me dit-il. De ma vie, je n’ai jamais rencontré quelqu’un comme lui. Il a une intelligence tellement profonde et pénétrante, une telle énergie, il travaille tant ! Il pense tellement peu à lui-même, il se sacrifie entièrement pour le bien de l’Église. Il est sévère et exigeant avec ses subordonnés, mais il s’intéresse à eux. » Il me sembla le père Esipenko était si enthousiaste à propos du métropolite Nicodème parce qu’il était convaincu que celui-ci ne serait pas patriarche ; ses paroles étaient d’autant plus sincères et désintéressées.
Vers quatre heures de l’après-midi, les évêques membres de l’assemblée commencèrent à arriver au monastère Novodievitchi et à se rassembler dans l’église de la Dormition auprès du réfectoire. Là, dans une longue pièce aux vastes dimensions, des tables étaient disposés en « U ». La partie centrale était destinée à ceux que l’on pourrait qualifier de « présidium » (les membres permanents du Saint-Synode). Le reste des évêques prit place sur les cotés latéraux. Contrairement au Concile où chaque évêque ainsi que tous les membres de sa délégation se voyaient attribuer une place, pour l’assemblée, les évêques étaient libres de s’asseoir où bon leur semblait, même si généralement les plus anciens s’asseyaient plus près du présidium. Voyant que je ne savais où m’asseoir, le métropolite Nicodème me proposa un siège très bien placé, à côté du métropolite Antoine, notre exarque, tout en haut du côté droit, près du présidium. J’en fus très heureux (du point de vue « utilitaire »), car je savais par expérience que plus on est proche du présidium, plus on obtient facilement la parole.
La séance fut ouverte à quatre heures pile (106). Après le Te Deum, le métropolite Pimène, qui présidait la séance, nous annonça qu’il convenait avant tout de résoudre deux « problèmes de procédure ». Étant donné qu’il devait nous quitter une heure plus tard pour accueillir à Moscou le patriarche d’Alexandrie et qu’il n’assisterait donc pas à la fin de la réunion, il nous demandait d’élire, pour le remplacer à la présidence, le métropolite Nicodème et de désigner à la tête du secrétariat le métropolite Alexis de Tallin. Sa proposition fut acceptée. Et, effectivement, peu de temps après, le métropolite Pimène s’éclipsa, ce qui était d’ailleurs mieux pour tous, car son absence nous laissait plus libres pour discuter de sa candidature. Avant de se retirer, le métropolite Pimène prononça un discours introductive (107), suivi d’une allocution du métropolite Nicodème (108).
L’allocution du métropolite Nicodème reprenait les grandes lignes du discours du métropolite Pimène, mais il insistait particulièrement sur la question du vote à main levée et de la personnalité du candidat au patriarcat, deux thèmes que le métropolite Pimène ne pouvait pas aisément aborder.
« Je suis convaincu, nous dit le métropolite Nicodème, que Son Éminence le métropolite Pimène sera sur le trône de Moscou un digne successeur des patriarches de toutes les Russies, reconnus pour leur fidélité à la sainte orthodoxie et leur profond patriotism (109). »
Le métropolite Nicodème parla longuement, de manière expressive, et loua le métropolite Pimène de toutes les façons possibles. Exprimant l’espoir que l’assemblée épiscopale approuverait les décrets de 1961 sur les paroisses ainsi que les recommandations de la commission préconciliaire, que les membres du Concile nommeraient unanimement le métropolite Pimène « comme notre élu au trône primatial », le métropolite Nicodème conclut son discours par un nouvel appel à une volonté et à une action communes. À cet instant, le métropolite Pimène entra dans la pièce et reprit sa place à la table présidentielle.
C’est alors que je pris la parole. De même que pour les autres interventions (110), je rapporte ici une version abrégée de mes propos, reconstitués de mémoire ou à partir de notes.
« Je dois dire que quand nous avons été informés par le patriarcat de la candidature unique et du vote à main levée, cela a provoqué chez nous une indignation générale. Nombreux ont été ceux qui ont pris cela comme un défi, une provocation. Ce fut comme un soufflet en pleine figure. J’ai été heureux d’entendre à l’instant que la « candidature unique » n’est qu’un malentendu, qu’il s’agit d’une erreur de formulation du bulletin d’information et que chacun au Concile sera libre de voter pour qui bon lui semblera. Je regrette seulement qu’un malheureux malentendu ait provoqué une telle inquiétude parmi les croyants. Cependant, la question du vote à main levée ou à bulletins secrets reste entière. L’élection du patriarche porte sur une personne, or dans les questions personnelles, le vote à bulletins secrets est indispensable afin de garantir la liberté de vote. Si le patriarche est élu à main levée, cela donnera aux ennemis de notre Église un bon argument pour contester le caractère libre de l’élection. Cela affaiblira la légitimité du futur patriarche, et rendra plus difficile la réconciliation avec ceux qui nous ont quitté (111). À quoi bon donner aux ennemis de notre Église un motif de nous attaquer ? Ce que je dis là ne signifie pas que je sois opposé à la candidature du métropolite Pimène. Je me suis beaucoup cassé la tête à regarder dans notre calendrier les portraits de nos hiérarques et, mis à part le métropolite Pimène, je n’ai trouvé personne qui convienne. L’un est trop âgé, le second trop jeune, je ne connais pas assez bien le troisième. Je pense que le métropolite Pimène est un bon candidat et je déclare que quelle que soit l’élection, à main levée ou à bulletins secrets, je voterai pour lui. » (En entendant ces mots, le métropolite Pimène se levant à moitié du siège qu’il occupait à la table centrale, s’inclina et dit à mi-voix. « Je vous remercie ! » Ce geste me parut grandiloquent. Il aurait dû manifester une totale indifférence à mes propos, comme si mes paroles ne le concernaient en rien. C’est du moins ce qu’aurait voulu la tradition monastique.) Mais, je le répète, je considère que, pour que l’élection soit claire et complète, le vote à bulletins secrets est indispensable, et je vous invite tous à vous y rallier.«
Le métropolite Nicolas (Iourik) de Lvov (112) prit la parole à ma suite. J’avais fait sa connaissance à Uppsala en 1968 lors de l’assemblée générale du Conseil œcuménique des Églises (113). C’était un ancien uniate et il m’avait raconté que son père était prêtre, comme des générations de ses ancêtres, depuis plusieurs siècles. Il avait acquis sa formation théologique supérieure à Innsbruck, chez les catholiques-romains. On peut d’ailleurs dire que, malgré sa barbiche, toute sa personne et ses manières exprimaient un je-ne-sais-quoi de typiquement occidental, uniate, catholique. Il parlait un russe correct, mais avec un fort accent ukrainien (ou galicien). Avant sa conversion à l’orthodoxie en 1956, il avait enseigné un temps la littérature ukrainienne. C’était sans aucun doute un homme intelligent, probablement efficace dans l’accomplissement des tâches administratives, mais son image était ternie par ses interventions à caractère politique lors de toutes les consultations internationales possibles et imaginables. il s’était notamment distingué en déclarant que « pour être véritablement fidèles à l’Évangile, on doit à l’heure actuelle prendre une mitraillette et participer à la lutte armée aux côtés des insurgés contre les fascistes et les capitalists (114) ». Il me semble qu’aucun des « combattants pacifistes » de l’orthodoxie n’avait été aussi loin.
« Je suis entièrement d’accord avec le métropolite Antoine (115), dit l’archevêque Nicolas, quand il indique que notre élection unanime du métropolite Pimène serait l’expression de notre désir de le voir devenir notre patriarche et non la conséquence de l’absence d’autres candidats. Quand aux décrets de 1961 sur les paroisses, ils ne sont pour nous ni une question, ni un problème. Ils ne créent pas de nouvelle division des pouvoirs entre le clergé et les laïcs. Pour nous, les décrets de 1961 ne sont que la légalisation d’une pratique ancienne (116). Chez nous, tout ce qui concerne les finances et l’aspect matériel de la vie des paroisses a toujours été géré par les laïcs, les prêtres ne s’occupant que des questions spirituelles. En un mot, nos prêtres sont de mauvais gestionnaires, c’est pourquoi il vaut mieux qu’ils ne soient pas en charge des questions financières. »
La parole fut ensuite donnée à l’archevêque Alexis (van der Mensbrügghe) de Düsseldorf, un liturgiste érudit, de nationalité belge. Il s’exprimait en français, avec l’aide d’un traducteur. « J’avoue que la candidature unique m’a troublé moi aussi. Maintenant, je vois qu’il ne s’agit pas d’une candidature unique, mais que tous s’unissent unanimement autour du métropolite Pimène. Par ses interventions, le métropolite Pimène a su me convaincre qu’il était un bon candidat au patriarcat. Je voterai donc pour lui. »
Comme pour apporter une preuve supplémentaire à ces propos, l’évêque Pimène de Saratov, se levant, demanda la parole et fit une déclaration surprenante. « Vous savez tous les efforts immenses qu’a dû accomplir le patriarcat afin de trouver les fonds nécessaires pour couvrir les frais d’organisation et de convocation du Concile, d’accueil des hôtes, etc. Je propose donc que chacun de nous, évêques de l’Église russe, fasse au patriarcat une donation personnelle de 10 000 roubles afin de participer à ces frais. Je pense qu’une telle donation est dans nos moyens. »
Je fus estomaqué de cette déclaration. Selon le cours officiel, 10 000 roubles, équivalaient à 10 000 dollars (117), ce qui pour nous les émigrants représentait une somme colossale. Visiblement, la proposition de l’évêque Pimène avait suscité un fort mécontentement parmi les évêques de l’assemblée, cela se lisait sur leurs visages.
J’ai maintenant tendance à penser que la proposition de l’évêque Pimène n’était qu’une comédie destinée à nous montrer à nous, évêques de l’émigration, à quel point eux, les évêques « soviétiques », étaient riches (même après les décrets de 1961!).
Je m’apprêtais à protester, lorsque métropolite Nicodème, notre président de séance, prit la parole pour répondre à l’évêque Pimène. « Le présidium du Concile n’est pas responsable de la proposition de l’évêque Pimène. Il s’agit d’une initiative personnelle, qui n’engage que lui. Nous acceptons avec reconnaissance le don généreux de l’évêque Pimène. » Tous dans la salle furent soulagés. Je me demande si l’évêque Pimène tint sa promesse.
Les débats prirent fin sur ces entrefaites. Le métropolite Nicodème demanda encore. « Y a-t-il encore des questions ? » Il n’y en avait pas. Le métropolite Nicodème demanda. « Êtes-vous tous d’accord pour que le Concile approuve les modalités de l’élection du patriarche et les décrets de 1961? » Je déclarai qu’en ce qui concernait ces décrets, je m’en tenais à l’opinion que j’avais déjà exprimée, à savoir que je ne les approuvais pas. Personne d’autre ne prit la parole, ce qui me stupéfia. Puis, le métropolite Nicodème demanda si notre assemblée était d’accord sur le principe de la levée de l’anathème contre les vieux-croyants (118). Personne ne s’y opposa.
La séance fut levée. Après la prière, on se dispersa. Il était vingt heures vingt. La séance avait duré presque quatre heures et demie.
Après l’assemblée épiscopale, alors que je me dirigeais vers la sortie de l’église du réfectoire du monastère de Novodievitchi, où se tenait un petit groupe d’évêques, je fus abordé par l’évêque Pierre de Chersonèse, qui me dit en français. « Monseigneur, j’admire votre courage, je vous approuve entièrement, bien que je n’ose pas vous suivre. » Et il m’expliqua qu’il n’avait pas le courage d’intervenir dans le même sens que moi, parce qu’il était l’un des benjamins de l’assemblée, qu’il n’était pas russe et ne connaissait pas suffisamment la langue pour pouvoir s’exprimer sans interprète. Il me dit avoir remarqué que de nombreux jeunes évêques parmi ceux qui l’entouraient à la table, bien qu’ayant gardé le silence, étaient manifestement d’accord avec mon intervention. Puis, il parla de Mgr Antoine (Bloom, notre exarque). « Mgr Antoine, s’écria l’évêque Pierre, quelle honte ! Il a retourné sa veste ! C’est ignoble ! Il aurait mieux fait de se taire plutôt que renier ainsi ses paroles et même demander pardon. »
Il me dit que tous attendaient avec espoir et impatience la seconde intervention du métropolite Antoine, qu’il en avait déçu et attristé plus d’un par son reniement. À partir de là, tous avaient baissé la tête, perdu tout entrain et ne s’étaient plus intéressés aux débats. Quelque chose s’était cassé. Je répondis à l’évêque Pierre que je trouvais exagéré son jugement sur le métropolite Antoine, dans la mesure où son « reniement » concernait principalement le vote à bulletins secrets — ce en quoi j’étais plus ou moins d’accord avec lui — et où le métropolite n’avait mentionné qu’en passant les décrets de 1961.
« Non, répondit l’évêque Pierre, il a justement donné l’impression d’avoir renié son opposition aux décrets de 1961, ce que vous n’avez pas fait et l’avez exprimé clairement. »
Bien sûr, cette première réaction à mes interventions lors de l’assemblée épiscopale me rassura et me donna du courage. Je n’étais donc pas seul, d’autres pensaient comme moi, même s’ils n’osaient pas le dire ouvertement. Cependant, je n’étais pas encore sûr que ce soit bien le cas, et je ne savais pas si j’étais largement soutenu. L’évêque Pierre était un étranger, il vivait en Occident, il pouvait faire une erreur d’interprétation et prendre ses convictions personnelles pour celles de la majorité.
Force était de constater que lors de l’assemblée, pas un des évêques résidant sur le territoire de l’Union soviétique ne s’était opposé, ne fut-ce que d’une parole, aux décrets de 1961, ni même au vote à main levée. S’étaient tus le métropolite Joseph d’Alma-Ata, l’archevêque Benjamin d’Irkoutsk, l’archevêque Léonide de Riga, l’archevêque Théodose d’Ivanovo et l’archevêque Cassien de Kostroma, pour ne nommer que les plus connus d’entre eux. Assis dans la voiture qui me ramenait à l’hôtel Rossia, je ne savais pas encore dans quel état d’esprit ils se trouvaient. Parmi les soixante-neuf membres présents à l’assemblée, seuls vingt avaient pris la parole, si mes souvenirs sont bons. Tous les autres étaient restés silencieux, ils n’avaient pas élevé d’objections, mais il était difficile de dire ce qu’ils ressentaient intérieurement.
Le soir-là à l’hôtel, il y eu bien sûr beaucoup de monde à dîner, mais je n’assistai à aucune conversation particulièrement intéressante. Après dîner, en remontant dans ma chambre, je pris l’ascenseur avec l’archevêque Alypius de Vinnitsa (119). Il avait presque le même âge que moi, un an de moins peut-être. Il se souvenait donc de « l’ancien régime ». « Quel est votre nom ? » me demanda-t-il. — « Krivochéine », lui répondis-je. — « Oh-oh !, s’exclama-t-il d’un air entendu, presque complice, un nom de ministre ! »
Quelques instants plus tard, alors que nous venions de changer d’ascenseur et que nous avions été rejoints par l’évêque Théodose (Dikoun) de Poltava (120), l’archevêque Alypius dit. « Aujourd’hui, on aurait pu avoir un schisme, mais tout s’est finalement bien passé. »
L’évêque Théodose se mêla de la conversation et dit, d’une voix emportée. « Certains ont essayé ! »
La conversation n’alla pas plus loin. Il est difficile de dire à qui l’évêque Théodose avait fait référence. Peut-être était-ce à moi et aux quelques autres personnes qui avaient émis des critiques, comme par exemple l’évêque Denys, qui avait parlé d’une façon très brutale. Quoi qu’il en soit, la remarque de l’évêque Théodose me laissa une impression désagréable. Peut-être que tout le monde est contre nous, pensai-je.
Tard ce soir là (ou le lendemain matin), je réussis à avoir au téléphone le père Vsévolod Schpiller, ainsi que mon frère. Je leur racontai dans les grandes lignes le déroulement de l’assemblée épiscopale. Ils approuvèrent ma ligne de conduite.
Je fus étonné de constater qu’ils étaient au courant (surtout le père Vsévolod), de ce qui s’était passé à la réunion et en particulier de la position prise par le métropolite Antoine. Le père Vsévolod n’approuvait pas sa « palinodie ».
Le lendemain matin, après le petit déjeuner, j’eus l’occasion de faire mieux connaissance et de bavarder avec l’archevêque Benjamin (Novitski) d’Irkoutsk. Son apparence physique était assez étonnante. Voûté, totalement glabre, tant le crâne que le visage, comme si on lui avait entièrement rasé les cheveux, la moustache et la barbe. La première impression qu’il produisait était celle d’un castrat ou d’un curé latin. Pourtant, quelques années auparavant, il portait barbe et moustache. Mais il les avait perdues entre-temps. De même que son dos brisé, c’étaient là les conséquences d’un long séjour au bagne soviétique. On dit qu’il y avait été battu, qu’on lui avait cassé la colonne vertébrale et que c’est à la suite des privations qu’il avait perdu ses cheveux, plusieurs années après les faits. L’archevêque Benjamin était né en 1900 et, à la veille de la guerre de 1939, il était archimandrite, supérieur de la Laure de Potchaïev qui se trouvait alors en Pologne. En 1940, à l’arrivée de l’armée soviétique, il avait été sacré évêque au sein du patriarcat de Moscou. Apparemment, il était resté en Volhynie sous l’occupation allemande, mais cela n’est pas mentionné dans les publications du patriarcat, et d’ailleurs sa biographie n’apparaît nulle part. En tout cas, selon ses propres dires, il fut arrêté en 1943 par les Rouges, qui venaient de reprendre le territoire, et envoyé sur la Kolyma, où il passa douze ans, jusqu’en 1955.
Je demandai à l’archevêque Benjamin ce qu’il pensait des décrets de 1961 sur les paroisses et de ce que j’en avais dit à la séance de la veille. Après avoir jeté quelques regards effrayés par-dessus son épaule, l’archevêque Benjamin me dit, à mi-voix, qu’il avait déjà exprimé ses opinions dans plusieurs notes adressées à la commission préconciliaire, où il critiquait les décrets, en indiquait les conséquences négatives et suggérait les modifications — somme toute assez insignifiantes — qu’il serait nécessaire de leur apporter. Il aurait suffi, selon lui, de faire participer le recteur de la paroisse à l’organe exécutif de la « vingtaine » pour que ces décrets deviennent acceptables pour l’Église, sans pour autant devenir incompatibles avec la loi soviétique. L’archevêque Benjamin avait apprécié mes interventions, il me donnait raison.
« Mais alors, pourquoi n’êtes-vous pas intervenu à l’assemblée, afin de leur faire part de tout cela ? », demandai-je à l’archevêque Benjamin. — « Je me suis fait berner, me répondit-il mot pour mot, on m’a convoqué à la commission préconciliaire où l’on m’a longuement expliqué que les décrets sur les paroisses, étant une émanation directe de la loi soviétique, n’étaient pas sujets à discussion. Ils ne devaient pas être discutés et ne le seraient pas. Puis, j’ai constaté qu’il y avait une discussion. On m’a trompé. » — « Monseigneur, dis-je, quand vous avez vu que la discussion avait lieu, pourquoi n’avez-vous pas pris part au débat ? »
L’archevêque Benjamin me regarda dans les yeux et dit tristement. « Vous savez, j’ai passé douze ans au bagne de la Kolyma. Je n’ai plus la force de recommencer tout ça à mon âge. Pardonnez-moi ! »
Puis nous parlâmes de sa note adressée à la commission préconciliaire. L’archevêque Benjamin accepta volontiers de m’en donner une copie, et ajouta. « Si vous pouvez, emmenez-la à l’étranger. Il faut que là-bas on sache ce qui se passe ici. Montrez-là à qui vous voulez, mais ne la faites surtout pas publier, même anonymement. Ils devineront. Or, chez nous, envoyer et publier des documents à l’étranger, c’est une trahison à sa patrie. »
- Voir « Chapitre 2. Le métropolite Nicodème (Rotov) », n. 26.
- Compte rendu dans le Journal du patriarcat de Moscou, n° 8 (1971), p. 20-24.
- Publié dans le Journal du patriarcat de Moscou, ibid., p. 20-22.
- Ibid., p. 22-24.
- Ibid., p. 24.
- Je n’estime pas devoir reproduire ici certaines interventions, qui n’ont pas eu d’impact décisif ou historique (A. B.).
- Sont ici visés les membres de l’Église russe hors frontières et de l’archevêché des paroisses russes en Europe occidentale relevant du patriarcat de Constantinople (NdT).
- Mgr Nicolas (Iourik, 1910-1977), prélat orthodoxe russe. Évêque de Lvov et Tchernopol (1965), archevêque (1966), métropolite (1971).
- Voir n. 44.
- Je cite de mémoire (A. B.).
- L’intervention du métropolite Antoine (Bloom) ne figure pas dans les mémoires de Mgr Basile (NdR).
- Apparemment, Mgr Nicolas parlait ici de la situation de l’Église uniate en Galicie du temps des Polonais (A. B.).
- Selon un taux de change plus réaliste, cela représentait plutôt 200 dollars américains.
- « Vieux-croyants » ou « Vieux-ritualistes ». groupes séparés de l’Église orthodoxe russe en raison des corrections introduites dans le rite par le patriarche Nikon (Minine) de Moscou, en 1653. Ces réformes furent confirmées par les conciles de Moscou de 1666-1667 qui ont anathématisé les vieux-croyants. Voir Léon POLIAKOV, L’Épopée des vieux-croyants, Paris, Perrin, 1993.
- Mgr Alypius (Khotovitski, 1901-1977), prélat orthodoxe russe. Évêque (1958), évêque de Vinnitsa et Bratslav (1964), archevêque (1966).
- Mgr Théodose (Dikoun, 1926-2001), prélat orthodoxe russe. Évêque (1967), évêque de Poltava et Krementchoug, archevêque (1978), métropolite (1996).
SUITE : « Mémoire des deux mondes » De la révolution à l’Église captive, 528 pages
Par Basile Krivochéine Les Éditions du CERF — 2010
Préface du Métropolite Hilarion (Alfeyev) de Volokolamsk, président du département des relations extérieures du patriarcat de Moscou — Traduction du russe de Nikita Krivochéine, Serge Model, Lydia Obolensky — Présentation, révision et notes de Serge Model
Les mémoires d’Église, débute trente années plus tard, quand le prêtre (1951), puis l’évêque (1959) commence à participer à plusieurs conciles et congrès internationaux. Sa position d’« exilé » de l’Église russe fait de lui un observateur précis, parfois rude, voire critique, des instances orthodoxes, mais cet infatigable et dévoué serviteur de l’Église disait et écrivait immuablement ce qu’il pensait, quelles que soient les personnes mises en cause ou les circonstances.
Ces mémoires de Mgr Basile, portant sur des périodes peu ou mal connues, sont — tant dans leur partie « civile » que « religieuse » — très précieux pour comprendre l’histoire de la Russie et de son Église.

Le lendemain matin, jour de l’Ascension du Seigneur, je célébrais à l’église Saint-Nicolas-des-Forgerons chez le père Vsévolod Schpiller. Dans mon homélie, je parlai de la fête, sans évoquer le Concile. Au début de la liturgie, alors que nous concélébrions avec le père Vsévolod, les autres prêtres et le diacre, je m’aperçus que l’on n’était pas en train de célébrer une liturgie épiscopale (il n’y avait pas eu d’encensement pendant la petite entrée (101)). Je me dis que c’était une simple erreur et demandai qu’on me donne le dikerion et le trikerion (102). Je remarquai une certaine confusion parmi les prêtres, aussi bien qu’au pupitre des choristes. Le père Vsévolod dit. « Bon, eh bien, vous souhaitez une liturgie épiscopale, tant mieux. Nous allons célébrer une liturgie épiscopale. J’en suis très heureux. »
Puis, tout se passa sans incidents. J’appris par la suite que le Département des relations extérieures avait donné ordre de ne pas célébrer de liturgies épiscopales, car la présence de très nombreux évêques venus pour le Concile empêchait d’assurer partout des conditions de célébration dignes d’un évêque. Il y avait une grande confusion en raison des nombreux hôtes, venus pour le Concile. Le Département avait mis au point la règle suivante. on demandait aux évêques résidant en Russie et présents à Moscou, dans les journées qui précédaient les cérémonies officielles et les festivités du Concile, d’aller aux offices de la cathédrale patriarcale de la Théophanie. Les évêques venus de l’étranger étaient invités à célébrer dans les autres églises de Moscou, où chacun d’entre eux pouvait ainsi présider l’office. Notons que certains ont vu dans cet arrangement un moyen d’éviter les contacts entre les évêques de l’étranger et les évêques locaux.
Cela se confirma par un petit incident après la célébration chez le père Vsévolod.
À la fin de la liturgie, le père Vsévolod me dit qu’à son grand regret, il ne pourrait pas m’inviter à prendre du thé dans son « clocher » (où se trouvait aménagé le petit appartement dans lequel il vivait auparavant), comme il l’avait toujours fait lors de mes visites précédentes. Gêné, il m’avoua que le Département des relations extérieures avait indiqué qu’il ne devait y avoir aucune réception après les offices et qu’il fallait immédiatement renvoyer l’évêque à son hôtel. D’après le père Vsévolod, pour faciliter le travail du Département, il valait mieux isoler les hôtes, les empêcher de rencontrer les évêques locaux et les fidèles. Des conversations imprévues, des interrogations des gens et leurs questions à la veille du Concile pourraient avoir des conséquences inattendues… (Lesquelles ? pensai-je).
Après le repas, je pris une voiture pour rendre visite à mon frère aîné, Igor Krivochéine. Je fus alors soudain pris d’un malaise. J’avais déjà ressenti cela à la fin de l’office mais je pensais que cela passerait en mangeant un morceau. Je n’avais aucun appétit et me forçai à déjeuner. Mais quand je m’assis dans la voiture, après le déjeuner, pour aller voir mon frère (c’était un trajet assez long, d’une quarantaine de minutes, à travers tout Moscou), je me sentais encore moins bien. C’était une sensation bizarre, comme un début de grippe ou une intoxication alimentaire ; j’en avais l’esprit brouillé, des bribes de pensées tourbillonnaient dans ma tête. Ce vertige était accompagné d’un état de forte nervosité, le bruit du moteur et les sons de la rue s’étaient transformés en une musique folle et entêtante, je voyais dans mon demi-sommeil des visions qui se confondaient avec la réalité, presque des hallucinations. C’était sans aucun doute imputable à ma nervosité, et les conversations de la veille avec les métropolites Nicodème et Philarète y étaient certainement pour quelque chose. À cela venait s’ajouter la fatigue physique des longs offices de fête, du manque de sommeil, etc. Le temps venait de changer brutalement, un vent violent s’était levé, il s’était mis à faire froid, à pleuvoir, on entendait le tonnerre. « Cela aussi agit sur les nerfs », me dis-je. À travers la fenêtre, je voyais les rues de Moscou, et je me sentais de plus en plus mal. Soudain, une pensée sournoise me traversa l’esprit. on m’avait empoisonné ! Mais où et comment ? Je me mis à me rappeler…
Il se trouve qu’à l’église Saint-Nicolas où j’avais célébré, Nina Gueorguievna, la marguillière de la paroisse, m’avait offert un bouquet de fleurs, comme on le fait souvent dans ces cas-là en URSS.
J’avais porté ce bouquet à mon nez et l’avais déposé dans la voiture, alors que je quittais la paroisse. Étonnamment, il avait ensuite disparu. Je pensai qu’on avait oublié de le monter dans ma chambre et n’y attachai guère d’importance. Mais c’est après avoir humé les fleurs que je m’étais senti mal, que ma nausée et mes maux de tête avaient commencé.
Afin d’expliquer comment une telle idée avait pu me venir à l’esprit, il faut que j’explique qui était la marguillière de la paroisse du père Vsévolod et de quelle réputation elle jouissait.
Elle avait un nom français, était la descendante d’émigrants français, mais son français n’était pas extraordinaire, son anglais bien meilleur. C’était une femme assez cultivée, d’une cinquantaine d’années, plutôt élégante, de type artiste et bohème. Elle se donnait un genre « décadent ». Elle avait travaillé au ministère du commerce extérieur, avait été arrêtée et avait passé trois ans à la prison de la Loubianka (103). Peu après sa libération, elle était entrée au Département des relations extérieures du patriarcat. Je me souviens que le père Vsévolod m’avait raconté cela, mais je lui avais répondu que cette histoire semblait peu vraisemblable. D’abord, on ne garde jamais personne pendant trois ans à la Loubianka. On y instruit les dossiers, après quoi le détenu est soit libéré, soit transféré dans d’autres prisons. Cela signifie que si on l’avait gardée à la Loubianka, c’était pour qu’elle surveille ses codétenus et les dénonce. Si son chef d’accusation avait réellement été un quelconque engagement contre-révolutionnaire, il semble encore plus hautement improbable qu’elle ait pu, après la Loubianka, entrer au Département des relations extérieures. En revanche, cela parait parfaitement naturel pour un agent. En un mot, Nina Gueorguievna s’était forgé une solide réputation d’agent du KGB.
À cette époque, le père Vsévolod se trouvait en conflit permanent avec ses marguilliers. Ils lui parlaient grossièrement, gênaient le bon déroulement des offices, intriguaient contre lui, et la situation semblait dans une vraie impasse.
Les paroissiens soutenaient le père Vsévolod et adressaient des plaintes au préposé aux affaires religieuses et au Conseil aux affaires religieuses. L’affaire avait été portée à la connaissance de l’Occident, on en parlait beaucoup dans les journaux. Préoccupé du retentissement de cette affaire à l’étranger, Makartsev, l’adjoint de Kouroïedov, proposa une solution de compromis. avec l’accord du métropolite Nicodème, il « envoya » au père Vsévolod Nina Gueorguievna comme marguillier, malgré la résistance du secrétaire du comité de district local qui avait son propre candidat pour le poste, un athée déclaré. Bien entendu, tout cela se fit dans les formes, on réunit la « vingtaine », et Nina Gueorguievna fut élue marguillier.
Le père Vsévolod connaissait la réputation de Nina Gueorguievna et la jugeait fondée, mais accueillit néanmoins la nouvelle marguillière et se déclara globalement satisfait de sa gestion « administrative ». Son arrivée mit fin aux conflits, Nina Gueorguievna avait un comportement décent, elle collaborait loyalement avec lui, faisait son possible pour satisfaire ses demandes et allait même au-devant d’elles, en œuvrant au retour à la paroisse du père Alexandre (104) qui en avait été écarté et transféré dans un petit village à l’époque du marguillier précédent. Nina Gueorguievna se comportait comme une fidèle. elle faisait des signes de croix, venait demander la bénédiction, s’inclinait devant les évêques en touchant le sol de la main, connaissait les nuances des offices. Était-elle croyante ? Le père Vsévolod lui-même ne savait pas répondre à cette question, et moi encore moins. En tout cas, le père Vsévolod se méfiait d’elle et évitait de parler d’affaires d’Église en sa présence. Il nous conseillait de nous tenir sur nos gardes. On peut penser qu’elle avait pour mission de surveiller le père Vsévolod, mais avec ordre de ne pas faire obstacle à son travail. Qui sait. peut-être ne voulait-elle pas nuire à l’Église, et n’était qu’une victime du terrible système soviétique qui déformait les âmes ?
Toujours est-il qu’après les fleurs de Nina Gueorguievna, je me sentis mal et tout en étant conscient du caractère invraisemblable, monstrueux même, d’une telle supposition, je ne parvenais pas à me défaire de l’idée qu’elle m’avait empoisonné.
Je passai tout le restant de la journée chez mon frère, on me soigna comme on put, depuis le charbon jusqu’aux moyens les plus radicaux. On ne voulait pas appeler un médecin, pour éviter que je sois hospitalisé et, par conséquent, complètement isolé. C’est d’ailleurs peut-être dans ce but que tout cela avait été imaginé. Le soir, mon malaise était passé et K. P. Troubetzkaïa vint me voir chez mon frère. Nous parlâmes du concile à venir. Voyant mon état, elle fut fort inquiète, et ne cessait de répéter. « Nous savons avec quel courage vous défendez l’Église. Nous vous en sommes très reconnaissants. Il est indispensable que le Concile amende les décrets de 1961 sur les paroisses ; tout le monde l’espère. » Et elle faillit fondre en larmes.
- Petite entrée. procession de l’Évangile durant la liturgie eucharistique. Un encensement est prévu lors des célébrations pontificales.
- Dikerion et trikerion. chandeliers portant respectivement deux et trois cierges (symbolisant les deux natures du Christ et les trois personnes de la Trinité), utilisés exclusivement par l’évêque lors des célébrations.
- Siège central du KGB à Moscou, place de la Loubianka.
- Voir n. 24.

Le lendemain matin, mercredi 26 mai, je comptais aller à la liturgie de clôture de la période pascale, quand je reçus dans ma chambre un appel du père Michel Syrtchine me demandant de ne pas quitter ma chambre, car le métropolite Nicodème désirait me voir le jour même. Le père Michel dit que le métropolite n’était pas encore arrivé au Département et qu’eux-mêmes ne connaissaient pas son emploi du temps du jour, mais dès qu’il serait là, on me téléphonerait. Je dus donc attendre. Ce n’est que vers trois heures que l’on me dit enfin que le métropolite Nicodème me priait d’être chez lui au Département à seize heures quinze.
À l’heure dite, le métropolite me reçut dans son cabinet de travail au Département des relations extérieures. Il me proposa du thé.
« Pour commencer, réglons les questions urgentes, me dit-il. Demain, c’est l’Ascension. Où souhaitez-vous célébrer la liturgie et les vigiles de ce soir ? »
Ne voulant pas exprimer devant lui mes préférences, je lui répondis que cela m’était égal.
« Dans ce cas, je vous propose de célébrer aux Sokolniki. C’est une des plus grandes églises de Moscou », précisa le métropolite. — « Entendu. Mais peut-être que je pourrais y célébrer les vigiles et demain aller dans une église moins éloignée ? » — « Que diriez-vous de l’église du Prophète Élie, rue Obydennaya ? » demanda-t-il. — « Eh bien, puisque vous insistez, j’aimerais bien aller à Saint-Nicolas-des-Forgerons, si c’est possible » (c’était l’église du père Vsévolod Schpiller). — « Mais comment donc, bien sûr, puisque tel est votre souhait », dit le métropolite Nicodème et il donna des ordres dans ce sens.
Puis il entra dans le vif du sujet.
« Monseigneur, j’ai lu votre lettre et je dois avouer que je ne suis pas d’accord avec vous. » — « Pourquoi ? » — « Premièrement, en ce qui concerne ce que vous dites de la communion des catholiques. Cette question n’est pas assez importante pour être discutée au Concile. » — « Non, je ne suis pas de cet avis ; c’est vraiment une question très importante, mais j’admets qu’il y en a d’autres, plus vitales et plus urgentes et c’est pourquoi je ne soulèverai pas, au Concile, la question de la communion des catholiques-romains. Laissons-la donc de côté et passons aux autres questions. Pouvez-vous me garantir qu’il ne sera pas question d’une candidature unique pour laquelle tout le monde sera obligé de voter et qu’il y aura un choix ? » — « Vous parlez de candidature unique. Mais d’où tenez-vous cela ? Il n’y a pas de candidature unique », s’exclama le métropolite Nicodème. — « Comment, d’où je tiens cela ? Mais des documents officiels qui nous ont été adressés, sous la signature du métropolite Alexis de Tallinn. On y évoque expressément la proposition de ne présenter qu’un seul candidat », répondis-je.
Le métropolite Nicodème se renfrogna, fit une grimace, comme s’il avait avalé quelque chose de désagréable.
« Le métropolite Alexis a tout confondu. Tant que les communiqués de presse étaient émis par notre Département, ils étaient au moins précis et exacts. Mais depuis que, sous prétexte de l’imminence du Concile, c’est le métropolite Alexis qui s’est mis à les rédiger, on n’y peut plus rien comprendre. Ils sont composés incorrectement. On a presque honte de les lire ! » Le métropolite Nicodème était à ce point exaspéré qu’il se leva et s’approcha de la fenêtre. « En réalité, il n’y aura aucune candidature unique obligatoire. Chacun pourra librement voter pour qui il le souhaite. » — « C’est bien, dis-je, car l’annonce d’une candidature unique a suscité chez nous une incompréhension et une indignation générales. Vous pouvez donc m’assurer qu’il ne sera pas question, au Concile, de candidature unique, et qu’il y aura le choix ? » — « Je vous donne ma parole, répondit le métropolite Nicodème, mais jugez donc par vous-même de la façon dont se présentent les événements. Nous avons beaucoup discuté entre nous du candidat le plus à même de devenir patriarche et nous n’avons réussi à trouver personne d’autre que Pimène. Si vous connaissez quelqu’un, nommez-le. Tenez, prenez ce calendrier, qui contient les portraits de tous les évêques, choisissez vous-même, dites-moi lequel des évêques de plus de cinquante ans conviendrait pour être élu patriarche ? »
Par les mots « plus de cinquante ans », le métropolite Nicodème s’excluait de la candidature, en même temps que d’autres membres du synode tels que les métropolites Alexis de Tallin et Philarète de Kiev. J’étais d’accord avec ce principe et cela rendait la conversation plus aisée. Néanmoins, la question du métropolite Nicodème m’embarrassait. Premièrement, parce que je ne voulais pas nommer des gens comme l’archevêque Hermogène ou l’archevêque Paul de Novossibirsk, par peur de les compromettre ou de « dévoiler prématurément mon jeu » au métropolite Nicodème avant d’avoir pu évaluer, par des conversations avec d’autres évêques, à quel point ces candidatures étaient envisageables et possibles. D’ailleurs, en disant « prenez le calendrier », le métropolite Nicodème avait exclu d’emblée l’archevêque Hermogène, ce dernier ne figurant pas dans les calendriers édités par le patriarcat ces dernières années car il était en disponibilité. Je ne voulais pas évoquer le nom de l’archevêque Paul, car je savais par avance que le métropolite Nicodème me servirait en réponse les conclusions sordides de la commission de contrôle qui s’était penchée sur son cas suite à une accusation de « comportement immoral » formulée par les autorités ecclésiastiques et civiles. Je n’accordais aucun crédit à ces accusations que j’estimais fabriquées de toutes pièces dans le but de l’empêcher de prendre la parole durant le Concile. Mais la principale raison de mon silence était qu’en mon for intérieur, et pour diverses raisons, je ne considérais pas ces deux évêques, ni aucun autre d’ailleurs, dignes de devenir patriarches, pas plus dignes que le métropolite Pimène en tout cas.
Je dis cependant au métropolite Nicodème. « Qu’auriez-vous par exemple contre la candidature de Mgr Antoine de Minsk ? Certes, il n’a que quarante-sept ans, mais enfin, c’est presque cinquante. C’est un bon évêque, cultivé, il gère avec succès un diocèse de quatre cent vingt-cinq paroisses, il a donc l’expérience nécessaire. »
Entendant ces mots, le métropolite Nicodème se mit à rire. « Voyons, Monseigneur ! Lui ? Patriarche ? Vous savez bien vous-même que c’est impossible. »
Je dois admettre que, connaissant la timidité et la faiblesse de caractère du métropolite Antoine, je tombai intérieurement d’accord avec le métropolite Nicodème et ne cherchai pas à le contredire, me contentant de dire. « Il me semble que Mgr Léonide de Riga ferait l’affaire lui aussi. »
Cette fois, c’est presque de la colère que refléta le visage du métropolite Nicodème. « Vous n’imaginez pas, Monseigneur, l’intrigant que c’est ! Il a été responsable du Département des finances du patriarcat. Il a fallu le licencier à cause des intrigues qu’il fomentait. »
Je n’étais pas d’accord avec une telle appréciation de l’archevêque Léonide. J’avais certes entendu dire qu’il avait un caractère difficile et capricieux. Mais d’un autre côté, un aussi bon prêtre que le père Boris Stark de Iaroslavl (94), et d’ardents défenseurs de la vie spirituelle issus de l’intelligentsia de Moscou (comme la poétesse N. A. Pavlovitch, mes cousines germaines Nadège (95) et Olga Kaveline (96)) ne tarissaient pas d’éloges sur Mgr Léonide, disant que c’était un homme profondément spirituel, d’esprit monastique, qui avait su préserver dans son diocèse l’existence de deux monastères féminins, les meilleurs de toute la Russie. Cependant, eux aussi reconnaissaient la piètre santé et le caractère timoré du métropolite Léonide. Vu ces caractéristiques, aurait-il été apte à la charge de patriarche ? Je ne sais…
J’estimai toutefois nécessaire de défendre cette candidature face au métropolite Nicodème, avant de poursuivre. « Monseigneur, le problème, ce n’est pas de nommer des candidats. Personnellement, je n’ai rien contre le métropolite Pimène, je le considère vraiment comme le candidat le plus apte à devenir patriarche, même s’il était préférable qu’il ne soit pas candidat unique. Mais je suis résolument opposé à un vote à main levée. Car le vote est une question d’opinion personnelle, or par ce moyen on fait pression sur les votants. Il est vrai que les canons ne parlent pas de vote à bulletins secrets et il est difficile de déterminer si dans le passé les élections se faisaient publiquement ou à bulletins secrets, mais, de nos jours, un vote à main levée pour une élection personnelle est inadmissible et provoquera l’indignation et la réprobation générales ! On dira partout, et surtout en Occident, que l’élection du patriarche a été ni libre, ni canonique. Cela n’est pas dans l’intérêt de l’Église russe. Même avec un vote à bulletins secrets, Pimène passera. Mais s’il se trouvait des personnes pour donner leur voix à d’autres candidats, cela n’en serait que mieux. Cela donnerait la preuve qu’il s’agit bien d’élections libres. En fait, il vaudrait mieux que le métropolite Pimène ne soit pas élu à l’unanimité, sans quoi il y aurait un risque qu’il exerce un pouvoir trop personnel. on ne sait pas s’il sera bon gouvernant. »
« Vous raisonnez comme un Occidental, Monseigneur, comme un Bruxellois, me répondit le métropolite Nicodème en souriant, alors que nous, nous raisonnons comme des gens d’ici. Ici, personne ne viendra nous reprocher des élections à main levée. Mais chez vous, en Occident, quoi que nous fassions, on nous y critiquera. » — « Je pense, répondis-je, que même chez vous un vote à main levée pour un candidat unique provoquera des critiques et du mécontentement. » Et je lui racontai les conversations que j’avais eues avec l’ingénieur kiévien dans l’avion et avec le douanier à l’aéroport. — « Demandez donc à votre ingénieur de vous raconter comment se passent les élections dans l’institut où il travaille, s’écria le métropolite Nicodème, s’il s’agit de votes à main levée ou à bulletins secrets ? Pourquoi est-ce qu’il se tait sur son lieu de travail et vient se mêler des affaires de l’Église, auxquelles il ne connaît rien et pour lesquelles on ne lui demande pas son avis ! »
C’est là un exemple très caractéristique de la façon dont le métropolite Nicodème avait l’habitude de mener une discussion. au lieu d’analyser et réfuter le fond de l’argument de l’adversaire, il faisait une digression démagogue et à caractère personnel qui détournait l’attention de l’interlocuteur du sujet de la discussion. Un tel procédé était plus adapté à une tribune politique qu’à une conversation sérieuse.
« Ne me dites pas, Monseigneur, que, dans l’Église, on doit se conformer aux mêmes règles que dans le premier institut venu ? »
Mais le métropolite Nicodème était lancé. « Objectivement, à l’exception du patriarche Tikhon dont la légitimité canonique de l’élection ne fait aucun doute, pas un seul de nos patriarches, ni ceux du XVIIe siècle, ni Serge, ni Alexis n’ont été élus en accord avec les canons. Et pourtant, ils étaient tous des patriarches légitimes. Et bien maintenant, en votant publiquement, nous n’enfreignons pas plus les canons que cela n’a été fait par le passé. Je dirai même que le vote à main levée nous semble actuellement mieux correspondre aux intérêts de l’Église. Pour ce qui est de vos appréhensions de voir le futur patriarche exercer son pouvoir de façon abusive, vous êtes dans l’erreur. Nous avons eu l’occasion de le voir à l’œuvre depuis qu’il est locum tenens et qu’il préside le Saint-Synode. C’est un homme au caractère doux, totalement exempt de tendances autoritaires ; il fait toujours grand cas des avis extérieurs et tient réellement à collaborer avec ses confrères. Il est très agréable de travailler avec lui. »
Il ne m’avait pas échappé que lors de cette conversation, contrairement aux fois précédentes, le métropolite Nicodème ne s’était pas permis la moindre critique à l’égard du métropolite Pimène. Il soutenait visiblement très sincèrement la candidature de ce dernier.
Puis, après avoir bu notre thé avec un biscuit, nous abordâmes la question principale. celle des décrets de 1961 sur les paroisses.
Cette question devait être examinée par le Concile, or je critiquais ces décrets depuis longtemps, tant du point de vue canonique, que de ceux de l’ecclésiologie et de la pratique pastorale.
« M’avez-vous jamais entendu dire, me demanda le métropolite Nicodème, que ces décrets fussent merveilleux et bénéfiques pour l’Église ? Jamais de la vie ! Je dirai même que, si quelqu’un s’avisait d’affirmer une chose pareille pendant le Concile, je l’arrêterais immédiatement. Mais croyez-moi, Monseigneur, je vous en prie, on ne peut rien faire pour changer quoi que ce soit à ces décrets. Ils sont en accord avec la loi de 1929 sur les cultes (97) et en découlent directement. Le gouvernement de l’URSS tient particulièrement à la mise en accord de la législation ecclésiale avec la législation civile. Le Conseil des ministres a fait parvenir un courrier en ce sens au Conseil aux affaires religieuses et c’est sur la base de cette requête que l’assemblée épiscopale de 1961 a adopté ces décrets. »
« Mais, Monseigneur, l’interrompis-je, ce n’était pas une assemblée épiscopale légitime ! » — « Comment cela ? », s’étonna-t-il sincèrement.
— « Tous les évêques n’y ont pas été convoqués, comme il se devait. Ni Mgr Antoine, ni moi-même, ni aucun évêque de l’étranger n’y a été invité. En ce qui concerne les autres évêques, ils n’ont pas été prévenus suffisamment à l’avance. Ils avaient été invités à la fête de saint Serge et ce n’est que tard le soir, après les vigiles, qu’ils ont été informés qu’il y aurait le lendemain une assemblée épiscopale, sans qu’on leur dise de quoi il y serait question. Ils ont été pris au dépourvu et n’étaient absolument pas préparés à discuter de cette question », tentai-je d’expliquer au métropolite Nicodème.
« Tout ce que vous dites là est inexact. On avait commencé à discuter de la question des paroisses dès le printemps 1960, quand le Synode a largement édité et diffusé son décret sur les paroisses, en vue de le faire ensuite entériner par l’assemblée épiscopale. on peut dire que les évêques qui, en juillet, étaient présents à cette assemblée connaissaient déjà bien le problème. En ce qui concerne les évêques de l’étranger, on ne les a pas invités, pour la bonne raison qu’il n’était question que des paroisses qui se trouvaient sur le territoire de l’Union soviétique. » — « Je ne suis pas tout à fait d’accord avec vous, répondis-je, lors de l’assemblée épiscopale de 1961, il a également été question de l’entrée de l’Église russe dans le Conseil œcuménique des Églises, et cette question ne concerne pas seulement l’Église sur le territoire de l’URSS, mais l’Église russe dans son entier. Et si, selon vous, les décrets de 1961 ne nous concernent pas, alors pourquoi nous convoquer maintenant à Moscou pour nous demander de les approuver ? Ce n’est pas logique. »
« Nous vous avons convoqués pour l’élection du patriarche et, à partir du moment où vous serez présents au Concile, on ne peut pas vous écarter des débats autour du problème des paroisses. Vous vous rappellerez que l’assemblée épiscopale de 1961 a soumis la ratification de cette question au prochain concile épiscopal, qui se réunit maintenant. Et si nous n’en discutons pas, ce sera perçu par les autorités comme une contestation de la loi et ne fera que tendre nos relations avec « ells ». Cela nuira à l’Église, alors que nous avons besoin d’aller vers une normalisation de nos relations avec les autorités, étant donné que la question des décrets de 1961 ne concerne pas directement la foi, mais seulement l’ordre dans l’Église. »
Et le métropolite Nicodème me lut un extrait du discours qu’il s’apprêtait à prononcer à l’assemblée épiscopale, il y déclarait notamment que « l’Église se souvient bien des difficultés qu’elle a éprouvées, quand ses relations avec l’État n’étaient pas normalisées, et ne souhaite pas un retour à cette époque. »
« Je conviens, dis-je, qu’il ne faille pas tendre les relations avec les autorités civiles sans nécessité, mais malgré cela, je ne puis approuver en conscience ces décrets. Ils sont contraires aux canons, détruisent la structure de l’Église et ont eu, en outre, des conséquences néfastes dans la vie de l’Église. Vous savez vous-même que cela a grandement facilité aux autorités la campagne de fermeture massive des églises au début des années soixante. » — « Quels canons ? Que disent-ils ? », s’étonna le métropolite Nicodème.
J’avais préparé cette question et je sortis de ma poche un papier sur lequel j’avais noté le contenu du 41e canon apostolique qui dit que, si « les précieuses âmes des hommes doivent être confiées » [à l’évêque], [celui-ci] doit a fortiori avoir « pouvoir sur les biens de l’Église » (98). « Or, selon les décrets de 1961, l’évêque et ses représentants, les recteurs des paroisses, sont complètement écartés des aspects économiques et administratifs de la vie des paroisses. Les affaires paroissiales sont entièrement aux mains des laïcs, ce qui enfreint la règle de l’unité de la direction ecclésiale », répondis-je.
Le métropolite Nicodème eut, un instant, l’air interdit. Il était visible qu’il avait complètement oublié l’existence de ce canon, mais il se reprit immédiatement et, avec sa capacité habituelle de réponse immédiate, s’exclama. « Mais ce canon ne s’applique pas à la vie contemporaine. Car « avoir pouvoir sur » signifie commander souverainement et disposer selon son bon plaisir. Quel évêque, où cela, dispose aujourd’hui d’un tel pouvoir en matière de biens ecclésiastiques ? Chez vous non plus, il n’en est pas ainsi. Ce canon n’est pas applicable aujourd’hui. » — « Vous jouez avec les mots, répondis-je. Le terme grec qui signifie « disposer » a une acception plus nuancée, mais la signification principale de ce canon, son esprit, qui a gardé tout son sens jusqu’à nos jours, c’est que l’évêque participe activement et au premier chef dans la vie de l’Église. Tant matérielle qu’autre ! Et les décrets de 1961 l’écartent complètement de cette participation et le placent sous le contrôle de gens, souvent opposés à l’Église… »
Le métropolite Nicodème était fort mécontent de mes conclusions et s’efforçait de trouver des justificatifs à ces « bonnes dispositions ».
« Savez-vous qu’en ce cas, l’ensemble des administrations paroissiales de l’Église orthodoxe en Amérique est contraire aux canons ? », demanda le métropolite. « Et plus encore au patriarcat d’Antioche. Mais nul ne les considère comme hérétiques. Et dans notre propre Église, depuis Pierre le Grand (99) et jusqu’à la restauration du patriarcat, toute l’administration ecclésiale était anti-canonique. D’après vous, toute l’Église russe de la période synodale fut non orthodoxe, voire hérétique ? » Le métropolite Nicodème tenait absolument à me démontrer qu’il avait raison (mais en quoi ?). « Dites-moi, Monseigneur, pourquoi les autres peuvent enfreindre les canons et personne ne les condamne, mais quand nous sommes contraints de le faire, on nous juge, on nous condamne et on nous exclut ? »
« Personne ne dit que l’Église russe de la période synodale ait été « non orthodoxe », protestai-je. Personnellement, j’aime beaucoup la période synodale. ce fut la période de Séraphim de Sarov (100), des startsy d’Optino, du renouveau de la théologie, des entreprises missionnaires. Cependant, il est incontestable que la structure anti-canonique, si elle ne privait pas l’Église de son orthodoxie, lui a causé un tort immense. Elle l’a affaiblie, ce qui a eu des conséquences catastrophiques. Il en est de même aujourd’hui ; les dispositions anti-canoniques sur les paroisses ne rendent pas l’Église russe « hérétique », mais l’affaiblissent et lui causent un grand tort. L’Église survivra, bien sûr, mais à quoi bon lui causer du tort, et on ne peut justifier une illégalité par une autre. Peu importe ce qui se passe en Amérique ou à Antioche. Ce n’est pas une raison pour que nous-mêmes enfreignions les canons. »
« Les décrets de 1961, répondit le métropolite Nicodème, n’ont pas eu les conséquences dramatiques que vous décrivez. La fermeture de paroisses a été exagérée ; on n’a jamais fermé « dix mille paroisses », comme on l’a écrit dans la presse. Des fermetures ont eu lieu, mais ce n’était pas sur base des décrets de 1961; cette question est complexe et on ne va pas ressasser maintenant l’histoire du pays… » — « Quoi qu’il en soit, répondis-je, je reste sur mes positions, aussi bien en ce qui concerne le vote à main levée qu’au sujet des décrets de 1961 sur les paroisses. Je me réjouis cependant de ce que cette « candidature unique » ne soit pas à l’ordre du jour et que cela n’ait été qu’un malentendu. Cependant, je compte bien exprimer mes opinions tant devant l’assemblée épiscopale qu’au Concile. » — « Libre à vous. C’est votre droit », me répondit le métropolite Nicodème. — « Vous ne pensez donc pas que cela puisse nuire à l’Église, comme le disent certains ? », demandai-je. — « En aucune manière, comment cela pourrait-il être nuisible à l’Église ? », répondit-il.
Nous devions nous dépêcher pour nous rendre aux vigiles de l’Ascension à l’église des Sokolniki, et notre longue et intéressante conversation prit fin. Nous arrivâmes d’ailleurs avec cinq minutes de retard, ce qui était gênant, car on nous attendait pour l’entrée épiscopale. Dans la voiture pour y aller, je me repensai à ma conversation avec le métropolite Nicodème. j’en gardais une impression mitigée, mais pas négative.
- Père Boris Stark (1909-1996), prêtre orthodoxe russe et père spirituel reconnu, en France puis en Russie (1952).
- Nadège Alexandrovna Kavéline (1906-1981), cousine de l’auteur, résidant à Moscou.
- Olga Alexandrovna Kavéline, en religion moniale Séraphima (1916-2003), cousine de l’auteur, résidant à Moscou.
- Décret du Comité exécutif central de toute la Russie et du Conseil des commissaires du peuple sur les Associations religieuses (8 avril 1929). Texte français dans N. STRUVE, op. cit., p. 371-382.
- Voir Les Constitutions apostoliques, Paris, Éd. du Cerf, 1992, p. 346.
- En 1721, le tsar Pierre le Grand remplaça, à la tête de l’Église orthodoxe russe, le patriarche par un organe collectif (le Saint-Synode), soumis à l’autorité de l’empereur. On qualifie de « synodale » l’histoire de l’Église russe de 1721 à la restauration du patriarcat en 1917.
- Saint Séraphim de Sarov (1759-1833), moine et prêtre orthodoxe russe, starets et thaumaturge de toute la Russie. Un des saints russes les plus connus et les plus populaires.

Le mardi 25 mai à près de six heures du soir, l’avion d’Aeroflot que j’avais pris atterrit à l’aéroport de Cheremetievo à Moscou. J’avais quitté Bruxelles seul, car les deux autres délégués au Concile pour notre diocèse, le diacre Serge Reingardt (79) et V. E. Drachoussoff (80) ne participaient pas à l’assemblée épiscopale du 28 mai et devaient donc me rejoindre trois jours plus tard. Mon évêque auxiliaire, Denys de Rotterdam, monta dans mon avion à Amsterdam et nous pûmes longuement parler du concile à venir, quoique avec prudence, étant donnée la présence possible de micros. Nous nous trouvâmes d’accord en tout, même si l’évêque Denys se montrait réticent à s’exprimer ouvertement au Concile, d’abord parce qu’il était l’un des plus jeunes dans l’épiscopat mais aussi à cause de sa citoyenneté soviétique (qu’il avait acquise après la Deuxième Guerre mondiale, abandonnant son statut d’émigrant).
Je discutai dans l’avion avec un ingénieur d’une quarantaine d’années qui rentrait à Kiev après un colloque scientifique et qui était assis à côté de nous. Je ne saurais dire à quel point il était croyant, mais il avait en tout cas assisté aux matines pascales à la cathédrale Saint-Vladimir et il connaissait le nom du métropolite Philarète de Kiev. Il s’intéressait vivement au concile et à l’élection du nouveau patriarche.
« Je suppose qu’il y aura plusieurs candidats ; quels noms cite-t-on ? Bien entendu, le scrutin sera secret ? », demanda-t-il.
Je me sentis honteux d’avoir à répondre que selon toute vraisemblance, il y aurait un candidat unique en la personne du métropolite Pimène (dans le meilleur des cas, s’y ajouterait Nicodème) et que le vote serait probablement public. L’étonnement et la déception se peignirent sur le visage de mon interlocuteur. « Mais pourquoi ?, demanda-t-il. Est-ce exigé par les lois de l’Église ? » — « Non et d’ailleurs ce n’est pas encore définitif, cela dépend entièrement du Concile lui-même. »
Mon interlocuteur sembla rassuré.
À mon arrivée, un incident se produisit au moment du contrôle des passeports, dont la signification ne me sembla longtemps pas claire. Un lieutenant de la police des frontières examina soigneusement mon passeport et mon visa d’entrée, et me demanda d’où je venais et quel était le but de mon voyage. Je répondis que je venais de Belgique et que j’étais invité par le patriarcat de Moscou pour le concile.
« Attendez ! Votre visa n’est pas en règle. »
Il me fit attendre un moment, puis fit signe à un major qui se tenait à proximité et lui tendit mon visa et mon passeport, apparemment sans lui donner un seul mot d’explication. Le major prit mon passeport, s’écarta de nous en me tournant le dos (je ne voyais donc pas ce qu’il faisait), mais moins de trois minutes après, se retourna vers moi et dit. « Tout est en règle, mais venez au prochain guichet. »
Il me fit patienter encore à ce guichet, puis vint lui-même pour me remettre mon passeport. Le sens de ces manipulations m’était incompréhensible, car mon visa était parfaitement en règle.
« Vous êtes sans doute venu pour le concile ?, me demanda-t-il. Quels seront les candidats ? On dit que la majorité veut Pimène ? » — « Le métropolite Pimène, le corrigeai-je. Oui, la majorité voudrait que ce soit lui. » — « Et il y a d’autres candidats ? »
Comme j’avais honte de répondre que je craignais fort que le métropolite Pimène ne soit candidat unique, je bredouillai quelque chose d’indistinct. Mais j’étais heureux de voir que l’élection du patriarche intéressait autant la population russe. Quant aux raisons pour lesquelles le lieutenant avait jugé bon de contester la validité de mon visa, je ne les comprends pas. Était-ce de l’incompétence ? Était-ce suite à des instructions qu’il aurait reçues de ne pas me laisser entrer en URSS ? Toutes les autres formalités furent accomplies sans encombre. On ne fouilla pas nos bagages, nous n’eûmes qu’à remplir l’habituelle déclaration sur la quantité de devises en notre possession.
Quand nous eûmes passé les contrôles avec l’évêque Denys (qui, lui, n’avait eu aucun problème de passeport), nous fûmes accueillis par des représentants du patriarcat, employés du Département des relations extérieures, le père Vladimir Esipenko et le diacre André Iourtchenko. Nous apprîmes qu’en raison de l’afflux de personnes à l’occasion du concile, il était difficile au patriarcat de fournir à chaque évêque venant de l’étranger un accompagnateur particulier, comme il avait coutume de le faire. C’est pourquoi, le père Vladimir avait été désigné pour accompagner l’évêque Denys en même temps que moi-même, ce qui me réjouit fort, car cela me donnait une plus grande liberté de mouvements (81). Mon frère aîné Igor Alexandrovitch Krivochéine (82), qui vivait alors à Moscou, était aussi venu m’accueillir à l’aéroport. En compagnie du père Vladimir, de l’évêque Denys et de mon frère, nous nous rendîmes en voiture à l’hôtel Rossia. En chemin, nous apprîmes que plusieurs évêques, dont notre exarque le métropolite Antoine, étaient déjà arrivés à Moscou, mais que la majorité d’entre eux était encore en route.
Je ne vais pas décrire ici l’hôtel Rossia où je descendais pour la première fois. C’était un bâtiment grandiose par ses dimensions, avec des couloirs interminables et des « salles de banquet » impressionnantes, son ameublement se voulait à la pointe de la modernité. Mais comme dans tous les hôtels soviétiques, il y avait toujours quelque chose qui ne fonctionnait pas. soit l’électricité dans votre chambre, soit l’eau dans les robinets ou les toilettes. Mais le téléphone fonctionnait toujours parfaitement, et l’on pouvait appeler directement la ville, voire l’international.
De même qu’aux autres évêques, on m’avait attribué une chambre individuelle (les prêtres et les laïcs venus pour le Concile étaient logés en chambres doubles). Les VIP du Concile avaient été logées dans l’aile ouest, plus luxueuse. Quant aux invités de premier plan, comme le patriarche d’Alexandrie, la délégation américaine ou Willebrands (83) et Blake (84), ils logeaient à l’hôtel Sovietskaïa (l’ancien Iar, rénové et agrandi après la Révolution), qui était considéré comme l’hôtel le plus luxueux de Moscou. Comme on me l’expliqua plus tard, cette étrange répartition avait aussi été opérée à des fins d’isolement, pour ne pas donner aux « étrangers distingués » l’occasion de trop nombreux échanges avec les membres du Concile et pouvoir les contrôler spécialement.
À l’hôtel Rossia, aucun contrôle ne semblait être exercé et nous pouvions nous voir en toute liberté ou bavarder au téléphone.
Les premiers jours, alors que nous n’étions pas encore au complet, nous prenions nos repas dans une des salles communes du restaurant. Puis, on nous alloua une grande salle « de banquet ». Nous déjeunions vers trois heures de l’après-midi et prenions notre dîner tard, vers neuf heures du soir. Les premiers jours, la nourriture fut simple et nous n’eûmes pas droit au vin, mais lorsque nous passâmes à la salle de banquet, les mets devinrent plus recherchés et on nous servit du vin (de Roumanie ou de Bulgarie principalement). Dans l’hôtel, s’était installé un « État-major » du patriarcat (composé de collaborateurs du Département des relations extérieures), chargé de la coordination et de l’aide aux invités, etc. Sous la direction de l’archiprêtre Michel Syrtchine (85), il gérait notre répartition dans les chambres, les voitures dont nous disposions, le programme de la journée. J’avais rencontré l’archiprêtre peu de temps auparavant à Bruxelles, où il accompagnait l’archevêque Antoine de Minsk. L’archevêque Antoine m’en avait parlé comme de quelqu’un de « moins bien » que l’archiprêtre Michel Tourtchine (86), qui était son second accompagnateur. Cela se basait sur le fait que, quand l’archevêque Antoine était arrivé à Bruxelles, l’archiprêtre Syrtchine n’ait rien eu de plus pressé que de téléphoner à l’ambassade soviétique, puis d’y rendre compte de l’arrivée de la délégation et que, durant tout son séjour à Bruxelles, le comportement du père Syrtchine laissa penser qu’il travaillait pour les autorités soviétiques. Il était cependant un homme plein d’énergie, efficace, capable et qui me sembla plutôt sympathique ; il était tout à fait légitime qu’on lui ait confié une mission lourde et responsable au Concile.
On me communiqua son numéro de téléphone « secret » à « l’État-major » (il en avait un normal, qui sonnait occupé en permanence), ce qui me permettait de m’adresser à lui directement en cas de besoin, par exemple pour organiser certaines rencontres. Mais en règle générale, je m’adressais plutôt au père Vladimir Esipenko, mon accompagnateur.
Mon installation à l’hôtel et les formalités de passeport (comme d’habitude, on nous avait pris nos passeports) prirent tellement de temps que je ne pus me rendre, comme j’en avais eu l’intention, à l’église pour les vêpres de clôture de la période pascale et j’en fus contrarié. Je dus au lieu de cela dîner au restaurant de l’hôtel, où je rencontrai les quelques membres de l’assemblée épiscopale qui étaient déjà là, entre autres le métropolite Philarète de Kiev, l’archevêque Jonathan de Tambov (87) (ancien exarque en Amérique), l’évêque Bartholomée de Kichinev, l’évêque Théodose de Tchernovitz (88), l’évêque Sabbas de Pereïaslavl (89) et notre exarque, le métropolite Antoine. C’était agréable de revoir de vieilles connaissances, mais nous n’eûmes ce soir-là aucune conversation intéressante. Nous pûmes seulement évoquer quelques points importants. Le métropolite Antoine me dit que, le lendemain, il verrait le métropolite Nicodème, sur l’initiative de ce dernier, et qu’ils discuteraient de toutes les questions brûlantes telles que le vote à bulletins secrets, la candidature unique, les décrets de 1961. Mgr Antoine ajouta qu’il solliciterait un rendez-vous avec Kouroïedov pour discuter des mêmes thèmes, qu’il lui expliquerait l’impression désastreuse que produirait en Occident l’élection du patriarche par un vote à main levée et que cela ferait du tort, en fin de compte, au prestige du gouvernement soviétique lui-même. J’exprimai quelques doutes sur l’efficacité d’une conversation avec Kouroïedov. « Personnellement, je n’ai l’intention de rencontrer ni Kouroïedov, ni Makartsev pour discuter de ces sujets », ajoutai-je. Je demandai ensuite au métropolite Antoine son opinion sur ma lettre au métropolite Nicodème. Il répondit qu’il en approuvait entièrement le contenu et ajouta que plusieurs évêques d’URSS, dont l’archevêque Benjamin d’Irkoutsk (90), l’archevêque Paul de Novossibirsk, l’archevêque Léonide de Riga, l’archevêque Cassien de Kostroma (91) et l’évêque Michel d’Astrakhan (92) avaient écrit à la commission préconciliaire pour exprimer leur désaccord avec les dispositions de 1961 et exiger leur révision. « Manifestement, votre lettre leur a donné de l’espoir et du courage », ajouta Mgr Antoine.
Le père Vsévolod Schpiller, qui assistait à notre conversation, et réagissait vivement à ce que nous disions, me demanda. « Et avez-vous lu la lettre de l’archevêque Benjamin d’Irkoutsk ? » — « Bien sûr que non, répondis-je. D’où aurais-je pu la tenir ? Ce document est inconnu à l’étranger. » — « Demandez-la à la commission préconciliaire. Ils sont tenus de vous la communiquer, car c’est un document officiel. » — « Que dites-vous là ? C’est inutile, ils ne la donneront pas. Mais je vais essayer de me la procurer par d’autres moyens. »
Ensuite, le père Vsévolod raconta que tous les évêques qui avaient écrit contre les décrets de 1961 avaient été convoqués à Moscou par la commission préconciliaire, où on leur avait fermement déconseillé d’intervenir, lors du Concile, contre ces dispositions, qui « découlent de la législation soviétique relative aux cultes » ; toute opposition serait considérée comme un « acte antisoviétique. »
Au Conseil aux affaires religieuses, on expliqua la même chose aux évêques. « Celui qui s’opposera aux dispositions relatives aux paroisses se cassera lui-même une jambe », déclara Makartsev (d’après le père Schpiller).
C’est avec l’archevêque Paul que la conversation fut la plus sérieuse, car, outre ses objections contre les décrets de 1961, il avait « constitué un dossier contre le métropolite Pimène » (à propos de l’instruction donnée par celui-ci de refuser la communion aux fidèles, dans les régions atteintes du choléra). Et comme l’archevêque Paul tenait fermement sur ses positions et avait l’intention d’intervenir au Concile, on le prévint. « Si c’est ainsi, vous n’arriverez pas au Concile ! Nous avons reçu des plaintes contre vous pour comportement immoral, tant de la part de personnalités civiles qu’ecclésiastiques… et l’archevêque Michel de Kazan est envoyé pour inspecter votre diocèse. Si cette inspection confirme les accusations portées contre vous, vous serez démis de vos fonctions et ne pourrez participer au Concile. »
D’après le père Vsévolod, après cette conversation, l’archevêque Paul était rentré chez lui, à Novossibirsk, physiquement et moralement brisé (il était très fragile). Actuellement, l’"inspection" et les vérifications, qui ont eu lieu en l’absence (!) de l’archevêque Paul, sont achevées, mais on n’en connait pas le résultat.
J’interrogeai ensuite le père Vsévolod au sujet de l’archevêque Hermogène (anciennement évêque de Kalouga). Il me répondit que l’archevêque Hermogène était évidemment opposé aux décrets de 1961 et à l’élection du patriarche par un vote à main levée, qu’il avait également écrit en ce sens à la commission préconciliaire. En outre, il était venu à deux reprises à Moscou, il avait été reçu par le métropolite Pimène et avait longuement discuté avec lui. Pimène l’avait même invité à déjeuner, il semblait qu’entre eux s’étaient établies des relations cordiales. Mais ensuite, cela s’était dégradé, et l’archevêque Hermogène a cessé de se rendre au patriarcat.
« Peut-être que le métropolite Pimène a subi des pressions du Conseil aux affaires religieuses, peut-être qu’on a exigé qu’il cesse ces relations avec l’archevêque Hermogène ? », demandai-je au père Vsévolod. — « C’est difficile à dire, me répondit le père Vsévolod. Il se fait qu’au plus haut niveau des sphères gouvernementales, coexistent deux tendances. La première est la plus rigide. Ses représentants estiment qu’il faut limiter et restreindre l’action de l’Église de toutes les manières possibles. L’autre tendance est plus souple. Ses représentants considèrent que, puisque l’existence de l’Église dans le système soviétique est un fait établi, il faut en tirer les conséquences et cesser les pressions inutiles à son égard, car cela n’entraîne que des tensions supplémentaires. » — « Il me semble qu’il faut donner à l’Église une reconnaissance juridique réelle, et non fictive, dans les conditions de la Russie contemporaine », dis-je. — « Cette politique à double face et ces désaccords se sont exprimés tant à l’égard du Concile qu’à l’égard de l’élection du patriarche proprement dite. Kouroïedov personnellement est un partisan de la tendance dure. Il a insisté sur le vote à main levée et la ratification des décrets de 1961, ainsi que sur le fait que le Concile devait se dérouler strictement en conformité avec le programme prévu. » — « Mais il y a eu des objections ? », demandai-je. — « Oui, quelques voix se sont élevées, mais bien peu. On a dit que cela engendrerait des protestations et ne passerait tout simplement pas. Beaucoup se sont référés à votre lettre, qu’on a pu lire en samizdat. Mais Kouroïedov a répondu qu’il se portait personnellement garant du fait qu’il ne se passerait rien, que tout le monde se tairait et que personne n’interviendrait », acheva tristement le père Vsévolod.
Pour achever mon récit de cette conversation à table, j’ajouterai que mon frère Igor, qui dînait avec nous, m’apprit que Krasnov-Lévitine (93) avait été condamné à trois ans de détention, qu’il avait eu une attitude très digne au tribunal et que les fidèles de Narofominsk avaient intenté un procès au journal local, mais l’avaient perdu. C’était Krasnov qui avait été leur défenseur.
- Serge Reingardt (1932-2005), diacre de l’église orthodoxe russe de Saint-Nicolas à Bruxelles.
- Vladimir Evguenievitch Drachoussoff (1917-2003), laïc orthodoxe russe, marguillier de l’église russe de Saint-Nicolas à Bruxelles, membre du conseil diocésain de l’archevêché orthodoxe russe de Belgique.
- Je veux d’ailleurs ici anticiper sur mon récit pour préciser que le père Vladimir se révéla être le meilleur accompagnateur que j’aie eu durant toutes mes dernières visites, il ne me limitait pas dans mes mouvements, quand je lui disais que je n’avais pas besoin de lui à tel ou tel moment et qu’il était libre, il en était heureux (A. B.).
- Voir « Chapitre 1. Les journées de février 1917 à Petrograd », n. 9.
- Mgr Johannes Willebrands (1909-2006), prélat catholique néerlandais et personnalité du mouvement œcuménique. Président du Secrétariat pontifical pour l’unité des chrétiens (1969-1975), cardinal (1969), archevêque d’Utrecht (1975-1983).
- Pasteur Eugene Carson Blake (1906-1985), américain, secrétaire général du COE (1966-1972).
- Père Michel Syrtchine, prêtre orthodoxe russe, collaborateur du Département des relations extérieures du patriarcat de Moscou.
- Père Michel Tourtchine (1938-1997), prêtre orthodoxe russe, collaborateur du Département des relations extérieures du patriarcat de Moscou.
- Mgr Jonathan (Kopolovitch, 1912-1990), prélat orthodoxe russe. Évêque (1965), archevêque et exarque d’Amérique (1967), archevêque de Tambov (1970), archevêque de Kichinev et Moldavie (1972).
- Mgr Théodose (Protsiouk, né en 1927), prélat orthodoxe russe. Évêque (1962), évêque de Tchernovtsy (1967), évêque de Smolensk et de Viazma (1972), archevêque (1972), métropolite d’Omsk (1997).
- Mgr Sabbas (Babinets, 1926-1992), prélat orthodoxe russe. Évêque de Pereïaslavl-Khmelnitski (1969), évêque de Tchernovtsy (1972), de Poltava (1985), archevêque (1990).
- Mgr Benjamin (Novitski, 1900-1976), prélat et confesseur de la foi orthodoxe russe. Évêque (1941), déporté (1943-1955), archevêque d’Irkoutsk (1958), archevêque de Tcheboksary et Tchouvachie (1973).
- Mgr Cassien (Iaroslavski, 1899-1990), prélat orthodoxe russe. Évêque (1961), archevêque de Novossibirsk (1963), archevêque de Kostroma (1964).
- Mgr Michel (Moudiouguine, 1912-2000), prélat orthodoxe russe. Évêque (1966) et recteur des écoles de théologie de Leningrad, évêque d’Astrakhan (1968), archevêque (1972), archevêque de Vologda (1979).
- Anatole Emmanouilovitch Lévitine, dit Krasnov (1915-1991), laïc orthodoxe russe, écrivain et publiciste (historien de l’Église, défenseur des droits de l’homme et des droits des croyants). Déporté (1949-1956) et ré-arrêté à plusieurs reprises (1969-1970, 1971-1973), expulsé d’URSS (1974).

Dans le courant de l’hiver 1970-1971 des informations concernant la préparation du Concile et l’élection du nouveau patriarche continuèrent à affluer à Bruxelles où je me trouvais. Ces informations, que je suivais avec intérêt, me parvenaient en partie au gré des visites à Bruxelles de différents évêques du patriarcat de Moscou et en partie par les lettres que je recevais de mes proches et de mes amis.
Ainsi, au début du mois de février, lors d’une visite à Bruxelles de l’archevêque Antoine de Minsk, nous apprîmes que des réunions de la commission préconciliaire se tenaient à Moscou sous la présidence du métropolite Pimène et que plusieurs opinions y avaient été exprimées sur les modalités de vote. « Mais rien de définitif n’a encore été décidé », nous dit l’archevêque Antoine. D’après lui, certains étaient partisans d’élections selon le modèle du concile de 1917, où l’on avait tiré au sort parmi trois candidats, eux-mêmes préalablement élus à bulletins secrets, d’autres étaient favorables à un scrutin majoritaire, que ce soit à bulletins secrets ou à main levée (les partisans de cette dernière solution semblaient l’emporter).
Quant à moi, ce qui m’intéressait, c’était la personnalité de l’archevêque Antoine. Je n’avais pas renoncé à ma quête d’un outsider qui viendrait ajouter sa candidature à celle des deux candidats officiels et je dois dire que Mgr Antoine me fit fort bonne impression cette fois-là. Je le connaissais déjà d’Uppsala, où nous avions été voisins de chambre lors de la IVe assemblée du COE en 1968 (43) et où nous avions souvent eu l’occasion de parler. C’était un homme cultivé, érudit (sa bibliothèque personnelle comportait environ sept mille volumes), aimable, à la fois observateur et plein de bon sens mais, surtout, on ne sentait en lui rien de « soviétique » ; c’était simplement un vrai russe, un moscovite. Toutefois, dans quelle mesure ces qualités convenaient-elles pour les fonctions de patriarche à ce moment précis de l’histoire de l’Église russe ? Avait-il pour cela la résistance et la force nécessaires ? Et était-il souhaité par d’autres ?
Lui-même m’avait précisé, à Uppsala, son point de vue. « J’apprécie beaucoup Mgr Hermogène, mais c’est un utopiste. Il écrit à Podgornyï (44), à Kossyguine (45), à Kouroïedov, pour démontrer que la Constitution et les lois soviétiques en matière de cultes sont violées au détriment de l’Église. Mais il ne parvient pas à comprendre qu’à défaut d’un changement radical et fondamental du régime en URSS (ce qu’on peut difficilement attendre), il ne peut y avoir aucune amélioration significative de la situation de l’Église. Nos dirigeants comprennent parfaitement eux-mêmes qu’ils violent les lois, mais ils ne sont pas disposés à modifier leur attitude envers l’Église. Les protestations de l’archevêque Hermogène ne font que les irriter, et n’apportent aucun avantage à l’Église, que du contraire ! Personnellement, j’agis autrement. je m’efforce de m’entendre avec les préposés locaux et, sans nécessité particulière, je ne me plains pas d’eux au Conseil aux affaires religieuses à Moscou. Sinon, cela entraîne plus de nuisances que d’avantages. Il faut agir petit à petit et, sur place, obtenir de petites concessions, qui s’avèrent en définitive plus importantes que les « déclarations et plaintes grandiloquentes »… J’agis de la sorte et, croyez-moi, c’est ainsi que j’ai réussi ces dernières années à ouvrir cinq paroisses. »
Il était difficile de contester ce raisonnement de Mgr Antoine, mais mes relations à Moscou le qualifiaient d’homme faible, indécis, tremblant devant les préposés ; le père Vsévolod Schpiller, notamment, ajoutait. « Nonobstant toutes ses qualités d’esprit, sa culture et son « non-soviétisme », il a un grand défaut. c’est un carriériste invétéré ! » Le père Vsévolod disait cela avec peine, car il avait été lié d’amitié avec Mgr Antoine durant de longues années, et l’avait porté aux nues de toutes les façons possibles, allant jusqu’à le qualifier d’"embellissement" de l’Église russe.
Plus tard, je me mis à observer moi-même chez Mgr Antoine, en dépit de toute son ouverture à l’égard de l’Occident et de sa culture, une certaine incompréhension des problèmes de l’orthodoxie en Europe. Ainsi, par exemple, nos théologiens parisiens, comme Nicolas Lossky (46) ou Ouspensky (47), n’étaient, pour lui, que des « érudits-fanatiques », comme il les avait qualifiés, en racontant en privé à Moscou l’un de ses voyages à l’étranger. Je me souviens que cette expression m’avait blessé. De même, il manifestait une incompréhension et une antipathie avérées (cela, je le compris plus tard) à l’égard de notre Mission orthodoxe belge (48), mais on ne peut le lui reprocher, car il n’était tout de même pas un homme « libre ». Mais alors, après sa visite à Bruxelles, je tendais à le voir comme le meilleur candidat au trône patriarcal et considérais sa personnalité comme plus indiquée que celle de Nicodème, et même de Pimène. Il n’était certes pas un homme « libre », mais c’était un proche, on pouvait parler aisément avec lui, son aménité et sa grande culture étaient fort attractives. J’ajoute qu’il était monarchiste de sentiment et manifestait du respect à la mémoire de l’empereur Nicolas II (« le Souverain », comme il disait). Dans la personnalité de Mgr Antoine, se ressentait cependant un fort dédoublement, pour ne pas dire de l’opportunisme. Il s’accommodait de l’existence du système soviétique, n’imaginait aucune forme d’opposition à celui-ci et était prêt au nom du bien de l’Église à accepter beaucoup de choses (mais pas tout, à la différence de certains autres).
Le hiérarque suivant d’URSS, que je rencontrai à cette époque, fut le métropolite Philarète de Kiev et Galicie. En mars 1971, il était de passage à Bruxelles. Il n’avait pas de visa de transit pour la Belgique et, trois heures durant, on le retint à l’aéroport sans le laisser se rendre en ville. Je profitai de ce délai pour une conversation approfondie avec lui au sujet des affaires ecclésiales. Nous nous installâmes dans un canapé, à l’écart des autres, dans les locaux de la douane aéroportuaire. Le métropolite Philarète m’apprit une nouvelle désagréable. l’élection du patriarche se tiendrait à main levée et, probablement, il n’y aurait qu’un seul candidat. le métropolite Pimène. Il me dit que c’était là la décision de la commission préconciliaire. Cette nouvelle souleva en moi une tempête d’émotions ; naturellement, je me mis à protester énergiquement et à dire au métropolite Philarète qu’une telle élection serait contestée par tous les hommes libres, que pour l’opinion publique en Occident un tel vote « à main levée » était inadmissible, et ce, sans parler des commentaires des adversaires de l’Église russe. Cette question est personnelle et fondamentale, car pour des élections libres, un vote secret est indispensable. Il faut dire que toute mon argumentation semblait, pour le métropolite Philarète, peu compréhensible.
Ce n’était pas un homme stupide, il avait une compréhension des choses claire mais limitée, sans véritable culture, en un mot, c’était un produit typique du système soviétique. Étonnamment, ces qualités ne l’empêchaient pas de s’entendre avec des gens en Occident, et même d’être particulièrement aimé et populaire dans notre paroisse patriarcale à Vienne, dont les paroissiens étaient pourtant, pour l’essentiel, des aristocrates de l’ancienne émigration. Il avait servi là trois ans en tant qu’évêque diocésain.
À mes objections en faveur d’un vote secret, il répondit. « Mais qu’est-ce qu’ils comprennent, en Occident ? Qui se soucie de leur opinion ? Ils sont de toute façon toujours contre nous ! » — « Peut-être, mais c’est justement pourquoi il ne faut pas leur donner de prétexte pour attaquer l’Église russe. Il ne faut pas se montrer esclaves du système [soviétique] », rétorquai-je.
Mais je compris que les nuances d’une procédure électorale, avec un vote secret et le choix entre plusieurs candidats, lui étaient simplement inconnues, à lui qui était habitué au système soviétique d’élections. Ensuite, notre conversation dévia vers la question des résolutions synodales de 1961 (49), en conséquence desquelles, on le sait, toute l’autorité dans les paroisses avait été de facto remise à la « vingtaine (50) » et à son organe exécutif. Qui plus est, le recteur et le clergé n’étaient pas considérés comme des membres de la paroisse et ne pouvaient être membres de cette « vingtaine », ni de l’organe administratif, qui pouvait les nommer ou les licencier selon son bon vouloir. Certes, il fallait la « bénédiction » (autrement dit, l’accord de l’évêque) pour la nomination [du clergé], mais il n’en fallait pas pour son licenciement ! La gestion administrative, économique et financière de la vie de la paroisse était tout entière aux mains de l’organe administratif et de la vingtaine (sans que le recteur ou l’évêque puissent intervenir).
La vingtaine pouvait même décider si l’église paroissiale pouvait continuer à fonctionner ou s’il fallait la fermer pour cause d’inutilité. « Nous n’avons pas besoin d’église ici » ; combien de paroisses avaient été fermées de la sorte en URSS ! Selon ces résolutions de 1961, ni l’évêque, ni le recteur ni les paroissiens, ni les uns et les autres ensemble n’avaient le droit de se mêler de ces questions.
Je demandai au métropolite Philarète si la question des résolutions de 1961 serait évoquée et sérieusement discutée au Concile.
« Oui, me dit-il, et ces résolutions seront approuvées ! »
Je n’en crus pas mes oreilles, me mis à protester, mais le métropolite Philarète déclara. « Dans tous les pays du monde, la réglementation religieuse est toujours en accord avec la législation civile et ne peut la contredire. Chez vous en Belgique, les statuts de votre archevêché sont aussi conformes à la législation belge », insista-t-il.
— « Sans doute, répondis-je, et ils sont même confirmés par un arrêté (décret) royal (51). Mais la différence avec l’URSS est énorme. la législation belge permet aux Églises et organisations religieuses une complète liberté d’organisation interne, conformément à leurs principes religieux. La législation belge ne contient rien qui porte atteinte à l’organisation canonique de notre Église orthodoxe. Bien plus, si nous le voulions, nous pourrions même ne pas nous faire enregistrer et ne pas organiser officiellement notre vie religieuse. Mais ce ne serait pas avantageux, du point de vue des droits civils. La législation soviétique relative aux cultes, d’où découlent les résolutions de 1961, elle, enfreint les fondements de l’organisation canonique de l’Église orthodoxe ! »
Durant notre conversation, je compris soudain que le métropolite Philarète était incapable de saisir les finesses juridiques et la différence entre les législations. Qui plus est, il me regardait avec méfiance et l’on voyait à son expression qu’il ne me croyait guère, comme si je lui mentais.
« Les résolutions de la commission préconciliaire sont-elles définitives ou pourront-elles être révisées par le Concile ? », demandai-je. — « Oui, bien sûr, si le Concile souhaite les revoir, il pourra le faire, mais pourquoi ? », répondit avec indécision le métropolite Philarète. — « Et comment comprendre cette « candidature unique » ? Sera-t-il vraiment interdit de voter pour quelqu’un d’autre ? », m’intéressai-je. — « Si quelqu’un le souhaite, il pourra le faire… mais s’il y aura une candidature unique, il est peu probable que quelqu’un agisse ainsi, pour ne pas briser l’unité de l’Église. »
Ma conversation avec le métropolite Philarète me laissa une impression amère et désagréable. Je continuai à espérer que la commission préconciliaire n’avait pas encore adopté ses résolutions. Mais mes espoirs furent déçus, car je reçus rapidement des documents officiels, et une lettre du métropolite Pimène — locum tenens patriarcal — datée du 16 mars, me communiquait ce qui suit (je ne reproduis pas la lettre dans son intégralité, mais seulement les passages les plus importants) :
Le concile local, conformément aux décisions du Saint-Synode du 25 juin 1970 et de la commission préconciliaire du 10 novembre 1970, se tiendra en la Laure de la Trinité-Saint-Serge, du 30 mai au 2 juin 1971. Conformément au programme annexé à la présente, toutes les solennités s’achèveront le 6 juin.
En informant Votre Éminence, nous vous invitons fraternellement, par la présente, ainsi qu’un clerc de Belgique et un laïc des Pays-Bas (ou un clerc des Pays-Bas et un laïc de Belgique) (52) à vous rendre à Moscou pour participer au concile local. Pour information, nous vous signalons que l’évêque Denys de Rotterdam (53) a également été invité à participer au Concile. Nous joignons à la présente une information au sujet des réunions tenues par la commission préconciliaire.
Dans les documents annexes, il était indiqué que la commission préconciliaire avait, lors de sa réunion du 10 février, adopté la résolution suivante :
Considérant l’ancienne pratique de l’Église orthodoxe russe, et attendu que, lors de sa réunion du 10 novembre 1970, la commission préconciliaire a résolu de recommander aux groupes de travail de s’inspirer, dans le cadre de la préparation du concile de 1971, des pratiques et de l’expérience du concile de 1945, estimer que la procédure de l’élection du patriarche de Moscou et de toutes les Russies au concile local de 1971 devait avoir lieu à main levée, selon la forme adoptée au concile de 1945.
Quelques jours après, je reçus un nouveau document, signé par le métropolite Alexis de Tallin et d’Estonie, vice-président de la commission préconciliaire préparatoire.
Lors de sa réunion ordinaire du 24 mars 1971, la commission préparatoire au concile local de l’Église orthodoxe russe a adopté les résolutions suivantes :
1. Des réunions du clergé et des fidèles doivent se tenir, après les fêtes de Pâques, dans tous les diocèses de l’Église orthodoxe russe, en vue de l’élection des membres du concile local et de la discussion d’autres questions.
Les comptes rendus de ces réunions avec les noms des représentants du clergé et des fidèles élus membres du Concile doivent être adressés à la commission préconciliaire au plus tard le 10 mai de cette année.
2. Le concile local sera précédé d’une assemblée épiscopale qui discutera des questions liées à la tenue du concile local.
Ensuite, l’on indiquait que la commission préconciliaire avait pris connaissance de l’information suivante :
1. De nombreux évêques diocésains se sont adressés à la commission préconciliaire en proposant un candidat unique à l’élection de primat de notre Église en la personne de Son Éminence le métropolite Pimène de Kroutitsy et Kolomna, locum tenens patriarcal. Tous ceux qui ont soumis cette demande sont fermement convaincus qu’en tant que plus proche collaborateur de Sa Sainteté le défunt patriarche Alexis, il sera un digne successeur de celui-ci et un continuateur de son œuvre au trône primatial.
2. De telles propositions écrites ont été reçues par la commission préconciliaire de la part de membres permanents du Saint-Synode. leurs Éminences les métropolites Nicodème de Leningrad, Philarète de Kiev et Alexis de Tallin ;
de la part des métropolites Palladius d’Orel (54), Joseph d’Alma-Ata et Jean d’Iaroslavl (55);
de la part des archevêques Job d’Oufa (56), Palladius de Jitomir (57), Jean de Pskov (58), Michel de Kazan (59), Innocent de Kalinine (60), Michel de Voronège (61), Joseph d’Ivano-Frankovsk (62), Flavien de Gorki (63), Serge d’Odessa (64), Séraphim de Koursk (65), Antoine de Vilnius (66) ;
et de la part des évêques Léonce d’Orenbourg (67), Nicolas de Vladimir (68), Bartholomée de Kichinev (69), Vladimir de Tchernigov (70), Gédéon de Smolensk (71), Platon de Samarkand (72).
3. La commission préconciliaire reçoit, de la part de nombreux évêques, membres du clergé, organes exécutifs et simples fidèles de différents diocèses de notre patrie, des lettres argumentées, soutenant les résolutions du concile épiscopal de 1961 et proposant de les ratifier au concile local de 1971. Et de telles propositions à ce sujet continuent à arriver.
Si je reproduis, ici, ces deux lettres de manière aussi détaillée, c’est parce que, dans le Journal du patriarcat de Moscou, les résolutions de la commission préconciliaire des 10 février et 24 mars sont à ce point résumées qu’il est impossible de comprendre ce qui a été réellement decide (73). Dans le compte rendu de la réunion du 10 février, le paragraphe relatif au vote à main levée a purement et simplement été omis. Manifestement, l’on ne souhaitait pas que le contenu de ces résolutions soit largement connu à l’avance.
La première information, relative au vote à main levée, m’a profondément affligé, mais la deuxième, celle portant sur une « candidature unique » et l’approbation des décrets illégaux de 1961 au sujet des paroisses, m’a stupéfait et rempli d’indignation. C’est comme si une bombe avait explosé sous mes pieds ou qu’on m’avait donné un soufflet. Jusque là, je m’étais tu et n’étais pas intervenu dans le travail de la commission préconciliaire, étant donné que je n’en étais pas membre, et que nul ne me demandait mon avis. Mais là, je décidai de m’exprimer ouvertement et par écrit, d’autant qu’à en croire ces « déclarations », de nombreux hiérarques, clercs et fidèles, s’étaient déjà exprimés et avaient unanimement soutenu le vote à main levée et la candidature unique. J’étais indigné contre ces hiérarques, les considérant, sinon comme des traîtres, du moins comme des conformistes, et me réjouissais de ne pas rencontrer parmi les signataires les noms de personnes que je respectais et appréciais, comme Antoine de Minsk, Paul de Novossibirsk, Léonide de Riga, etc.
Quoi qu’il en soit, je décidai d’adresser au métropolite Nicodème une lettre au contenu suivant :
À Son Éminence
Monseigneur Nicodème,
Métropolite de Léningrad et Novgorod,
Président du Département des relations extérieures du patriarcat de Moscou
Bruxelles, le 19 avril 1971.
Le Christ est ressuscité (74) !
Je vous informe que j’ai bien reçu la lettre de Son Éminence le métropolite Pimène de Kroutisty et Kolomna, locum tenens patriarcal, datée du 6 mars 1971 (n° 422), à laquelle était annexée une information au sujet du travail de la commission préconciliaire préparatoire.
Aujourd’hui, j’ai reçu en complément une lettre de Mgr Juvénal, datée du 12 avril 1971 (n° 601), contenant des informations supplémentaires au sujet de la réunion du 24 mars de ladite commission, sous la signature de Son Éminence le métropolite Alexis.
À propos des éléments communiqués dans le cadre de ces informations, je me dois de vous exposer mon point de vue.
1. Je salue la décision de tenir une assemblée épiscopale avant l’ouverture du concile local. J’espère fermement qu’y participeront tous les évêques diocésains de l’Église orthodoxe russe, y compris ceux qui résident à l’étranger.
Je demande que les invitations à l’assemblée épiscopale soient envoyées à temps en vue d’obtenir les visas nécessaires. De même, je demande que la date précise du début des travaux de l’assemblée nous soit communiquée, dès qu’elle sera connue.
2. Je dois dire que je ne puis marquer mon accord sur la résolution adoptée par la commission préconciliaire au sujet de l’élection du patriarche par vote « à main levée », car ce vote est par essence personnel, et que seul un vote à bulletins secrets peut garantir une réelle liberté de choix. Seul un vote à bulletins secrets confèrera à l’élection du patriarche un caractère irréprochable. Les arguments avancés en vue d’un vote à main levée ne me paraissent pas convaincants. Je n’estime pas devoir les développer en détail maintenant, étant donné que la résolution adoptée par la commission préconciliaire au sujet d’un vote à main levée ne constitue qu’une proposition, que le concile local, en tant qu’autorité administrative et spirituelle suprême de l’Église russe, pourra adopter, rejeter ou modifier.
Il appartient au concile local de se prononcer en dernière instance sur le type d’élection du patriarche (vote à main levée ou à bulletins secrets).
3. Encore moins acceptable m’apparaît la proposition, faite par un groupe d’évêques, de ne proposer qu’une seule candidature au trône patriarcal en la personne du métropolite Pimène. Nous respectons profondément et aimons sincèrement Son Éminence le locum tenens, apprécions hautement ses mérites devant l’Église russe, le considérons comme un digne candidat au trône patriarcal, mais limiter l’élection du prochain patriarche à une seule personnalité est, pour moi, parfaitement intolérable. L’élection se transformera en une pure formalité, et il ne servira à rien de convoquer le Concile pour cette fiction. Bien plus, je considère que ce système de candidature unique est blessant et humiliant, tant pour les membres du Concile (obligés de voter contre leur propre volonté, s’ils ne sont pas d’accord avec la candidature proposée) que pour le candidat lui-même. Car il ne serait pas élu en fonction de ses qualités propres, mais en raison du fait qu’il sera impossible de voter pour quelqu’un d’autre.
4. On ne peut que saluer le fait que les décisions de ce qu’on appelle le « concile épiscopal » de 1961 soient soumises à l’examen du prochain concile local. Mais pas seulement dans le sens de leur « soutien » et « confirmation », comme le proposent certains. Il faut, au contraire, les réexaminer d’un œil critique, les corriger et même les annuler partiellement, afin de les mettre en accord avec l’ordre canonique de l’Église orthodoxe russe et les exigences de la vie de l’Église. Je me permets de rappeler que l’obligation d’examiner les dispositions de 1961 au prochain concile local avait été reconnue par les participants mêmes de l’assemblée de 1961.
5. Enfin, le Concile doit réexaminer la décision du Saint-Synode du 16 décembre 1969 qui permet d’accorder les sacrements de l’Église orthodoxe (et notamment celui de la sainte communion) aux catholiques-romains. Par son ambiguïté, elle a créé de nombreuses confusions dans l’esprit des fidèles orthodoxes et a permis aux autres Églises autocéphales d’attaquer violemment l’Église orthodoxe russe, ce qui a grandement affecté son bon renom.
6. C’est pourquoi, j’estime indispensable de réexaminer et de préciser, au prochain concile local, cette décision synodale, en vue de préserver le pureté de l’orthodoxie et d’éviter à notre Église les attaques de ses adversaires.
Voilà, en résumé, ce que j’ai considéré de mon devoir épiscopal d’écrire à Votre Éminence en réponse aux documents d’informations reçus du Département des relations extérieures à propos du prochain concile local. Je vous demande de faire part des idées, points de vue et convictions que j’ai exprimés dans cette lettre aux membres de la commission préparatoire et aux membres du Saint-Synode, dont Son Éminence le locum tenens patriarcal au premier chef. Avec l’aide de Dieu, je compte m’en tenir à ces convictions lors du Concile également.
En demandant vos saintes et fraternelles prières, je vous assure de mon affection dans le Seigneur ressuscité,
Basile, archevêque
de Bruxelles et de Belgique
Dans ma lettre, j’avais demandé au métropolite Nicodème d’en porter le contenu à la connaissance du métropolite Pimène et des membres de la commission préconciliaire. Néanmoins, sachant que de telles lettres étaient souvent arrêtées au Département des relations extérieures et n’allaient pas plus loin, j’en envoyai des copies au locum tenens patriarcal, aux archevêques Antoine de Minsk, Paul de Novossibirsk, Léonide de Riga et Pimène de Saratov (75). Bien que j’aie envoyé toutes ces lettres en recommandé, je ne reçus aucune réponse écrite ; au Concile, cependant, j’appris que tous les destinataires les avaient reçues. Je considérai également de mon devoir d’adresser copie de ma lettre à notre exarque le métropolite Antoine (76), à l’évêque Pierre de Chersonèse (77) et à l’évêque Denys de Rotterdam. Sachant, en outre, que des représentants de l’Église orthodoxe d’Amérique seront présents au Concile, j’en envoyai également une copie à l’archevêque Jean (Schakhowskoy) de San-Francisco (78). De tous ceux qui résidaient en Occident, je reçus des réponses qui approuvaient et soutenaient ma lettre au métropolite Nicodème.
- Assemblée générale du Conseil œcuménique des Églises, Uppsala (Suède), 4-19 juillet 1968.
- Nicolas Victorovitch Podgornyi (1903-1983), apparatchik soviétique, président du Présidium du Soviet suprême de l’URSS (chef d’État nominal) (1965-77).
- Alexis Nicolaïevitch Kossygine (1904-1980), apparatchik soviétique, premier ministre d’URSS (1964-80).
- Nicolas Lossky (né en 1929), prêtre et théologien orthodoxe russe à Paris. Professeur à l’université de Paris X-Nanterre et à l’Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge de Paris.
- Léonide Ouspensky (1902-1987), laïc orthodoxe russe à Paris, iconographe et théologien de l’icône renommé.
- Voir Père Serge MODEL, « Une page méconnue de l’histoire de l’orthodoxie en Occident. la Mission orthodoxe belge (1963-1987) », Irénikon, revue des moines de Chevetogne, op. cit.
- Modifications apportées au Règlement de 1945 par l’assemblée épiscopale de juillet 1961 (qui approuva les résolutions du Saint-Synode à ce sujet). Texte français dans N. STRUVE, Les Chrétiens en URSS, op. cit., p. 388-390.
- Vingtaine de laïcs, nommés sous le contrôle des autorités soviétiques, qui constitue le conseil paroissial et prend toutes les décisions relatives à la gestion de la paroisse, le prêtre n’ayant d’autre possibilité qu’obéir à ces décisions.
- Voir « Chapitre 1. Le métropolite Nicolas (Iarouchevitch) », n. 66.
- Finalement, ce seront un clerc et un laïc de Belgique qui accompagneront Mgr Basile au concile (NdR).
- Mgr Denys (Loukine, 1911-1976), prélat orthodoxe russe aux Pays-Bas. Évêque de Rotterdam, auxiliaire de l’archevêque Basile de Bruxelles (1966-72).
- Mgr Palladius (Cherstennikov, 1895-1976), prélat orthodoxe russe. Évêque (1930), archevêque (1947), archevêque d’Orel et Briansk (1963), métropolite (1968).
- Mgr Jean (Wenland, 1909-1989), prélat orthodoxe russe. Évêque (1959), archevêque (1961), métropolite (1963), métropolite de Iaroslavl et Rostov.
- Voir « Chapitre 1. Le métropolite Nicolas (Iarouchevitch) », n. 62.
- Mgr Palladius (Kaminski, 1896-1978), prélat orthodoxe russe. Évêque (1947), archevêque (1956), archevêque de Jitomir (1968).
- Mgr Jean (Razoumov, 1898-1990), prélat orthodoxe russe. Évêque (1953), évêque de Pskov (1954), archevêque (1962), métropolite (1972).
- Mgr Michel (Voskressenski, 1896-1976), prélat orthodoxe russe. Évêque (1953), évêque de Kazan (1960), archevêque (1963), archevêque d’Oufa (1967).
- Mgr Innocent (Leoferov, 1890-1971), prélat orthodoxe russe. Évêque (1953), archevêque (1958), archevêque de Kalinine et Kachine (1960).
- Voir « Chapitre 1. Le métropolite Nicolas (Iarouchevitch) », n. 32.
- Mgr Joseph (Savrach, 1904-1984), prélat orthodoxe russe. Évêque d’Ivano-Frankovsk (1957), archevêque (1965).
- Mgr Flavien (Dimitriiouk, 1894-1977), prélat orthodoxe russe. Évêque (1958), archevêque de Gorki et Arzamas (1967).
- Mgr Serge (Petrov, 1924-1990), prélat orthodoxe russe. Évêque (1960), archevêque (1963) archevêque d’Odessa (1965), métropolite (1971).
- Voir « Chapitre 2. Le métropolite Nicodème (Rotov) », n. 89.
- Mgr Antoine (Varjansky, 1890-1971), prélat orthodoxe russe. Évêque de Vilnius et de Lituanie (1963), archevêque (1963).
- Mgr Léonce (Bondar, 1913-1971), prélat orthodoxe russe. Évêque (1956), évêque d’Orenbourg (1963), archevêque (1971).
- Mgr Nicolas (Koutiepov, 1924-2001), prélat orthodoxe russe. Évêque (1961), évêque de Vladimir (1970), archevêque (1972), métropolite (1991).
- Mgr Bartholomée (Gondarovski, 1927-1988), prélat orthodoxe russe. Évêque (1963), évêque de Kichinev et Moldavie (1969), archevêque de Tachkent et d’Asie centrale (1973).
- Mgr Vladimir (Sabodan, né en 1935), prélat orthodoxe russe. Évêque (1968), évêque de Tchernigov (1969), archevêque (1973), métropolite de Kiev, primat de l’Église orthodoxe d’Ukraine (1992).
- Mgr Gédéon (Dokounine, 1929-2003), prélat orthodoxe russe. Évêque de Smolensk (1967), archevêque (1977), métropolite (1987).
- Mgr Platon (Lobankov, 1927-1975), prélat orthodoxe russe. Évêque (1970) évêque de Samarkand (1971), de Voronège (1972).
- Journal du patriarcat de Moscou, n° 3 (1971), p. 1, 4.
- Voir « Chapitre 1. Le métropolite Nicolas (Iarouchevitch) », n. 77.
- Voir « Chapitre 1. Le métropolite Nicolas (Iarouchevitch) », n. 50.
- Voir « Chapitre 1. Le métropolite Nicolas (Iarouchevitch) », n. 40.
- Voir « Chapitre 2. Le métropolite Nicodème (Rotov) », n. 42.
- Mgr Jean (Schakhowskoy, 1902-1989), prélat orthodoxe d’origine russe et écrivain religieux. Évêque aux États-Unis (1950), évêque de San-Francisco et d’Amérique de l’Ouest (1950), archevêque (1961).

À la mort de Sa Sainteté le patriarche Alexis (Simansky) (1), le 17 avril 1970, la question de sa succession au trône patriarcal occupa tout naturellement la première place dans les pensées et les sentiments de tous ceux qui, que ce soit en Russie ou en Occident, se sentaient concernés par la vie de l’Église orthodoxe russe.
En Occident, et tout particulièrement chez les karlovtsiens (2) et les catholiques-romains, on était convaincu que le métropolite Nicodème (3) allait être élu patriarche. Les catholiques en étaient persuadés parce qu’ils connaissaient bien le métropolite Nicodème — il était venu plusieurs fois au Vatican —, et qu’ils le croyaient à la tête de toutes les affaires de l’Église. De plus, il leur était sympathique et ils le considéraient comme le hiérarque russe le plus proche d’eux. Quant aux karlovtsiens, leurs préjugés solidement ancrés leur faisaient tenir un raisonnement très simple. l’Église russe est entièrement administrée par le Conseil gouvernemental aux affaires de l’Église et le KGB, Nicodème est un agent du gouvernement et du KGB et se trouve être la personnalité la plus dynamique parmi les hiérarques, il sera donc dans l’intérêt du pouvoir soviétique de le nommer patriarche. On pouvait encore lire ce type de considérations ou de convictions dans les organes de presse des karlovtsiens (dans La Russie orthodoxe tout particulièrement) à la quasi-veille du Concile, alors qu’il était clair, pour tous les observateurs de la vie de l’Église russe, que c’était bien le métropolite Pimène (4) qui serait élu patriarche. À cette occasion, les karlovtsiens n’avaient fait que montrer, une fois de plus, leur mauvaise connaissance et leur absence de liens avec l’Église de Russie. Dès l’été 1970 en effet, on entendait des personnes (comme par exemple une délégation de jeunes gens de Belgique invités par le patriarcat (5)) raconter à leur retour de Russie que les noms des métropolites Pimène et Nicodème étaient tous deux cités, mais que la candidature du métropolite Pimène semblait susceptible de l’emporter. Ils rapportaient aussi une anecdote amusante selon laquelle lors d’un dîner donné à Kiev en l’honneur de la délégation belge, un prêtre de Kiev, peut-être un peu éméché, avait, en présence du métropolite Philarète de Kiev (6), « levé son verre » à l’élection de celui-ci au trône patriarcal.
En octobre de la même année 1970, une réunion, à Genève, de la commission panorthodoxe de dialogue avec les Anglicans (7), me fournit l’occasion de revoir le protopresbytre Vital Borovoï (8) et de parler avec lui de l’élection du patriarche. Le père Vital se montra, comme à l’accoutumée, plein de retenue et de prudence, mais bien informé, intelligent et honnête, bien que non dépourvu d’une certaine malice (on sentait toujours chez lui la présence d’une arrière-pensée en fonction de laquelle il prenait la parole ou gardait le silence). Il évita de nommer un candidat au patriarcat, mais m’expliqua le pourquoi d’une période si longue (qui, en fin de compte, durera plus d’un an et suscitera la perplexité générale) avant l’élection du patriarche. selon lui, les responsables de l’Église, aussi bien que les autorités civiles, désiraient s’assurer d’un choix consensuel. « Or, cela nécessite une certaine préparation, surtout en province. Et cette campagne est menée en ce moment, tant par le patriarcat que par les autorités. » Je ne sais pas dans quelle mesure cette explication était juste, mais le fait est que je n’en entendis jamais de plus plausible au sujet de cette longue attente avant l’élection. Les autres explications que l’on donnait semblaient triviales ou « préfabriquées ». soit la période de deuil pour le patriarche précédent (mais pourquoi la faire durer un an ?), soit l’impossibilité, à cause des invités, d’organiser un concile en hiver (mais entre avril et le début de l’hiver en octobre, il y aurait largement eu le temps de préparer et convoquer un concile !). Ces explications, et d’autres que me donnait même le métropolite Nicodème, ne résistaient pas à une analyse sérieuse. Il n’en restait pas moins que, selon les statuts de 1945 sur l’administration de l’Église orthodoxe russe (9), l’élection du nouveau patriarche devait être organisée dans un délai n’excédant pas les six mois consécutifs à la mort du patriarche precedent (10) et le Synode n’avait pas le droit de modifier cette décision du concile de 1945. Je ne comprends pas très bien quel intérêt il y avait, pour le gouvernement, à repousser l’élection du patriarche et à rechercher l’unanimité. Peut-être désirait-il éviter que les élections ne se déroulent en 1970, qui était officiellement « l’année Lénine (11) » ? C’est ce que l’on disait à Moscou, mais cela ne me semble pas être une explication sérieuse.
C’est lors d’une visite à Moscou, entre le 19 octobre et le 5 novembre 1970, que je réussis pour la première fois à obtenir quelques informations précises au sujet des élections à venir. J’étais venu en « touriste » mais avais été accueilli en « hôte » du patriarcat, logé à l’hôtel Leningrad, une voiture avec chauffeur avait même été mise à ma disposition. Lors de ce séjour à Moscou, je fus accueilli rue Tchisty (12) par le métropolite Pimène, locum tenens patriarcal (en présence de l’évêque Philarète de Dmitriev (13)). Je fus invité à concélébrer avec lui par deux fois, pour des vigiles ainsi que pour la liturgie à l’occasion des fêtes des icônes de Notre-Dame de Kazan et de Notre-Dame des Ibères (à l’église de la Résurrection des Sokolniki, ainsi qu’à la cathédrale patriarcale) ; je m’entretins aussi avec les métropolites Nicodème et Alexis de Tallin (14), avec des professeurs des académies de théologie de Moscou et Leningrad, ainsi qu’avec de nombreux prêtres et laïcs. Toutes ces conversations me permirent de me forger une opinion assez éclairée des différents courants de pensée dans l’Église à propos de l’élection du patriarche. C’est dans ce but que, chaque matin, sans parler à quiconque de ma destination et sans être accompagné, je prenais la voiture que l’on m’avait fournie et indiquais au chauffeur l’église que je souhaitais visiter ce jour-là. Là-bas, je priais à la liturgie, puis restais un certain temps à bavarder avec le clergé et les laïcs. Ils étaient souvent très étonnés de me voir apparaître sans escorte du patriarcat. « Comme c’est agréable de vous voir venir seul pour une fois !, s’exclama un prêtre que j’avais connu lors de précédentes visites, on va pouvoir parler. »
Ces visites matinales à différentes églises m’apportèrent beaucoup. Ainsi, à l’église de la Glorieuse-Résurrection à Sokolniki, le marguillier, un homme respectable d’âge moyen, d’allure plus bourgeoise qu’intellectuelle, répondit de la façon suivante à la question que je lui posais sur l’identité du futur patriarche :
— « Eh bien, si cela dépend de Moscou, ce sera Pimène, c’est évident. Ici, tout le monde le connaît et l’aime, il vient constamment célébrer dans les églises de Moscou. Et il célèbre très bien. Sa prestance, sa piété, tout en ferait le meilleur patriarche. En plus, il sait traiter avec les autorités, on dit que le gouvernement le soutient. »
— « Et Nicodème ? demandai-je. À l’étranger, beaucoup pensent qu’il sera patriarche. »
— « Alors là, vous savez, ce n’est pas sérieux. Il est trop jeune. Le patriarche, c’est quand même un « père ». »
Dans la majorité des églises où je me rendis, tout le monde disait que, selon toute vraisemblance, c’était Pimène qui serait élu, qu’il convenait le mieux à cette fonction, que le peuple des fidèles l’appréciait pour sa façon recueillie et pieuse de célébrer, que dès sa jeunesse il avait su se faire respecter en tant que moine. Du métropolite Nicodème, on entendait dire qu’il avait de nombreux adversaires dans le peuple, qu’on ne lui faisait pas confiance, qu’il était considéré comme un novateur et un ami des catholiques. « Il nous vendra aux « calottes rouges » » (c’est-à-dire aux cardinaux)« , disait-on de lui parmi la foule.
On racontait aussi l’anecdote suivante. alors qu’il partait à Rome pour assister à la dernière session du concile de Vatican, auquel il avait été invité, le métropolite Nicodème, à la fin d’un office qu’il venait de célébrer à Leningrad, s’adressa aux fidèles, leur demandant de prier pour lui, car il se rendait à la « clôture du concile du Vatican ». « Comment ?, protestèrent les fidèles, qui n’avaient pas compris ce qu’il venait de dire, on ferme encore une cathédrale (15) et toi tu vas y participer ! On ne te laissera pas faire ! Tu ne sortiras pas d’ici ! »
Le métropolite Nicodème déchaîna chez les fidèles de Leningrad une indignation tout aussi forte le jour où il se mit à célébrer en cappa magna rouge. Cela fut interprété comme une marque de soutien au communisme ! En réalité, on aurait plutôt pu y voir une imitation des catholiques. En tout cas, c’était une innovation troublante pour les simples fidèles. L’hostilité exprimée par une partie des croyants envers le métropolite Nicodème rendait donc son élection au trône de patriarche non souhaitable, dans la mesure où elle aurait pu provoquer la discorde, voire un schisme, dans l’Église (le métropolite Pimène, en revanche, n’avait pas d’adversaires).
Pour ce qui est de Nicodème, un grand tort lui avait été causé par une résolution (adoptée par le Saint-Synode à son initiative) relative à l’admission des catholiques-romains à la communion lorsqu’ils se trouvaient loin de toute église ou prêtre catholiques (16). Les dégâts s’en ressentaient moins dans la population, qui ne se sentait pas directement concernée par ces questions et ne s’y intéressait pas, que dans les milieux de l’intelligentsia d’Église à tendance conservatrice. C’était un véritable « faux pas », me dit A. V. Vedernikov (17) qui, après avoir connu de longues années de disgrâce pendant lesquelles le métropolite Nicodème l’avait écarté de la rédaction du Journal du Patriarcat de Moscou et exclu du Département des relations extérieures, venait d’être nommé consultant en théologie auprès du métropolite Pimène, au grand dam de l’entourage du métropolite Nicodème (l’évêque Philarète, par exemple). Il est intéressant de noter que l’engouement du métropolite Nicodème pour les catholiques-romains — un engouement plutôt superficiel — avait aussi provoqué le mécontentement dans les cercles du pouvoir qui considéraient cela comme un « écart » par rapport à la ligne [idéologique officielle]. On raconte que, lorsque Kouroïedov (18) apprit que le métropolite Nicodème avait choisi, pour thème de sa thèse de maîtrise, le pape Jean XXIII (19), il fut indigné. « Quelle honte ! Il aurait tout de même pu trouver un patriarche ou un métropolite orthodoxe, pour sa thèse ! »
Par ailleurs, de l’avis général, en ce qui concerne leur loyauté vis-à-vis du pouvoir soviétique et leur empressement à prendre en compte ses desiderata, les métropolites Pimène et Nicodème ne se distinguaient pas beaucoup l’un de l’autre. j’entendis cette opinion exprimée de nombreuses fois par le clergé des paroisses. On peut résumer ces propos en citant les paroles de l’higoumène Marc (Lozinski) (20), professeur à l’académie de théologie de Moscou, auteur d’une volumineuse thèse sur saint Ignace Briantchaninov (21), et qui était un représentant typique des milieux monastiques traditionnels, proches du monastère d’Optino (22), et un opposant acharné au métropolite Nicodème qu’il trouvait trop novateur. « Dans les circonstances actuelles, le candidat le plus adapté, je dirais même le seul possible, reste le métropolite Pimène », me dit-il.
Quelques voix discordantes se faisaient cependant entendre parmi l’opinion généralement unanime. Ainsi, le père Alexandre (23), prêtre à l’église Saint-Nicolas-des-Forgerons, après avoir nommé le métropolite Pimène et Nicodème comme étant les candidats les plus plausibles, me répondit. « Pour être tout à fait sincère, ni l’un ni l’autre ne conviendraient. » — « Qui donc alors ? », m’intéressai-je. — « Eh bien, l’archevêque Hermogène (24). Et la majorité du jeune clergé pense de même. Mais c’est parfaitement irréalisable ! » — « Qui, selon vous, pourrait être un candidat sérieux au trône de patriarche, si l’on exclut les métropolites Pimène et Nicodème ? », insistai-je. Cette question, je l’avais posée à de nombreuses autres personnes, mais nul jusque-là n’avait pu me répondre. Aucun nom ne leur venait à l’esprit.
Le père Alexandre réfléchit un instant et dit. « Il y a bien d’autres bons archevêques. Théodose d’Ivanovo (25), Léonide de Riga (26), Paul de Novossibirsk (27). Mais je ne sais pas s’ils feraient de bons patriarches. »
J’accorderai une attention spéciale à l’opinion de l’archiprêtre Vsévolod Schpiller (28). Cet homme très intelligent, cultivé, mais aussi très subjectif dans ses jugements et changeant d’opinion sur les gens, doit être considéré comme représentatif de l’intelligentsia d’Église plus que du clergé, même s’il semblait se considérer lui-même comme un starets (29) dont l’autorité s’étendrait à toute la Russie, un héritier de l’évêque Athanase (Sakharov) (30) et de l’archevêque Séraphim (Sobolev) (31). Il avait, il est vrai, de nombreux enfants spirituels dans l’intelligentsia et le monde de l’art, mais il n’était pas aimé du clergé qui le trouvait fier, aristocrate, esthète. Quoi qu’il en soit, il fut l’un des interlocuteurs les plus intéressants qu’il m’ait été donné de rencontrer à Moscou à cette époque. Je le trouvai dans une période plutôt « pro-Nicodème ».
Voici ce qu’il répondit à mes questions et comment il développa ses idées. « C’est tout de même un homme plus fort et plus actif que Pimène. Avec Pimène, ils peuvent être tranquilles, il n’y aura aucune surprise. Alors que Nicodème, même s’il fait à l’heure actuelle tout son possible pour être en bons termes avec le pouvoir, reste susceptible de devenir plus indépendant s’il est élu patriarche. On lui reproche aussi d’être allé trop loin sur la question du rapprochement avec les catholiques. Cela va contre les intérêts des autorités et cela leur fait peur. On remarque qu’il y a une sorte de mécontentement généralisé à l’égard de Nicodème dans les sphères du pouvoir. Tenez, par exemple. il y a quelques jours, j’ai rencontré dans la rue l’archevêque Cyprien (Zernov) (32) qui vit non loin de notre paroisse ; c’est un homme intelligent et très informé. Il m’a dit. « Nicodème tremble sur son piédestal ! » J’ai l’intention de l’inviter pour en parler plus en détails, pour comprendre de quoi il retourne. Quant au métropolite Pimène, je vais vous raconter un épisode qui le caractérise parfaitement. Cet été, après l’épidémie de choléra qui a sévi dans le sud de l’URSS, le métropolite Pimène a promulgué un décret qui a été envoyé aux évêques des diocèses du sud, leur interdisant de « donner la communion aux fidèles, de les laisser vénérer les icônes, de leur donner la croix à embrasser, etc. » On dit qu’après cela, un collaborateur de Kouroïedov (lequel était en voyage) fut convoqué par le Comité central du parti pour une réprimande sévère. « C’est vous qui auriez dû faire passer des directives en ce sens et personne n’aurait songé à nous le reprocher. nous sommes tenus de nous préoccuper de la santé de la population. Mais vous, vous avez contraint le métropolite à l’écrire en son nom. Il est évident que jamais un croyant n’aurait pu promulguer un tel décret. Maintenant, on va nous accuser de persécutions contre l’Église. » »
Le père Vsévolod me lut par ailleurs la lettre d’un hiéromoine de l’Église « non-commémorante (33) », qui résidait dans une ville au sud de Moscou. Ce hiéromoine n’était pas lui-même en contact avec l’Église du patriarcat, il célébrait à son domicile des liturgies clandestines mais n’interdisait pas à ses fidèles de fréquenter les églises du patriarcat, il leur conseillait même de le faire. À propos du concile à venir, le hiéromoine écrivait que, « quelle que soit la tournure qu’il prendra[it], quelles que soient les candidatures avancées, tout sera[it] de toute façon réglé d’avance par le pouvoir soviétique et le concile en soi ne sera[it] qu’une profanation ». Il va sans dire que je protestai contre la validité d’une telle opinion. « Ne parlez pas trop vite, me répondit le père Vsévolod, vous verrez ; vous aussi serez, comme les autres, contraint de dire à ce concile ce que l’on vous aura prescript (34). »
Je rapporterai encore ici les propos du père Jacques, archiprêtre à l’église du Prophète Élie de la rue Obydennaïa. Il était plutôt curieux de connaître mon propre avis sur l’issue de l’élection du patriarche et quand je lui dis que, selon moi, Pimène serait élu, il me répondit. « Oui, vous avez raison. Mais le pouvoir restera comme avant, aux mains de Nicodème. »
Dans les milieux moscovites de l’intelligentsia d’Église que j’eus l’occasion de côtoyer, ceux qui se représentaient une piété orthodoxe traditionnelle étaient du côté du métropolite Pimène. ils soutenaient sa candidature au patriarcat, parlaient de lui avec amour et confiance et témoignaient de la méfiance à l’égard du métropolite Nicodème, disant qu’il y avait en lui quelque chose de tout à fait inadmissible pour une sensibilité religieuse, quelque chose qui repoussait les croyants. « Quand il célèbre, il y a beaucoup de gens qui refusent d’aller demander sa bénédiction. » On lui reprochait ses activités en tant que président du Département des relations extérieures du patriarcat, sa « théologie de la Révolution » ou, pour reprendre l’expression assez juste du père Vsévolod Schpiller, sa « théologie d’Octobre ». A contrario, dans l’autre partie de l’intelligentsia de cette époque, parmi les croyants libéraux ou peu religieux, on soutenait en revanche majoritairement le métropolite Nicodème (et ce soutien s’était renforcé depuis ma visite à Moscou en 1969). Ces gens-là le trouvaient plus dynamique, plus conscient des besoins de l’Église de notre époque, plus moderne et plus « progressiste » et en même temps plus intelligent et plus talentueux que le métropolite Pimène. Ils critiquaient ce dernier pour sa « mauvaise élocution, son manque de finesse ainsi que sa faiblesse et son opportunisme ». Non seulement les tendances œcuménistes du métropolite Nicodème et sa bienveillance à l’égard des catholiques-romains ne troublaient pas ces intellectuels libéraux mais, au contraire, cela constituait un argument en sa faveur. Bien sûr on condamnait sans hésitation sa « théologie d’Octobre », mais avec moins de sévérité que la fameuse interview du métropolite Pimène à propos de Svetlana Alliloueva (35).
Il est curieux de remarquer que deux représentantes radicales de l’opposition d’Église, à savoir la célèbre pianiste Marie Veniaminovna Ioudina (36) et K. P. Troubetzkaïa (longtemps opposées au métropolite — puis patriarche — Serge, et séparées de l’Église patriarcale) préféraient le métropolite Nicodème qu’elles considéraient comme plus dynamique [que le métropolite Pimène].
Dans mes conversations, je posai sans relâche la même question à tous mes interlocuteurs. « Vous n’allez pas me dire que, hormis les métropolites Pimène et Nicodème, il n’y ait personne qui puisse devenir patriarche ? N’y a-t-il vraiment aucun évêque diocésain qui convienne ? »
Je n’obtins quasiment jamais de réponse claire. Mes interlocuteurs perdaient contenance et me disaient. « Je ne vois pas », me donnaient quelques noms de « bons » évêques, pour ajouter aussitôt qu’ « à notre époque difficile et dans notre pays », ils ne convenaient pas pour être patriarche. Prenons, par exemple, le métropolite Joseph d’Alma-Ata (37), un homme au caractère bien trempé, énergique. mais il avait déjà quatre-vingts ans, avait subi l’occupation allemande et séjourné dans les camps, ce que les autorités n’aimaient pas (pourtant on disait qu’un préposé local du Conseil aux affaires religieuses lui avait proposé de se porter candidat au patriarcat, lui promettant de le soutenir, à quoi le métropolite Joseph lui avait répondu. « Je n’ai que faire de votre soutien ! »). Il semblait découler de tout cela qu’à l’exception des deux candidatures précitées, sur lesquelles se concentrait l’attention des milieux d’Église, il n’y avait personne d’autre dans le pays.
Lors de mes rencontres avec divers représentants de l’épiscopat, je tentai d’évoquer, dans la mesure du possible, la question de l’élection du patriarche. Il m’était bien sûr difficile d’en parler directement au métropolite Pimène, du fait qu’il était à la fois locum tenens et principal candidat au trône patriarcal. J’avais entendu dire que le métropolite Pimène lui-même ne tenait pas particulièrement à devenir patriarche, mais que, s’il était élu, il ne refuserait pas cette charge. D’autres affirmaient qu’il avait commencé par refuser de poser sa candidature pour ensuite revenir sur son refus. Quant à moi, j’avais envie de me faire de lui une opinion plus personnelle, de savoir si oui ou non il ferait un bon patriarche.
Le métropolite tint à me recevoir en visiteur officiel.
Lorsque, par l’intermédiaire d’A. V. Vedernikov, son « consultant en théologie », je me renseignai pour savoir si le métropolite pouvait me recevoir, on me répondit que c’était tout à fait faisable, mais qu’il me fallait déposer une demande auprès du Département des relations extérieures du patriarcat de Moscou. Après de brèves formalités, le métropolite Pimène me reçut rue Tchisty, à trois heures de l’après-midi, dans son salon, en présence de l’évêque Philarète (de Dimitriev), alors vice-président du Département des relations extérieures et remplaçant du métropolite Nicodème. Il m’offrit du café et des petits gâteaux. Il avait une attitude digne et plutôt distante, mais restait simple, il ne cherchait pas à se donner de l’importance. Notre conversation fut assez banale, jusqu’au moment où je lui demandai. « Je suppose qu’en ce moment vous devez crouler sous le travail ? » — « Oui, me répondit-il, jusqu’à présent je menais une vie de vacancier, mais maintenant j’ai une montagne de choses à faire, dont je ne soupçonnais même pas l’existence ! »
Lors de cette rencontre, je ne pus vraiment déterminer l’état d’esprit du métropolite Pimène. J’eus avec lui une conversation bien plus intéressante en prenant le thé après une liturgie célébrée à l’église de la Résurrection aux Sokolniki pour la fête de l’icône de Notre-Dame des Ibères. Nous évoquâmes Dion, le prêtre catholique-romain de l’ambassade américaine. Pendant la liturgie, lui et un autre américain s’étaient tenus dans le sanctuaire. Il n’avait pas communié, mais on lui avait donné l’antidoron (38) et le vin. Par association d’idées, nous abordâmes le thème de la résolution du Saint-Synode datée du 16 décembre 1969, concernant l’admission des catholiques à la communion dans les cas où il ne se trouverait à proximité ni église ni prêtre catholiques.
« On n’aurait jamais dû adopter une résolution pareille, fit remarquer le métropolite Pimène, de toute façon, même sans elle, on admettait les catholiques à la communion en cas d’absolue nécessité. On aurait dû laisser les choses en l’état, au lieu d’aller fixer par une résolution du Synode une pratique qui découlait de considérations pastorales. Cette résolution n’a fait que nous attirer des ennuis et des mécontentements. » — « Chacun peut l’interpréter à sa convenance et décider quand et pour quelles raisons l’admission des catholiques à la communion est acceptable, répondis-je. Le principal défaut de cette résolution est son ambiguïté. À ce propos, j’ai été très heureux de constater que ce matin dans votre église, on n’a pas donné la communion à un prêtre catholique. » — « Comment aurait-il pu en être autrement ?, s’exclama le métropolite Pimène. Chez nous, on ne donne la communion aux catholiques qu’en cas d’absolue impossibilité pour eux de communier dans une église catholique. » — « Mais, Monseigneur, que dites-vous de ces cas où des dignitaires de l’Église catholique en visite au patriarcat de Moscou se sont vus admettre à la communion, parfois même dans tous leurs ornements sacerdotaux et avec les honneurs dus à leur rang ? »
Je faisais référence à la communion donnée en automne 1969 à Kiev par le métropolite Philarète, puis à Toula par l’évêque Juvénal (39), au père Mailleux (40) et au recteur de l’université grégorienne de Rome. Sans même mentionner la communion des catholiques à Rome par le métropolite Nicodème, à peu près à la même époque.
— « Je n’ai jamais eu vent de choses pareilles. Cela n’a pas pu se produire », me répondit le métropolite Philarète.
Bien entendu, je ne pouvais pas citer de noms, en présence des nombreuses personnes qui se trouvaient à notre table, et d’ailleurs je ne voulais pas « dénoncer » mes confrères, aussi gardai-je le silence. Mais pour moi cela reste un mystère. le métropolite Pimène ignorait-il réellement tous ces cas d’intercommunio, ce qui aurait signifié qu’il était mal informé de ce qui se passait dans sa propre Église et qu’on lui cachait beaucoup de choses, ou avait-il diplomatiquement choisi de feindre l’ignorance, dans la mesure où il ne pouvait rien changer à la situation ? Quelle que soit la réponse à cette question, la position de principe du métropolite Pimène au sujet de l’intercommunion avec les catholiques-romains était manifestement plus ferme que celle du métropolite Nicodème, ce qui me fit une bonne impression.
Le métropolite Nicodème, que je rencontrai plusieurs fois dans les locaux du Département des relations extérieures, se montra très discret lorsque je l’interrogeais sur les candidatures et évita de prononcer le moindre nom. « L’avenir nous le dira », répétait-il. Mais on sentait qu’il était parfaitement conscient que c’était Pimène qui allait devenir patriarche, qu’il s’était fait une raison de cette fatalité et qu’il ne comptait plus poser sa candidature. De ce point de vue, les rumeurs qui couraient à l’étranger à propos d’une prétendue lutte entre les deux métropolites autour du trône patriarcal étaient infondées. Cela n’empêchait certes pas le métropolite Nicodème de conserver un regard critique sur l’action du métropolite Pimène. Ainsi, quand je lui posai une question à propos des modalités de l’élection du patriarche « à bulletin secret ou à main levée », le métropolite Nicodème me répondit. « Rien n’est décidé. Ces questions seront réglées par la commission préconciliaire. Son président, le métropolite Pimène, n’a pas encore convoqué cette commission une seule fois, il a fait preuve d’incapacité à organiser son travail. Quant au métropolite Alexis de Tallin, il est encore pire » (je ne compris pas ce qu’il voulait dire par là). Mais quand je me mis à développer l’idée qu’il était absolument nécessaire de procéder à un vote à bulletins secrets, le métropolite Nicodème sembla se refermer sur lui-même et, sans me contredire, se mit à m’expliquer que l’on pouvait avoir en la matière des opinions diverses et que cette question serait discutée en temps utile. Il me donna l’impression d’être opposé au vote à bulletins secrets.
Durant ce séjour en URSS, j’eus l’occasion de m’entretenir avec le métropolite Alexis de Tallin et d’Estonie, membre permanent du Saint-Synode et chancelier du patriarcat de Moscou. Il me reçut dans son cabinet de travail de la rue Tchisty. Contrairement à mes autres interlocuteurs, il me posa lui-même la question. « Vous qui avez déjà passé un certain nombre de jours à Moscou et avez certainement rencontré pas mal de monde, dites-moi, s’il vous plaît, ce qu’on dit des élections du futur patriarche ? Qui souhaite-t-on voir élire et qui, croit-on, sera élu ? »
Je m’étonnai d’une telle question. « Monseigneur, c’est à moi de vous poser la question. Je ne suis ici que de passage, alors que vous y vivez en permanence. » — « C’est bien pour cela que vous êtes susceptible d’en savoir plus que nous. Vous voyez beaucoup de gens, ils vous parlent. Alors que nous — les évêques membres du Synode surtout — sommes coupés des réalités. Nous passons nos journées dans nos cabinets de travail, ne rencontrons les fidèles que lors des offices, ce qui ne nous donne pas l’occasion de bavarder avec eux. Eh bien, qu’avez-vous entendu dire ? »
Je lui répondis que la majorité des gens que j’avais rencontrés souhaitaient l’élection du métropolite Pimène et pensaient d’ailleurs qu’il serait élu, que le métropolite Nicodème avait aussi ses partisans, mais qu’il en avait moins, que la plupart des gens le trouvaient trop jeune et que certains étaient même violemment opposés à lui.
Le métropolite Alexis était visiblement très satisfait de mon compte rendu. « C’est vrai, dit-il, le peuple ne veut pas d’un patriarche aussi jeune. Quant au métropolite Pimène, il bénéficie de la confiance générale pour sa piété, son goût pour la célébration liturgique. On apprécie aussi qu’il soit un moine issu de la vieille école, il perpétue la tradition monastique. Il y a très peu d’hommes comme lui de nos jours. »
La conclusion générale que je tirai de cet entretien fut qu’il soutiendrait sans conditions le métropolite Pimène. Quant à son affirmation selon laquelle le peuple ne voulait pas d’un patriarche aussi jeune que Nicodème, il soulignait par là qu’il s’excluait d’office des candidats potentiels (Alexis avait le même âge que Nicodème).
Je parlai aussi à l’évêque Philarète (Vakhromeïev) de Dimitriev, deuxième remplaçant du métropolite Nicodème au Département des relations extérieures du patriarcat. De même que tous les collaborateurs du métropolite Nicodème, l’évêque Philarète soutenait totalement ce dernier, mais il comprenait que Pimène serait élu patriarche et que le métropolite Nicodème en était pleinement conscient.
« Et comment le prend-il ? », lui demandai-je. — « Peut-être qu’en son for intérieur il en est affecté, mais il n’en montre rien, répondit l’évêque Philarète. Vous connaissez sa maîtrise de soi. »
Il semblait évident que le principal, si ce n’est l’unique candidat fut le métropolite Pimène et que son élection ne faisait aucun doute. Et bien que le métropolite Nicodème ait eu des sympathisants, il était peu probable qu’il soit vraiment candidat à l’élection.
Mais j’étais déçu et inquiet de voir qu’à l’exception de ces deux-là, il n’y ait pas eu d’autres candidats. « L’Église russe est-elle si appauvrie, qu’elle ne peut proposer que ces deux candidats ? » Je posai cette question plus d’une fois mais les réponses que j’obtins furent toujours vagues et indécises. Dans ces conditions, il ne restait qu’à faire son choix entre Pimène et Nicodème et je penchais en faveur du métropolite Pimène. pour son âge (soixante ans au lieu de quarante-et-un pour Nicodème), l’amour et la confiance que lui portaient les fidèles, sa fermeté dans la foi orthodoxe. Mais je réservais ma décision définitive au moment du Concile. « Un troisième candidat y apparaîtrait peut-être », pensai-je.
J’ajouterai ici encore un mot à propos du soutien dont bénéficiait le métropolite Nicodème auprès de l’intelligentsia d’Église de tendance libérale. Il serait erroné de le considérer comme un ami de l’intelligentsia ou de le classer parmi les évêques « cultivés » au même titre que, par exemple, l’archevêque Antoine (Melnikov) de Minsk (41), l’archevêque Léonide (Poliakov) de Riga ou l’archevêque Michel (Tchoub) de Voronège (42). Le métropolite Nicodème était un homme d’une intelligence exceptionnelle, non dépourvu d’éducation, il avait beaucoup lu et était relativement formé en théologie. Mais on ne peut pas dire qu’il ait été profondément cultivé. Quant à son opinion de l’intelligentsia, on peut l’exprimer de la façon suivante. « De même qu’avant la Révolution, l’intelligentsia ne faisait que créer des problèmes et critiquer l’Église, elle continue à le faire maintenant. » De nombreux membres de l’intelligentsia orthodoxe de tendance traditionnelle (comme A. V. Vedernikov ou le personnel du musée André Roublev) ressentaient cette opinion du métropolite Nicodème à leur égard, et c’est pourquoi ils soutenaient la candidature du métropolite Pimène.
Telles sont globalement mes impressions de mon séjour à Moscou à l’automne 1970.
- Voir « Chapitre 1. Le métropolite Nicolas (Iarouchevitch) ».
- Voir « Chapitre 1. Le métropolite Nicolas (Iarouchevitch) », n. 7.
- Voir « Chapitre 2. Le métropolite Nicodème (Rotov) ».
- Mgr Pimène (Izvekov, 1930-1990), prélat orthodoxe russe, patriarche de l’Église orthodoxe de Russie. Évêque (1957), archevêque (1960), métropolite (1961), métropolite de Kroutisty et Kolomna (1963). Patriarche de Moscou et de toutes les Russies (1971-1990).
- Voir « Palomniki iz Belgii » [Pèlerins de Belgique], Journal du patriarcat de Moscou, n° 9 (1971), p. 9.
- Voir « Chapitre 2. Le métropolite Nicodème (Rotov) », n. 8.
- Rencontre de la Commission mixte de dialogue théologique orthodoxes-anglicans, Chambésy-Genève, 1-7 octobre 1970.
- Voir « Chapitre 1. Le métropolite Nicolas (Iarouchevitch) », n. 75.
- « Règlement de l’administration de l’Église orthodoxe russe, adopté par le concile local de l’Église orthodoxe russe, le 31 janvier 1945 ». Texte français dans N. STRUVE, Les Chrétiens en URSS, op. cit., p. 383-390.
- Art. 14 du Règlement précité (N. STRUVE, ibid. p. 385).
- À l’occasion du centenaire de la naissance (1870) du fondateur de l’État soviétique.
- Siège officiel du patriarcat.
- Voir « Chapitre 2. Le métropolite Nicodème (Rotov) », n. 73.
- Voir « Chapitre 2. Le métropolite Nicodème (Rotov) », n. 29.
- En russe, le même terme sobor signifie « concile » et « cathédrale ». Il s’agit donc ici d’un malentendu sur le mot sobor (NdT).
- Voir « Chapitre 2. Le métropolite Nicodème (Rotov) », p. 253-254.
- Voir « Chapitre 1. Le métropolite Nicolas (Iarouchevitch) », n. 76.
- Voir « Chapitre 1. Le métropolite Nicolas (Iarouchevitch) », n. 53.
- Voir « Chapitre 2. Le métropolite Nicodème (Rotov) », n. 113.
- Père Marc (Lozinski, 1939-1973), prêtre et moine orthodoxe russe. Professeur à l’académie de théologie de Moscou.
- Saint Ignace (Briantchaninov, 1807-1867). Évêque et auteur spirituel orthodoxe russe. Voir Ignace BRIANTCHANINOV, Introduction à la tradition ascétique de l’Église d’Orient, Sisteron, Éd. Présence, 1978.
- Célèbre monastère orthodoxe russe à 350 km de Moscou, renommé pour ses saints et pères spirituels, fréquenté par l’élite intellectuelle russe des XVIIIe-XIXe siècles.
- Père Alexandre Koulikov (1933-2009). Prêtre orthodoxe russe à Moscou, vicaire du père Vsévolod Schpiller.
- Voir « Chapitre 2. Le métropolite Nicodème (Rotov) », n. 71.
- Mgr Théodose (Pogarski, 1909-1975), prélat orthodoxe russe. Évêque (1958), archevêque d’Ivanovo (1968), archevêque d’Oufa et Sterlitamak (1973).
- Mgr Léonide (Poliakov, 1913-1990), prélat orthodoxe russe. Évêque (1959), archevêque de Riga et de Lettonie (1966), métropolite (1979).
- Mgr Paul (Golychev, 1914-1979), prélat orthodoxe russe. Émigré en Belgique et en France, retourne en URSS (1947), évêque (1957), archevêque de Novossibirsk et Barnaoul (1964), limogé (1972), revient en Belgique où il décède.
- Voir « Chapitre 1. Le métropolite Nicolas (Iarouchevitch) », n. 83.
- Dans l’Église russe, le mot starets (au pluriel startsy) — littéralement. « l’ancien » — désigne un « père spirituel », un « guide ».
- Saint Athanase (Sakharov, 1887-1962), prélat orthodoxe russe, confesseur de la foi et père spirituel reconnu. Évêque (1921), déporté (1922-1954).
- Mgr Séraphim (Sobolev, 1881-1950), prélat orthodoxe russe en Bulgarie. Évêque (1920), archevêque (1934).
- Mgr Cyprien (Zernov, 1911-1987), prélat orthodoxe russe. Évêque (1961), archevêque (1963). Chancelier du patriarcat de Moscou (1961-1963).
- En russe. nepominajuschaya (NdT). En 1927, devant les compromissions du métropolite (puis patriarche) Serge (Stargorodski) avec le pouvoir soviétique, une partie du clergé et des fidèles cessa de commémorer durant les célébrations le nom du patriarche de Moscou, sortant par là de la communion avec l’Église orthodoxe et se plaçant en position de schisme.
- Je vais anticiper un peu sur mon récit pour dire que les événements donnèrent tort au père Vsévolod (A. B.).
- À la suite de la fuite à l’Ouest de la fille de Staline, Svetlana Allilouïeva, en 1967, le métropolite Pimène avait donné aux Izvestia une interview dans laquelle il expliquait que, même sous Staline, l’Église orthodoxe avait été complètement libre en URSS.
- Maria Veniaminovna Ioudina (1899-1970), pianiste russe, opposante au régime soviétique.
- Mgr Joseph (Tchernov, 1893-1975), prélat orthodoxe russe et « confesseur de la foi ». Évêque (1932), déporté (1944-1954), évêque d’Alma-Ata et du Kazakhstan (1960), métropolite (1968).
- Pain béni que l’on donne après la communion, afin de permettre aux communiants de mieux absorber les saints dons (la communion se fait sous deux espèces, pain et vin/corps et sang).
- Voir « Chapitre 2. Le métropolite Nicodème (Rotov) », n. 87.
- Père Paul Mailleux (1905-1983), jésuite belge, délégué du général des jésuites pour les catholiques russes, recteur du collège pontifical Russicum à Rome.
- Mgr Antoine (Melnikov, 1924-1986), prélat orthodoxe russe. Évêque (1964), archevêque de Minsk et de Biélorussie, métropolite (1975), métropolite de Leningrad et Novgorod (1978-1986).
- Voir « Chapitre 1. Le métropolite Nicolas (Iarouchevitch) », n. 32.


Jusque là, mes relations épistolaires avec le métropolite Nicolas et l’entrevue privée que j’avais eue avec lui en 1956 présentaient surtout un caractère professionnel et assez superficiel. Si les choses en étaient restées là, je n’aurais probablement pas entrepris d’écrire cette partie de mes mémoires.
Mais, lors de mon voyage en Russie en juillet 1960, je pus rencontrer le métropolite Nicolas et m’entretenir avec lui en toute franchise. C’était l’époque des premières persécutions de Khrouchtchev contre l’Église, persécutions dont on ne savait encore presque rien en Occident (43). On était au courant du reniement d’Ossipov et de son excommunication en décembre 1959 (44), du courageux discours du patriarche en février 1960 (45) et de la retraite de Karpov (46) qui l’avait suivi de près. Tout cela, et en particulier la retraite de Karpov que l’on disait plutôt bienveillant vis-à-vis de l’Église, n’annonçait rien de bon, mais personne ne pouvait s’imaginer l’ampleur et la violence de persécutions qui commençaient.
Cependant, la mise à la retraite soudaine et inexplicable du métropolite Nicolas (le 21 juin 1960) de son poste de président du Département des relations extérieures de l’Église et son remplacement par l’archimandrite Nicodème (Rotov) nous frappa tous comme la foudre (47). Le métropolite Nicolas semblait si solidement ancré à la tête du Département des relations extérieures, ses activités dans ce domaine semblaient tellement suivre en tous points la ligne du gouvernement soviétique, il était si célèbre à l’étranger, que son départ à la retraite semblait tout simplement inexplicable. Il se passait quelque chose de grave dans le pays, pensions-nous tous, mais nous ne savions pas quoi exactement. Vraisemblablement, quelque chose de mauvais !
C’est dans cette atmosphère alarmante et pleine d’incertitude que, le 16 juillet, moins d’un mois après la retraite du métropolite Nicolas, je m’envolai pour Moscou, sur invitation du patriarcat. À l’aéroport, je fus accueilli par l’évêque Nicodème, aimable et accueillant comme à l’accoutumée. J’avais fait sa connaissance à peine plus d’un mois auparavant en Grande-Bretagne où il était venu, encore archimandrite, à la tête d’une délégation de moines, invité par une communauté monastique anglicane. Bien entendu, il n’avait pas fait la moindre allusion au départ imminent du métropolite Nicolas et au fait qu’il allait bientôt le remplacer (il se peut qu’il l’ignorait lui-même).
Le lendemain de mon arrivée, c’était la veille de la fête de saint Serge de Radonège (48), je me renseignai sur les possibilités de rencontrer le métropolite Nicolas auquel je voulais transmettre un message de la part de notre exarque. J’avais moi-même très envie de le voir.
Il me fut répondu par mon accompagnateur l’archiprêtre Matthieu Stadniuk (49) que le métropolite Nicolas serait présent à la Laure pour la fête du lendemain et que le plus simple serait de le voir là-bas. Pour organiser cette entrevue, il fallait s’en remettre à l’archimandrite Pimène (Khmelevski), prieur de la Laure (50).
Nous arrivâmes en voiture à la Laure le jour de la fête, le 5/18 juillet, une heure avant le début de la liturgie. À l’hôtellerie du monastère, nous fûmes accueillis par l’archimandrite Pimène, auquel je dis immédiatement que j’avais besoin de m’entretenir avec le métropolite Nicolas. Que fallait-il faire ?
« Bien, dit l’archimandrite, c’est très simple. Allez immédiatement dans telle salle (je ne me souviens plus de laquelle il s’agissait), le métropolite doit s’y rendre pour son habillement (51). Vous pourrez lui parler. Le patriarche viendra plus tard. »
C’est ce que je fis. On m’emmena dans ladite salle et m’y laissa seul. Quelques minutes plus tard, arriva le métropolite Nicolas. Nous étions seuls. Sans perdre une seconde, car j’ignorais de combien de temps nous disposions ainsi en tête-à-tête, je dis au métropolite Nicolas. « Je vous transmets les salutations de notre exarque et de tout notre exarchat d’Europe occidentale et je tiens à vous dire combien nous avons tous été profondément affectés de votre départ à la retraite. Nous espérons que cela ne sera que temporaire. » — « Oui, dit le métropolite Nicolas, on m’a chassé comme ça !… » et il fit deux gestes énergiques de la main gauche et de la main droite, de haut en bas et en diagonale devant soi, comme des coups de sabre. Je ne sais toujours pas exactement ce qu’il a voulu exprimer par ces gestes. Il voulait probablement dire qu’il avait été frappé de tous côtés. — « Mais pourquoi, demandai-je stupéfait, que s’est-il passé ? » — « Ça ne vient pas de l’Église. Je n’ai pas de problèmes avec le patriarche. Nous avons toujours été et sommes en très bons termes. Ce sont les autorités civiles. Vous savez probablement qu’il y a dans le pays un fort regain de propagande antireligieuse ces derniers temps. J’ai protesté contre cela dans mes homélies. Pas dans celles qui étaient publiées dans le Journal du patriarcat de Moscou, mais dans les églises. Le peuple écoute mes homélies et les apprécie. Et c’est ce que les autorités ne pouvaient pas accepter. Eux, ce qu’ils veulent, ce sont des évêques qui se taisent et se contentent de célébrer avec faste. Mais ceux qui prêchent et luttent contre une société sans Dieu, ils ne les supportent pas. C’est pour cela qu’on m’a écarté. Bien entendu, en apparence, tout a été fait dans les règles, c’est le Synode qui m’a libéré de mes fonctions sur ma propre requête, mais en fait, j’ai démissionné sous la contrainte. »
— « Mais, Monseigneur, remarquai-je, il aurait été plus naturel de vous relever de vos fonctions de métropolite de Kroutitsy et de vous laisser à la tête du Département des relations extérieures du patriarcat, d’autant plus que votre engagement en faveur de la paix était connu du monde entier et probablement très apprécié du gouvernement soviétique. Pourtant, ils ont fait le contraire. vous êtes renvoyé du Département des relations extérieures mais restez métropolite de Kroutitsy. » — « Vous n’êtes pas sans savoir, répondit le métropolite Nicolas, qu’il y a eu des changements dans la hiérarchie du pays (il faisait allusion au remplacement de Karpov par Kouroïedov (52)). La nouvelle hiérarchie n’est pas au courant de mes activités pour la paix et ne les apprécie pas à leur juste valeur. Quant à me relever de mes fonctions de métropolite de Kroutitsy, ils ne le pouvaient pas. Ils n’en ont pas le pouvoir. Et le Synode n’accepterait jamais de faire une chose pareille. »
(L’avenir allait montrer à quel point le métropolite se fourvoyait en la matière. On voit qu’il n’avait pas encore pris la mesure de toutes les épreuves qui l’attendaient.)
J’interrogeai aussi au métropolite Nicolas au sujet du discours du patriarche Alexis lors d’une séance du Comité soviétique de défense de la paix, qui avait fait du bruit (53).
« C’est moi qui ai écrit son discours, me dit le métropolite Nicolas, le patriarche n’a fait que le lire. Vous savez ce qui s’est passé ensuite ? Quand le patriarche a fini sa lecture, il y a eu dans la salle deux ou trois applaudissements timides, puis les représentants de la « société » se sont mis à vilipender le patriarche. « Vous voulez nous faire croire que toute la culture russe vient de l’Église, que nous sommes tous les obligés de l’Église, mais c’est faux, etc. ». Ils ont fait un esclandre. »
Je transmis alors au métropolite une invitation de notre exarque lui demandant de venir en France, pour visiter notre exarchat. « Cela renforcerait beaucoup la position de notre Église en France », ajoutai-je. D’après ce que je sais, l’idée d’une visite en France sur invitation de l’exarque d’Europe occidentale émanait du métropolite Nicolas lui-même, ou tout au moins de ses proches à Moscou qui en avaient fait la demande écrite à notre métropolite Nicolas (Éremine) à Paris, soulignant qu’une telle invitation et a fortiori un tel voyage seraient à l’avantage du métropolite Nicolas. Il est difficile de dire quelles étaient les motivations réelles du métropolite Nicolas en ces temps difficiles pour lui, mais je ne pense pas qu’il ait eu l’intention de rester en France et de devenir un transfuge. Nous avons vu qu’à cette époque, il n’imaginait pas que l’on puisse le forcer à se retirer complètement, et croyait plutôt sa disgrâce temporaire.
Le métropolite Nicolas était manifestement intéressé par l’invitation que je lui transmettais et me demanda d’en parler au patriarche. Je répondis que j’avais déjà, pour lui, une lettre de notre exarque qui invitait le métropolite Nicolas en France.
« C’est très bien, dit le métropolite Nicolas, mais ce serait aussi très bien si vous pouviez parler au patriarche de cette invitation en présence de Kouroïedov, en insistant sur l’importance de ma visite en France. Vous verrez Kouroïedov aujourd’hui, au déjeuner auquel vous êtes convié. Le patriarche y sera aussi. » — « Et comment est-il, ce Kouroïedov ? », demandai-je, curieux. — « Nous n’avons pas encore réussi à bien comprendre qui il est », répondit le métropolite Nicolas avec diplomatie. — « Quelles raisons faut-il invoquer, à l’étranger, pour expliquer votre départ à la retraite ? » — « Dites que j’ai été relevé de mes fonctions pour des raisons inconnues et, en tout cas, certainement pas pour raisons de santé. Démentez cette rumeur si vous venez à l’entendre. Il est vrai que j’ai été malade il y a quelque temps, mais je me sens actuellement dans une forme physique bien meilleure que toutes ces dernières années. Cependant, ne dites rien des véritables raisons de mon départ à la retraite. Annoncez aussi mon départ à l’archimandrite Arsène (Schilovsky) à Vienne, ainsi qu’à l’archiprêtre Feriz Berki (54) à Budapest. À eux aussi, dites que c’est pour des « raisons inconnues. » (L’archimandrite Arsène et l’archiprêtre Berki se trouvaient alors sous la responsabilité directe du métropolite Nicolas).
À ce moment-là, le patriarche Alexis fit son entrée dans la pièce, ce qui mit un terme à notre conversation à cœur ouvert avec le métropolite Nicolas.
Je remis au patriarche la lettre de notre exarque et confirmai oralement son invitation au métropolite Nicolas à visiter notre exarchat en France. Quant au métropolite Nicolas, il demanda au patriarche de faire allusion à cette invitation pendant le repas, en présence de Kouroïedov. Le patriarche promit de le faire, mais on voyait bien à l’expression de son visage qu’il était relativement sceptique quant au succès de notre entreprise. Je ne rapporterai pas ici ma conversation avec le patriarche, qui ne concernait pas le métropolite Nicolas.
La liturgie de la fête fut célébrée en la cathédrale de la Trinité par le patriarche, le métropolite Nicolas et moi-même. Les autres évêques (il s’en était rassemblé dix-huit) célébraient dans les autres églises de la Laure. Les concélébrants de la liturgie ainsi que les invités « de marque » furent conviés à déjeuner avec le patriarche. cela constituait un groupe de dix à quinze convives. Les autres déjeunaient au réfectoire avec les moines. Le patriarche présidait, le métropolite Nicolas était assis à sa droite et Kouroïedov à sa gauche. On me plaça juste à côté du métropolite ; plus loin, il y avait l’évêque Nicodème (Rotov) de Podolsk et P. V. Makartsev, l’adjoint de Kouroïedov.
Je voyais Kouroïedov pour la première fois. C’était un homme très brun, d’une cinquantaine d’années, il avait l’air de quelqu’un de moyennement cultivé et manifestait une certaine arrogance dans son maintien, mais il ne semblait ni rustre, ni goujat. De temps à autre, il s’adressait au patriarche sur un ton assez aimable et ce dernier lui répondait à peu près de la même façon. Je fus très frappé d’entendre que Kouroïedov en s’adressant au patriarche disait non pas « Votre Sainteté », mais simplement. « Alexis Vladimirovitch ».
Mais ce qui me frappa par-dessus tout fut que Kouroïedov et le métropolite Nicolas, bien qu’assis face à face, non seulement n’échangèrent pas une parole de tout le repas, mais ne se regardèrent pas. Le métropolite Nicolas, en particulier, ne se départit pas d’un air renfrogné ; il gardait silencieusement la tête baissée et ne regardait jamais devant lui, mais toujours en biais vers le patriarche. Kouroïedov et le métropolite Nicolas ressemblaient à deux personnes qui, s’étant brouillées et se trouvant ensuite contraintes par les circonstances à se rencontrer, non seulement ne s’adressaient pas la parole, mais tentaient par tous les moyens d’éviter de se voir.
Pendant le repas, le patriarche dit à Kouroïedov. « J’ai reçu de Paris une lettre de notre exarque, invitant le métropolite Nicolas à visiter l’exarchat d’Europe occidentale, ce qui serait très bénéfique pour notre Église en France. » — « Tiens, et en quoi ? demanda Kouroïedov, je ne comprends pas bien cette idée. »
Le patriarche me demanda d’expliquer cela.
Je m’attelai à cette tâche difficile, tant il est vrai que la seule raison valable d’inviter le métropolite Nicolas en France était notre désir de le soutenir et l’encourager. « Avant tout, le métropolite Nicolas est une personnalité célèbre et reconnue au niveau mondial, à la fois comme artisan de la lutte pour la paix et comme hiérarque de l’Église russe, son voyage en France ne pourra donc qu’accroître le prestige de l’Église russe en Occident et renforcer ses positions face aux juridictions qui nous sont hostiles, en particulier les karlovtsiens (55). De plus, la personnalité et l’éloquence du métropolite Nicolas ne manqueront pas de faire venir à nous de nombreuses personnes. »
Kouroïedov prit un air songeur. « Je ne comprends tout de même pas très bien pourquoi la visite du métropolite est si importante en ce moment précis » remarqua-t-il. — « Nous en aurions aussi eu besoin plus tôt, répondis-je, mais le métropolite Nicolas n’avait pas de temps à nous consacrer. »
Kouroïedov ne répondit rien et la conversation dévia vers un autre sujet. Pendant tout cet échange, le métropolite Nicolas, tendu, était resté silencieux.
Après le repas, alors que nous nous promenions dans les couloirs de la résidence patriarcale, je fus abordé par Makartsev qui s’adressa à moi sur un ton amical et aimable. « Mgr Basile ! Comme nous sommes heureux de vous voir ! Nous avons tant entendu parler de vous ! » Nous nous mîmes à bavarder, et bientôt, notre conversation se transforma en dispute, comme cela allait encore souvent m’arriver avec Makartsev. Il s’était mis à affirmer qu’ils n’étaient absolument pas des Pobedonostsev (56) des temps modernes et ne voulaient en aucun cas se mêler des affaires internes de l’Église.
« Je vais vous dire une chose, me dit Makartsev, ici nous n’avons ni le temps ni réellement la possibilité de parler de tout cela en détail. Mais passez nous voir au Conseil (aux affaires religieuses), là-bas nous pourrons bavarder et faire plus ample connaissance. Nous serons très heureux de vous y accueillir. Je serai toujours heureux de votre visite, votre jour sera le mien. »
Je répondis de façon évasive, disant que je n’étais pas sûr de trouver le temps pour lui rendre visite, visite dont je ne voyais d’ailleurs pas la nécessité, puisque l’Église en URSS était séparée de l’État et que les affaires de l’Église ne devaient donc pas préoccuper celui-ci. Makartsev insista, mais je persistai à décliner son invitation et finis par lui dire que j’y réfléchirais et le tiendrais au courant de ma décision. Je voulais auparavant demander conseil au métropolite Nicolas et réussis à m’entretenir un instant en privé avec lui. Je lui racontai ma conversation avec Makartsev et lui demandai s’il fallait accepter cette invitation. — « Et pourquoi pas ?, me demanda le métropolite d’un ton vif, un tel entretien ne peut avoir aucune conséquence négative et peut au contraire se révéler très bénéfique. Acceptez cette invitation, allez-y. »
Je compris alors que nous avions sur certaines questions des conceptions assez différentes, mais par respect et confiance envers le métropolite Nicolas, je décidai de suivre son conseil. Après quoi, je donnai mon accord à Makartsev et nous fixâmes un rendez-vous dans son bureau au Conseil pour le vendredi 22 juillet à trois heures de l’après-midi. Comme nous le verrons dans la suite de mon récit, cette rencontre ne devait jamais avoir lieu.
Le jeudi 8/21 juillet, c’était la fête de Notre-Dame de Kazan, que l’on célébrait en grande pompe à Moscou. Les vigiles de la veille avaient été célébrées en la cathédrale patriarcale par les patriarches Alexis de Moscou et Éphrem de Géorgie (57). Le métropolite Nicolas concélébrait, ainsi que d’autres évêques, dont je faisais partie. À la fin des vigiles, le métropolite Nicolas s’adressa à moi, un sourire malicieux, quoique bienveillant, aux lèvres. « Vous êtes évêque ? » — « Oui », répondis-je. — « Vous êtes évêque ? » répéta-t-il avec une curieuse insistance. — « Oui », répondis-je à nouveau. — « Alors, vous ne savez encore rien ? Eh bien, vous l’apprendrez demain. Je ne peux rien vous dire aujourd’hui. »
Je compris qu’il avait été décidé de m’élever au rang d’archevêque, mais je gardai le silence et ne répondis rien au métropolite.
Le jour suivant, avant que ne commence la liturgie solennelle célébrée par les deux patriarches, les évêques concélébrants se rassemblèrent dans le sanctuaire de la cathédrale patriarcale, pour être habillés pendant la lecture des heures. Le patriarche Alexis était attendu un peu plus tard et le patriarche géorgien devait revêtir ses ornements au milieu de l’église.
J’entrai dans le sanctuaire avant la lecture des heures (58) et le métropolite Nicolas arriva juste après moi.
Nous étions là, debout, côte-à-côte et une conversation passionnante et tout à fait sincère s’engagea entre nous au sujet de la situation de l’Église dans la Russie contemporaine. Quelques instants après, des sous-diacres s’approchèrent de nous pour nous habiller, mais le métropolite ne sembla en aucune façon troublé de leur présence et continua la conversation. Ayant rapidement achevé notre habillement, les sous-diacres se retirèrent.
La conversation eut pour point de départ une question que je posai au métropolite Nicolas. Je lui demandai s’il était vrai que cette année, lors de l’office de Pâques à Kiev dans la cathédrale Saint-Vladimir, des jeunes du komsomol (59) étaient venus perturber la célébration des matines et les avaient même interrompues par des cris et d’autres agissements de voyous. J’avais appris cela par la presse étrangère.
« Cela ne s’est pas passé à Kiev seulement, répondit le métropolite Nicolas, cette année, à Pâques, une vague de manifestations antireligieuses grossières et blasphématoires a déferlé sur toute la Russie. Je préférerais ne pas vous dire ce qu’ils ont fait, surtout que nous sommes dans une église, mais je vais le faire tout de même, pour que vous sachiez la vérité. Dans une ville d’Ukraine, une foule de jeunes a fait irruption pendant l’office, portant une jeune fille dénudée, et s’est dirigée vers le sanctuaire pour tenter d’y entrer par les portes royales et déposer la jeune fille sur l’autel. Bien sûr, ils n’y sont pas parvenus, car les fidèles ne les ont pas laissés faire, mais cela a provoqué une bagarre généralisée et une mêlée. » — « Et quelle est la réaction du patriarcat à tout cela ?, demandai-je. Est-ce qu’il a protesté officiellement ? Et que fait la milice ? N’est-elle pas tenue par la loi d’empêcher que de tels incidents se produisent ? » — « Le patriarcat fait ce qu’il peut, mais sans grands résultats. À chaque fois que nous avons vent de comportements blasphématoires de ce type pendant les offices — ce dont nous informent nos évêques sur place, le clergé ou même les fidèles —, nous protestons et portons plainte auprès du Conseil aux affaires de l’Église orthodoxe pour de tels désordres. Nous leur demandons d’appliquer des sanctions contre les coupables et de prendre des mesures pour éviter que pareils faits se reproduisent. En règle générale, nous recevons une réponse quelques mois plus tard, nous informant que l’enquête n’a pas confirmé le bien-fondé de notre plainte et que cette plainte est rejetée. En ce qui concerne la milice, dans des cas pareils, elle disparaît tout bonnement et ne réapparaît qu’une fois l’incident terminé. »
J’étais intéressé à poursuivre cette conversation, pour comprendre ce qui se passait dans le pays avec l’Église et les fidèles. « Est-il vrai, comme je l’ai entendu dire, qu’en l’espace de ces six derniers mois, l’on a fermé plus de cinq cent églises dans le pays ? Comment procède-t-on à leur fermeture ? La loi ne stipule-t-elle pas que pour fermer un lieu de culte, il faut l’accord des fidèles ? », demandai-je. — « C’est vrai, poursuivit le métropolite, on ferme des églises et il y a de nombreuses façons de le faire. Il y en a une par exemple, qui est assez pacifique et soi-disant légale. prenons une église avec un bon prêtre, plein d’ardeur. Il prêche, il organise des processions… » — « Vous voulez dire qu’il prêche contre l’athéisme ? », l’interrompis-je. — « Oh non, certainement pas, il prêche, tout simplement. Beaucoup ont pris peur et ne prêchent plus du tout, mais lui continue. » — « Les processions sont donc interdites ? », m’étonnai-je. — « Elles sont autorisées uniquement autour de l’église et deux fois par an, pour Pâques et pour la fête paroissiale. Mais notre prêtre en organise plus de deux et continue à prêcher. Eh bien, le préposé aux affaires religieuses (60) le raye des registres ou réclame son transfert dans une autre paroisse sous peine de le rayer des registres. L’évêque est contraint d’obéir et nomme un nouveau prêtre dans cette paroisse. Mais le préposé aux affaires religieuses refuse obstinément, sous divers prétextes, d’inscrire dans les registres le nouveau prêtre que l’évêque tente de nommer dans cette paroisse. Pendant plus de six mois, aucun office n’est célébré dans cette église et les autorités procèdent à sa fermeture, puisqu’elle ne fonctionne plus. »
J’étais stupéfait par ce que j’entendais, et je demandai au métropolite Nicolas de poursuivre son récit.
« Je puis vous citer des procédés plus brutaux de fermeture d’églises. Les autorités fixent un jour, généralement le dimanche après l’office, alors que les fidèles sont rentrés chez eux. À l’heure dite, une foule de plusieurs centaines de personnes — des communistes, des membres du komsomol, tout ce qu’on appelle les militants — se réunit devant l’église, munie des instruments nécessaires et pendant quelques heures s’acharne à dégrader et démolir physiquement l’église ; pour ce qui est des objets de culte, livres, vêtements sacerdotaux, etc., ils les chargent sur un camion et les emmènent on ne sait où. » — « Mais cela ne se passe probablement que dans les campagnes ? », demandai-je, complètement abattu par le récit du métropolite Nicolas. — « Non, pas du tout, cela se passe même dans des villes relativement importantes », répondit-il.
Je lui demandai ensuite ce qu’il pensait de la récente condamnation à trois ans de prison de l’archevêque Job (Kressovitch) de Kazan (61) et des accusations d’abus de biens sociaux et de fraude fiscale dont il était l’objet (62). La nouvelle de cette condamnation nous était parvenue par la presse à l’étranger et, lors de mon séjour à Moscou, un grand article était paru dans Russie soviétique qui l’attaquait avec vigueur et décrivait le déroulement de son process (63).
« Ces accusations de malversations sont tout à fait fausses, ou alors au moins fausses à 80%, répondit le métropolite Nicolas. Je vais vous expliquer le fond de cette affaire. L’archevêque Job était un évêque actif, il prêchait, il rendait visite à ses paroisses, il luttait contre l’athéisme, il résistait à la fermeture des paroisses. Évidemment, cela déplaisait beaucoup aux autorités civiles et il fut décidé de s’en débarrasser. Mais comme on ne pouvait décemment pas retenir contre lui ses activités pastorales, on entama une action pour non-paiement d’impôt. Il se fait que nos évêques reçoivent un salaire mensuel fixe (disons 5 000 roubles) mais aussi une somme (de 10 000 roubles environ) pour frais de représentation. Cette somme est affectée à leurs frais de transport, au salaire d’un secrétaire, à l’achat et l’entretien d’une voiture, etc. Il est communément admis que seul le salaire fixe soit déclaré à l’inspection des finances et, par-là même, soumis à l’impôt. Les frais de représentation, par contre, ne sont pas déclarés et sont exempts d’impôts. C’est une pratique établie depuis longtemps et que le gouvernement connaît parfaitement. Jamais, il n’a fait la moindre objection à cet état de fait. L’archevêque Job faisait comme tout le monde. Et voilà que soudain, on le traîne en justice pour avoir dissimulé à l’inspection financière le montant de ses frais de représentation. Mais ce chef d’accusation pourrait être retenu contre tous les évêques, moi y compris. En outre, quand une personne est accusée de dissimulation de revenus, elle n’est jamais immédiatement poursuivie, on la convoque d’abord à l’inspection financière pour s’expliquer ; si l’accusation se révèle fondée, on lui fixe un délai pour régler le montant de la somme incriminée et ce n’est qu’en cas de refus que l’on fait passer l’affaire au tribunal. Mais l’archevêque Job a immédiatement été traduit en justice. Ses fils, qui sont ingénieurs, ont eu beau régler le montant de la somme que l’on exigeait de lui, il a été condamné à trois ans de prison, ce qui constitue une peine d’une sévérité inusitée dans les affaires fiscales. On l’a aussi accusé de falsifier sa comptabilité. Au pire, on peut lui reprocher d’avoir tenu ses comptes avec négligence, mais en aucun cas, il n’a commis d’abus. Le procès tout entier s’est tenu dans une atmosphère monstrueuse, incroyable, et les journaux en rendaient compte en déformant tout ce qui s’y disait. Toute cette affaire a clairement été montée dans le but de lancer un avertissement aux autres évêques afin qu’ils se tiennent tranquilles et ne luttent pas contre l’athéisme. On pourrait entamer une procédure de ce type contre chacun de nous.«
Je demandai au métropolite Nicolas s’il me permettait et s’il jugeait nécessaire de raconter cela à l’étranger. Le métropolite resta pensif quelques instants (visiblement, ma question le mettait mal à l’aise).
« Oui, dit-il finalement, on peut raconter ces choses, ce serait même utile, mais sans donner trop de détails et sans citer mon nom. Et ne parlez pas en votre nom propre, pour qu’on ne puisse pas deviner d’où provient l’information. En revanche, ce n’est pas la peine de raconter tout cela aux jeunes gens qui sont venus ici avec vous de France. À quoi bon troubler ces jeunes âmes ? »
(Le métropolite voulait parler du groupe de jeunes de notre exarchat qui, sur invitation du patriarcat, était venu de Paris en même temps que moi, bien que de son côté.) Je pensai, au contraire, qu’il convenait que ces jeunes connaissent la vérité au sujet de ce qui se passait dans le pays, mais ne fis pas part de mes réflexions au métropolite Nicolas.
« Vous me parlez de la situation précaire de l’Église de Russie et des persécutions qu’elle subit, dis-je, mais il y a à peine quelques semaines, une délégation de moines de l’Église russe est venue en Grande-Bretagne, menée par l’archimandrite (maintenant devenu évêque) Nicodème (64). Aux questions que lui ont posées les Anglais, Mgr Nicodème a répondu que l’Église de Russie était libre et qu’elle ne subissait ni persécutions, ni même tracasseries. »
Le métropolite sourit tristement. « Si j’avais été à la place de Mgr Nicodème à Oxford, j’aurais probablement dit la même chose que lui. »
Je posai enfin une dernière question au métropolite Nicolas (à ce moment-là nous étions habillés, les sous-diacres nous avaient laissés seuls et nous étions assis côte à côte dans de moelleux fauteuils recouverts de housses blanches, dans le sanctuaire de la cathédrale). « Et peut-on faire confiance à votre successeur au Département des relations extérieures, l’évêque Nicodème ? C’est une question qui se pose dans notre exarchat et sur laquelle, personnellement, je voudrais connaître votre opinion. »
Le métropolite Nicolas fit une grimace expressive, comme s’il tentait d’avaler quelque chose de parfaitement répugnant et désagréable. Dans le même temps, il secouait la tête à droite et à gauche en la tenant légèrement penchée, et gardait obstinément le silence, un léger sourire aux lèvres. Je lui répétais ma question. « Alors, on peut lui faire confiance ou non ? », mais n’obtins pas de réponse. On nous appela, il était temps de commencer la liturgie et nous sortîmes par les portes royales pour nous rendre au milieu de l’église.
Comment expliquer ce silence que le métropolite Nicolas opposa à ma question, après tant de récits francs et de réponses directes sur des thèmes non moins délicats ? J’y ai beaucoup réfléchi. Peut-être son silence était-il dû à sa prudence, à sa méfiance ? Mais alors pourquoi s’était-il départi de cette prudence pour répondre à mes premières questions ? On peut plutôt supposer que malgré toute l’antipathie qu’il ressentait à l’endroit de l’évêque Nicodème (et qu’il avait exprimée par sa grimace), sa conscience d’évêque et son sens des responsabilités ne permettaient pas au métropolite Nicolas d’accuser ouvertement l’évêque Nicodème. Il ne pouvait pas le faire sans preuves suffisantes. Et malgré son signe de la tête qui semblait conseiller la méfiance envers l’évêque Nicodème, son silence semblait vouloir dire le contraire.
Après la liturgie solennelle célébrée en la cathédrale patriarcale par les deux patriarches avec la participation d’une multitude d’évêques, nous, les concélébrants, fûmes tous invités à déjeuner avec le patriarche Alexis dans les locaux du patriarcat de la rue Tchisty. Les inévitables Kouroïedov et Makartsev étaient au nombre des convives.
Avant le début du repas, le patriarche me dit. « Vous êtes élevé au rang d’archevêque de Bruxelles et de Belgique. Voilà le décret du Saint-Synode. Il comporte une erreur. Au lieu d’archevêque « de Bruxelles et de Belgique », il y est écrit « de Belgique et de Bruxelles ». Nous n’avons pas eu le temps de la corriger. N’y faites pas attention. » Puis il ajouta avec une ironie à peine perceptible. « Vous deviez vous y attendre ? »
Il m’était difficile de répondre. Avant ma conversation de la veille avec le métropolite Nicolas, il ne m’était jamais venu à l’esprit qu’on allait m’élever au rang d’archevêque, car cela faisait à peine plus d’un an que j’étais évêque. Mais, suite à ma conversation avec le métropolite Nicolas, j’avais deviné ce qui allait se passer. Je ne voulais cependant pas le « trahir ». C’est pourquoi je répondis. « Non, je ne m’y attendais pas. »
« C’est étonnant, s’exclama le patriarche, pourtant, ce rang vous est dû de par votre position en Belgique (65). Il est vrai que nous aurions pu attendre un peu, mais puisque vous êtes ici, nous avons décidé de vous faire archevêque sans plus tarder. »
Et se tournant vers Kouroïedov qui se tenait non loin de nous, le patriarche se mit en devoir de lui expliquer que la veille, lors d’une réunion du Synode, j’avais été fait archevêque, conformément à ce qu’exige la situation de notre Église en Belgique. Kouroïedov ne répondit rien. Je suis intimement convaincu que l’initiative de ma nomination anticipée au rang d’archevêque revient entièrement au métropolite Nicolas.
Tard dans la soirée de ce même jour, le téléphone sonna dans la chambre que j’occupais à l’hôtel « Sovietskaïa ». Je décrochai le combiné. « Ici une telle (j’ai oublié son nom), du service de nuit du patriarcat. Je vous passe le métropolite Nicolas. »
Quelques secondes plus tard, j’entendis la voix du métropolite Nicolas. « J’ai entendu dire que, demain, vous alliez chez Makartsev. S’il vous plaît, dites-lui ce que vous m’avez dit. à quel point mes activités en faveur de la lutte pour la paix sont connues à l’étranger, que j’y jouis d’une large notoriété, qu’on y apprécie mes interventions et que ces interventions sont importantes pour le prestige de l’Union soviétique [cela, je ne l’avais jamais dit expressément au métropolite Nicolas. Je l’avais dit à Kouroïedov dans l’espoir d’aider le métropolite Nicolas à venir en France — A. B]. Je vous supplie de lui dire cela, ce qui m’aidera beaucoup. » J’acceptai, sans grand enthousiasme. Je ressentais une certaine pitié pour le métropolite Nicolas. lui qui, tout récemment encore, était le hiérarque quasiment le plus puissant et influent du patriarcat de Moscou, en était à solliciter l’aide et le secours d’un évêque-émigré venu de l’étranger, bien plus jeune que lui, tant en âge qu’en années de sacerdoce.
Mais le rendez-vous que nous nous étions fixé avec Makartsev pour trois heures de l’après-midi le vendredi 22 juillet, n’eut finalement pas lieu. Au dernier moment, je fus invité pour deux heures à un banquet donné par l’évêque Basile (Samaha), représentant du patriarcat d’Antioche auprès du patriarche de Moscou, avant son retour dans son pays natal. Ce banquet devait avoir lieu dans la résidence secondaire de l’évêque au Serebriany Bor, près de Moscou. Je ne vais pas, dans ce récit, faire une grande place à l’évêque Basile (cela n’entre pas dans le cadre de mes mémoires concernant le métropolite Nicolas), je dirai seulement qu’il avait une réputation douteuse aussi bien morale que politique (j’avais entendu dire cela à l’étranger et dans certains cercles appartenant au patriarcat d’Antioche). Je ne décrirai pas non plus le banquet en question, qui fut dans son ensemble assez pittoresque et étonnant. Je dirais seulement qu’outre le patriarche Alexis, le métropolite Nicolas et d’autres dignitaires de l’Église, il y avait parmi les invités Kouroïedov, Makartsev, ainsi que des ambassadeurs de pays arabes et de Perse.
L’évêque Basile (Samaha) fit un long discours politico-ecclésiastique, durant lequel, avec une éloquence toute orientale, il fit un éloge dithyrambique de chaque personne présente. du patriarche, aussi bien que de Kouroïedov, du Conseil aux affaires de l’Église orthodoxe (et du gouvernement soviétique par la même occasion), du métropolite Nicolas et même de moi…
Mais tout cela sort du cadre de mon propos. Je noterai seulement que lorsque Samaha se mit à chanter les louanges du métropolite Nicolas comme d’un grand combattant pour la paix, le métropolite Nicolas, qui jusque là s’était tenu à l’écart, assis à une petite table dans un coin, l’air renfrogné, se leva, bondit presque de son siège et d’une voix criarde, quasiment hystérique, s’écria. « Oui, pour la paix, je suis prêt à me battre jusqu’à ma dernière goutte de sang ! »
Le banquet se termina vers cinq heures et, le soir même, je devais prendre le train pour Leningrad. Nous convînmes avec Makartsev de nous voir à mon retour à Moscou. Nous nous mettrions d’accord par téléphone pour préciser notre rendez-vous. Je n’ai quasiment pas parlé, à ce banquet, au métropolite Nicolas, mais qui pouvait prévoir que nous ne nous reverrions plus ?
À Leningrad, j’eus l’occasion de parler ouvertement du métropolite Nicolas avec l’archiprêtre Alexandre Medvedski (66) (décédé en 1973) recteur de la cathédrale Saint-Nicolas-des-Marins (67), dont j’avais fait la connaissance lors de ma visite en 1956.
« C’est sûr, la nouvelle du départ à la retraite du métropolite Nicolas nous a tous frappés comme la foudre, dit-il. C’est notre métropolite Pitirim (68) [Sviridov, décédé en 1963 — A. B] qui nous a appris la nouvelle à son retour de Moscou où il avait participé à la réunion du Synode. On y avait débattu de l’acceptation de la lettre de démission du métropolite Nicolas. « Votre Sainteté, déclara le métropolite Pitirim lors de la discussion, je préfère que ma main se dessèche plutôt que signer le décret d’acceptation de la démission du métropolite Nicolas. » — « Il le faut ! » fut la réponse, en coup de tonnerre, du patriarche. Et, étonnamment, le métropolite Nicolas ajouta lui-même. « Il le faut ». Alors j’ai signé. »
À la suite de ce récit, je demandai au père Medvedski. « Mais pourquoi le métropolite Nicolas a-t-il écrit une telle requête ? Qu’est-ce qui a pu le pousser à faire une chose pareille ? » — « C’est difficile à dire. À mon avis, on a dû exiger de lui des choses que sa conscience lui interdisait d’accepter. Alors, il a préféré partir à la retraite », me répondit-il.
Je rentrai à Moscou le 28 juillet. J’avais décidé de ne pas voir Makartsev. À Leningrad, j’en avais trop appris sur la terrible situation de l’Église dans le pays et, lors d’une entrevue avec Makartsev, j’aurais été obligé soit de taire mes impressions (ce qui me semblait inadmissible), soit de lui dire franchement le fond de ma pensée, ce qui aurait représenté un danger pour les personnes avec qui j’avais été en contact.
Je n’avais d’ailleurs aucune envie de « dévoiler mon jeu » à Makartsev en lui laissant voir à quel point j’étais renseigné sur la véritable situation de l’Église en Russie.
Il y avait des raisons sérieuses à cette réticence. Quant à « aider » le métropolite Nicolas, dans les circonstances présentes, cela me semblait malheureusement impossible. Aussi, quand l’archiprêtre Paul Sokolovski (69) (qui devait périr dans un accident d’avion au-dessus de Prague, en 1973) me demanda quand je comptais voir Makartsev, je répondis que je n’aurais pas le temps de le voir avant mon départ. Cela déplut manifestement au père Sokolovski, mais il n’en dit mot.
Le jour suivant alors que je prenais mon thé matinal dans ma chambre à l’hôtel Sovietskaïa, le père Sokolovski me dit que quelqu’un désirait me voir. Je sortis dans le vestibule pour y trouver une dame d’une cinquantaine d’années, en robe marron plutôt démodée, l’allure d’une personne cultivée, portant des lunettes, si je ne me trompe. Elle me demanda la bénédiction, me tendit une lettre en disant. « C’est de la part du métropolite Nicolas » et repartit.
Je revins dans ma chambre et le père Sokolovski me dit. « C’est Zoé Mikhaïlovna, la secrétaire du métropolite Nicolas. Elle a beaucoup d’influence sur lui. Il ne fait rien sans elle. »
Je ne sais si le père Sokolovski avait vu qu’elle m’avait donné une lettre. Je crois que non, mais qu’il l’avait deviné. D’ailleurs, je ne m’en cachai pas, et décidai de lire la lettre immédiatement.
Je pensais qu’il n’y avait dans cette lettre rien de très important, et que le métropolite Nicolas me proposerait de nous voir une dernière fois avant mon départ. En d’autres termes, je m’assis et lus (silencieusement, bien entendu) la lettre. Celle-ci, que je garde précieusement dans mes archives, était entièrement écrite à la main. En voici le contenu :
Très cher et bien-aimé Monseigneur Basile !
À votre retour de Leningrad, j’ai essayé à plusieurs reprises de trouver le moyen de vous rencontrer, vous et S. Nic. [Bolchakov, qui était lui aussi venu à Moscou sur invitation du patriarcat — A. B.] ainsi que les jeunes gens. Le nouveau responsable du Département des relations extérieures et son collaborateur [Bouïevsky — A. B.] m’ont tenu loin de vous. Je n’ai même pas pu disposer d’une petite heure pour vous rencontrer, alors que vous, probablement, vous ignoriez tout de mes tentatives. Tout cela est bien triste !
Je vous serre dans mes bras, très fraternellement.
Transmettez, s’il vous plaît, les lettres ci-jointes à leurs destinataires. Je me sens très oppressé.
Dites à S. Nic. [Bolchakov — A. B.] que je suis dans l’impossibilité de lui accorder un entretien.
Transmettez à vos jeunes ma profonde reconnaissance pour leur lettre et le livre qu’ils m’ont offert. Dire qu’on ne m’a pas permis de les rencontrer !
Je vous serre dans mes bras fraternellement et donne ma bénédiction à tous les autres. Je vous dis au revoir à tous — à distance, hélas !
Si Son Éminence votre exarque ou qui que ce soit d’autre désire m’écrire, qu’il le fasse à mon adresse personnelle exclusivement. à mon nom, Baumanski 6, Moscou 5.
Je vous souhaite bon voyage ! Et succès dans votre travail avec la bénédiction de Dieu, cher Monseigneur !
Priez pour moi !
Je ne comprends pas ce qui m’arrive.
Je serai toujours avec vous tous en esprit.
Avec mon affection éternelle,
Votre M. N.
Le 29 juillet 1960.
Ayant lu cette lettre, je mis tout en œuvre pour pouvoir rencontrer ou au moins parler au métropolite Nicolas par téléphone. Je dis au père Sokolovski qu’il m’était absolument indispensable avant mon départ de voir le métropolite Nicolas, pour lui faire mes adieux. Il appela le patriarcat, où on lui dit que le métropolite Nicolas n’était pas là, mais qu’il allait arriver et qu’il y resterait jusqu’à trois heures. Je demandai qu’on lui dise que je souhaitais le voir. Quand je rappelai, on me répondit (je crois que c’était Bouïevsky) que le métropolite était passé au patriarcat, mais qu’il était reparti plus tôt que prévu, pour accompagner à l’aéroport le patriarche, dont l’avion pour Odessa décollait à une heure. On n’avait pas eu le temps de lui transmettre ma requête, mais on me promit que ce serait fait à l’aérodrome. Plus tard, je rappelai encore le patriarcat, où l’on me répondit que le métropolite, après le départ du patriarche, était rentré directement chez lui, et qu’on n’avait donc rien pu lui transmettre. Quant à lui parler avant le départ du patriarche, cela s’était révélé impossible, car le métropolite Nicolas ne répondait jamais au téléphone. À la fin de ses journées de travail au patriarcat, le métropolite « s’enfermait » chez lui et il devenait impossible de le joindre, même en cas d’extrême urgence. Il ne répondait pas plus si l’on sonnait à sa porte et n’ouvrait absolument à personne. Le patriarcat en avait fait bien des fois l’expérience. Et en effet, c’est en vain que j’essayai, aussi bien dans la journée que tard le soir, de le joindre au téléphone à son domicile. Personne ne répondit.
À trois heures de l’après-midi, j’étais au patriarcat, dans les locaux du Département des relations extérieures (qui se trouvaient encore à l’époque à la même adresse que le patriarcat, rue Tchisty (70)), pour m’entretenir avec l’évêque Nicodème (Rotov) et lui faire mes adieux. Nous parlâmes longuement avec lui des affaires de l’exarchat, mais aussi de mes impressions sur la situation de l’Église. Comme toujours (ou presque toujours) avec lui (sauf pour les questions pratiques), notre conversation ne fut qu’à moitié franche. Sans citer mes sources, évidemment (le métropolite Nicolas n’était d’ailleurs pas mon seul informateur, loin s’en faut), je lui fis part de mes inquiétudes à propos de la vie ecclésiale et paroissiale dans le pays. L’évêque Nicodème acquiesçait parfois à mes propos, mais souvent il apportait ses explications ou ses corrections à mes opinions, ou alors il déclarait qu’il ignorait tout des événements auxquels je faisais allusion (il prétendit ne rien savoir des incidents à Kiev pendant les matines de Pâques que je lui racontai en prétendant l’avoir appris en Occident par des touristes français qui avaient assisté à ces matines).
« C’est très intéressant. Je ne sais rien à propos de cet incident. Il conviendrait d’en vérifier la véracité », dit l’évêque Nicodème.
Bouïevsky était présent tant que nous parlâmes de questions pratiques, mais ensuite, l’évêque Nicodème le congédia et commença, sur un ton très grave, à me parler du métropolite Nicolas. « Je sais que dans votre exarchat d’Europe occidentale, le métropolite Nicolas est très apprécié et que vous êtes nombreux à penser que son départ à la retraite lui a été imposé mais qu’il reviendra bientôt à son poste de président du Département des relations extérieures de l’Église. Je me dois de vous affirmer catégoriquement (et je vous prie de transmettre officiellement cette information de ma part à votre exarque et à tout l’exarchat). le départ du métropolite Nicolas est définitif. Il ne reprendra jamais ses anciennes fonctions. Vous devez le comprendre et cesser d’espérer son retour, ne pas entreprendre de démarches en ce sens et collaborer avec les personnes que le patriarcat a nommées pour le remplacer. Et vous pouvez être assurés de rencontrer de notre part encore plus de bienveillance à votre égard et d’attention à vos besoins et problèmes que du temps du métropolite Nicolas. »
« Monseigneur, répondis-je, vous pouvez être sûr que nous collaborerons loyalement et fraternellement avec vous, comme c’est notre devoir, car nous ne servons pas des personnes, mais l’Église orthodoxe russe. Il nous est suffisant de savoir que vous avez été nommé à vos fonctions par le Synode et Sa Sainteté le patriarche. Et nous savons que nous trouverons chez vous intérêt et bienveillance à l’égard de notre exarchat. Mais cela ne peut nous empêcher de regretter le départ du métropolite Nicolas qui nous a toujours témoigné tant de bonté et d’intérêt. De plus, nous l’estimons beaucoup car c’est une personnalité marquante de l’Église orthodoxe russe. Nous sommes très affectés de ce qui s’est passé. »
« Et vous avez tort, répliqua l’évêque Nicodème. En Occident, vous vous êtes fait une fausse idée du métropolite Nicolas. Vous ne le connaissez pas suffisamment. Je vais essayer de trouver le mot juste pour le décrire. Vous avez probablement entendu une expression très à la mode chez nous en ce moment. le « culte de la personnalité (71) » ? Eh bien, le métropolite Nicolas était un exemple typique de ce genre de culte. De sa propre personnalité, bien entendu. Jetez un coup d’œil au dernier numéro du Journal du patriarcat de Moscou paru avant sa retraite. La moitié en est occupée par les lettres et télégrammes de félicitations qu’il a reçus pour les fêtes. Cela occupe deux fois plus d’espace que les lettres au patriarche. Et ses homélies, constamment publiées par le Journal du patriarcat ! Admettons qu’il prêche bien. Mais il n’est pas le seul dans l’Église russe ; il y en a d’autres ! Qu’est-ce que c’est que ce monopole ? Et c’est la même chose dans tous les domaines. Mais en ce qui concerne les affaires concrètes, le métropolite Nicolas est une nullité. Regardez ce qui se passe dans le diocèse de Moscou dont il est responsable en tant que métropolite de Kroutitsy et Kolomna. Il n’y a pas un diocèse de l’Église russe aussi négligé que celui-là. En gros, il ne termine jamais ce qu’il entreprend, il s’arrête toujours en cours de route. Prenez, par exemple, la réunification de l’exarchat russe et celui de Constantinople en 1945 (72). Pourquoi n’a-t-il pas obtenu la reconnaissance de cette réunification par le patriarcat de Constantinople ? À l’époque, cela aurait été possible. Au lieu de quoi, l’affaire est tombée à l’eau.
« Peut-être, mais le métropolite Nicolas n’en est pas moins très connu en Occident, très apprécié par les chrétiens des autres confessions et on ne peut pas ne pas en tenir compte », rétorquai-je. — « Bien au contraire, s’écria l’évêque Nicodème, par ses prises de positions extrêmes et inutilement brutales, il s’est attiré l’inimitié de tous, se rendant odieux et inacceptable pour la majorité. C’est en partie la cause de son renvoi. »
Après cette conversation intéressante et instructive avec l’évêque Nicodème, je me dirigeais vers la sortie, m’apprêtant à partir. Soudain, je fus rattrapé devant la porte de l’immeuble par A. S. Bouïevsky qui m’entraîna tout au fond de la cour du patriarcat, à un endroit où nul ne pouvait nous entendre. L’air extrêmement inquiet, la voix tremblante, il se mit de manière précipitée à me parler du métropolite Nicolas. Cette conversation dura plus d’une heure, et je n’en donnerai ici qu’un résumé concis.
« Vous allez probablement me condamner et — pour parler de façon grandiloquente — me « rayer des tablettes de votre cœur », commença Bouïevsky, car moi, l’un des plus proches collaborateurs du métropolite Nicolas, moi qui lui dois tant, à peine part-il à la retraite que me voilà en train de parler contre lui. Mais je ne peux pas me taire. Ma conscience me force à dire toute la vérité. Je vous dirai franchement que, s’il n’était pas parti, nous aurions, tous, dû partir. Il était devenu impossible de collaborer avec lui en aucune manière. Il était sujet à des explosions d’énergie débordante, suivies de longues phases de dépression, de prostration, durant lesquelles toutes nos activités étaient suspendues. Et il faisait tout lui-même ! Il ne désirait pas avoir de véritables collaborateurs. Pendant les longues années de sa présidence du Département des relations extérieures, il a refusé ou n’a pas réussi à former des cadres aptes à travailler dans ce Département, alors même que de nombreuses personnes avaient insisté sur la nécessité de cette formation. C’est honteux. pendant de longues années, moi, laïc et sans formation spécifique pour ce travail, j’ai été le seul collaborateur du Département. Pour des raisons de fierté, de gloire personnelle, il était prêt à tout, il pouvait accepter toutes les humiliations, pour lui aussi bien que pour l’Église. Par exemple, non content des nombreuses décorations qu’il possédait déjà, il s’est mis en tête de se faire attribuer par le Comité soviétique de défense de la paix le Prix Lénine de la paix. Pour ce faire, il m’a envoyé plusieurs fois voir le Comité, où j’ai du faire la liste de ses mérites dans la lutte en faveur de la paix et supplier qu’on lui accorde ce prix. C’était pénible et j’avais vraiment honte d’accomplir cette exigence du métropolite Nicolas. Par ces manœuvres pour recevoir ce Prix Lénine, il a tellement humilié et couvert de honte l’Église russe dans son ensemble ! Mais la fin de l’affaire est encore plus honteuse. Le gouvernement soviétique a fini par attribuer au patriarche Alexis une citation pour son action en matière de « défense de la paix », mais n’a rien accordé au métropolite Nicolas. Le métropolite s’est alors senti vexé et m’a envoyé dire au Comité pour la paix, qu’il renonçait au Prix Lénine !
« Au Comité, on m’a répondu d’un ton ironique que le métropolite Nicolas se faisait du souci pour rien, car nul n’avait jamais eu l’intention de lui attribuer ce prix. »
C’est ainsi que Bouïevsky acheva son récit.
Le soir du même jour, vendredi 29 juillet, un banquet fut organisé à l’occasion de notre départ, au restaurant Praga. C’était la veille de mon soixantième anniversaire, qui fut aussi fêté lors de ce banquet. Parmi les invités, il y avait l’évêque Nicodème et le protopresbytre (73) Vital Borovoï (74). Makartsev n’était pas là, lui qui manquait pourtant rarement de telles occasions. Visiblement, il m’en voulait de ne pas être venu le voir.
Après le dîner, je réussis à m’asseoir quelques instants à la table de A. V. Vedernikov (75), un proche du métropolite Nicolas qui, comme l’avenir allait le montrer, lui restait fidèle même dans sa disgrâce.
Je lui demandai à voix basse. « Dites-moi, quelles sont les vraies raisons du départ à la retraite du métropolite Nicolas ? »
Vedernikov, brusquement, me pressa le pied sous la table et me dit presque à l’oreille. « Il vous a déjà tout raconté lui-même ! »
Le lendemain matin, le 30 juillet 1960, je repartis pour Paris…
- Après les violentes persécutions contre la religion des années 1920-1930 en Union soviétique, une nouvelle offensive antireligieuse fut lancée à l’instigation de Khrouchtchev dès 1958. Cette persécution, administrative et idéologique, amena à la fermeture forcée de milliers d’églises et à la suppression de la majorité des séminaires et des monastères. Voir N. STRUVE, op. cit., 1968, p. 255-295; Jean MEYENDORFF, L’Église orthodoxe, hier et aujourd’hui, Paris, Éd. du Seuil, 1995, p. 127-128 et Mgr KALLISTOS (WARE), op. cit., p. 202-203.
- Voir N. STRUVE, op. cit., p. 276-277.
- Discours prononcé à la Conférence des organisations politiques et sociales soviétiques de l’URSS pour le désarmement. Le patriarche y vantait les mérites historiques de l’Église et dénonçait les injustices dont elle était victime. Texte dans N. STRUVE, op. cit., p. 331-333.
- Georges Grigorievitch Karpov (1898-1967), officier du NKVD et apparatchik soviétique. Président (1943-1960) du Conseil aux affaires de l’Église orthodoxe (organe soviétique de contrôle de l’Église).
- Voir N. STRUVE, op. cit., p. 271-274. Le métropolite Nicolas a non seulement été écarté de ses fonctions par le pouvoir soviétique, mais ce dernier ne semble pas étranger à sa mort mystérieuse le 13 décembre 1960.
- Saint Serge de Radonège (ca. 1314-1392), plus grand saint national de Russie, est fêté deux fois durant l’année liturgique orthodoxe. le 5/18 juillet et le 25 septembre/8 octobre.
- Père Matthieu Stadniuk (né en 1925), prêtre orthodoxe russe. Aujourd’hui, recteur de la cathédrale patriarcale de la Transfiguration à Moscou.
- Mgr Pimène (Khmelevski, 1923-1993), prélat orthodoxe russe. Prieur de la Laure de la Trinité-Saint-Serge (1957-65), évêque (1965), archevêque (1977). L’abbé de la Laure est, ex officio, le patriarche de Moscou et de toutes les Russies.
- Liturgique (NdT).
- Vladimir Alexeïevitch Kouroïedov (1906-1994), apparatchik soviétique. Président (1960-1984) du Conseil aux affaires de l’Église orthodoxe (voir n. 46), rebaptisé en 1965 « Conseil aux affaires religieuses ». Voir N. STRUVE, op. cit., p. 271.
- Voir n. 46.
- Père Feriz Berki (1917-2006), prêtre orthodoxe d’origine hongroise. Recteur de la paroisse de langue hongroise de Budapest et administrateur du doyenné des paroisses du patriarcat de Moscou en Hongrie
- Voir n. 7.
- Constantin Pobedonostsev (1827-1907), homme politique russe ultraconservateur. Tout-puissant haut-procureur (1880-1907) du Saint-Synode (organe d’administration de l’Église orthodoxe russe à l’époque des tsars).
- Mgr Éphrem II (Sidamonidze, ?-1972), prélat orthodoxe géorgien. Patriarche-catholicos de Géorgie (1960-1972).
- Bref office (lecture de psaumes) précédant la Liturgie eucharistique.
- Mouvement de jeunesse du parti communiste soviétique.
- Le Conseil aux affaires religieuses disposait de délégués locaux sur tout le territoire.
- Mgr Job (Kressovitch, 1898-1977), prélat orthodoxe russe. Évêque (1942), Archevêque (1954). Archevêque de Kazan (1957), il fut démis de ses fonctions en raison de sa condamnation pénale (1960) et fut réintégré à l’issue de celle-ci (1967).
- Voir N. STRUVE, op. cit., p. 270 et Jean MEYENDORFF, op. cit., p. 129.
- Sovietskaïa Rossia, 21 juin et 20 juillet 1960. Voir aussi les Izvestia du 8 juillet 1960.
- Voir « Chapitre 2. Le métropolite Nicodème (Rotov) ».
- L’arrêté (décret) royal du 5 juin 1937, par lequel l’État belge a reconnu l’archevêché de l’Église orthodoxe russe en Belgique, précise que l’évêque diocésain « porte canoniquement le titre d’archevêque orthodoxe russe de Bruxelles et de Belgique » (Moniteur belge des 14-15 juin 1937, p. 3773).
- Père Alexandre Medvedski (1890-1973), prêtre orthodoxe russe.
- Célèbre église baroque de Saint-Pétersbourg.
- Voir n. 22.
- Père Paul Sokolovski (1929-1973), prêtre orthodoxe russe.
- Depuis lors, le Département des relations extérieures du patriarcat a déménagé dans les locaux du monastère Saint-Daniel.
- Voir N. STRUVE, op. cit., p. 135-136.
- Voir n. 4.
- Dignité ecclésiastique orthodoxe, plus haut titre honorifique pour un prêtre séculier.
- Père Vital Borovoï (1916-2008), prêtre et théologien orthodoxe russe, collaborateur du Département des relations extérieures du patriarcat de Moscou, représentant de l’Église russe auprès du Conseil œcuménique des Églises à Genève, observateur au concile Vatican II.
- Anatole Vassilievitch Vedernikov (1901-1992), laïc orthodoxe russe, collaborateur du patriarcat de Moscou, secrétaire de rédaction du Journal du patriarcat de Moscou.
SUITE : « Mémoire des deux mondes » De la révolution à l’Église captive, 528 pages
Par Basile Krivochéine Les Éditions du CERF — 2010
Préface du Métropolite Hilarion (Alfeyev) de Volokolamsk, président du département des relations extérieures du patriarcat de Moscou — Traduction du russe de Nikita Krivochéine, Serge Model, Lydia Obolensky — Présentation, révision et notes de Serge Model
La seconde partie, les mémoires d’Église, débute trente années plus tard, quand le prêtre (1951), puis l’évêque (1959) commence à participer à plusieurs conciles et congrès internationaux. Sa position d’ « exilé » de l’Église russe fait de lui un observateur précis, parfois rude, voire critique, des instances orthodoxes, mais cet infatigable et dévoué serviteur de l’Église disait et écrivait immuablement ce qu’il pensait, quelles que soient les personnes mises en cause ou les circonstances.

Telles furent, dans les grandes lignes, mes relations avec le métropolite Nicolas de 1951 à 1956, pendant que je séjournais à Oxford. Ce n’est qu’en été 1956 qu’il me fut donné de le rencontrer personnellement, lors de mon premier voyage en URSS après trente-six ans d’interruption. Le patriarcat de Moscou avait invité un groupe de pèlerins de l’exarchat d’Europe occidentale, parmi lesquels l’archimandrite Denis Chambault (23), Vladimir N. Lossky (24), Olivier Clément (25) et Dimitri D. Obolensky (26), à visiter l’Union soviétique. Je faisais moi aussi partie du groupe. Notre séjour en Russie eut lieu entre le 9 et le 16 août ; nous visitâmes Moscou, la Laure de la Trinité-Saint-Serge, Vladimir, Leningrad et Kiev (27).
C’était probablement la période (et peut-être même l’année) la plus faste dans la vie de l’Église russe après la révolution. La terreur s’était relâchée, les prisonniers rentraient des camps, la déstalinisation était en cours, Khrouchtchev n’avait pas encore pris en main la totalité du pouvoir et il n’y avait encore aucun signe des nouvelles persécutions qui allaient s’abattre avec force sur l’Église à la fin des années cinquante. Les milieux ecclésiaux étaient pleins d’optimisme et d’énergie, on parlait de l’ouverture de nouvelles églises, de séminaires, etc.
Nous ne rencontrâmes pas le patriarche lors de cette visite, car il était en vacances à Odessa, mais nous vîmes plusieurs fois le métropolite Nicolas. À notre arrivée, il nous réserva un accueil charmant dans les locaux du patriarcat de la rue Tchisty, il s’adressa tout d’abord à notre groupe dans son entier, avant de s’entretenir avec chacun de nous en particulier. Il manifestait un vif intérêt pour la vie de l’Église en Occident. Son cœur de pasteur était manifestement blessé par l’histoire du jeune hiéromoine anglais Séraphim Robertson, homme plein de talent et qui semblait très prometteur, mais qui avait soudain tout abandonné pour se marier. Le métropolite Nicolas nous questionna pour savoir comment une chose pareille avait pu se produire. Il semblait plus affecté encore par l’affaire de l’archiprêtre Eugraphe Kovalevski (28) qu’il appréciait beaucoup et avec qui il avait sympathisé. « N’y a-t-il aucun espoir de le voir revenir au sein de notre Église ? », demanda-t-il.
Lors de notre entretien privé, nous parlâmes longuement du Mont Athos et je fus très heureux de trouver en lui une connaissance et une compréhension rares des affaires de l’Athos chez les hiérarques russes contemporains. À sa question sur les mesures concrètes par lesquelles on pouvait aider le monachisme russe, je répondis. « Il faut obtenir des autorités grecques l’autorisation pour dix personnes de se rendre au Mont Athos pour devenir moines au monastère de Saint-Pantéléimon. Il faut se limiter à dix personnes pour commencer, par crainte d’effrayer aussi bien les monastères grecs que les autorités civiles, ce qui n’est pas souhaitable. Mais un groupe plus réduit aurait des difficultés à s’adapter et ne pourrait pas apporter de renouveau à un monastère en déclin. Notre requête d’accès pour des moines de Russie est justifiée par une tradition séculaire et par des accords internationaux ; le gouvernement grec pourra difficilement nous opposer un refus, même s’il tentera de le faire. Il est surtout important de rester dans le cadre de la loi et d’agir par l’intermédiaire du patriarcat œcuménique. »
Je développai ces idées au métropolite Nicolas. « Il ne serait pas sage de soulever la question d’une révision des statuts de l’Athos qui, bien que souvent injustes, ont force de loi. Sinon, il faudrait aussi contester la juridiction du patriarcat de Constantinople, la nationalité grecque des moines russes, etc. Par ces contestations, nous n’obtiendrions rien d’autre que l’inimitié des moines athonites grecs ainsi que celle de l’opinion publique et les résultats en seraient désastreux pour nous. Le gouvernement grec prendrait prétexte de nos prétentions pour refuser l’accès à des moines de Russie. Pour l’heure, une seule chose compte. obtenir l’admission d’un premier groupe de moines russes, sans quoi le monachisme russe à l’Athos mourra, le monastère de Saint-Pantéléimon passera aux Grecs et on ne pourra plus jamais le récupérer. »
Le métropolite Nicolas approuva mes paroles et souligna qu’il ne convenait pas de contester les lois athonites existantes, et encore moins la juridiction du patriarcat de Constantinople sur les communautés russes du Mont Athos. « Puisqu’ils ont été, par le passé, au sein du patriarcat de Constantinople, comment pourrions-nous exiger qu’il en fût autrement maintenant ? Nous ne voulons qu’une chose. l’admission de moines russes sur le Mont Athos ; c’est là notre tâche principale. »
J’étais heureux d’une telle position. la compréhension que le métropolite Nicolas semblait avoir de la situation au Mont Athos était « rare », car l’année précédente, en 1955 à Londres, il m’avait été donné de discuter sur le même thème avec le métropolite Pitirim. Je lui avais dit à peu près la même chose que ce que je venais d’expliquer au métropolite Nicolas, mais sa réaction avait été tout autre. Le métropolite Pitirim m’avait interrompu en frappant du poing sur la table et s’était exclamé avec irritation. « Non, vous avez tort. La question du Mont Athos a été abordée par notre Saint-Synode et il a été décidé d’exiger que nos monastères passent sous notre juridiction ! » — « Mais c’est impossible », avais-je répondu. — « Nous en avons décidé ainsi », insista le métropolite Pitirim.
Voyant qu’il était inutile de discuter avec lui, je n’avais pas poursuivi cette conversation et m’étais senti attristé à l’idée que nos hiérarques, par leur méconnaissance de la situation et leur obstination, allaient mettre à mal la situation du monachisme russe au Mont Athos.
J’étais d’autant plus heureux de constater maintenant la largesse d’esprit et la compréhension pénétrante de ce sujet délicat par le métropolite Nicolas, de trouver celui-ci prêt à entendre les opinions de personnes qui parlaient d’expérience.
Nous rencontrâmes encore une fois le métropolite Nicolas et, à cette occasion, il m’offrit une croix pectorale ornée, de celles que portent généralement les archimandrites, alors que je n’avais même pas encore reçu la croix simple en or. « C’est un cadeau de Sa Sainteté le patriarche, me dit-il, je lui ai parlé par téléphone à Odessa. Ne me dites pas que cela ne correspond pas à votre rang (j’étais seulement hiéromoine à ce moment-là), le patriarche vous donne sa bénédiction pour la porter. » Lorsque, quelques jours plus tard, nous rendîmes visite à la mère Euphrosyne, sœur du patriarche, au monastère de la Protection-de-la-Mère-de-Dieu à Kiev, celle-ci me fit la remarque que la croix que je portais ne correspondait pas à mon rang. Je lui expliquai que c’était sur la bénédiction du patriarche lui-même et elle en fut étonnée.
La veille de notre départ, nous eûmes une dernière entrevue avec le métropolite, à l’hôtel Sovietskaïa (l’ancien Iar), lors d’un banquet qu’il donnait en notre honneur. C’était déjà le carême de la Dormition et nous étions vendredi, le repas suivait donc strictement les règles du jeûne. On ne nous servit pas même de poisson, mais les mets étaient abondants, variés et recherchés. Le métropolite Nicolas se comportait en hôte charmant, accueillant et attentionné ; dans son discours, il eut un mot pour chacun de nous en particulier, ainsi que pour notre groupe en tant que délégation de l’exarchat d’Europe occidentale. Il n’évoqua que des thèmes ecclésiaux, ne dit pas un mot à portée politique ni ne fit la moindre allusion à la « lutte pour la paix ». Il m’appelait « notre cher Athonite ».
Après une si longue absence de Russie, il m’était difficile d’espérer, dès ma première visite en URSS, d’établir des relations de confiance avec des personnes qui non seulement seraient au courant des affaires de l’Église mais qui, de plus, oseraient parler franchement. Cependant même maintenant, après de nombreuses années et à la lumière de l’expérience des voyages ultérieurs, je continue à penser que nos impressions d’alors étaient en grande partie exactes. l’Église menait à ce moment-là une vie relativement calme et sereine.
Pour conclure, je dirai que lors de ce séjour en Russie en 1956, je n’eus pas l’occasion de parler avec le métropolite Nicolas de la situation de l’Église en URSS ; il n’aborda pas cette question de lui-même et je ne lui demandai rien. De manière générale, nos conversations, même si elles se déroulaient sur un mode cordial, restèrent assez superficielles (exception faite de notre entretien à propos du Mont Athos). On peut dire la même chose de la majorité des rencontres et contacts que nous eûmes lors de ce séjour.
À mon retour en Grande-Bretagne, ma correspondance avec le métropolite Nicolas se poursuivit et devint même plus fréquente. Il se mit à répondre à mes vœux pour Pâques et pour Noël par des lettres chaleureuses, parfois même assez longues, il s’intéressait aux affaires de l’Athos et exprimait sa reconnaissance de me voir « ainsi dévoué et préoccupé des moyens de compléter les effectifs du monastère de Saint-Pantéléimon du Mont Athos par des moines russes » (Lettre du 12 janvier 1957).
Je reçus aussi une lettre dans laquelle il me remerciait du récit de mon voyage d’août-septembre 1957 en Grèce et à Constantinople et particulièrement de la description de mon entretien avec le patriarche œcuménique Athénagoras (29) à propos de l’Église de Finlande (30). Cette conversation avait été l’initiative du patriarche lui-même car mon voyage au Proche-Orient avait un objectif purement scientifique ; je venais pour consulter les manuscrits de saint Syméon le Nouveau Théologien et évitais de prendre la moindre initiative ecclésiale, n’ayant aucun mandat en ce sens de l’Église russe. « Je suis heureux d’apprendre, écrivait le métropolite Nicolas dans sa lettre datée du 31 décembre 1957, que le patriarche œcuménique Athénagoras est satisfait du règlement de la situation de l’Église orthodoxe de Finlande. Nous sommes déterminés à adopter une ligne de conduite similaire pour résoudre les situations de ce type et espérons pouvoir compter sur la même bienveillance de sa part, notamment en ce qui concerne le règlement de la question [du Mont Athos] pour laquelle nous n’avons à ce jour reçu aucune réponse du patriarcat œcuménique. Nous serons toujours heureux de connaître vos suggestions, dictées par votre dévouement à la cause de notre sainte Église. »
Notre correspondance avec le métropolite Nicolas était intéressante et portait sur des sujets variés. Il portait un intérêt vif et bienveillant à mes travaux en vue de la publication des œuvres de saint Syméon le Nouveau Théologien. Il se fait que l’un des plus précieux manuscrits des Catéchèses de saint Syméon le Nouveau Théologien se trouvait au Musée historique de Moscou. Il aurait été impensable d’envisager une publication critique du texte grec sans y inclure ce manuscrit. Pendant plusieurs années (de 1952 à 1956), j’avais tenté par tous les moyens d’obtenir un microfilm ou une photocopie de ce manuscrit, mais toutes mes tentatives, y compris par l’intermédiaire de l’ambassade de Grande-Bretagne à Moscou, étaient restées vaines. Tantôt le Musée historique ne me répondait pas, tantôt il me faisait savoir que le manuscrit était dans un état tel qu’il était techniquement impossible de le photographier (je compris par la suite que ce n’était pas la vérité, mais un prétexte pour refuser). En août 1956, lors de mon séjour à Moscou, je me rendis personnellement au département des manuscrits du Musée historique et pus vérifier que mon manuscrit se trouvait dans un état tout à fait satisfaisant. Les silences ou les refus de la direction du Musée s’expliquaient par le fait que ce musée ne possédait pas le matériel nécessaire au microfilmage des documents, ce que la direction avait honte d’avouer. L’unique solution était de photographier ces manuscrits avec un appareil photographique classique, et le musée en possédait un, mais en raison de la longueur du manuscrit (environ deux cents pages) cette solution se serait avérée très onéreuse.
Je m’adressai au métropolite Nicolas pour lui demander son appui dans le but d’obtenir une photocopie du manuscrit, il me promit de faire son possible. Et effectivement, huit mois plus tard, en mars 1957, je reçus à Oxford d’excellents clichés du manuscrit tant désiré, ce dont je suis très reconnaissant au métropolite Nicolas. Il a rendu possible l’achèvement de mon travail.
Il est vrai que par la suite un des détracteurs du métropolite Nicolas, lorsque je lui racontai l’histoire des clichés du manuscrit et de l’aide reçue, me dit. « Vous pensez que c’est le métropolite qui vous a aidé ? Vous vous trompez, il se contente toujours de promettre, mais ne fait jamais rien. Vous n’auriez jamais vu la fin de votre affaire sans l’intervention d’un jeune collaborateur du patriarcat, un ancien élève de l’académie de théologie de Moscou qui, de sa propre initiative, désirant vous venir en aide, a pris les choses en main. Il s’est rendu plusieurs fois personnellement au Musée historique, a fait les démarches nécessaires et a fini par tout arranger. » Je pense que c’est là une spéculation injuste. Il se peut que le métropolite Nicolas ait délégué la réalisation matérielle de ma requête à cette personne, ce qui est bien naturel, car on ne pouvait tout de même pas s’attendre à ce que le métropolite aille en personne faire des photocopies au musée. Mais il y avait aussi à régler le côté financier de l’affaire, ce dont je suis encore plus redevable au métropolite Nicolas. Pour ces photocopies, on m’avait, en effet, réclamé une somme défiant l’imagination (20.000 roubles de l’époque, ce qui équivalait à 2.000 dollars), dont je ne disposais pas. Il y eut une décision spéciale du Saint-Synode pour la prise en charge de ces frais. Le métropolite Nicolas avait fait le nécessaire pour la délivrance de cette somme.
J’eus également affaire au métropolite Nicolas pour l’envoi de théologiens des académies de théologie de Russie à des congrès scientifiques et théologiques, notamment aux congrès d’études patristiques qui se déroulèrent à Oxford en 1955 et 1959 ainsi que pour le congrès de byzantinologie de Munich en 1958. J’écrivis à plusieurs reprises au métropolite Nicolas pour lui dire combien il serait profitable à nos théologiens de rencontrer des chercheurs occidentaux et combien serait bénéfique une telle rencontre pour le prestige de l’Église russe en Occident. Dans le même temps, je m’étais adressé au Dr Cross, organisateur du congrès d’études patristiques, lui demandant d’envoyer aux académies de Leningrad et Moscou des invitations collectives, ainsi que des invitations individuelles à certains théologiens comme l’évêque Michel (Tchoub) (31) et le professeur Ouspensky (32). Mais mes efforts furent vains. on envoya au congrès de 1955 les professeurs Pariïsky (33) et Zborovsky de l’académie de Leningrad, qui ne connaissaient aucune langue étrangère et qui, pour cette raison, ne purent participer activement aux travaux du congrès.
Je regrettai particulièrement l’absence de l’évêque Michel (Tchoub) qui parlait plusieurs langues européennes, avait beaucoup écrit sur les œuvres de Méthode d’Olympe et dont la participation à ce congrès semblait s’imposer. Il y avait été personnellement invité et il désirait venir, mais n’arriva pas. Je fus déçu et étonné. comment le métropolite Nicolas avec son intelligence et sa compréhension des choses n’était-il pas conscient que la participation de l’évêque Michel au congrès de patristique était légitime et utile à l’Église ? Il est possible que le choix de ces intervenants ait été dicté par des facteurs indépendants de la volonté du métropolite Nicolas, mais je ne pouvais que le subodorer.
Il se trouve que deux mois avant le congrès en question, lors d’une réception en l’honneur du métropolite Pitirim et de la délégation qui l’accompagnait, je fis connaissance, par hasard, d’un certain Tikhvinsky, conseiller de l’ambassade soviétique à Londres (la réception était donnée par des Anglicans et ne se tenait pas à l’ambassade soviétique). Ayant appris que j’étais russe, il m’accosta de lui-même. C’était un monsieur aux manières fort désinvoltes, parfaitement ignare de tout ce qui concernait l’Église ou la religion (de plus, je lus par la suite dans les journaux qu’il avait été expulsé des États-Unis et transféré à Londres en raison d’activités « incompatibles avec les fonctions diplomatiques »). Pendant la conversation, il me demanda quelle impression produisait la délégation de l’Église russe sur les Anglais. Bien entendu, je n’en dis que du bien et, profitant de l’occasion, lui mentionnai le congrès de patristique à venir, lui expliquant combien il était important que des membres de nos académies de théologie y assistent, combien cela accroîtrait en Grande-Bretagne le prestige de l’Église russe et, par là même, celui de l’Union soviétique (j’avais délibérément avancé ce dernier argument pour donner du poids à mon discours, sachant à qui j’avais affaire). Il me fallut un certain temps pour lui faire comprendre ce qu’était la patristique, et d’autres nuances qu’il ne saisissait que difficilement. « Et quel rapport cela a-t-il avec le nouveau dogme de la divinisation de la Vierge Marie ? », demanda-t-il soudain (il voulait sans doute parler du dogme catholique-romain de l’Assomption, récemment (34) promulgué par le pape). — « Aucun rapport, lui dis-je, vous parlez d’un dogme catholique-romain, alors que moi je vous parle d’un congrès scientifique de théologiens de diverses confessions chrétiennes. »
Tikhvinsky parut rassuré (les relations entre le pouvoir soviétique et le Vatican étaient des plus tendues à cette époque). — « Et vous pensez que nos théologiens seront au niveau de la théologie occidentale ? »
Je décidai de faire une entorse à la vérité et répondis que, globalement, oui (bien qu’honnêtement, j’étais loin d’en être convaincu). « Et de qui dépend l’envoi de ces théologiens ? » demanda-t-il. — « Du patriarcat de Moscou, bien sûr, mais si l’ambassade soviétique de Londres écrivait à Moscou qu’il est souhaitable que l’on envoie des théologiens russes à ce congrès, cela nous faciliterait grandement la tâche. » — « D’accord, dit Tikhvinsky, nous essayerons d’arranger cela. »
Il est difficile d’affirmer avec certitude que cette conversation a eu une influence sur le cours des événements et les invitations, mais il est probable que oui, dans une certaine mesure. Il était seulement regrettable que l’évêque Michel (Tchoub) ne soit pas arrivé. Quand je le rencontrai, en 1958, à Londres, où il était venu avec le métropolite Pitirim pour représenter l’Église russe à la conférence de Lambeth, je lui demandai pourquoi il n’était pas venu au congrès de patristique et lui dis à quel point j’avais regretté son absence. Nous nous trouvions seuls dans sa chambre à l’hôtel Saint-James où il était descendu. « C’est le métropolite Nicolas qui m’a empêché de venir », me dit-il. — « Pourquoi ? », m’étonnai-je.
L’évêque Michel jeta (par habitude) un regard craintif autour de lui, tira sa chaise vers le centre de la pièce, comme s’il y avait des micros dissimulés dans les murs et me dit à mi-voix. « Je vous demande de ne répéter à personne ce que je vais vous dire. Le métropolite Nicolas a beaucoup de qualités et des talents exceptionnels, mais il a un talon d’Achille qui gâche tout. son orgueil démesuré. Il veut toujours être non seulement le premier partout, mais le seul. Regardez le Journal du patriarcat de Moscou, on n’y publie que ses homélies, comme s’il n’y avait en Russie aucun autre bon prédicateur ! C’est la même chose pour tous les congrès et conférences. Il veut toujours être le seul. Et comme il comprend bien qu’il ne peut pas faire l’affaire pour un congrès de patristique, il préfère qu’il n’y ait personne, et surtout pas moi. Il m’a littéralement interdit de venir. »
J’étais sidéré. L’évêque Michel était certes assez impulsif et ne savait parfois pas tenir sa langue, mais il était de bonne foi et c’était un homme de cœur. Et je ne pouvais entièrement contester le portrait qu’il venait de faire du métropolite Nicolas ; au plus, il avait peut-être un peu noirci le tableau. D’ailleurs, il reconnaissait lui-même de nombreux mérites au métropolite Nicolas.
Plusieurs années plus tard, je lus dans le journal Science et Religion (n° 4, 1969) un article écrit par le célèbre renégat Ossipov (35), prêtre défroqué, qui sous le titre « Mes évêques » avait publié ses souvenirs dans un esprit tout à fait athée et dénué de bienveillance, bien que restant dans les cadres de la décence et d’une certaine objectivité. En évoquant le métropolite Nicolas, il insistait sur le même trait de caractère. cet orgueil démesuré, et reprenait, à ce propos, presque mot à mot les paroles de Mgr Michel (Tchoub).
Début février 1957, je reçus une lettre de notre exarque l’archevêque Nicolas (Eremine), dans laquelle il m’informait que « sur proposition de Son Éminence le métropolite Nicolas, en récompense de vos travaux scientifiques et théologiques et par décision du 25 janvier 1957 de Sa Sainteté le patriarche Alexis (36), vous êtes élevé au rang d’archimandrite (37) » ce qui était relativement inattendu.
Je dis « relativement inattendu », car la croix d’archimandrite qui m’avait été remise six mois auparavant à Moscou pouvait être considérée comme une allusion au désir du patriarcat de m’élever à ce rang. Cela restait cependant inattendu pour moi, car je n’avais pas pensé à cela et surtout, il était de mise d’être higoumène (38) avant de devenir archimandrite. Le patriarcat m’élevait directement au rang le plus élevé sans passer par l’étape intermédiaire. De plus, l’initiative provenait entièrement du métropolite Nicolas, alors que, dans notre exarchat, le droit d’attribuer le rang d’archimandrite revenait au seul patriarche de Moscou. En outre, alors que la coutume voulait que la proposition en soit faite par notre exarque, dans le cas présent, celui-ci n’était même pas au courant de la démarche inattendue du métropolite Nicolas.
Les choses se passèrent tout autrement pour mon intronisation épiscopale. C’est notre exarque, l’archevêque Nicolas (Eremine) qui prit l’initiative cette fois. après une conversation que nous eûmes à la fin de 1957, il s’adressa au patriarcat en lui demandant ma nomination en tant qu’évêque auxiliaire pour la France. Je ne sais pas quel fut le rôle du métropolite Nicolas dans cette affaire. Il est possible que l’exarque l’ait consulté avant de prendre sa décision, mais j’en doute. On peut supposer que le métropolite appuya la requête de l’exarque après la visite en France en 1958 d’une commission de contrôle officieuse du patriarcat (officiellement, il s’agissait d’un simple « groupe de pèlerins ») composée de l’archiprêtre Statov et d’A. S. Bouïevsky (39), qui était secrétaire du métropolite Nicolas et son adjoint au Département des relations extérieures de l’Église. J’avais rencontré cette « commission » à Paris lors d’une de mes visites en France (j’habitais encore à Oxford).
Toujours est-il que le 26 mai 1958 arriva un décret me nommant second vicaire de l’exarque d’Europe occidentale (le premier vicaire étant l’évêque Antoine [Bloom], l’exarque actuel (40)), pour la France.
Dans une lettre du 10 juin 1958 qui accompagnait ce décret, le métropolite Nicolas me félicitait d’être ainsi « appelé au grand et saint service épiscopal. » Mon intronisation eut lieu à Londres le 14 juin 1959, avec un certain retard dû aux difficultés à obtenir un visa français.
Ces difficultés inquiétaient le métropolite Nicolas qui m’écrivit. « Il vous faut un lieu de séjour qui vous permette d’allier vos activités épiscopales avec votre travail de recherche » (lettre du 29 mars 1959).
Finalement les difficultés s’aplanirent et je pus enfin, en novembre 1959, déménager à Paris.
Maintenant, je voudrais raconter comment eut lieu ma nomination d’évêque de Bruxelles et de Belgique. C’est à notre exarque, l’archevêque Nicolas (Eremine) que revient dans une grande mesure l’initiative de cette nomination, suite au décès à Bruxelles, le 11 avril 1960, de Mgr Alexandre (Nemolovsky). Il semble même que cette décision rencontra quelques réticences de la part du métropolite Nicolas qui désirait nommer à Bruxelles son protégé et vieil ami viennois, l’archimandrite Arsène (Schilovsky) (41). L’exarque, venu à Bruxelles pour l’enterrement du métropolite Alexandre et pour s’informer de la situation et des dispositions de la communauté sur place, avait compris que tout retard dans la nomination d’un remplaçant à Mgr Alexandre risquait d’être lourd de conséquences, car nos schismatiques s’efforçaient régulièrement de nous prendre notre église Saint-Nicolas à Bruxelles.
Sachant que les fidèles de Bruxelles réclamaient ma nomination, l’exarque était très inquiet de la lenteur du patriarcat à prendre une décision, ainsi que du silence que ce dernier opposait à ses requêtes. Un jour qu’A. S. Bouïevsky lui avait téléphoné pour une affaire de routine, il lui demanda pourquoi ma nomination tardait tant et lui expliqua combien ce délai était dangereux pour les affaires de l’Église en Belgique.
Bouïevsky répondit. « Bien sûr, l’évêque Basile est un candidat tout à fait digne et qui ferait très bien l’affaire, mais vous savez, il y a d’autres candidats possibles pour le siège de Bruxelles. » — « Qui ça ? » demanda l’exarque. — « Eh bien, par exemple l’archimandrite Arsène. » — « Mais vous savez quel passeport il a ? » poursuivit l’exarque. — « Non », répondit Bouïevsky. — « Un passeport soviétique ! C’est absolument inacceptable pour les fidèles bruxellois. Je vous préviens que vous allez à la catastrophe si vous perdez encore du temps et ne nommez pas l’évêque Basile à Bruxelles. » — « Je vous remercie de vos remarques, nous en tiendrons compte. »
Ainsi s’acheva cette conversation téléphonique avec Moscou et, effectivement, par un décret du Saint-Synode du 31 mai 1960, je fus nommé évêque de Bruxelles et de Belgique. Dans le même temps, le diocèse de Bruxelles et de Belgique fut inclus dans l’exarchat d’Europe occidentale. Je déménageai donc à Bruxelles.
Il est intéressant de noter que la copie de ce décret fut signée par l’archimandrite Nicodème (Rotov), futur métropolite de Leningrad, alors chancelier du patriarcat (et remplaçant du métropolite Nicolas au Département des relations extérieures de l’Église russe). Mais j’évoquerai mes rencontres et mes longues conversations avec lui séparément (42).
- Père Denis (Chambault, 1899-1965), moine et prêtre orthodoxe d’origine française. Fondateur et recteur d’une communauté orthodoxe de rite « occidental » à Paris, relevant de l’Église russe.
- Vladimir Nicolaïevitch Lossky (1903-1958), émigré russe en France, philosophe et théologien orthodoxe.
- Olivier Clément (1921-2009), historien, poète et théologien orthodoxe d’origine française, auteur de nombreux ouvrages.
- Dimitri Dimitrievitch Obolensky (1918-2002), émigré russe en Grande-Bretagne, historien byzantiniste.
- Sur ce voyage, voir Messager de l’exarchat du patriarche russe en Europe occidentale, n°25 (1957), p. 22-28.
- Mgr Jean (Eugraphe) Kovalevsky (1905-1970), prélat orthodoxe d’origine russe, primat de la dénommée « Église catholique-orthodoxe de France », une communauté orthodoxe de rite occidental, non-reconnue par les Églises orthodoxes canoniques.
- Mgr Athénagoras Spyrou (1886-1972), prélat orthodoxe grec. Patriarche œcuménique de Constantinople (1948-72). Voir O. CLÉMENT, Dialogues avec le patriarche Athénagoras, Paris, Fayard, 1969.
- Ancien diocèse de l’Église russe, l’Église orthodoxe de Finlande avait rejoint (avec un statut d’autonomie) le patriarcat de Constantinople en 1923, situation qui ne fut acceptée par le patriarcat de Moscou qu’en 1957.
- Mgr Michel (Tchoub, 1912-1985), prélat et théologien orthodoxe russe. Évêque (1953), archevêque (1965).
- Nicolas Dimitrievitch Ouspensky (1900-1987), théologien laïc orthodoxe russe, professeur à l’académie de théologie de Leningrad.
- Lev Nicolaïevitch Pariïsky (1892-1972), théologien laïc orthodoxe russe, professeur à l’académie de théologie de Leningrad.
- Le 1er novembre 1950.
- Alexandre Ossipov (1911-1967), prêtre orthodoxe russe et professeur à l’académie de théologie de Leningrad. En 1959, sous la pression des autorités soviétiques, il renie publiquement sa foi et devient un propagandiste de l’athéisme. Voir Mgr JEAN de San Francisco, « L’affaire Ossipov », dans Le Messager orthodoxe, n° 10, Paris, 1960; S. L. FIRSOV, Apostassia. Ateist Alexandr Ossipov i epokha khrouchtchevskikh goneniy na Rouskouiou Pravoslavnouiou Tserkov’ [L’Apostasie. L’athéiste Alexandre Ossipov et l’époque des persécutions khrouchtchéviennes contre l’Église orthodoxe russe], Saint-Pétersbourg, Éd. Satis, 2004.
- Mgr Alexis (Simansky, 1877-1970), prélat orthodoxe russe. Patriarche de l’Église orthodoxe de Russie (1945-70).
- Voir n. 5.
- Dignité ecclésiastique orthodoxe, correspondant à celle de supérieur d’abbaye en Occident.
- Alexis Sergueïevitch Bouïevsky (1920-2009), laïc orthodoxe russe, collaborateur du Département des relations extérieures du patriarcat de Moscou.
- Mgr Antoine (Bloom, 1914-2003), prélat orthodoxe russe à Londres. Évêque (1957), archevêque titulaire de Souroge (1962), métropolite et exarque patriarcal d’Europe occidentale (1965-74). Prédicateur et auteur spirituel renommé.
- Père Arsène (Schilovsky, 1894-1969), prêtre et moine orthodoxe russe. A servi en Russie, puis à Prague, enfin à Vienne.
- Voir « Chapitre 2. Le métropolite Nicodème (Rotov) ».

Jusqu’à mon départ de Grèce pour Oxford à la fin du mois de février 1951, je ne connaissais le métropolite Nicolas (Iarouchevitch) de Kroutitsy et Kolomna (1) que par l’intermédiaire du Journal du patriarcat de Moscou (2), dont les numéros ne me parvenaient en Grèce que sporadiquement. Dans les journaux russes de Paris et plus encore par les lettres ou les récits des personnes venues de France, j’avais lu ou entendu bien des choses sur le rôle du métropolite Nicolas dans l’affaire du retour du métropolite Euloge au sein du patriarcat de Moscou (3), ainsi que sur la forte impression qu’avaient produit sa personnalité et son talent de prédicateur sur les émigrés russes en France. Ce n’est que plus tard — vers la fin de mon séjour en Grèce — que j’eus vent de ses prises de position en matière de « défense de la paix », contre la bombe atomique, etc. Celles-ci ne me furent d’ailleurs décrites que dans les grandes lignes, par une personne qui venait de Paris et qui était acolyte à l’église russe d’Athènes.
Je m’étais globalement forgé du métropolite Nicolas l’image d’un homme d’Église éminent, proche collaborateur du patriarche, prédicateur remarquable et personnalité sachant charmer son public. Quand je fus arrivé en Grande-Bretagne, je pus lire systématiquement tout ce qui le concernait dans le Journal du patriarcat de Moscou. J’appris aussi de nombreux détails sur sa personnalité de la bouche de l’archimandrite (4) Nicolas (Gibbs) (5), un orthodoxe britannique, ancien professeur d’anglais des enfants de Nicolas II, qui avait suivi l’empereur dans son exil à Tobolsk et Ekaterinbourg et qui, après un passage par le schisme karlovtsien (6), avait été accepté au sein du patriarcat de Moscou par le métropolite Nicolas lors de la visite de ce dernier en Angleterre en 1945.
Le métropolite Nicolas avait fortement impressionné l’archimandrite Nicolas (Gibbs) qui avait apprécié l’intelligence de celui-ci et avait été charmé par sa personne agréable tout en restant, en raison de son caractère soupçonneux et de sa prudence d’Anglais « pur et dur », quelque peu méfiant à son égard. Le père Nicolas était troublé par les prises de position « pacifistes » du métropolite Nicolas et ses attaques particulièrement véhémentes contre l’Occident. Je lui répondais (et c’était mon intime conviction) qu’il ne fallait accorder aucune importance à ces déclarations « pacifiques » du métropolite, car il les faisait sous la contrainte et pour le bien de l’Église, en échange des privilèges et tolérances que Staline, dans les dernières années, avait assurément accordés à l’Église (7). Je dois avouer que je ne lisais quasiment jamais les déclarations politiques du métropolite Nicolas publiées dans le Journal du patriarcat de Moscou, tant elles me paraissaient dénuées d’intérêt. Mais je déplorais le tort qu’elles faisaient à la réputation de l’Église orthodoxe russe en Occident.
Il semble que le patriarcat de Moscou ait ignoré mon arrivée en Grande-Bretagne jusqu’en mai 1951, bien que le patriarcat et le métropolite Nicolas en personne aient été au courant des gros ennuis que m’avaient causé les autorités civiles et militaires grecques, qui m’avaient expulsé de l’Athos et avaient fini par me contraindre à quitter la Grèce (8).
En mai 1951, à l’occasion de mon ordination sacerdotale, l’archimandrite Nicolas (Eremine) (9), président du conseil de l’exarchat à Paris et futur exarque, dut demander la bénédiction au patriarcat. C’était indispensable pour me faire ordonner par l’évêque serbe Irénée de Dalmatie (10) qui résidait en Grande-Bretagne, en raison de l’absence, en Grande-Bretagne et même en France, d’évêque relevant de la juridiction du patriarcat de Moscou. Pour des questions de visa, il aurait été compliqué pour moi de me rendre en Belgique chez l’archevêque Alexandre (11), qui par ailleurs avait des relations compliquées avec l’exarchat de Paris.
S’étant préalablement assuré que l’évêque Irénée n’était pas un schismatique et que, bien que résidant en Grande-Bretagne, il restait rattaché au patriarcat de Serbie, le métropolite Nicolas donna par télégramme sa bénédiction pour mon ordination. Je fus ordonné hiérodiacre et hiéromoine (12) en l’église de Saint-Nicolas à Oxford, paroisse dont le recteur était l’archimandrite Nicolas (Gibbs) précité.
Quelques mois plus tard, je reçus de Moscou, par la poste, une lettre du métropolite Nicolas datée du 7 août, dans laquelle il me félicitait d’avoir reçu la « grâce du sacerdoce », m’assurait de ses prières à Dieu pour mon progrès spirituel et continuait ainsi. « J’aimerais que vous me disiez, très cher père en Christ, Basile, ce que vous avez pu observer de la vie de nos frères russes au Mont Athos et de notre situation générale là-bas à l’heure actuelle. Nous pensons que vous disposez de renseignements à ce sujet et serions très heureux si vous pouviez nous écrire à ce propos. »
Après quoi, le métropolite me proposait de lui faire part de mes « impressions sur [mon] travail pastoral et ecclésial » sur les lieux d’exercice de mon « service sacerdotal. »
Comme on le voit, cette lettre, à laquelle je ne m’attendais pas et qui me réjouit en raison de l’attention du métropolite Nicolas à mon égard, avait un contenu purement ecclésial.
Elle ne contenait pas l’ombre d’une incitation à prendre part au « combat pour la paix » ou d’autres activités du même acabit. Le désir du métropolite Nicolas de recevoir de moi, vieux moine de l’Athos ayant passé vingt-deux ans sur la Sainte Montagne, des informations sur le sujet, était tout à fait naturel et lui faisait honneur en tant que hiérarque de l’Église russe qui avait toujours pris à cœur les intérêts du monachisme russe au Mont Athos.
Je répondis au métropolite Nicolas par une lettre du 24 août 1951, dans laquelle je décrivais la situation des moines russes au Mont Athos et lui faisais part de mes suggestions pour leur venir en aide. Ces suggestions se ramenaient à une idée principale. il fallait s’efforcer d’obtenir la seule chose qui compte pour l’heure, l’admission de moines russes au Mont Athos, faute de quoi le monachisme russe y mourrait (13). Dans ma conclusion, j’écrivais qu’il y aurait encore bien des choses à dire sur le sujet, mais que c’était difficile par écrit et préférable de vive voix. Je ne voulais nullement laisser entendre que j’avais des secrets à révéler, mais qu’il était plus facile de donner une idée juste de toutes les subtilités de la situation sur le Mont Athos lors d’une conversation personnelle. Je ne sais pas comment mes paroles furent interprétées par le métropolite Nicolas, mais elles eurent des répercussions quelque peu inattendues.
Je ne me souviens pas parfaitement du déroulement chronologique des événements qui suivirent, mais il me semble qu’en octobre-novembre 1951, je reçus de Londres une lettre de Jérôme Kykkotis, hiérodiacre grec de ma connaissance, qui m’écrivait qu’un pasteur anglican de ses amis voulait absolument me rencontrer, et me demandait à quel moment je pourrais me rendre à Londres pour venir chez lui faire la connaissance de ce pasteur. Mais, étonnamment, il ne me donnait pas le nom de celui-ci…
Il faut préciser que ce Kykkotis m’avait été recommandé à Athènes par Mgr Georges (Papageorgiadis), ancien métropolite de Nevrokopion, que nous avions surnommé « orthodoxie ambulante », homme aux opinions très strictement orthodoxes et aux convictions très personnelles, mais certainement pas gauchiste. « Je vous recommande à Londres le père Kykkotis, il peut vous être utile, m’avait-il dit. Il y est propriétaire de la librairie Zénon où vous pourrez trouver de nombreux livres intéressants, grecs ou autres. Il faut cependant que je vous prévienne que Kykkotis est accusé d’être communiste. Mais c’est tout à fait injuste ; c’est son frère qui est communiste. Lui, il est tout simplement patriote chypriote, il a manifesté contre les Anglais pour l’indépendance de Chypre, ce qui n’a pas plu à ceux-ci et a amené l’Église grecque de Londres à l’accuser de sympathies communistes et l’exclure des rangs du clergé. Mais c’est un homme bon et un vrai chrétien. »
À Londres, j’avais rencontré Kykkotis plusieurs fois, j’avais acheté des livres dans sa librairie ainsi qu’une machine à écrire à clavier grec et nous avions bavardé de choses et d’autres.
Voilà pourquoi, quand je reçus la lettre de Kykkotis, je me dis qu’il s’agissait d’une rencontre œcuménique et ne supposai pas un instant qu’il puisse s’agir d’autre chose. Et je lui répondis que je viendrais bientôt d’Oxford à Londres pour rencontrer ce pasteur anglican.
À l’heure convenue (vers une heure de l’après-midi), je me présentai à la boutique de Kykkotis. Il était seul.
« Où est donc ce pasteur anglican ? », lui demandai-je. — « Il nous attend dans un restaurant près d’ici, où nous allons déjeuner ensemble. Il sera accompagné d’un autre de ses amis, je ne sais pas qui exactement, un autre pasteur probablement. » — « Et comment s’appelle celui qui voulait me rencontrer ? », demandai-je. Kykkotis nomma le pasteur anglican Stanley Evans (14). Ce nom ne me dit rien sur le moment, mais par la suite j’appris qu’Evans était assez connu pour être un « prêtre rouge » anglais, une sorte de petit Johnson (15), ce doyen de Canterbury connu pour ses tentatives de concilier communisme et christianisme et ses déclarations en faveur du pouvoir soviétique (16).
Nous entrâmes dans un restaurant petit mais agréable. Il était presque deux heures, aussi était-il quasiment vide. il y avait une ou deux personnes dans la première salle et nous étions seuls dans la salle du fond, ou plus exactement, il n’y avait là qu’Evans et celui qui l’accompagnait. On me présenta d’abord Evans. Il me donna l’impression d’un homme assez peu perspicace, voire naïf, mais ce n’était manifestement pas un méchant homme, plutôt discret et assez timide.
« Je suis très heureux de vous rencontrer, me dit-il. Vous étudiez les Pères de l’Église, moi aussi je les ai pas mal étudiés, on y trouve beaucoup de choses très intéressantes, particulièrement chez ceux d’avant le concile de Nicée. » — « Pourquoi seulement chez les pré-Nicéens ? », remarquai-je. À cet instant, le compagnon d’Evans s’approcha de moi et me dit en russe. « Bonjour ! Je suis très heureux de faire votre connaissance ! » — « Vous parlez russe ? », m’étonnai-je. — « Et comment donc ! Je suis russe. Je travaille même à l’ambassade soviétique ! »
J’étais estomaqué. Ma première idée fut de partir. D’exprimer mon mécontentement à Kykkotis de ne pas m’avoir prévenu à qui j’allais avoir à faire. Car je m’attendais à rencontrer des pasteurs anglicans et voilà qu’on m’imposait un employé de l’ambassade. En tant que membre du clergé, je ne voulais avoir de rapports avec aucune ambassade et surtout pas l’ambassade soviétique. Je savais par expérience, car il m’avait été donné en Grèce de me rendre à l’ambassade soviétique pour des questions d’ordre purement ecclésial concernant le Mont Athos, combien ces contacts étaient dangereux pour moi personnellement aussi bien que pour l’Église. Cela donnait en effet aux ennemis de notre Église un motif pour nous attaquer et nous nuire sous couvert de lutte contre le communisme. C’est pourquoi, j’avais fermement décidé de ne plus jamais avoir de contacts avec aucune ambassade soviétique, sauf pour l’obtention d’un visa. « Dans quelle histoire désagréable me suis-je retrouvé malgré moi ? », pensai-je. Le mieux serait de partir sans plus attendre ! Mais je ne le fis pas, en partie par crainte de causer un scandale qui porterait préjudice à notre Église et en partie mû par le désir de savoir de quoi il s’agissait. « Vous êtes de l’ambassade, répétai-je, et que voulez-vous donc ici ? » — « Je suis le secrétaire d’ambassade untel (il donna son nom, mais le temps l’a malheureusement effacé de ma mémoire). J’ai une commission pour vous de la part du métropolite Nicolas de Kroutitsy. Je pense que vous le connaissez, ou que vous avez entendu parler de lui ? »
À ces mots, je n’avais plus le choix, il fallait que je reste pour savoir de quoi il retournait. Nous nous assîmes tous les quatre pour déjeuner. Le secrétaire soviétique, qui maîtrisait mal l’anglais, se mit à passer commande avec l’aide d’Evans, tout en se plaignant à voix haute de la qualité exécrable de la cuisine anglaise et disant que la cuisine russe était bien meilleure, mais qu’il fallait bien se faire une raison. Dans l’ensemble, il donnait l’impression d’un type très sûr de lui, on peut même dire un cuistre, peu éduqué et mal dégrossi. Il raconta cependant qu’il avait étudié à l’université et qu’il était même inscrit en troisième cycle pour préparer une thèse. Notre conversation se poursuivit en russe pendant tout le déjeuner. Kykkotis et Evans, qui ne comprenaient pas le russe, ne dirent donc plus rien.
Il me posa tout d’abord quelques questions d’ordre général. « Que pense l’opinion occidentale des déclarations de l’Église russe en faveur de la paix, et tout particulièrement l’appel des trois patriarches. de Moscou, de Géorgie et d’Arménie (17) ? Ces déclarations ont sans doute fait sensation ? » — « Elles sont passées inaperçues, répondis-je. Personne ici ne s’intéresse à elles. »
Le secrétaire d’ambassade passa enfin au motif de sa présence. « Le métropolite Nicolas s’intéresse beaucoup à la situation des moines russes du Mont Athos et aimerait que vous lui en fassiez un rapport détaillé. Vous pourrez le transmettre par mon intermédiaire. » — « Je lui ai déjà écrit et envoyé tout ce que j’avais à dire », répondis-je. — « Oui, mais on ne peut pas tout confier à la poste. Vous pourriez peut-être donner au métropolite Nicolas des renseignements complémentaires que nous lui transmettrions. » — « Je vous remercie, mais je n’ai rien à ajouter et si, à l’avenir, il me vient le besoin de lui écrire quelque chose, je préférerai toujours le faire par la poste. Il n’y a rien de secret dans mes informations. Quant à écrire par l’intermédiaire de l’ambassade, ce n’est pas souhaitable ; c’est illégal et cela peut m’attirer des ennuis de la part des autorités anglaises. J’en ai fait l’expérience en Grèce (18) et je n’ai pas l’intention de la renouveler. D’ailleurs, je n’y vois actuellement aucune nécessité. » — « Pas pour l’instant, peut-être, mais demain qui sait, vous en aurez besoin, insistait le secrétaire. Vous ne pouvez pas tout écrire par la poste, or le métropolite Nicolas attend des renseignements de vous. Vous n’avez rien à craindre. Voilà ce que nous allons faire. Dans un mois ou deux, quand vous aurez accumulé de nouveaux renseignements, vous en ferez part à votre ami (Kykkotis) — en qui vous avez confiance, n’est-ce pas ? — qui le dira à Evans, lequel me le fera savoir. Alors nous nous rencontrerons à nouveau tous les quatre, ici ou dans un autre endroit. »
Je m’obstinai à répéter qu’il n’y aurait pas d’occasion de la sorte et que je n’envisageais de communiquer que par la poste. — « Non, non, réfléchissez-y à tête reposée. Vous me ferez signe par l’intermédiaire de votre ami. J’attendrai. »
Notre conversation n’alla pas plus loin. Le secrétaire demanda l’addition et paya pour nous tous avec ostentation, exhibant son portefeuille plein à craquer de livres anglaises.
Je décidai fermement de ne donner aucune suite aux propositions du secrétaire d’ambassade et d’éviter à l’avenir toute rencontre avec lui. Par crainte des bavardages, je décidai aussi de ne raconter à personne ce qui venait de m’arriver, à l’exception de l’archimandrite Nicolas (Gibbs), recteur de la paroisse où je servais et qui m’hébergeait dans sa maison à Oxford. Il ne me sembla pas possible de lui cacher ma rencontre involontaire avec le secrétaire d’ambassade soviétique, d’autant qu’il était anglais et qu’il avait des relations importantes dans divers milieux et probablement même dans la police, ce qui pouvait m’être utile au cas où cette affaire m’attirerait des ennuis. Je me rendis donc immédiatement chez lui (heureusement, il se trouvait à Londres à ce moment-là) et lui racontai tout dans les moindres détails, en soulignant mon intention de ne plus avoir le moindre contact avec le secrétaire d’ambassade. Le père Nicolas m’écouta attentivement, approuva mon comportement et mon refus et promit de n’en parler à personne.
Quelques temps après cependant, j’appris de façon indirecte (par S. N. Bolchakov (19), un de nos amis communs avec le père Nicolas) que les services secrets anglais étaient au courant de ma rencontre dans un restaurant avec le secrétaire d’ambassade, de sa proposition d’envoyer des lettres par son intermédiaire et de mon refus. Apparemment, ils avaient interrogé le père Nicolas Gibbs à ce sujet, et le père Nicolas en avait parlé à Bolchakov malgré sa promesse de n’en rien dire à personne.
Mais comment la police anglaise avait-elle eu vent de l’affaire ? Il n’y avait personne d’autre que nous dans la salle du restaurant où nous avions déjeuné. Je ne pense pas qu’Evans ou le père Kykkotis aient pu me dénoncer (quoique ?), cela ne leur ressemblait vraiment pas et d’ailleurs ils ne comprenaient pas le russe. Il y avait bien quelqu’un dans la pièce voisine, au début du moins, mais il eut été impossible, d’aussi loin, d’entendre ce que nous disions, sans matériel spécialisé. Peut-être que le secrétaire était surveillé (à l’époque, ce n’était pas exclu). on avait surpris son déjeuner avec moi, on s’était alors adressé au père Gibbs pour plus de renseignements et il avait répété ce que je lui avais raconté. Je pense que c’est là l’explication la plus vraisemblable. Si c’est le cas, je me félicite de n’avoir rien caché au père Nicolas Gibbs.
En ce qui me concerne, cet épisode m’inspira toutes sortes de sentiments et de pensées. J’étais mécontent et inquiet. On avait tenté de m’entraîner malgré moi sur un chemin que je me refusais à suivre, on m’avait détourné de mes activités théologiques et pastorales. En même temps, j’étais très impressionné des relations dont disposait le métropolite Nicolas au sein de l’appareil gouvernemental soviétique et de l’empressement avec lequel les employés de l’ambassade soviétique accédaient à ses demandes. Sans doute, ne pouvait-on reprocher au métropolite Nicolas de vouloir s’informer de la situation des moines russes du Mont Athos ; il était même de son devoir pastoral de le faire. Et il ne m’avait demandé que des informations à caractère purement ecclésial. Mais je ressentais une certaine amertume devant la façon abrupte qu’il avait de me mettre en contact avec des employés de l’ambassade soviétique. Sans me consulter au préalable pour savoir si j’étais d’accord ou si cela ne me faisait pas courir des risques, il m’impliquait dans une transmission de lettres via des services douteux.
Apparemment, ne connaissant pas assez bien la situation en Occident, le métropolite Nicolas n’en saisissait pas toutes les nuances et sensibilités, et ne comprenait pas combien était préjudiciable aux intérêts de l’Église patriarcale (20) tout contact avec les ambassades soviétiques.
Quelques temps après, je revis le père Kykkotis dans sa librairie à Londres. Avant même que je n’aie le temps de lui dire quoi que ce soit, il me présenta ses excuses. « Vous me voyez extrêmement confus d’avoir été la cause involontaire de votre rencontre avec une personne qui était peut-être pour vous indésirable. Je ne savais rien moi-même à l’avance, sinon je vous en aurais prévenu. Evans ne m’avait absolument rien dit et ce n’est qu’au dernier moment qu’il a mentionné la présence d’une quatrième personne au déjeuner. J’étais sûr que ce serait un autre pasteur anglican. » — « Oui, répondis-je, c’est une chose que de déjeuner avec des pasteurs anglicans, et autre chose avec des employés de l’ambassade soviétique. Je n’estime pas pouvoir rencontrer ces gens-là. »
Quelques mois plus tard, je reçus une lettre d’Evans, datée du 6 février 1952 (il était manifestement inquiet de n’avoir aucune nouvelle de moi depuis notre entrevue au restaurant). Dans cette lettre, il me demandait si je pouvais venir à Londres et écrivait que « notre collègue (c’est-à-dire le secrétaire d’ambassade) est très désireux de déjeuner encore une fois ensemble, mais en prenant plus de temps pour parler » et que lui-même (Evans) aurait également été heureux de me parler. À la fin de sa lettre, il me priait de lui indiquer la date de ma prochaine venue à Londres. Je ne répondis rien à cette lettre et ce fut la fin des mes relations avec Evans, qui ne tenta plus de me rencontrer. Nous nous revîmes bien plus tard, lors d’un banquet donné par l’ambassade soviétique à Londres en juillet 1955. C’était un banquet en l’honneur d’une délégation ecclésiale venue d’URSS et présidée par le métropolite Pitirim (Sviridov) de Minsk et de Biélorussie (21), et c’est pourquoi je n’avais pas jugé possible de décliner l’invitation de l’ambassade. Sur les huit années de mon séjour en Grande-Bretagne, c’est la seule fois que je mis les pieds à l’ambassade soviétique. D’ailleurs, ce jour-là, les invités étaient des plus recommandables. l’archevêque de Canterbury, Mgr Athénagoras, exarque du patriarcat de Constantinople (22), etc. Vers la fin du banquet, le métropolite Pitirim, à côté duquel j’étais assis à ce moment-là sur un canapé, me montra du doigt un homme au regard torve assis près du mur. « Aujourd’hui, notre ami Evans a bu un coup de trop ! » Je regardai plus attentivement cet homme et reconnus ma vieille connaissance, le pasteur Stanley Evans. Le pauvre ! Les « camarades » avaient manifestement forcé sur leur légendaire hospitalité et avaient fait boire Evans, inexpérimenté en la matière, presque jusqu’à en perdre conscience. C’est la dernière fois que je le vis. Quelques années plus tard, j’appris par les journaux la mort du pasteur Evans dans un accident de voiture.
Je ne sais si le métropolite Nicolas fut informé de ma rencontre avec le secrétaire d’ambassade, mais je reçus de lui (pour Noël) une lettre datée du 12 janvier 1952, dans laquelle il me remerciait pour ma lettre du 24 août 1951: « J’y ai appris quelques éléments intéressants sur la situation pitoyable de nos moines russes sur la Sainte Montagne de l’Athos, et sur l’état de notre Église en Angleterre. Nous serions très heureux si vous continuiez à l’avenir à partager avec nous les joies et les peines de votre vie. » L’expression « quelques éléments intéressants » laissait penser que le métropolite Nicolas n’était pas pleinement satisfait par ma lettre et attendait que je lui donne plus de détails sur le sujet (probablement par l’intermédiaire du fameux secrétaire).
Dans le même esprit, je reçus plus tard, de Moscou aussi, une lettre (du 24 février 1953) de l’archiprêtre Vladimir Elkhovski que je ne connaissais pas personnellement à ce moment-là. Au nom du métropolite Nicolas, il me remerciait pour l’information sur la situation du monachisme russe du Mont Athos et ajoutait que le métropolite « me remerci[ait] de tout cœur pour les informations que [j’avais] si aimablement communiquées à propos de nos moines athonites et [qu’il] attendait mes informations complémentaires. » Il m’écrivait aussi que le métropolite Nicolas était « très préoccupé par le sort de la paroisse d’Oxford et s’intéressait vivement à [mes] travaux de publication des œuvres de saint Syméon le Nouveau Théologien. »
Tout cela témoigne du vif intérêt que portait le métropolite Nicolas à la vie ecclésiale à l’étranger et tout particulièrement aux moines du Mont Athos. Je me demande seulement pourquoi, cette fois-ci, le métropolite ne m’avait pas écrit directement mais par l’intermédiaire de l’archiprêtre Elkhovski. Peut-être pensait-il qu’il me serait plus facile de correspondre avec une personne moins connue et moins marquée politiquement qu’il ne l’était lui-même, aux yeux du monde occidental.
- Mgr Nicolas (Iarouchevitch, 1892-1961, prélat orthodoxe russe, personnalité du mouvement œcuménique et du mouvement « pour la Paix ». Évêque (1922), archevêque (1935), métropolite de Kiev et Galicie (1941), métropolite de Kroutisty et Kolomna (1944) et président du Département des relations extérieures du patriarcat de Moscou (1946-60). Voir Nikita STRUVE, Les chrétiens en URSS, Paris, Éd. du Seuil, 1968, p. 134-136.
- Revue mensuelle du patriarcat de Moscou, publiée depuis 1943.
- En 1945, le métropolite Euloge (Gueorguievski, 1861-1946), primat de l’archevêché des paroisses russes en Europe occidentale (qui, en 1931, s’était placé sous l’autorité du patriarcat de Constantinople pour éviter les pressions du pouvoir soviétique), avait réintégré la juridiction du patriarcat de Moscou. La grande majorité des fidèles n’accepta cependant pas cette démarche — à laquelle le métropolite Nicolas avait largement contribué — qui ne survécut pas à la mort de Mgr Euloge.
- Dignité ecclésiastique orthodoxe, correspondant à celle de « Monseigneur » en Occident.
- Père Nicolas Gibbs (1876-1963), moine et prêtre orthodoxe d’origine britannique.
- De 1927 à 2007, l’Église orthodoxe russe « hors frontières » ou « à l’étranger » (également appelée « karlovtsienne » du nom de son premier siège en la ville serbe de Sremsky-Karlovtsy) fut séparée du patriarcat de Moscou en raison de la soumission de celui-ci au pouvoir soviétique. À l’époque, elle était considérée par le patriarcat comme schismatique.
- De 1943 à 1957, en effet, l’État soviétique desserra quelque peu l’étau autour de l’Église orthodoxe russe et lui accorda certaines concessions (élection d’un patriarche, réouverture d’églises, de monastères et de séminaires, etc.). En échange de cette tolérance limitée, les chefs de l’Église devaient être « loyaux » envers le gouvernement et soutenir activement la politique communiste en Russie et à l’étranger (voir N. STRUVE, op. cit., p. 52-59, 80-81; Mgr KALLISTOS (WARE), L’Orthodoxie, l’Église des sept Conciles, Paris-Pully, Éd. du Cerf/Le Sel de la Terre, 2002, p. 200-202).
- Alors que Basile Krivochéine était moine au Mont Athos, il fut accusé de travailler pour le compte des autorités soviétiques, ce qui lui valut de graves ennuis avec la justice grecque, et se solda par son expulsion du Mont Athos en 1947, sa détention dans un camp d’internement suivie d’une période de résidence surveillée à Athènes, puis son expulsion de Grèce en 1951. Voir Père Serge MODEL, « Mgr Basile et le Mont Athos », Messager de l’Église orthodoxe russe, n°15 (2009), p. 16-20.
- Mgr Nicolas (Eremine, 1892-1985), prélat orthodoxe russe à Paris. Évêque titulaire de Chersonèse (1953), archevêque (1954), métropolite (1960), exarque patriarcal d’Europe occidentale (1954-63).
- Mgr Irénée (Georgic), prélat orthodoxe serbe. Évêque titulaire de Dalmatie.
- Mgr Alexandre (Nemolovsky, 1880-1960), prélat orthodoxe russe en Amérique du Nord (1909-21) puis en Belgique (1929-1960). Évêque (1909), archevêque (1921), métropolite (1959).
- Le moine Basile (Krivochéine) fut ordonné hiérodiacre (moine-diacre) le 21 mai 1951 et hiéromoine (moine-prêtre), le lendemain.
- En raison de la guerre de 1914-1918, puis de l’interdiction de l’entrée de Russes au Mont Athos par les autorités grecques après la révolution bolchevique de 1917, le nombre de moines russes y avait été drastiquement réduit. de 2000 avant 1914, il était passé à 550 en 1925, 380 en 1932 et 180 en 1947. Ce déclin se poursuivra par la suite. 75 moines en 1956, 35 en 1961 et 20 en 1965. De nouveaux moines russes n’arriveront sur l’Athos que dans la deuxième moitié des années soixante (voir « Chapitre 2. Le métropolite Nicodème (Rotov) »).
- Stanley Evans (1912-1965), ecclésiastique anglican et activiste prosoviétique.
- Hewlett Johnson (1874-1966), ecclésiastique anglican, doyen de Canterbury, surnommé le « doyen rouge » pour son activisme prosoviétique.
- Il déclarait notamment. « Le programme soviétique voit dans tous les hommes des êtres humains et des frères […] La Russie est le pays le plus moral que je connaisse […] Il y a quelque chose d’étonnamment chrétien et de civilisé dans l’attitude et les intentions (de ce régime) » (cité dans D. POSPIELOVSKI, J.-C. ROBERTI, N. STRUVE, V. ZIELINSKI, Histoire de l’Église russe, Paris, Nouvelle Cité, 1989, p. 111-112).
- En août 1950, le patriarche Alexis Ier de Moscou et les patriarches-catholicos de Géorgie et d’Arménie avaient signé un « Message aux chrétiens du monde entier » en faveur de la paix (texte dans L’Église orthodoxe russe dans la lutte pour la paix. Résolutions, messages, discours, 1948-1950, Moscou, Éd. du Patriarcat de Moscou, 1950, p. 41-44). Voir aussi N. STRUVE, op. cit., p. 90.
- Voir n. 9.
- Serge Nicolaïevitch Bolchakov (1901-1990), émigré russe, philosophe et écrivain. Participant actif du mouvement œcuménique.
- De Moscou (NdT).
- Mgr Pitirim (Sviridov, 1887-1963), prélat orthodoxe russe. Évêque (1941), archevêque (1945), archevêque de Minsk et de Biélorussie (1947), métropolite (1955), métropolite de Leningrad et Ladoga (1959-1960), métropolite de Kroutitsy et Kolomna (1960-1963).
- Mgr Athénagoras (Kavvadas, 1885-1963), prélat orthodoxe grec. Primat du diocèse du patriarcat de Constantinople en Grande-Bretagne (1951-1963).


Les gardiens rient, les diables
Aux hallebardes ensanglantées.
V. J. Brioussov
La milice du district de Snagost était installée dans une grande maison paysanne. Nous entrâmes dans une pièce de bonnes dimensions, et le milicien, sans me poser la moindre question, s’assit derrière son bureau et se mit à rédiger le procès-verbal de mon arrestation. Je m’assis sur une chaise. Le procès-verbal l’occupa un temps assez long, on voyait bien que c’était là une tâche difficile pour lui, qu’il manquait d’éducation. Il parvint enfin à bout de son travail, et me le montra pour que je le lise avant de le signer. Le contenu de ce rapport était le suivant (je ne reproduis pas les nombreuses fautes qu’il contenait). « Le 15 septembre 1919, à trois heures de l’après-midi, au hameau de Snagost, Vsévolod Alexandrovitch Krivochéiev, soupçonné d’espionnage, a été interpellé par les soldats du 1er régiment koubanais rouge. Il a été transféré à la milice du district de Snagost, ainsi que les documents et l’argent qui ont été trouvés sur lui, pour enquête. » Je ne trouvai rien à redire au contenu de ce procès-verbal. Je dirais même que l’expression malhabile du milicien contribuait à donner à ce procès-verbal un ton qui m’était plutôt favorable. Ainsi, il y était indiqué que j’avais été arrêté à Snagost, sans préciser que j’étais alors en route pour Glouchkovo, c’est-à-dire pour le front même. Mon arrestation n’était pas justifiée par des raisons concrètes, « soupçonné d’espionnage » était une formulation vague. La perte puis la réapparition de mes papiers n’était pas mentionnée, ce qui renforçait l’impression que mon arrestation était sans fondement. Il ne parlait pas du sel non plus. Je signai le rapport. À ce moment, probablement en raison des émotions que je venais de vivre, je ressentis une forte envie de boire (je n’avais d’ailleurs rien mangé ni bu depuis le matin). Je demandai un verre d’eau au milicien. Il appela la maîtresse de maison, une Ukrainienne d’une trentaine d’années et lui demanda de me donner de quoi me désaltérer. Elle me fit passer dans la pièce voisine, si spacieuse, que nous nous trouvâmes suffisamment loin du milicien pour qu’il ne puisse pas nous entendre. Elle m’apporta une jatte de lait froid et d’une voix compréhensive et pleine de compassion me demanda. « Alors monsieur, comment avez-vous pu vous faire attraper ? » Touché, je répondis. « Ça va aller, ne vous inquiétez pas, je vais sans doute m’en sortir. » L’Ukrainienne hocha la tête, d’un air sceptique et triste, et dit doucement. « Avec eux, ce n’est pas si facile de s’en sortir. » Ayant bu tout mon saoul, je retournai vers le milicien qui m’emmena à la prison du district, non loin du bâtiment de la milice.
C’était une cellule située en entresol, assez étroite et longue, probablement héritée de l’ « ancien régime ». Elle ne contenait aucun meuble, le sol était de pierre, une unique porte du côté le plus étroit de la cellule dans laquelle était découpée une lucarne. La lucarne était sans vitre, mais avec des barreaux. Il est possible que cette cellule ait servi par le passé à dessoûler les ivrognes. On m’y enferma pour la nuit (qui commençait à tomber quand nous y arrivâmes), et on me désigna comme geôlier un paysan en pelisse, qui arborait en guise d’arme une hache glissée à la ceinture. On m’apporta un morceau de pain noir et de l’eau. Le paysan me les fit passer par la lucarne. J’essayai d’engager la conversation avec lui, mais il ne répondait pas. « Eh bien, lui dis-je, tu as donc même peur de parler ! » Il avait manifestement reçu l’ordre de se taire. Il ne me restait qu’à m’allonger sur le sol de pierre et dormir. Il faisait froid, mais j’étais si fatigué que je m’endormis rapidement et profondément.
Lorsque je me réveillais, il faisait déjà clair, et c’était, comme la veille, une belle journée ensoleillée. Vers huit heures, le milicien vint me chercher. On me fit asseoir sur un break, le cocher à l’avant, un milicien armé à l’arrière et moi au milieu. Je fus emmené à Korenevo, où on me remit entre les mains de la milice du district. On m’installa dans une pièce d’une maison de ville. Cette maison, réquisitionnée par la milice, avait dû être l’hôtel particulier de quelqu’un d’assez aisé. Une porte ouverte donnait sur le couloir, il n’y avait aucun gardien en vue. Un instant, j’éprouvais une tentation. fuir ! Mais c’était trop risqué. je ne savais pas où menait le couloir, et la sortie serait forcément gardée. À quoi bon courir un tel risque, pensai-je, puisque étant à nouveau en possession de mes papiers, je n’étais pas dans une situation désespérée ? Deux ou trois heures plus tard, on me fit sortir sous la garde d’un soldat armé, et monter dans un wagon de marchandises découvert qui se trouvait sur la ligne à voie unique Korenevo-Rylsk (outre la ligne principale vers Kiev et Koursk, il existait aussi à Korenevo une ligne est-ouest à voie unique d’une trentaine de verstes qui atteignait Rylsk, chef-lieu de district dans la province de Koursk). C’est cette ligne que nous empruntâmes.
Le soldat, fusil à l’épaule, s’assit près de la porte ouverte du wagon laissant pendre ses deux jambes à l’extérieur et sembla contempler le paysage. De nouveau, la même idée. et si je poussais le soldat hors du train et m’enfuyais ? Mais non, c’était impossible. Premièrement, j’étais incapable de faire une chose pareille (je ne me déciderais jamais à le pousser et ne saurais pas le faire), et de plus, le soldat avait mes papiers et sans eux, je n’irais pas bien loin. Une demi-heure plus tard, nous étions à Rylsk. Cette fois on m’emmena dans une grande bâtisse de pierre, pleine de monde. Je ne savais pas quelle administration abritait cette maison, probablement le commandement de la ville de Rylsk.
On me fit passer à travers la foule dans une pièce séparée, où se trouvait un chef bolchevik, assis à un bureau. Les cheveux ébouriffés, le col de sa chemise dégrafé, il avait l’air à moitié fou. Il avait devant lui un autre militaire, debout dans une attitude décontractée. Apparemment, il était en train de solliciter une permission pour se rendre au chevet de sa mère gravement malade. Son supérieur lui faisait des reproches en hurlant et en gesticulant. « Qu’est-ce qu’une mère ? Tu dois servir la Révolution et oublier tout le reste, tout sacrifier, y compris ta mère. Qu’elle meure ! La Révolution passe avant tout ! » Le militaire regardait son supérieur comme s’il avait affaire à un fou et, avec un sourire plein de mépris et d’ironie, répondit entre ses dents. « Comment ça. sacrifier ma mère ? Qu’elle meure ? Jamais de la vie ! » Ils continuèrent leur dispute. L’un hurlait, l’autre lui répondait calmement, d’un air de dérision. Finalement, le chef s’aperçut de notre présence, prit les papiers des mains de mon gardien, les examina. « Une affaire d’espionnage ! », s’exclama-t-il. « Ha ! ha ! ha ! », et il éclata d’un rire bruyant. « C’est une belle activité, il n’y a rien à dire ! Je vous félicite ! » — « Ce n’est pas du tout de l’espionnage » rétorquai-je. — « Qu’est-ce que c’est alors ? » — « Eh bien, j’étais allé chercher du sel … » commençai-je à raconter. — « Chercher du sel ? », cria le fou, « C’est donc de la spéculation ! Ce n’est pas mieux ! Tu es donc soit un espion soit un spéculateur ? » Mais je savais qu’une affaire de spéculation était moins grave qu’une affaire d’espionnage, et continuai à parler de sel. L’officier signa un papier et le remit à mon gardien. Je m’adressai à lui. « Je n’ai rien mangé depuis hier. Pourriez-vous me faire donner un peu de pain ? » — « Il n’y a pas de pain ici » me répondit sèchement l’officier.
On me fit passer dans la salle attenante. Nous attendîmes un certain temps dans la foule. Un soldat rouge me fit signe d’approcher (il avait probablement entendu ma conversation avec le chef) et je le suivis dans une petite pièce vide. Là, il sortit d’un sac une grande miche de pain et en coupa un gros morceau. « Prends-la, mais ne le dis à personne, sinon je serai sévèrement puni. » Je le remerciai du fond du cœur. Qui était-il ? Un brave homme, tout simplement, ou un sympathisant secret des Blancs ? (Peut-être avait-il deviné qui j’étais.)
Environ quarante minutes après, on me fit traverser la ville jusqu’au bâtiment de la milice du district. C’était un grand bâtiment de pierre qui ressemblait à une prison. Apparemment, cela avait été le bâtiment de la police avant la Révolution. On m’enferma seul dans une grande cellule. À une certaine hauteur, il y a une petite fenêtre, percée dans un mur tellement épais que ses barreaux étaient hors de portée. Tout indiquait qu’il s’agissait là d’une prison de l’ « ancien régime », les bolcheviks étaient bien incapables de construire des bâtiments aussi solides. Je ne me souviens plus s’il y avait une couchette dans ma cellule, il me semble que c’était un lit de planches. J’examinai la cellule. Sur les murs, de nombreuses inscriptions, laissées par les détenus. Parfois juste un nom et une date. Par exemple. « Ça fait vingt-six jours que je suis là, sans savoir pourquoi. » Ou. « J’ai passé ici dix-sept jours pour rien. » Ou encore. « Je suis ici, et je ne sais pas quand on me laissera sortir. Peut-être serai-je tué… » C’était peu encourageant. Apparemment, on restait longtemps ici.
Le premier jour, on ne me donna rien à manger, puis on commença à me donner un morceau de pain par jour. Deux fois par jour, le gardien venait vérifier que j’étais toujours là. Je me plaignais à lui de ce que l’on me gardât sans me nourrir ni procéder à la moindre enquête. « T’as qu’à écrire une réclamation », me dit-il. J’étais un peu étonné d’un tel conseil, mais c’est ce que je fis, et je transmis ma plainte écrite au troisième jour de ma détention à la prison de Rylsk.
Le quatrième jour après mon arrivée, on amena un deuxième prisonnier dans ma cellule. C’était un jeune homme, portant l’uniforme militaire, le visage déplaisant. Il avait l’air à la fois maladif et dégénéré. Très pâle. Nous nous mîmes à bavarder. C’était un tchékiste, un employé de l’administration locale de la Tcheka. D’après lui, on l’avait arrêté pour être rentré de permission avec un jour de retard, mais je suppose qu’il devait y avoir d’autres chefs d’accusation. « Que faisais-tu à la Tcheka ? » lui demandai-je. — « Oh, surtout des fouilles et des arrestations. J’en faisais très souvent, presque chaque nuit. Parfois plusieurs fois par nuit. » — « Et tu en as déjà fusillé ? » — « Non, il y en a dont c’est le travail. » — « Est-ce qu’on pouvait, pendant les fouilles, se mettre quelques petites choses dans la poche ? » — « Ça, non ! Pour ça, ils sont très sévères. Ils vous fusillent. » Le tchékiste était très inquiet pour son sort et disait qu’il ne sortirait jamais d’ici, qu’on allait le fusiller.
C’est ainsi que je passai près de quatre jours à la prison de Rylsk. Je réfléchis beaucoup en faisant les cent pas dans ma cellule. J’avais sans cesse en tête un poème de Brioussov, qui semblait être en résonance avec mon emprisonnement dans les geôles bolchéviques. Je ne pus me retenir d’écrire sur le mur deux vers de Brioussov (que j’ai placés en exergue du présent chapitre). « Les gardiens rient, les diables aux hallebardes ensanglantées. » C’est ainsi que je ressentais alors ma détention.
Le 6 septembre, on me transféra de la prison de Rylsk dans une institution autrement plus importante du (jeune !) appareil répressif soviétique de ce temps-là. le Point de contrôle militaire de la 41e division soviétique (42).
C’était une institution ambulante, qui se déplaçait en fonction de l’évolution de la ligne de front, et dont l’objectif était la lutte contre les crimes militaires (espionnage, spéculation, etc.) en zone de front. En cela, il se distinguait des établissements de la Tcheka, qui fonctionnaient en permanence sur des lieux fixes et dont l’objectif était la lutte contre la « contre-révolution ». En réalité, cependant, comme nous allons le voir, les points de contrôle militaire s’occupaient souvent d’affaires à caractère purement « contre-révolutionnaire » et n’ayant qu’un très vague rapport avec les affaires militaires ; il était donc difficile de tracer une limite bien définie entre leurs compétences et celles de la Tcheka. Il semble d’ailleurs assez illusoire de parler de compétence dans le contexte de chaos et d’arbitraire qui prédominait dans les institutions soviétiques en 1919, et en particulier dans la zone de front. En principe, les points de contrôle militaire ne faisaient que mener l’enquête avant de transmettre les dossiers aux tribunaux militaires et révolutionnaires. Dans les faits cependant, ils pouvaient prononcer eux-mêmes leur verdict, c’est-à-dire exécuter le prisonnier ou le remettre en liberté. La troisième solution, celle d’une peine de prison, était très rarement appliquée en cette période de guerre civile.
Le Point de contrôle militaire de la 41e division soviétique, où l’on m’avait transféré, occupait à Rylsk un hôtel particulier réquisitionné. À l’accueil, un marin au pantalon déchiré nota les renseignements me concernant (nom, prénom, etc.). À ses côtés, un autre marin, élégamment habillé, très brun, au beau visage, mais à l’expression cruelle. Sa casquette de marin, au lieu d’un nom de bateau, portait l’inscription « Terreur rouge ». Il était aisé de comprendre dans quel genre d’établissement je me trouvais. On me fit entrer dans une pièce située au centre de la maison, dépourvue de fenêtres mais comportant une seconde porte qui donnait sur une autre pièce, plus grande, avec des fenêtres sur la cour par lesquelles on apercevait des arbres. Sur une chaise près de la porte ouverte, était assis un gardien. un soldat rouge, tenant un fusil dans les mains. Ces gardiens se succédaient fréquemment les uns aux autres, mais il y avait toujours quelqu’un à la porte.
Il y avait beaucoup de prisonniers dans la pièce. Certains étaient debout, d’autres assis sur le sol. On en amenait, on en reprenait, mais il y en avait toujours quinze ou vingt dans la pièce. Je les observai et compris que la majorité d’entre eux était des habitants de Rylsk, ou des environs, que l’on accusait de sympathies pour les Blancs qui avaient occupé Rylsk pendant un temps avant de se replier vers le sud. Mais il y avait aussi des soldats de l’Armée rouge, coupables de quelque méfait. Dans l’ensemble, c’étaient surtout des petites gens, et il me sembla qu’il n’y avait parmi eux aucun autre véritable contre-révolutionnaire ou intellectuel que moi-même. Il y avait bien deux ou trois personnes, des fonctionnaires de l’armée, qui avaient l’air éduqué, mais ils furent vite emmenés ailleurs.
On nous apporta un bortsch (43) chaud. J’étais affamé, et il me parut succulent. Je ne me souviens plus si je dus passer la nuit dans cette pièce ou si nous fûmes transférés ailleurs le jour même. Quoi qu’il en soit, le 6 septembre vers midi, nos gardiens donnèrent des signes d’inquiétude. Je compris immédiatement ce que cela signifiait. les Blancs avançaient et menaçaient de prendre Rylsk ! Cela signifiait que les Blancs avaient avancé vite, puisque jusque là la ligne de front passait à trente ou quarante verstes au sud de Rylsk. En écoutant les conversations de nos gardiens, nous apprîmes que la ville était en cours d’évacuation. Les rues étaient encombrées de longues files de chariots, les institutions soviétiques déménageaient en hâte, emportant des monceaux d’affaires.
Nos gardiens étaient nerveux. L’un d’eux, un jeune gars un peu voyou, s’acharnait à briser les vitres des fenêtres qui donnaient sur la cour. « Ça de moins pour les Blancs ! » Un autre, plus âgé, tenta de l’en empêcher. « Mais qu’est-ce que tu fais, idiot, peut-être qu’on reviendra, et qu’est-ce qu’on fera, en hiver, avec des vitres cassées ? » On vint nous dire de nous tenir prêts à partir. Notre gardien disparut. À ce moment-là, plus fort que jamais, je fus pris de l’envie de fuir. Profiter de la panique et de l’absence de gardien, et m’évader. Me cacher en ville dans l’un des nombreux jardins ou potagers pour y attendre la venue des Blancs. Ils allaient arriver d’un moment à l’autre (44). Je m’approchai de la porte et regardai dans le couloir, par lequel les gens allaient et venaient régulièrement. Il menait certainement à la sortie principale. Il suffisait de sortir rapidement, de prendre à gauche, et je serais hors de vue. Mais si on me voyait ? Ou si, en chemin, il y avait un garde ? Ou s’il n’y avait pas de sortie par-là ? On me rattraperait, et on me fusillerait sur-le-champ. C’était trop risqué, d’autant plus qu’il n’y avait pas d’absolue nécessité de s’évader. Mes documents pouvaient me tirer d’affaire. Je restai près de la porte, sans pouvoir me décider.
Au dernier moment, on amena un nouveau groupe de prisonniers. C’étaient cinq personnes du hameau de Snagost où j’avais moi-même été arrêté par les Koubanais rouges. Parmi eux, Cyrille Dioubine, le président du soviet de district de Snagost qui avait assisté à mon arrestation. « Mais que faites-vous là ? », dis-je, étonné. — « C’est à cause de vous », me répondit-il. « Les Koubanais sont revenus, vous ont cherché, ils voulaient vous fusiller. Mais vous n’étiez plus là. Ils m’ont accusé de vous avoir fait transférer rapidement exprès pour vous sauver la vie. C’est pour ça qu’on m’a arrêté. » Plus tard, j’appris qu’il y avait une seconde charge contre lui. la première fois que les Blancs avaient commencé à approcher de Snagost, il aurait dû être évacué en tant que fonctionnaire soviétique occupant un poste à responsabilités. Mais Dioubine n’obéit pas à la règle et resta à Snagost sous l’occupation blanche. Quand les Rouges revinrent, cela constitua un chef d’accusation. Il invoquait comme explication le fait que la venue des Blancs avait été très soudaine, qu’il n’avait pas eu le temps de partir.
Parmi les autres prisonniers de Snagost, il y avait un prêtre, le père Paul. On l’avait arrêté parce que son fils était officier dans l’Armée blanche. Je ne sais pas comment cela avait été découvert, soit son fils était venu lui rendre visite pendant l’occupation de Snagost par les Blancs, soit c’est pendant cette occupation qu’il était entré dans l’armée. En tout cas, les Rouges ayant repris Snagost, arrêtèrent le père Paul. Ils arrêtèrent aussi l’ancien doyen administratif du hameau, un vieux de soixante-dix ans, pour avoir remis sa médaille au moment où les Blancs étaient là (j’appris à cette occasion que les doyens administratifs, avant la Révolution, possédaient une médaille qu’ils portaient comme signe distinctif de leur fonction). Il y avait encore deux paysans de Snagost, eux aussi coupable d’avoir exprimé de la sympathie pour les Blancs. Tout ce groupe avait été arrêté à Snagost par les Koubanais rouges. À la dernière minute, on amena encore une femme d’une soixantaine d’années, de Rylsk. C’était une petite-bourgeoise, propriétaire de sa maison, très peu éduquée, que l’on accusait d’avoir offert un bouquet de fleurs aux Blancs.
La nuit tombait quand nous nous mîmes en route. Dans le chaos de l’évacuation, notre administration n’avait pas réussi à se procurer de chariots, elle n’en avait que deux, sur lesquelles nous chargeâmes nos affaires. Nos dix gardiens allaient à pied, comme nous, et en étaient fort mécontents. Un jeune officier rouge, habillé de noir, vint s’ajouter au groupe des prisonniers. Comme les bolchéviques avaient réussi à la découvrir, c’était un ancien officier de l’armée impériale. Sa femme et sa belle-mère l’attendaient à la lisière de la ville et lui remirent des baluchons contenant de la nourriture et des vêtements pour la route. Les gardiens n’intervinrent pas. Ils le traitaient différemment de nous. Peut-être était-ce dû au fait qu’il était natif de Rylsk, comme beaucoup d’entre eux. En tout cas, il bénéficiait d’un régime de faveur. Avec lui, nous étions dix-huit à quitter Rylsk. Surtout des paysans, habitants de Rylsk et des villages situés à l’intérieur de la zone de front. Les Koubanais avaient bien travaillé !
Nous avancions à marche forcée, constamment houspillés par notre escorte. Vers dix heures du soir, nous entendîmes derrière nous, en provenance du sud-ouest, un bruit éloigné de tirs d’artillerie. Le ciel s’enflamma des lueurs d’un incendie. D’après les commentaires des gardiens, c’étaient des entrepôts bolcheviques qui brûlaient. Au matin, nous entrâmes dans un village. Nous nous installâmes en plein air pour nous reposer. Il faisait froid, nous somnolions. Les gardiens réussirent à se procurer des chariots et nous n’eûmes plus à marcher à pied. En général notre avancée se faisait de la façon suivante. notre « commandement » ouvrait la marche sur des chariots à part, c’était l’ « État-major » du Point de contrôle militaire, composé de cinq ou six personnes. Nous les voyions peu. Puis les prisonniers, deux par chariot, chacun conduit par un paysan, avec un gardien armé à l’arrière.
Apparemment, il était impossible de nous évacuer par le chemin de fer vers le sud par Korenevo et Lgov, la voie étant barrée par les Blancs. La nuit, nous nous arrêtions dans des villages où on essayait de nous trouver un local vide et facile à garder. Je me souviens de notre halte pour la nuit au village de Bereza, à mi-chemin. Il y avait là un grand domaine. On voyait de beaux bâtiments. On nous enferma pour la nuit dans un grand hangar. Conversation de notre gardien, le marin « Terreur rouge », avec le jeune paysan qui nous ouvre le hangar. « C’est à qui ce domaine ? » — « Aux Voljyne (45) » — « Et alors, vous les avez tués ? » — « Non », répond le paysan. « Eh bien, vous avez eu tort », dit le marin, d’un ton haineux, « il faut tous les tuer. Et tous leurs enfants avec. Sinon, quand ils seront grands, ils voudront récupérer leurs biens. Pourquoi ne les avez-vous pas tués ? » — « Mais ils sont partis, se sont cachés. » Sur ces entrefaites, on nous enferma dans le hangar, à l’aide d’un cadenas bien solide.
Le jour, nous nous déplacions en chariot, comme je l’ai dit. Grâce à Dieu, le temps restait clair, ensoleillé, les journées étaient même chaudes, mais les nuits avaient fraîchi. Soudain, deux cavaliers apparurent aux côtés de notre convoi, qui semblaient être des officiers rouges, ou des tchékistes. Ils n’avaient aucun maintien et ressemblaient à des voyous. Ils s’amusaient à se déguiser en Blancs. L’un d’eux se mit des epaulettes (46), l’autre déploya un drapeau jaune ukrainien et le porta ainsi, flottant, un bon bout de chemin à côté de nous. L’un d’eux s’adressa à moi sur un ton de moquerie. « Lieutenant, comment ces misérables vous ont-ils attrapé ? » Je ne répondis pas tout de suite, puis je dis. « J’ai été interpellé par des soldats de l’Armée rouge. » Le cavalier poursuivit ses bouffonneries. « Ah, les scélérats ! Comment ont-ils osé ? Il faut les fusiller ! » Notre gardien finit par se fatiguer de ces plaisanteries et chassa les voyous. « Allez-vous-en ! Déguerpissez ! Assez de bêtises ! » Les cavaliers disparurent. Pourquoi s’étaient-ils adressés à moi en particulier, pourquoi m’avaient-ils appelé « lieutenant » ? Apparemment, ils m’avaient distingué des autres. Un autre jour, alors que j’étais dans la charrette, on me donna un léger coup dans le dos. Je me retournai et aperçus un de nos marins-convoyeurs (mais pas « Terreur rouge », sur la casquette de celui-ci était brodée l’inscription « Flotte de la mer noire »). Sans un mot, il me tendit une miche de pain blanc. Cela tombait on ne peut mieux, car cela faisait deux jours qu’on ne nous avait rien donné à manger (ce qui n’était pas le cas de notre escorte).
Les soldats de notre escorte nous racontaient les « exploits » de l’Armée rouge (dont j’allais par la suite entendre de nombreuses variantes). « Il y a quelques jours, les nôtres ont décidé de vérifier qui est pour les Rouges, et qui est pour les Blancs. Ils ont mis des épaulettes, des cocardes. Ils ont composé un détachement, et se sont présentés dans cette tenue à Poutivl. Ils déclaraient. « Nous sommes Blancs, nous venons vous libérer. » Les habitants ont commencé par être sceptiques, puis les ont crus. Ils se sont mis à sortir de leurs maisons, et leur ont souhaité la bienvenue, les remerciaient, leur offraient des fleurs. Alors, les nôtres leur proposent de s’enrôler dans l’Armée des Volontaires. Cent cinquante personnes s’inscrivent. Arrive le pope, et le voilà qui célèbre un Te Deum sur la place. Il y a foule. Au beau milieu du Te Deum, les nôtres, sur un signe, ouvrent le feu. Les victimes sont très nombreuses. Toutes les nouvelles recrues sont fusillées. » Ce récit soulevait immanquablement l’enthousiasme et l’approbation des Rouges qui considéraient ce stratagème comme un modèle de l’art de la guerre, cela les faisait rire aux éclats. Mais je me demande aujourd’hui si tout cela s’était réellement passé, ou si cela relevait du simple folklore de l’Armée rouge. Je suppose que c’est une histoire vraie, mais fortement embellie dans ses details (47).
La majorité de mes codétenus, je l’ai dit, étaient des paysans. J’étais impressionné par leur foi, leur religiosité profondément ancrée. Dès qu’ils le pouvaient, ils priaient, se signaient, se prosternaient. Ils ne juraient pas, ils parlaient de Dieu. Bien sûr, « il faut que le tonnerre gronde pour que le paysan se signe (48) », mais il est tout de même indéniable que le paysan russe de cette époque était profondément croyant et religieux.
Après trois de jours de voyage, ayant parcouru une distance d’environ cent verstes à pied ou en chariot, nous atteignîmes la ville de Dmitriev, point de départ de mon épopée en zone de front. Le 9 septembre en fin d’après-midi, on nous amena jusqu’à la gare et on nous fit monter dans des wagons de marchandises. Cette fois-ci, la répartition était la suivante. la « hiérarchie » s’installa confortablement dans le premier wagon. Ils dormaient dans des draps et des couvertures (et probablement sur des matelas). Le deuxième wagon était celui de nos gardiens. Le troisième était occupé par nous, les détenus, en tout dix-huit personnes. Il y avait en permanence dans notre wagon un gardien armé (les gardiens, bien entendu, changeaient à tour de rôle). Pour la nuit, on bloquait de l’extérieur la porte de notre wagon à l’aide d’une barre de fer.
Bien qu’on nous ait éloignés de la ligne de front, le front lui-même s’était considérablement rapproché de nous. Cette impression nous fut immédiatement confirmée par les récits de nos gardiens. Lgov venait de tomber. Bien plus, ils venaient d’apprendre que les Blancs avaient pris Koursk (49). « Et ce qui est encore pire, dit un jeune gardien un peu nigaud, c’est qu’ils ont capturé tous les travailleurs de la Tcheka de Koursk. Tous. » — « Mais qu’est-ce qu’ils vont devenir ? », demanda l’un des paysans avec naïveté, ou peut-être avec malice. — « Comment ça, qu’est-ce qu’ils vont devenir ? s’exclama le gardien, pourquoi tu poses cette question ? Tu ne vas pas me dire que tu ne le sais pas ? » Les paysans chuchotaient entre eux. « Et si les Blancs finissaient par l’emporter ? » Un convoi de soldats rouges entra en gare en provenance du nord, de Briansk. On les envoyait au front. Ils étaient bruyants, ils chantaient, n’étaient pas démoralisés. Nos gardiens entrèrent en conversation avec eux (leur train était juste en face du nôtre). « D’où venez-vous ? » — « Du front de Sibérie. On vient d’écraser Koltchak, et maintenant on arrive pour achever Denikine. Et vous, qui êtes-vous ? » — « On escorte des détenus. » — « Des Blancs ? Pourquoi les escorter ? Autant les tuer tout de suite ! » Tard le soir, notre train se mit en route vers le nord, en direction de Briansk, qu’il nous fallut deux jours pour atteindre.
Ce délai me permit de faire connaissance aussi bien de mes « compagnons de détention » dans mon wagon, que de nos gardiens et même — dans une moindre mesure, il est vrai — de la « hiérarchie ». Je vais donc maintenant essayer d’en faire une description. La « hiérarchie » se tenait à l’écart, et nous les voyions rarement de près. Ils étaient cinq ou six, mais je ne saurais dire quelles étaient leurs fonctions exactes. À leur tête, deux hommes très bruns, de type méridional, plutôt des caucasiens que des juifs, me sembla-t-il, pour l’un d’entre eux tout au moins. Dans leur groupe, je me souviens d’un Arménien d’une cinquantaine d’années qui était très bavard et que cette caractéristique distinguait des autres. Pendant les arrêts du train, il venait souvent bavarder longuement avec les gardiens de notre wagon. Il était respecté de ces derniers, qui nous apprirent que c’était un vieux révolutionnaire et un érudit. Il évitait de nous parler.
Nos gardiens étaient une dizaine. Ils étaient sous les ordres d’un gardien-chef qui ressemblait à un sous-officier ou adjudant-chef de l’armée impériale qui se serait rallié aux bolcheviks. Il était d’une raideur militaire, ses gestes étaient retenus, son visage indiquait une certaine rigidité. Parmi les autres, on remarquait surtout les deux marins mentionnés plus hauts. Le premier, « Flotte de la mer Noire », silencieux et plutôt bon, m’avait donné une miche de pain. Le second, « Terreur rouge », était le type même du communiste fanatique, du pervers cruel. Il n’était pas agité comme le commandant de Rylsk, bien au contraire, il était très calme, son uniforme de marin était impeccable. « Ça fait longtemps que je n’ai pas eu affaire à un officier », disait-il à un autre gardien, alors qu’ils étaient en faction à la porte de notre wagon lors d’un arrêt du train, « s’il m’en tombait un sous la main, je lui montrerais de quel bois je me chauffe. » L’un des paysans, en un mélange typique de naïveté et de malice, posa une question au marin. « Qu’est-ce que c’est cette l’inscription brodée sur ta casquette ? Le nom d’un bateau ? » — « Non, c’est un programme », répond l’autre d’une voix condescendante. Les gardiens restants étaient tous de jeunes soldats rouges, des paysans illettrés, qui n’étaient probablement pas mauvais bougres, mais que leur travail dans des « points de contrôle militaire » et autres institutions de ce type avait pervertis. Certains se conduisaient de manière dissolue, abrutis par la propagande soviétique, ou peut-être étaient-ils niais de nature. Leurs visages étaient en quelque sorte marqués du « sceau de Caïn ». On ne pouvait pas confondre ces visages avec ceux, simples, russes, des soldats appelés dans l’Armée rouge qu’il m’avait été donné de rencontrer. L’un des gardiens jurait particulièrement souvent et grossièrement. Voulant le raisonner, l’un des paysans lui dit. « Tu sais, c’est pour que les gens cessent de jurer qu’on a fait la Révolution. » — « C’est pas vrai, s’indigne le gardien, si c’était vrai, on se ferait fusiller pour avoir juré, alors que là, on n’est pas fusillé. » À un autre jeune gardien qui déjeunait une fois sous nos yeux, avec sa gamelle (nous, on ne nous donnait rien à manger), les paysans dirent sur un ton de reproche. « Pourquoi tu ne fais pas ton signe de croix avant de manger ? » Il grommela quelque chose d’inintelligible, mais le jour suivant, bien que gêné et mal à l’aise, il fit de lui-même son signe de croix, à la satisfaction de tous les paysans.
Parmi les détenus, je commencerai bien entendu par parler du prêtre, le père Paul. Je l’ai déjà mentionné. C’était un homme gentil, tranquille, discret et humble. Un homme persécuté. il devait endurer quolibets et moqueries, on l’appelait « le chevelu (50) ». Nous eûmes quelques conversations amicales, lui et moi, mais par précaution nous n’abordions aucun thème brûlant, je ne lui avouai pas mes plans « blancs », il ne me dit rien de son fils. Et je ne lui posai aucune question. Les autres détenus étaient des paysans, je l’ai déjà dit. Ils se prosternaient dans le wagon, se signaient, disaient des prières. Au début, les gardiens se moquaient d’eux, puis cela sembla avoir un effet sur eux. Ils se mirent à jurer moins. Parmi les paysans, il y en avait un qui était un peu particulier. D’âge moyen, barbe châtain, les cheveux coupés au bol, les yeux bleu transparent. Il parlait sans discontinuer de la Bible, il en possédait une chez lui qu’il avait coutume de lire souvent. « C’est dommage que vous ne l’ayez pas prise avec vous », lui dis-je. — « Je voulais, mais je n’ai pas osé. J’avais peur qu’ils me la prennent, qu’ils la profanent, qu’ils blasphèment. » Je me demandai si cet expert de la Bible n’était pas membre d’une secte. Une autre fois il me dit. « Je n’ai pas tellement peur de ce qu’ils peuvent me faire, ils peuvent me fusiller ou me faire mourir en prison, peu m’importe. Mais cela m’ennuie pour mes enfants, ils seront marqués à vie du sceau de l’infamie. Tout le monde dira que leur père était contre-révolutionnaire. »
Deux des détenus se tenaient ensemble à l’écart, apparemment ils se connaissaient déjà auparavant. Le premier, un paysan ukrainien de dix-huit ans, était fils de koulak. Il avait essayé de se cacher dans un champ de chanvre, mais les bolcheviks l’avaient retrouvé. Il parlait peu, mais ne faisait pas mystère de son antipathie pour tout ce qui était soviétique. Les gardiens lui rendaient la pareille. Ils l’appelaient le « nocif ». Le second venait de Soumy, devait avoir trente-cinq ans, il portait une fine moustache, des vêtements de citadin, il ressemblait en tout point à un commis de l’ancien régime. Il était très bavard. Il se trouvait à Soumy lorsque les Blancs avaient pris la ville, mais s’était ensuite rendu, je ne sais pourquoi, dans une région tenue par les Rouges. C’est là qu’on l’avait arrêté, le considérant comme un agent des Blancs. Il répondait volontiers aux questions, et racontait sa vie à Soumy sous l’occupation blanche, sur un ton, il faut l’avouer, qui leur était favorable. « Et les ouvriers, ils ne sont pas humiliés chez les Blancs ? », demanda quelqu’un, un des gardiens probablement. — « Humiliés ? En quoi ? Ils se promènent au parc, avec les officiers. » On lui demanda si les officiers se font appeler « Votre Noblesse (51) ». Il répondit par la négative. Commença alors une discussion, quelqu’un soutint qu’il n’y avait que chez les Rouges qu’on ne disait plus. « Votre Noblesse », alors que chez les Blancs on le disait toujours. — « Non, c’est faux, il n’y a plus aucun « Votre Noblesse » nulle part », répondit le « commis », « les loups l’ont mangé. » N’y tenant plus, le garde intervint. « Qu’est-ce que tu as à dire du bien des Blancs ? Tu as l’air de beaucoup les aimer. » Cela fit immédiatement taire le « commis ».
Parmi les détenus, il y avait aussi un soldat rouge letton. Cocaïnomane, vagabond, il avait traîné ses guêtres absolument partout, même chez les Blancs. C’était un homme en pleine déchéance et un peu fou. Son russe était assez bon, il le parlait avec beaucoup d’assurance. Il portait une capote de soldat. Il avait été arrêté comme déserteur. On voulait sans doute aussi faire une enquête sur ce personnage.
L’officier arrêté à Rylsk restait un mystère pour moi. Nos gardiens semblaient le tenir en haute estime. Il était constamment en conversation avec eux, il s’adaptait parfaitement à leur façon d’être. Les soldats étaient flattés de voir un officier, ancien lieutenant de l’armée impériale qui plus est, bavarder avec eux d’égal à égal. Il leur racontait son service dans l’Armée rouge. « C’est un bolchevik, me dis-je, il est avec eux. Mais pourquoi l’a-t-on arrêté ? » L’avenir allait donner une réponse partielle à mon étonnement (52).
Je me souviens aussi d’un jeune homme qui avait dû nous rejoindre en route. Il avait l’air éduqué, un physique de « poète », probablement un étudiant. Je ne sais pas ce qu’on lui reprochait. Il vivait sa détention dans un état second, semblait accablé, angoissé à l’idée d’être fusillé. Cela lui provoquait des crises d’épilepsie plusieurs fois par jour. Il était pris de convulsions et perdait connaissance. Et plus le temps passait, plus les crises se faisaient fréquentes. Ces crises nous pesaient, à nous aussi bien qu’aux gardiens. Je ressentais un sentiment d’impuissance assez avilissant et étais indigné que l’on puisse traiter un malade de cette façon. « Voilà le vrai visage du bolchevisme », pensais-je tout bas. On ne lui dispensait aucun soin médical. Mais les gardiens se mirent à exprimer leur mécontentement, et quelques jours plus tard, alors que le malade traversait à nouveau une de ses crises, un des hommes de la « hiérarchie » vint y « jeter un coup d’œil ». À la suite de cela, on le fit descendre du train dans une petite gare avant même d’arriver à Briansk, pour l’emmener à l’hôpital, nous dit-on.
Enfin, le dernier spécimen dont je me souvienne parmi mes codétenus du Point de contrôle militaire. la propriétaire petite-bourgeoise de Rylsk. C’était un être malheureux, pitoyable, à bout de nerfs, et en même temps insupportable, voire répugnant. Elle racontait inlassablement qu’on l’avait arrêtée suite à la dénonciation de sa nièce qui l’avait calomniée auprès des Rouges à leur retour à Rylsk, en prétendant qu’elle avait offert un bouquet de fleurs aux Blancs. « Et tout ça pour avoir ma maison. Elle m’avait demandé de me prendre chez elle avec son mari, mais j’ai refusé. Elle s’est vengée. » Et elle se mettait à prier à haute voix. « Seigneur, punis-la, foudroie-la ! Qu’elle devienne aveugle ! Qu’elle crève ! » Sur ces paroles, elle faisait des signes de croix, elle se prosternait. Les paysans lui disaient. « On ne peut pas prier comme ça, contre autrui. C’est un péché ! » Les gardiens, eux, riaient d’elle. C’était une femme d’une soixantaine d’années, que la vie n’avait pas accoutumée aux privations, et elle supportait mal les contraintes de la détention, les longues marches à pied, le bivouac à même le sol. Mais plus que tout, elle était tourmentée par l’idée qu’on allait la fusiller. Elle avait peur de la mort. Les gardiens la traitaient avec cruauté. Ils lui jouaient des tours, se moquaient d’elle, lui faisaient peur. Sur la fin du voyage, elle se mit très nettement à perdre la raison.
Nous étions entre Dmitriev et Briansk. Notre train marquait de longs arrêts dans les gares. Sentiment triste de nous éloigner de plus en plus du front. Nous avions faim. Au fur et à mesure de notre progression vers Briansk, le temps changeait. Il faisait froid, sombre, il pleuvait. C’était vraiment l’automne. De jour en jour, il devenait de plus en plus évident que j’étais mal vu de la « hiérarchie ». On me traitait différemment des autres. Il est vrai qu’il m’arrivait de commettre des imprudences. Un jour par exemple, j’entendis un de nos gardiens, un « nigaud », lors d’une conversation avec l’officier, raconter des arrestations. L’officier aussi raconta comment il avait fait la chasse aux espions sur le front de Gomel. « Et alors, vous les avez tous fusillés ? », dis-je. Le nigaud explosa. « Je vois bien que tu es le plus nocif de tous. Tu n’as que le mot « fusiller » à la bouche. On voit que tu as commis quelque chose, et maintenant tu as peur. » Je me tus, et ne me mêlai plus à la conversation. Il ne fallait pas narguer les fauves, c’était suffisamment pénible comme ça.
Un incident beaucoup plus sérieux se produisit dans une gare sur la route de Briansk. Il s’agissait d’aller chercher deux seaux d’eau pour notre wagon. Le gardien demanda des volontaires. Un paysan se proposa, moi aussi. Nous prîmes chacun un seau. Le robinet se trouvait à quelques sagènes de nous, derrière les wagons. Mon unique intention était de me détendre les jambes, mais comme je longeais le wagon de la « hiérarchie » un des gradés en jaillit littéralement, me saisit par l’épaule et m’ordonna d’un ton sec. « Au wagon ! » Puis, s’adressant au gardien. « Je vous avais pourtant donné l’ordre de ne pas laisser sortir celui-là ! Il doit être spécialement surveillé. » Je retournai à mon wagon, un paysan me remplaça. La nuit, le Letton cocaïnomane vint s’asseoir à coté de moi et me chuchota à l’oreille. « Aujourd’hui, le gardien-chef nous a dit qu’il ne fallait pas qu’on s’en fasse trop, que parmi nous il y n’y aurait que deux ou trois fusillés. Il a dit que le premier sur la liste, c’était vous, car vous aviez été pris en possession d’une carte, et étiez manifestement un espion. Vous risquez d’être fusillé. Je sais que vous êtes un officier. Évadons-nous cette nuit, ensemble. On casse la porte, et on s’enfuit. » — « Mais comment casser la porte ? Et que ferons-nous sans papiers ? Si l’on nous arrête, on nous fusillera sur place », répondis-je dans un souffle. — « Je sais comment casser la porte, il n’en restera que de la sciure. Quant aux papiers, ne vous en faites pas, j’en trouverai de nouveaux. Ce ne sera pas la première fois. » Je réfléchis. Dans une situation comme la mienne, la perspective d’une évasion était séduisante. Mais le plan d’une telle évasion était trop risqué, d’ailleurs, ma situation ne me semblait pas sans espoir. Il me semblait que je réussirais à me justifier ; alors pourquoi m’exposer à de tels risques ? Et puis ce Letton était tout de même vraiment un personnage douteux. C’était peut-être un provocateur, un dénonciateur et, en tout cas, il était manifestement dérangé. Je répondis donc. « Je ne suis pas officier, d’où tenez-vous cela ? Je suis étudiant. Mes papiers sont en règle, je serai innocenté, et on me relâchera. Je n’ai pas de raisons de m’évader. » — « Eh bien, c’est vous qui voyez, dit le Letton, mais n’en parlez à personne. » — « N’ayez pas peur, je ne dirai rien. » Le Letton s’écarta. Jusqu’à présent, je me demande qui il était. Il voulait probablement s’évader lui-même, et avait besoin de moi pour l’introduire auprès des Blancs.
Le lendemain matin, autre incident pénible. lors d’un arrêt en gare, la « propriétaire » de Rylsk demanda à sortir du wagon pour satisfaire un besoin naturel. On l’emmena à l’écart, sur les voies. Un gardien armé (un des « nigauds ») l’accompagna, comme cela se faisait toujours en pareil cas. Il resta à une certaine distance. Soudain, la « propriétaire » partit en courant. C’était de la pure folie, il n’y avait nulle part où se cacher. En un instant, le gardien la rattrapa, la frappa à coup de crosse, et l’entraîna vers le wagon. Elle était en pleine crise de nerfs. Un des chefs, un Caucasien, sortit de son wagon, se mit à crier au gardien. « Qu’est-ce qui t’a pris de ne pas lui tirer dessus ? » On agonit la « propriétaire » d’injures. On l’emmena. Les soldats discutaient entre eux. « Bon, c’est fini ! Une tentative d’évasion, c’est une balle dans la tête. » Pourtant, une demi-heure plus tard, on la ramena dans notre wagon. Ils avaient dû se dire que ce n’était pas la peine de fusiller une vieille folle. On lui avait probablement donné une correction, et la voilà de retour. « Elle a eu de la chance que ce ne soit pas le marin « Terreur rouge ». Lui, il l’aurait abattue sur place », remarqua notre gardien.
Le 12 septembre au matin, nous arrivâmes enfin à Briansk. Dix jours étaient déjà passés depuis mon arrestation à Snagost par les Koubanais, et personne ne m’avait encore interrogé, l’enquête n’avait pas commencé. À Briansk, on nous sépara. Ceux — la majorité d’entre nous, soit treize personnes — dont le cas avait été étudié par le Point de contrôle militaire furent remis au tribunal militaire et révolutionnaire. Les cinq restants, à savoir les trois paysans de Snagost, avec à leur tête Dioubine, le père Paul et moi, fûmes remis à la Section spéciale auprès de l’État-major de la 14e armée soviétique.
On nous fit entrer dans un grand bâtiment de briques de quatre étages, les locaux de la Section spéciale. C’était un ancien lycée de filles. À l’accueil, au rez-de-chaussée, nous fûmes inscrits dans un gros registre par un homme corpulent en uniforme militaire, qui avait aussi le type du sous-officier tsariste qu’il m’avait déjà souvent été donné d’observer parmi les Rouges. J’entendis que, lors de l’inscription au registre, outre les questions habituelles (nom, profession, etc.), on demandait notre appartenance de classe, ce qui semblait contradictoire, puisque les bolcheviks avaient aboli les classes. En attendant mon tour, je me demandai ce qu’il fallait répondre. la vérité, c’est-à-dire « aristocrate » ? C’était dangereux. « Paysan » ? J’avais peur qu’on ne me croie pas. Je dirais quelque chose entre les deux, « petit-bourgeois », par exemple. Mais le gardien, m’ayant dévisagé avec ironie — me sembla-t-il —, me demanda directement. « Paysan ? » — « Oui », répondis-je, puisqu’il le suggérait lui-même. Il poursuivit en me demandant de quelle province, région, district, village je venais. J’inventai une réponse sans la moindre difficulté. Je nommai un village qui se trouvait près de Vesyegonsk, l’endroit où j’avais travaillé.
Puis, on nous fit monter à l’étage, dans une gigantesque salle rectangulaire, dont l’un des murs était percé de fenêtres qui donnaient sur la ville. On nous laissa là avec d’autres détenus. Dès qu’ils remarquèrent parmi nous la présence du père Paul, ils se mirent à crier. « Un pope ! Un pope ! Regardez. un chevelu ! » Quelques détenus entonnèrent une chanson irrévérencieuse. « Le pope avait un chien, il l’aimait bien. Un morceau de viande il avala, le pope le tua. En terre, il le mit, et sur la tombe inscrivit. le pope avait un chien, etc. » Ils répétèrent cette chanson en boucle jusqu’à s’en lasser. Le père Paul ne prêtait pas attention à ces moqueries. Les chanteurs ne formaient, il faut le dire, qu’un tout petit groupe. Les autres détenus ne disaient rien. Les gardiens non plus ne réagirent pas.
Le nombre des détenus dans cette pièce oscillait entre quarante-cinq et cinquante. Certains étaient emmenés, ils étaient remplacés par d’autres. Dans la pièce, à part deux pupitres sur lesquels s’étaient installés deux « privilégiés » (ou plutôt des débrouillards), il n’y avait aucun meuble, et nous nous asseyions et dormions sur le sol poussiéreux. Grâce à Dieu, nous n’étions pas trop serrés. Vers midi, on nous distribua à chacun un bout de pain noir, puis on nous apporta un repas chaud qui, selon les normes de l’époque, était tout à fait décent. une soupe de semoule avec des petits cubes de viande. Le soir, on ne nous donna rien, car nous étions arrivés trop tard dans la matinée. En payant (on nous avait confisqué notre argent, mais nous pouvions le dépenser pour des achats), on pouvait commander, par l’intermédiaire d’un gardien, du pain et d’autres denrées au marché, mais seulement à partir du lendemain.
À Briansk, la Section spéciale fonctionnait de pair avec la Tcheka et le tribunal militaire révolutionnaire. Cette institution était bien plus importante hiérarchiquement que le Point de contrôle militaire, même si les champs de leurs compétences respectives étaient similaires, puisqu’il s’agissait dans les deux cas de lutte contre l’espionnage et autres crimes du même acabit à l’arrière du front rouge. En réalité, à la Section spéciale, il y avait une plus grande diversité chez les détenus, parmi lesquels on comptait très peu de véritables contre-révolutionnaires ou espions mais un assez grand nombre de bolcheviks de gros calibre (bien plus qu’au point de contrôle militaire). Mais je reparlerai de cela plus tard.
Le lendemain de mon arrivée, vers onze heures du matin, on vint me chercher pour un interrogatoire. Un gardien me fit passer par de nombreux couloirs et escaliers pour me faire entrer dans une grande pièce où deux hommes étaient assis à deux tables différentes dans deux coins opposés. L’un d’eux était le juge d’instruction. C’était un homme de trente-cinq ans environ, brun, le visage creux, portant une tunique noire. Je pense qu’il était russe. À ses premiers mots, je compris qu’il n’était pas très éduqué, en fait d’études je pense qu’il avait dû aller jusqu’en fin d’école municipale. L’autre homme, plus jeune et qui avait l’air plus cultivé, semblait plongé dans son travail, ce qui — comme cela s’avèrerait plus tard — ne l’empêchait nullement d’écouter mon interrogatoire avec la plus grande attention. Le juge d’instruction m’indiqua une chaise en face de lui et commença à m’interroger.
Je dois ici préciser que je m’étais beaucoup préparé à cet interrogatoire, cherchant à deviner à l’avance les questions que l’on allait me poser et réfléchissant à mes réponses. Je me souvenais des interrogatoires de Raskolnikov par le juge d’instruction Porphyre Pétrovitch dans Crime et Châtiment. Comme un joueur d’échec, j’avais cherché à anticiper le jeu de l’adversaire et à élaborer des réponses utiles et convaincantes. Surtout qu’il y avait dans mon dossier bien des points faibles ou délicats. Par exemple, le laissez-passer que m’avait donné à Lgov le « camarade Kahn » portait la date du 10 septembre, alors que j’avais été arrêté à Snagost, près de Korenevo, le 15 septembre. On allait me demander ce que j’avais fait pendant ces cinq jours. Il était hors de question d’expliquer que j’étais retourné de Korenevo à Dmitriev (plus de cent verstes aller-retour) ; c’était insensé et injustifiable de la part de quelqu’un en mission. Et je ne pouvais pas non plus cacher ces déplacements. que se passerait-il si le juge, m’ayant laissé débiter mes explications et l’histoire du « sel », vérifiait la date de mon laissez-passer, et, comme Porphyre Petrovitch sur Raskolnikov, me tombait dessus en demandant. « Mais qu’avez vous fait pendant ces cinq jours ? Pourquoi m’avez-vous caché vos déplacements ? » Ne valait-il mieux pas tout avouer spontanément ? Cependant, cela risquait de compliquer inutilement mon dossier. Pour un juge voulant m’accuser d’espionnage, la direction que j’avais prise et mes déplacements n’étaient pas une énigme ; je me dirigeais vers le front. À cela, je n’avais qu’une réponse à donner. le sel. Mais ce n’était guère convaincant.
Je cherchai en vain à élaborer une tactique pour contourner ces questions délicates. Mais quand mon véritable interrogatoire commença enfin, je me rendis compte que mon enquêteur était bien loin de Porphyre Petrovitch ! Globalement, la première partie de mon interrogatoire consista à me faire raconter en détail les étapes de mon voyage, à nommer les endroits que j’avais traversés et ce que j’y avais fait. Le juge essayait parfois de me troubler ou de me prendre en contradiction, mais de façon assez primitive. Ainsi, alors que j’expliquais que j’étais passé par Vologda et que j’y avais obtenu de l’État-major de la 6e armée l’autorisation de me rendre à Moscou, le juge dit. « La 6e armée ne se trouve absolument pas sur le front septentrional. » J’allais le contredire, quand l’homme qui était assis à l’autre table se mêla à la conversation. « Non, il a raison, l’État-major de la 6e armée se trouve bien à Vologda. » Le juge se vit contraint d’admettre son ignorance. Plus tard, il essaya de me confondre à propos des menuisiers. « Racontez-moi comment vous vous y seriez pris pour embaucher des menuisiers ? Par quoi auriez-vous commencé ? » Cette question me mettait dans une situation difficile, car je n’avais pas la moindre idée de la façon dont on embauche un menuisier. « Eh bien, je me serais rendu au Soviet local, répondis-je néanmoins avec assurance, et je leurs aurais demandé les noms des menuisiers disponibles. Et puis, j’aurais été aidé par mon camarade de mission, il est plus au fait des aspects techniques de la chose. » À ma grande chance, le juge n’avait pas plus que moi idée de la marche à suivre pour embaucher des menuisiers, il n’était donc pas en mesure de pousser plus avant son interrogatoire.
Nous en étions arrivés au moment le plus délicat de mon récit. D’une voix sourde, sans préciser les dates, je dis. « De Lgov, je suis allé à Korenevo… » Je m’attendais à ce que le juge voie la date inscrite sur mon laissez-passer et demande. « Qu’avez-vous fait pendant ces cinq jours ? » « Où avez-vous été ? », mais, grâce à Dieu, cela ne lui vint même pas à l’esprit, et je me gardai bien de mentionner mon aller-retour Dmitriev-Lgov-Korenevo, puis le hameau de Selino et Snagost. Il me fallut tout de même bien mentionner l’expédition pour le sel mais, bien que la fameuse carte se trouvât sur sa table, le juge était incapable de déterminer la distance entre Selino et Korenevo. Pour cette raison, le récit de mes détours lui sembla insignifiant.
Ma carte fut l’objet de quelques questions (pour des gens incultes, la simple possession d’une carte était un sérieux chef d’accusation qui pouvait avoir de sérieuses conséquences, positives ou négatives). J’insistai sur le fait que la carte était d’édition soviétique, rédigée selon la nouvelle orthographe, que je l’avais achetée à Dmitriev, et que si j’avais eu la moindre arrière-pensée (« hostile », « d’espionnage »), je me serais procuré une autre carte à l’avance. Était-ce convaincant ? Cela semblait plutôt naïf, mais le juge fut satisfait de mes réponses.
Il tomba ensuite sur une note de mon camarade de mission demandant à un paysan d’un hameau près de Korenevo de m’aider. Il resta un moment à déchiffrer ces pattes de mouches puis. « C’est vraiment écrit par quelqu’un de peu éduqué ! » Cette circonstance sembla apaiser ses soupçons. Il ne prit même pas la peine de me demander où se trouvait ce hameau en question.
Puis il passa à la deuxième partie de l’interrogatoire, à propos de mes origines sociales. J’avais préparé mes réponses. « Profession du père avant la Révolution ? » — « Il travaillait à la manufacture Morozov d’Orekhovo-Zouïevo », dis-je, ce qui n’était qu’un mensonge partiel, puisque mon père avait effectivement été l’un des directeurs de cette manufacture après la Révolution. — « Il travaillait ? Il la dirigeait, voulez-vous dire ? », demanda l’enquêteur d’un ton moqueur (c’était incroyable qu’il ait vu aussi juste) — « Non, il était comptable. » — « Et maintenant ? » — « Il est décédé », répondis-je. C’était faux, mais il me sembla plus raisonnable de mentir pour éviter des questions complémentaires. « Et vous, que faisiez-vous ? » — « J’étais étudiant à l’université. » Le juge s’était radouci, et, l’air narquois, me dit. « Bon, l’affaire me semble claire. on vous envoie en mission, vous laissez votre compagnon faire tout le travail, et vous, vous partez chercher du sel ! » — « Ce n’est pas tout à fait vrai », répondis-je, sans chercher toutefois à trop le contredire. L’interrogatoire était fini, et le juge se mit à en rédiger le procès-verbal. Il y passa un certain temps, se relut, puis me le donna à lire. Il était rédigé d’une façon beaucoup plus correcte que celui de la milice de Snagost mais comportait tout de même des fautes de grammaire. Ce texte reprenait en gros ce que j’avais déclaré, de manière brève et elliptique. Il n’y était fait mention ni du sel ni de la question à propos de mes origines sociales. Au contraire, tout paraissait en ma faveur et la vérité semblait de mon côté. « Vous acceptez de le signer ? », me demanda l’enquêteur. — « Oui », dis-je, et je le signai sans hésitations. « Mais de quoi suis-je accusé ? », demandai-je toutefois. Le juge émit encore un petit rire et me répondit d’un air entendu. « D’avoir l’air suspect. » — « Et maintenant ? Qu’allez-vous faire de moi ? » — « C’est la commission d’instruction qui va en décider. » Il se leva, appela le soldat qui me ramena par les longs corridors dans la salle des détenus. J’étais plein de sentiments contradictoires. Cela aurait pu être bien pire, pensai-je, on ne m’accuse de rien de précis. Mais il est impossible qu’ils accordent ainsi foi à mes paroles. C’est certainement un stratagème de leur part. Un Porphyre Petrovitch soviétique va certainement faire son apparition et dire. « Et ceci ? Et cela ? Pourquoi nous l’avez-vous caché ? »
Deux ou trois journées de détention passèrent ainsi, pleines de pensées pénibles et de sentiments d’inquiétude. J’eus aussi l’occasion de faire la connaissance de mes codétenus. C’est étonnant mais, pour la majorité d’entre eux, ils étaient eux-mêmes bolcheviks. C’était une curieuse collection de spécimens humains.
Le plus remarquable d’entre eux était probablement le camarade Azartchenko. Quarante-cinq ans environ, petit, roux, la poitrine et les bras couverts de tatouages. Sous le tsar, il avait connu le bagne de Sakhaline, après la Révolution, pendant la guerre civile, il avait été partisan sur le Don contre les Blancs. Il avait été fait prisonnier par ces derniers avec tout un groupe de partisans. Quand les Blancs les fusillèrent, il se laissa tomber sur le sol bien que n’ayant pas été blessé. À côté de lui, il y avait un mort dont le sommet du crâne avait été arraché. Il se couvrit le visage du crâne ensanglanté, et quand les Blancs vinrent achever les blessés, ils le prirent pour mort et ne le touchèrent pas. Ces derniers temps, il dirigeait une section de la Tcheka près de Kiev. « J’étais très bien organisé, racontait-il, j’avais des agents dans les cafés et dans les tavernes, ils liaient conversation avec tous les nouveaux venus, les faisaient boire et repéraient les contre-révolutionnaires. » Quand Kiev avait été prise par les Blancs, il avait décidé de se rendre au bureau central de la Tcheka, pour dénoncer les traîtres, des gens haut placés. Mais ces derniers l’avaient intercepté alors qu’il était en route, et c’est eux qui le gardaient ainsi en détention depuis plus de trois semaines. « On ne me laissera jamais sortir, disait-il, j’en sais trop sur les gens importants, sur leurs affaires. » Il s’installa à l’un des pupitres de notre salle, mais lorsqu’un jeune gars accusé d’être déserteur s’installa à l’autre pupitre, il se mit à hurler. « Tu n’es là que depuis hier, et déjà tu prends la meilleure place ! Tu es un déserteur ! Si j’étais libre, je t’aurais descendu ! Pourquoi est-ce qu’ils te gardent là ? » Je liai conversation avec lui, aussi bien par curiosité que pour passer le temps. « Je repère immédiatement les contre-révolutionnaires », me dit-il. Apparemment, grâce à Dieu, il ne m’avait pas repéré. En tout cas, quand je lui racontai qu’on m’avait envoyé en mission, que tous mes papiers étaient en ordre et que malgré cela, on m’avait arrêté, il dit. « C’est incroyable, ce manque de coordination qui subsiste entre nos différentes administrations. »
Il y avait un autre groupe intéressant parmi les détenus. c’était l’équipe de commandement d’un train blindé, six personnes en tout, dont deux juifs en civil, des commissaires probablement, les autres étant des officiers rouges. Les deux juifs étaient les plus cultivés et d’allure convenable. Le jour de mon arrivée, quand, n’ayant pas été nourri, j’avais vu que l’un des deux juifs s’était fait apporter du marché beaucoup de pain et divers aliments, je m’étais approché de lui et lui avais demandé du pain. Immédiatement, sans dire un mot, il m’avait coupé une grosse tranche de pain noir. Les officiers du train blindé avaient visiblement été des militaires de l’ancienne armée russe. Mais je compris pourquoi ils étaient passés chez les Rouges. C’étaient des gens au comportement de voyous, débauchés et imbibés d’alcool. Ils ne se laissaient pas abattre, surtout deux d’entre eux qui portaient des pantalons bouffants, ils chantaient des chansonnettes de l’époque, comme par exemple. « Vova s’est bien débrouillé », qu’ils accompagnaient de claquettes et d’autres danses de cabaret. Je demandai à l’un d’eux. « Pourquoi vous a-t-on arrêté, vous, des officiers rouges ? » — « Oh, eh bien, en état d’ivresse, nous avons fait des ricochets. » — « C’est-à-dire que vous aviez bu, et c’est pour cela qu’on vous a mis en prison ? » — « Oh non, on ne nous aurait pas arrêté pour si peu. Ce qu’il y a, c’est qu’ayant bu, nous avons fait des ricochets, et ça c’est mauvais. » Mais ils ne me dirent pas en quoi consistaient les « ricochets ». Cela devait être du sérieux. Au début, quand ils apprirent qu’on m’avait arrêté « en possession d’une carte », ils me prirent pour un espion, mais quand je leur racontai comment s’était passé mon interrogatoire, ils me dirent. « Eh bien, tu vas être libéré, mais pas nous. » J’ajouterai que ces deux officiers rouges étaient les instigateurs des moqueries envers le père Paul, c’était eux qui avaient commencé à chanter. « Le pope avait un chien. » Ces moqueries devaient d’ailleurs cesser au bout de quelques jours. était-ce par lassitude, ou avaient-ils eu honte ?
Je me rappelle aussi d’un officier de cavalerie rouge, dont le pantalon était réduit en lambeaux par ses continuels déplacements à cheval. « J’ai fait à cheval toute la retraite, plus de mille verstes, et à peine étions-nous arrivés au repos que je fus arrêté sur dénonciation, je ne sais pas du tout pour quel motif. » Il était difficile de savoir qui il était en réalité.
Parmi ceux que l’on pouvait désigner du terme convenu de « contre-révolutionnaire », je citerai, avant tout, deux ex-sergents de ville de Briansk. L’un d’eux était détenu depuis plus de huit mois, l’autre depuis plus longtemps encore. C’étaient deux hommes profondément malheureux, affamés, terrorisés, exténués par leurs transferts de prison en prison. Ils étaient sales, sentaient mauvais et avaient perdu toute dignité ; ils n’avaient plus apparence humaine. De plus, ils étaient pieds nus et en sous-vêtements déchirés. Ils étaient si sales qu’on les maintenait à l’écart, près du mur et il leur était interdit d’approcher les autres détenus, mais ils essayaient pourtant de le faire, et venaient quémander, mendier des mégots de cigarette ou des croûtons de pain. Ils se plantaient devant un détenu en train de manger et le regardaient sans dire un mot. Parfois on leur donnait quelque chose, parfois on les faisait déguerpir en les frappant. En manière de plaisanterie, on les avait surnommés « Denikine », et « Chkouro (53) », et on se moquait beaucoup d’eux, on les couvrait de quolibets. On les forçait à accomplir les tâches les plus sales. Pour reprendre la terminologie moderne du monde concentrationnaire, on peut dire que c’étaient des « crevards (54) ». On disait d’eux qu’ils avaient été arrêtés parce qu’ils avaient collé des affiches de Denikine, mais j’ai du mal à y croire, ils en semblaient bien incapables. On les avait tout simplement arrêtés en tant qu’anciens sergents de ville. Un matin, l’un d’eux se mit à uriner directement sur le sol de notre salle (on ne laissait personne aller aux toilettes la nuit, et il n’y avait pas de « tinette » dans la salle même). Voyant cela, l’un des officiers du train blindé s’approcha de lui d’un bond et se mit à le gifler. « Je t’ai pourtant interdit de le faire ! », criait-il. Mais l’autre, sans réagir aux coups, continuait à uriner.
Dans notre salle (cellule), il y avait aussi un groupe de cinq ou six personnes, arrêtées à Gloukhov et accusées d’appartenir à une organisation contre-révolutionnaire (55). Il y avait dans ce groupe une institutrice assez jeune, plutôt jolie, habillée convenablement, mais qui avait l’allure d’une déséquilibrée. Elle était très bavarde. « J’étais institutrice à Soumy. Je buvais beaucoup, j’ai commencé à consommer de la cocaïne, j’ai perdu ma place, j’étais dans la misère. Quand les Blancs sont arrivés, je suis allée voir leur commandement, et je leur ai demandé du travail. Un lieutenant m’a dit. « Nous n’avons pas de travail à vous proposer, mais si vous voulez, nous pouvons vous engager comme espionne. » Je n’ai pas réfléchi, j’ai dit oui. On m’a donné des faux papiers, de l’argent et on m’a envoyée à Gloukhov qui est ma ville natale. Ils m’ont aidée à franchir la ligne de front. Je suis arrivée à Gloukhov sans le moindre problème, mais là j’ai pris peur, et de moi-même je suis allée voir la police pour leur dire qu’on m’avait envoyée là pour espionner. Je pensais qu’on enquêterait et qu’on me relâcherait, mais ils m’ont arrêtée et beaucoup frappée, pour que j’avoue les noms de ceux que je devais contacter. J’ai fini par donner des noms de gens que je connaissais à Gloukhov. Et on les a arrêtés eux aussi. » Ceux qui avaient ainsi été arrêtés par sa faute étaient ici même et, bien entendu, lui en voulaient. D’après eux, l’institutrice avait tout inventé. Ils me disaient même. « Ne lui parlez pas, elle est folle, c’est une mythomane. Elle va s’inspirer de sa conversation avec vous pour vous faire dire des choses que vous n’avez pas dites. Et alors, malheur à vous ! » Aussi, me méfiais-je d’elle, même s’il m’arrivait parfois de lui parler. Je la plaignais. Elle était persuadée qu’on allait la fusiller.
« Ah, si je pouvais faire la fête un petit coup, pour finir en beauté ! », disait-elle souvent. Mais on ne lui rendait pas l’argent qu’on lui avait confisqué, ce qu’elle déplorait car elle ne pouvait pas faire d’achats ni, surtout, « faire la fête » avec cet argent.
Il y avait encore un drôle de type parmi les détenus, avec qui je conversai. Il était très gros et plus très jeune. Il me raconta qu’il avait été envoyé en mission et que, lors d’un contrôle d’identité au cours de son voyage, on avait découvert sur lui une liasse de formulaires vierges signés et portant un cachet de l’administration qui lui avait délivré son ordre de mission. Les autorités soviétiques punissaient sévèrement de tels agissements qui étaient assimilés à de l’espionnage ou de la spéculation. L’homme niait avoir eu des intentions de ce genre. « Vous savez bien qu’il y a pénurie de papier en ce moment ! J’ai pris ces feuilles en guise de papier à lettres, ou encore, pardonnez-moi d’avoir à le dire, de papier hygiénique. Évidemment, c’est facile d’être intelligent a posteriori. Si j’avais su qu’on m’arrêterait pour ces formulaires, je ne les aurais pas pris. » Il racontait cette histoire à tout le monde, et s’y tint pendant l’interrogatoire. C’était peut-être la vérité, qui sait ? Je doute fort que les enquêteurs fussent satisfaits d’une telle explication, mais je pense que le prévenu n’était pas un contre-révolutionnaire. c’était plutôt un spéculateur. Mais allez prouver aux organes soviétiques que vous n’êtes pas un agent double !
Dans notre groupe, il y avait un cas d’arrestation tout à fait stupide. On n’aurait pas pu l’inventer ! Un homme avait été arrêté à cause d’une lettre qui était arrivée en poste restante à la poste centrale de Briansk, portant son nom de famille, sans initiales de prénom toutefois. Elle était restée six mois sans être réclamée, puis les autorités bolcheviques l’avaient ouverte. Le contenu en était bref, mais ne plut pas à la Tcheka, car on pouvait l’interpréter comme un code. Les autorités s’étaient mises en quête à Briansk d’une personne répondant au nom du destinataire. Elles avaient trouvé cet homme, l’avaient arrêté et amené à la Section spéciale. La lettre servait de pièce à conviction pour une accusation d’espionnage. Il tentait d’objecter que si la lettre lui avait réellement été adressée, il serait passé la prendre à la poste centrale, qu’il ignorait tout de cette lettre, et que d’ailleurs le nom n’était pas accompagné d’initiales. Mais les bolcheviks ne le crurent pas. Je ne connais pas la fin de cette histoire.
Un seul de nos codétenus était vraiment soldat de l’Armée blanche (d’après ce que je sais, bien évidemment). C’était un jeune homme de dix-neuf ans, je crois, qui avait servi dans l’un des régiments de cavalerie de l’Armée des Volontaires. Lors d’une charge de cavalerie, il avait été assommé d’un coup de sabre sur la tête, avait perdu connaissance, était tombé de cheval et avait été retrouvé ainsi, inanimé, par les bolcheviks. Les Rouges comprirent que ce n’était pas un appelé, mais un engagé volontaire, et l’envoyèrent à la Section spéciale pour enquête. J’eus avec lui de véritables conversations amicales et relativement sincères, même si ne nous ne nous disions pas tout. Il me racontait, à voix basse, pour que personne n’entende, de nombreuses choses intéressantes sur les Blancs, mais jamais il ne me dit s’il était engagé volontaire, ce que d’ailleurs je ne cherchai pas à savoir, pas plus que je ne lui avouai mon intention de rejoindre les Blancs, mais nous nous comprenions parfaitement à demi-mots. Il me parlait de l’Armée blanche longuement et avec amour, sans jamais franchir toutefois les limites de la prudence.
Tous les jours, deux d’entre nous devaient balayer le palier devant notre salle. Ce fut au tour du père Paul. Les voyous se mirent à scander. « Prenez le barbu ! Le chevelu ! Ça lui fera du bien de travailler ! » Humble, sans un mot, le prêtre sortit balayer le palier. Nous avions eu le temps de nous rapprocher lors de notre détention à Briansk, et nous bavardions souvent. Si on le libérait, il rêvait de rentrer à Snagost, à pied s’il le fallait. « Seulement, comment pourrai-je traverser la ligne de front ? », s’inquiétait-il. « Peut-être que, d’ici là, le front sera arrivé jusqu’ici », dis-je.
Le jour suivant, après le père Paul, ce fut mon tour de balayer le palier. On me donna un balai. Je me mis au travail avec énergie, mais je soulevais plus la poussière que je ne la balayais. Le soldat qui me surveillait s’en aperçut et tenta de me montrer comment faire, mais je n’étais pas très doué. « On voit que tu n’as jamais touché un balai de ta vie, dit-il, irrité. Tu aurais mieux fait de te tenir tranquille, au lieu de te fourrer là où il ne fallait pas. » Une autre fois, j’entendis le même gardien raconter à son camarde rouge. « On emmenait un général pour le fusiller. Un monarchiste, on l’avait pris avec trois livres de propagande antisémite. Il ne disait rien, il ne faisait que répéter. « Ce que vous faites, faites-le vite. » On passe devant une église, il fait un signe de croix. A quoi cela lui servait son signe de croix ? De toute façon il allait mourir, Dieu n’allait pas le sauver. C’est incroyable qu’il ne comprenne pas cela de lui-même. »
Alors que je balayais, on amena sur le palier vingt à trente prisonniers blancs. C’étaient d’anciens soldats rouges qui avaient été capturés par les Blancs et enrôlés par ces derniers dans l’Armée blanche, puis refaits prisonniers par les Rouges. « On est mal traité chez les Blancs, me dit l’un d’eux. Pour un oui ou pour un non, on vous frappe à coup de baguette. Alors on est repassés chez les Rouges. » — « Mais comment aviez-vous fait pour passer chez les Blancs ? », demandai-je. — « On n’est pas passés chez les Blancs, ce sont eux qui nous ont fait prisonniers », me répondit le prisonnier, que ma question avait alarmé. Il était difficile, dans son récit, de distinguer ce qui était vérité de ce qui était adaptation aux circonstances. Ils avaient passé trois semaines chez les Blancs. On ne les laissa pas dans notre salle, contrairement au cavalier blanc. Bien que sous le coup d’une arrestation, ils bénéficiaient d’un régime plus libre que le nôtre. Je bavardai sans succès avec Cyrille Dioubine. C’était un homme impénétrable. Il racontait qu’il avait participé au congrès des Soviets d’Ukraine, mais il n’y avait pas moyen de comprendre vers qui allaient ses sympathies.
Durant ma détention, j’appris que les règles de conduite des Rouges envers les prisonniers blancs étaient les suivantes. On distinguait trois catégories de prisonniers. les appelés, qu’on enrôlait rapidement dans l’Armée rouge ; les anciens soldats rouges, capturés et enrôlés par les Blancs, puis repris par les Rouges. Ils étaient traités avec plus de sévérité, ils étaient soumis à une enquête qui visait à établir les circonstances de leur capture par les Blancs, pour s’assurer qu’ils n’étaient pas passés aux Blancs de leur plein gré ; et, enfin, les Blancs invétérés que l’on envoyait dans les Sections spéciales et que l’on finissait par liquider, lorsque l’on ne les avait pas fusillés sur place.
J’appris que nos paysans de Snagost avaient été battus lors de leurs interrogatoires, qu’on les avait menacé de les fusiller. Tout le monde n’était donc pas traité de façon aussi « correcte » que moi. on m’avait vouvoyé, pas une fois on ne m’avait appelé « camarade ».
Au troisième jour de ma détention à Briansk, on amena un groupe de détenus de la Tcheka de Briansk. La nuit passée, la Tcheka avait fusillé quarante-cinq otages qui se trouvaient dans la même prison qu’eux. Ces jours-là, une vague d’exécutions d’otages déferla sur la Russie. Ce qui s’était passé, c’est qu’une bombe avait été placée au siège du Comité central du parti communiste à Moscou. L’explosion avait fait plusieurs dizaines de morts. Les journaux soviétiques en parlaient (56). En guise de représailles, les bolcheviks avaient procédé à des exécutions en masse d’otages sur tout le territoire russe.
À Briansk, c’étaient des « bourgeois » locaux qui tenaient lieu d’otages, des marchands, et autres notables. Certains d’entre eux avaient déjà passé de nombreux mois en détention et ne s’attendaient en aucune manière à ce qui allait leur arriver. « Parmi les fusillés, il y avait un homme riche de la région, il était tellement plein d’énergie, de joie de vivre », nous racontait, choqué, l’un des détenus transférés de la Tcheka. « Il nous consolait, nous rassurait, en disant qu’on allait tous rentrer à la maison. Le soir, il ne savait rien encore, et soudain, la nuit, on l’a emmené, lui et un de ses amis, et on les a fusillés. C’est tellement affreux de penser qu’un homme avec qui on a parlé la veille est aujourd’hui mort, fusillé. » La nouvelle de ces exécutions nous impressionna, nous aussi. Je me mis à redouter que la vague de terreur rouge ne nous engloutisse, nous qui étions dans cette salle, qu’on ne nous exécute de la même façon arbitraire. Je fis part de mes craintes à l’un des détenus. Sa réaction fut tout à fait inattendue. « Mais enfin, cela n’a rien à voir ! Ceux-là sont des bourgeois, des contre-révolutionnaires, alors que nous, on est des fonctionnaires soviétiques. C’est normal qu’on ait fusillé les autres, ils le méritaient, mais nous ça ne risque pas de nous arriver. Nous, on ne nous accuse pas de contre-révolution. »
Trois jours passèrent. Je lisais les journaux de Moscou, on pouvait en commander en même temps que les produits du marché. J’y appris que les Blancs étaient en train de remporter victoire sur victoire sur le front Lgov-Dmitriev. Ils avançaient. S’ils continuaient ainsi, ils prendraient bientôt Dmitriev ainsi que Selino, ce qui risquait de compliquer mes affaires. Les autorités allaient se renseigner, vérifier mes papiers, s’adresser à Moscou. Plutôt que de passer chez les Blancs, comme je l’espérais, je serais vraisemblablement fusillé ici même, et dans un futur très proche.
Tel était alors mon état d’esprit, aussi ne fus-je pas peu surpris quand le lendemain matin, le 16 septembre, cinquième jour de ma détention, je fus convoqué à un interrogatoire. Une fois de plus, on me fit prendre toute sorte d’escaliers et de couloirs pour me faire entrer dans une pièce où se trouvait, assis à un bureau, un homme de quarante-cinq ans environ, au visage sanguin, aux traits bouffis. Il portait une tunique militaire. Il était d’un grade nettement plus élevé que mon interlocuteur précédent. Je m’assis face à lui. Sur sa table, je vis mes papiers et ma carte qu’il semblait étudier attentivement. Je tentai de lui expliquer où j’avais acheté cette carte, mais il me coupa immédiatement la parole. « Ne dites rien, cette carte n’a aucune importance. Nous avons examiné votre cas, et sommes parvenus à la conclusion que vous avez été arrêté sans fondement, à tort. Je vous prie de ne pas nous en vouloir. Vous savez, nos soldats sont en ébullition sur le front, ils sont inquiets, irascibles. Il faut les comprendre, mais ne nous en tenez pas rigueur, à nous ! Comme dit le proverbe, « on n’échappe pas à son destin. » Aujourd’hui, vous serez libéré. » Je n’en crus pas mes oreilles. N’étais-je pas en train de rêver ? Je restai digne, et dis. « Puisque tout est bien qui finit bien, je ne vous en voudrai pas, mais il est vrai que les soldats sur le front dépassent les bornes. » Je le saluai et quittai la pièce, escorté par mon gardien. Comme on dit, je me sentais pousser des ailes.
Je regagnai la salle de détention et commençai par ne rien dire de ce qui venait de m’arriver. Peu après, on m’envoya à nouveau balayer le palier. « On me libère aujourd’hui », dis-je en guise de protestation. — « Et alors ? » répondit le gardien, « c’est ce soir qu’on te libère, tu as encore le temps de balayer. » Je dus obtempérer. L’annonce de ma libération avait fait sensation. Certains se réjouissaient, exprimaient leur sympathie. D’autres m’enviaient, et s’étonnaient. « Comment se fait-il qu’on libère un espion avéré, avec sa carte, alors que nous-mêmes restons enfermés pour rien ? » J’appris que certains avaient même l’intention d’écrire à l’administration pénitentiaire pour exprimer leur indignation. Je faisais les cent pas dans la salle et me demandai comment une chose pareille avait pu se produire. Il est vrai qu’il n’y avait contre moi aucune preuve formelle, mais ils auraient dû se renseigner à Moscou ! En cette période totalement chaotique, ils m’avaient cru sur parole. Bien plus, ni l’enquêteur, ni les Koubanais rouges n’avaient deviné que je m’apprêtais à passer chez les Blancs. Une seule explication possible à toute cette confusion et cet arbitraire. la section de Briansk était infiltrée par des sympathisants des Blancs, et c’est eux qui m’avaient fait libérer. J’avais lu dans un journal soviétique, peu auparavant, un cas similaire où la Tcheka de Koursk avait été infiltrée par des Blancs qui y avaient aidé les contre-révolutionnaires, avant d’être démasqués. Peut-être était-ce le cas de la Section spéciale de Briansk ? Car, même en camouflant mon projet sous l’histoire de l’ordre de mission, puis du sel, il était incroyable qu’on puisse me relâcher ainsi, sans vérifications. En effet, tant par ma manière de m’exprimer que par mon apparence, je semblais suspect. À une verste, on pouvait voir mon air de « ci-devant », de bourgeois.
Les heures passaient, et personne ne venait me chercher. Je commençai à me sentir nerveux. Se pouvait-il qu’on m’ait trompé ? À cinq heures, enfin, on m’appela. À la hâte, je fis mes adieux au père Paul. Le gardien me fit à nouveau traverser le bâtiment, nous entrâmes dans une pièce qui n’était pas celle où j’avais été interrogé. On m’y laissa seul un long moment. Il commençait à faire sombre. Puis entra un employé qui alluma la lumière et s’appliqua de longues minutes à rayer quelque chose de l’épais registre. « Je voudrais une attestation indiquant que j’ai été arrêté sans fondement, que l’on m’a libéré après deux semaines de détention, et que je suis autorisé à poursuivre ma mission », dis-je. L’employé tapa à la machine le texte suivant. « Le dénommé Untel, arrêté à telle date, a été remis en liberté par la Section spéciale de la 14e Armée, l’accusation étant jugée sans fondement. Il est autorisé à se rendre à Dmitriev pour raisons de service. » On me restitua mes papiers, y compris la carte. Je refusai de la prendre. « Je n’en ai pas besoin », dis-je. — « Elle est à vous. Prenez-la ! », me répondit l’employé. Je cédai pour éviter toute discussion. On me rendit aussi l’argent qui m’avait été confisqué, mais au lieu des cinq cents roubles-Kerenski que j’avais au départ, on me donna une obligation d’emprunt du même montant, émise par le Gouvernement provisoire et dépourvue de toute valeur. C’était une véritable escroquerie ! J’aurais pu protester, mais je gardai le silence, redoutant de retarder ne serait-ce que d’une minute ma sortie de prison.
Le gardien me fit traverser la cour de la prison en direction de la sortie. Là, je vis l’un des officiers du train blindé (celui qui dansait des claquettes), en train de couper du bois. Me voyant, il se redressa et dit d’une voix plutôt triste. « Eh bien, il y en a qui ont de la chance ! » Je fus escorté jusqu’aux portes, le gardien n’alla pas plus loin. Je passai devant le soldat en faction qui ne sembla pas me remarquer. J’étais libre…
- Cette division faisait partie de la 14e armée soviétique. La 41e division était placée sous le commandement d’Eideman, letton de nationalité, qui devait par la suite devenir commandant de corps. Il fut fusillé en 1937 avec Toukhatchevski (voir R. CONQUEST, op. cit., p. 604 et 627).
- Soupe à la betterave. Plat traditionnel russe (NdR).
- Rylsk ne devait être occupé par les Blancs que le 10 septembre, soit quatre jours plus tard.
- Il s’agissait du domaine d’A. N. Voljyne, haut-procureur du Saint-Synode en 1915-1916. Je le rencontrai en 1922 à Munich, et lui racontai cet épisode.
- Les épaulettes dorées, signe du grade des officiers dans l’ancienne armée russe, avaient été supprimées dans l’Armée rouge. Durant la guerre civile, la chasse aux épaulettes — devenues un signe distinctif des Blancs — fut une pratique courante des Rouges (NdR).
- Le général Tourkoul vient confirmer la véracité de tels incidents. Il donne la description de la façon dont les « Écarlates », affublés d’épaulettes et imitant les Blancs, occupèrent un lieu-dit près de Vorojba et y fusillèrent plus de 200 paisibles citoyens qui, les ayant pris pour des Blancs, les avaient bien accueillis (A. V. TOURKOUL, op. cit., p. 119-120).
- Vieux proverbe russe (NdT).
- Koursk a été pris par les unités de Kornilov le 7 septembre.
- Traditionnellement, en signe de consécration à Dieu, les prêtres orthodoxes portent la barbe et — du moins à l’époque — les cheveux longs (NdR).
- Voir « Chapitre 1. Les journées de février 1917 à Petrograd », n. 31.
- Voir p. 130.
- André Grigorievitch Chkouro (1887-1947), général russe, combattant dans les armées blanches durant la guerre civile russe (NdR).
- En argot concentrationnaire, un « crevard » est un détenu parvenu au terme de la déchéance physique, et dont on attend seulement qu’il « crève » (NdR).
- Gloukhov avait été prise par les Blancs le 14 septembre, c’est-à-dire précisément dans le courant de ces journées.
- Voir la Pravda du 26 septembre. Il y est écrit que la bombe a été placée le 12/25 septembre. Parmi les communistes tués, il y avait le vieux bolchévik Zagorov, en l’ « honneur » de qui la Laure de la Trinité-saint-Serge a été rebaptisée « Zagorsk ». Selon les journaux soviétiques, plus de soixante « contre-révolutionnaires » furent fusillés en liaison avec l’affaire, principalement des cadets (les frères Astrov, et bien d’autres), des militaires, et même quelques femmes, des « espionnes ».
SUITE : « Mémoire des deux mondes » De la révolution à l’Église captive, 528 pages
Par Basile Krivochéine Les Éditions du CERF — 2010
Préface du Métropolite Hilarion (Alfeyev) de Volokolamsk, président du département des relations extérieures du patriarcat de Moscou — Traduction du russe de Nikita Krivochéine, Serge Model, Lydia Obolensky — Présentation, révision et notes de Serge Model
La première partie, consacrée aux années de jeunesse, relate de l’intérieur et avec une sincérité rare la période de la Révolution et de la guerre civile. son sens de l’observation fait merveille, et Soljenitsyne ne s’y est pas trompé, qui a repris presque sans changement plusieurs de ses pages sur les événements de 1917. En ressort un tableau peut-être plus véridique que celui présenté dans bien des livres d’historiens.

On m’attrapa, on m’arrêta,
On voulut voir mon passeport,
Je ne suis pas cadet, je ne suis pas soviétique,
Je suis commissaire des coqs
Chansonnette de l’époque de la guerre civile
Le matin, notre train arriva à Lgov. Il y avait trois stations Lgov. Lgov 1, Lgov 2 et Lgov 3. Il fallait que je descende à la troisième, puisque c’est de là que partait la ligne Korenevo-Kiev, c’est aussi là que se trouvait la gare principale. J’y étais bien descendu lors mon premier voyage, mais la deuxième fois, je me trompai et descendis prématurément à Lgov 1, où l’on me dit que jusqu’à Lgov 3, il y avait trois verstes, et qu’aucun train n’y allait pour l’instant. Il fallait donc faire le trajet à pied, heureusement que je n’avais plus mes bagages. Je rejoignis donc la route qui passait non loin de la voie ferrée, mais un obstacle imprévu surgit. J’avais devant moi un fossé que la route franchissait au moyen d’un petit pont. Je m’en approchai, pensant le traverser, quand je fus interpellé par un soldat de l’Armée rouge, un grand blond au visage russe, qui montait la garde. « Le mot de passe ? », me dit-il. Je me mis à lui expliquer que, par erreur, j’étais descendu du train trop tôt, que je devais aller à Lgov 3, que j’avais un ordre de mission, etc. « Le mot de passe ? », répéta le garde, et comme j’étais incapable de le lui donner, il déclara. « On ne passe pas. Ce sont les ordres. » Et il cessa toute conversation. Que pouvais-je faire ? Ayant un peu réfléchi, je m’écartai de cinquante sagènes (35) vers la gauche, et d’un bond, franchis le fossé sous les yeux du garde. Je craignais que celui-ci ne m’arrête, mais il ne fit aucunement attention à moi. C’était un appelé typique de l’Armée rouge, indifférent à tout, qui exécutait les ordres mais refusait de prendre la moindre initiative. Un vrai soldat bolchevique ne se serait jamais comporté de la sorte.
Je poursuivis ma route et atteignis bientôt la gare de Lgov 3. D’après des bribes de conversations de soldats et cheminots que j’y surpris, je compris que la situation sur le front avait connu un brusque revirement. Les Blancs étaient passés à l’offensive (36) ! Il y avait de la tension et de l’inquiétude dans l’air. Pourtant, le train de Korenevo partait à l’heure habituelle. Je le pris, cette fois sans passer chez le « camarade Kahn », auprès de qui, quatre jours auparavant, j’avais sollicité un laissez-passer. Je ne voulais pas me rappeler à son souvenir, et en cas de besoin je pouvais toujours présenter au contrôle le laissez-passer de la dernière fois. Je montai à nouveau dans un wagon de marchandises découvert. Il y avait peu de monde, des paysannes comme d’habitude. Deux passagers se distinguaient des autres. un jeune soldat et un militaire plus âgé, corpulent, le type même du sous-officier d’avant la Révolution, devenu maintenant tchékiste, ou du moins quelqu’un qui avait des liens étroits avec l’un des services de la « gendarmerie rouge » ou des « organes de sécurité », comme on dit de nos jours. Le convoi s’ébranla vers onze heures de matin. Le temps s’était éclairci, c’était de nouveau une belle journée ensoleillée d’automne. Vers une heure de l’après-midi, alors que nous approchions de Korenevo, nous entendîmes soudain à gauche, au sud de la voie ferrée, les tirs assourdis d’une salve d’artillerie. On se battait à dix ou quinze verstes de nous, et la canonnade dura un certain temps. Je fus pris d’une grande joie en entendant ces sons pour la première fois de ma vie, et me sentis plein d’espoir. le front n’était pas loin, les Blancs avançaient, la libération était proche ! Bien sûr, je ressentais aussi un sentiment d’inquiétude et de peur. La canonnade eut un effet spectaculaire sur le soldat et le « sous-officier ». Ils se recroquevillèrent tous les deux, le visage alarmé. Ils se mirent à parler avec animation de ce qui était en train de se passer, ils disaient. « Encore une offensive des Blancs. Pas moyen d’en venir à bout. Apparemment, on est mal organisés, il y a des traîtres un peu partout », ou — pour reprendre les mots du « sous-officier » — des « vendus ». Et il regardait dans ma direction avec une certaine animosité.
Une heure plus tard, nous arrivâmes à Korenevo. Les coups de canon avaient cessé. La gare de Korenevo était pleine de convois de marchandises qui occupaient les voies de garage. « Ils préparent l’évacuation », me dis-je. Dans la gare, il y avait un certain nombre de soldats. J’échafaudai immédiatement un plan d’action. il ne fallait aller nulle part, ne traverser aucun front, mais attendre ici, à Korenevo, l’arrivée des Blancs. Selon toute vraisemblance, ils seraient là d’ici deux ou trois jours. Je dormirais la nuit dans les wagons de marchandises vides, il y en avait tant ! En cas de contrôle, je montrerais mes papiers. Et je n’irais pas me faire enregistrer, même si c’était contraire au règlement en vigueur dans la zone de front. Mon grand problème, c’était la nourriture. À la rigueur, si je ne réussissais pas à m’en procurer, je pouvais jeûner quelques jours. Bien sûr, tout cela était assez risqué, je pouvais être arrêté en tant que personne suspecte se trouvant à Korenevo sans raison valable, mais c’était tout de même moins risqué que de traverser la ligne de front (37).
Afin de passer le temps, et pour éviter de trop me montrer à la gare, je sortis faire un tour dans la localité. Revenu à la gare, je versai dans ma gamelle de l’eau chaude de la bouilloire qui se trouvait à notre disposition. L’eau n’avait pas encore bouilli, et l’on me mit en garde. « N’en bois pas, tu vas être malade ! », mais je passai outre, et ne tombai pas malade. Quelqu’un me donna un morceau de pain, mais globalement, personne ne fit attention à moi.
Vers quatre heures, changement de situation. On entend de nouveau le canon tonner au sud de Korenevo, il semble s’être rapproché depuis ce matin. On a l’impression que ce sont des pièces d’artillerie lourde. À la gare, c’est l’inquiétude chez les « camarades » rouges. Parmi eux, il y a un groupe de trente à cinquante « Koubanais rouges » comme on les appelle. Je parlerai beaucoup d’eux dans la suite de mon récit, et me bornerai à dire pour l’instant que c’était une compagnie d’élite de cavalerie de l’Armée rouge, la seule qui combattait réellement, et dont on disait que le front tout entier reposait sur elle. À vrai dire, il y avait peu de vrais habitants du Kouban dans cette brigade de Koubanais rouges. Les recrues en étaient majoritairement originaires des provinces de Kharkov et de Poltava. C’étaient de vrais brigands, toute la population souffrait et se plaignait de leur cruauté et leur violence. Parmi eux, sans aucun doute, il y avait un fort pourcentage de repris de justice. Ils étaient très différents des simples appelés de l’Armée rouge qui étaient souvent de braves garçons, pas bolcheviks pour deux sous (38). Mais je reviendrai à tout cela plus tard. Pour l’heure, les « Koubanais » étaient massés sur le quai de la gare, et discutaient avec animation de la situation. J’essayai d’entendre ce qu’ils disaient. Bien entendu, leurs propos étaient ponctués des jurons blasphématoires les plus grossiers. « Ils tirent à l’arme lourde ! Ça tonne plus fort que le bon Dieu ! » Sur leurs visages on pouvait lire un mélange d’excitation et préoccupation, et ils disaient, ou plus exactement beuglaient. « Il paraît que les Blancs ont pris les canons de douze pouces de leurs navires de guerre à Sébastopol, pour les envoyer sur le front. Et les nôtres détalent comme des lapins, ils n’essaient même pas de les arrêter. On est entourés de vendus. » — « Ils n’y a rien à dire, ajoute un autre, les Blancs se battent bien. Mais ils sont peu nombreux. Si les nôtres se battaient comme eux, on les aurait écrasés depuis belle lurette. » C’était agréable à entendre (39).
À la nuit tombante, la canonnade cessa, et les « Koubanais » avaient disparu. Je pénétrai dans le bâtiment de la gare, et m’assis sur un banc dans l’ancienne salle du buffet. La salle où je me trouvais fut bientôt envahie de nouveaux arrivants, ils étaient cent cinquante environ. C’étaient des habitants du coin que les Rouges venaient juste de recruter, des paysans pour la plupart. Ils étaient en civil, tenaient des petits baluchons dans les mains. Ils s’étaient présentés à l’appel, et on les envoyait se battre ailleurs. L’un d’eux s’assit à côté de moi, et se mit à me raconter que pendant la guerre contre l’Allemagne il avait été appelé, et avait fait son service dans un convoi de bains à vapeur. Il avait un certificat. Il voulait même me le montrer pour que je l’aide à trouver de nouveau une place dans un convoi de bains, car il s’y connaissait bien. Il me prenait manifestement pour un chef bolchevik. Je lui dis que je ne pouvais rien pour lui, et pensai tout bas. « Quelle idée de te présenter à l’appel des bolcheviks ! Tu aurais mieux fait de rester chez toi, car il va y avoir un tel bain que tu ne t’en réjouiras pas ! » En fait, j’éprouvais un sentiment d’amertume à constater qu’une telle quantité de gens avaient répondu à l’appel de l’Armée rouge, et à les voir si tranquilles, si soumis. Pour éviter toute autre conversation, je quittai le bâtiment et partis chercher, dans la nuit tombante, un coin pour dormir dans un wagon de marchandises sur les voies de garage du fond, pas trop près de la gare. C’est sans difficulté que j’en trouvai un parmi les nombreux convois qui étaient stationnés là. Je grimpai dans le wagon, tirai la porte derrière moi, et m’allongeai sur la paille. Il faisait chaud, j’enlevai ma vareuse et m’endormis profondément jusqu’au matin.
Quand je me réveillai, il faisait déjà clair. La lumière s’infiltrait dans le wagon par la porte mal fermée. C’était le matin du 2/15 septembre. Par habitude, machinalement, je plongeai la main dans la poche intérieure droite de ma vareuse où je conservais mon portefeuille avec mes papiers. Je dis. « par habitude », parce que je vérifiais régulièrement la présence de mon portefeuille, et que j’aimais bien relire mes papiers. Cela me rassurait, me donnait une impression de sécurité. À mon grand étonnement, la poche était vide. Le portefeuille qui contenait mes papiers avait disparu ! Je me dis qu’il avait dû tomber de ma poche au moment où j’avais enlevé ma vareuse pour m’en faire un oreiller. À tâtons, je le cherchai à l’endroit où j’avais posé ma tête, mais il n’y avait rien. C’était impossible, il n’avait pas pu disparaître ! Je l’avais encore la veille au soir en m’endormant, je m’en souvenais parfaitement, et je n’avais pas quitté le wagon depuis. Je me sentais gagné par la panique. Je commençai une fouille obstinée. Plus de dix fois, je vérifiai mes poches, tâtonnai dans le coin où j’avais dormi, fouillai tout le wagon. Rien ! Je me sentais gagné par le désespoir, mais la raison l’emportait. c’était impossible, je n’étais pas sorti du wagon, personne n’y était entré, et d’ailleurs comment aurait-on pu voler un portefeuille que je portais sur moi ! Ça m’aurait réveillé ! Non, il n’avait pas pu disparaître ainsi, il fallait continuer à chercher !
Et je recommençai à chercher. Je fouillai à nouveau le wagon, puis en sortis, et me mis à scruter le sol autour et en dessous du wagon, même si c’était absurde. À une dizaine de sagènes, il y avait un trou, je jetai un coup d’œil au fond de ce trou, même si cela semblait idiot. Comment mon portefeuille aurait-il atterri là, puisque je n’étais pas sorti du wagon ? Non loin de là, il y avait deux hommes, des cheminots apparemment, qui travaillaient. Je leur demandai s’ils n’avaient pas trouvé un portefeuille, car j’avais perdu le mien. Ils me regardèrent avec étonnement. Je revins à mon wagon, repris mes recherches qui restèrent vaines. Plus d’une heure s’écoula ainsi. Cela avait beau être absurde et invraisemblable, il me fallut me rendre à l’évidence. mon portefeuille avait disparu. Mais que faire maintenant ? Il fallait entreprendre quelque chose, sans perdre de temps. Cela changeait tous mes plans. Je me mis à réfléchir. La solution la plus raisonnable aurait consisté à me rendre à la gare, et déclarer la perte de mes papiers à l’antenne ferroviaire de la Tcheka. En faisant cela, je ne risquais probablement pas grand-chose, on me placerait sans doute en garde-à-vue et on m’enverrait à l’arrière pour vérifier mon identité. Et si l’on n’y découvrait pas qui j’étais réellement, et quelles étaient mes véritables intentions, on me libérerait très certainement. Mais cela revenait pour moi à capituler, car j’aurais été contraint de renoncer à traverser le front, alors que j’étais si près du but. Et pour une raison stupide. la perte d’un portefeuille ! Quelle honte !
Sans papiers, cependant, il ne m’était plus possible d’attendre les Blancs à Korenevo comme j’en avais eu l’intention. Les Blancs pouvaient n’arriver que d’ici quelques jours, dans cet intervalle il était hautement probable que quelqu’un demande à voir mes papiers, et comme je n’en avais plus, cela se terminerait très mal pour moi. Je ne voyais qu’une possibilité (acceptable en conscience). quitter immédiatement Korenevo en direction du front et tenter de le traverser, à pied. C’était une décision insensée, mais je ne voyais pas d’autre solution. Plus tard, avec l’expérience, je compris qu’il aurait certainement été plus sage d’attendre à Korenevo le soir en me cachant dans un des wagons et tenter de nuit l’approche du front. Mais cela aussi aurait comporté une part de risque. il n’était pas si facile de quitter la localité de Korenevo même la nuit. Il y avait des patrouilles partout et on était en plein couvre-feu. Je ne pouvais plus rester sans rien faire. J’étais à bout de nerfs.
Ainsi, c’est vers midi que je sortis de Korenevo. Je traversai sans encombre cette petite ville avec ses maisonnettes, ses jardins et ses haies et continuai vers le sud-ouest en direction de Snagost, le gros hameau d’où nous parvenait hier le son du canon. C’était une journée chaude et ensoleillée. J’étais parfaitement conscient du danger qu’il y avait à marcher ainsi à découvert et sans papiers en direction du front. Je rattrapai sur la route un soldat sur une charrette. Il allait à Soudja (la route y bifurquait depuis celle de Snagost) et proposa de m’y déposer. Je refusai sous prétexte que ce n’était pas ma direction. Je n’avais pas envie de me lier à lui, même si ce garçon était aimable, gai, et manifestement me prenait pour un des siens. Vers deux heures de l’après-midi, j’entrai dans le hameau de Snagost du district de Rylsk de la province de Koursk, à douze verstes de Korenevo. J’en remontai la longue rue centrale, sans rencontrer personne. De cette rue en partait une autre, perpendiculaire à la première, bordée de maisons elle aussi.
Près de la maison qui faisait le coin de la rue où je me trouvais, je vis un groupe de gens, certains debout, d’autres assis. Je suis myope, j’avais cassé mes lunettes pendant mon voyage, et je ne parvenais pas à distinguer qui étaient ces gens massés au loin. Presque arrivé à leur hauteur, je pris la rue de gauche en évitant de regarder dans leur direction (selon ce principe dit « de l’autruche ». si je ne les regarde pas, ils ne me verront pas non plus). Ils me laissèrent passer devant eux et tourner à gauche, mais soudain j’entendis une voix qui criait dans mon dos. « Eh, camarade, attends un peu ! » Je m’arrêtai. « Où vas-tu ? » — « À Glouchkovo », répondis-je. C’était le nom du hameau (et de la gare) suivant, plus loin vers le sud-ouest. J’avais vu cela sur ma carte que j’avais encore, car je ne l’avais pas mise dans la même poche que mon portefeuille. « À Glouchkovo ? » dit le soldat d’un air entendu. « Et tu sais ce qui se passe à Glouchkovo ? » — « Non », répondis-je. Il semblait savoir que le front et les Blancs (40) y étaient. Le soldat poursuivit son interrogatoire. « Que vas-tu faire à Glouchkovo ? » — « Chercher du sel, dis-je, mais si on n’a pas le droit d’y aller, je n’irai pas. » J’avais dit « chercher du sel », parce qu’il aurait été absurde, en l’absence de papiers, de mentionner mon ordre de mission. Alors que le sel, tout le monde venait en chercher, justement dans cette région. Et le sel, c’était une chose plus facile à comprendre pour des gens simples qu’une mission. « Du sel ! Voyez-vous ça ! », insista le Rouge, « et des papiers, tu en as ? » — « Oui », mentis-je d’un ton assuré. — « Eh bien, montre-les ! » Je portai ma main à la poche de ma vareuse, dans l’espoir chimérique que mon portefeuille s’y trouverait, mais bien entendu, elle était vide. « Je les ai perdus », fus-je obligé de constater, et je souris bêtement. — « Perdus ! » s’exclama le soldat, « eh bien, tu vas nous suivre ! » Et toute cette bande m’entraîna dans la maison, où elle me fit subir un interrogatoire.
C’étaient ces fameux « Koubanais rouges » dont j’avais vu un détachement la veille à la gare de Korenevo. Cette fois, ils étaient trente. Ils étaient dans un état d’agitation extrême, certains d’entre eux étaient déchaînés. « Tu es avec Denikine, criaient-ils, tu es un officier, un espion, on va te fusiller. » Je me défendais comme je pouvais. « Je ne suis pas officier, je n’ai que dix-neuf ans. » — « Qu’est-ce qui nous prouve que tu as dix-neuf ans ? Pourquoi pas vingt-six ? » — « Je te connais, tu es le fils d’un propriétaire terrien de Lébédine ! », criait un autre. — « Je n’ai jamais mis les pieds à Lébédine. » — « Je t’avais remarqué hier à la gare, et je m’étais déjà dit. Celui-là, c’est un gars de Denikine. » — « Pourquoi ne m’as-tu pas demandé mes papiers à ce moment-là ? C’est d’autres qui en sont chargés là-bas ? » — « Je t’ai vu approcher tout à l’heure dans la rue, criait un autre, et j’ai dit. Regardez, voilà un gars de Denikine qui arrive ! » Un des principaux arguments prouvant que j’étais un espion, c’était ma carte. Puisque j’avais une carte, j’étais un espion, il n’y avait pas besoin de chercher plus loin. C’était clair. Bien que je tentai, de répliquer que mes documents avaient disparu ou m’avaient été volés, rien n’y faisait. « Pourquoi as-tu une carte, si tu n’es pas un espion et es en mission ? », demandaient-ils. En vain, tentai-je de me défendre en montrant que ma carte était neuve, libellée selon l’orthographe soviétique, achetée à Dmitriev, et que je me l’étais procurée afin de m’orienter dans la région et éviter de tomber chez les Blancs par erreur. Ils ne me croyaient pas ; quant à mes arguments, ils ne les convainquaient pas ou cela dépassait leur niveau intellectuel. Je me mis à expliquer que j’avais eu un ordre de mission et un laissez-passer de la Tcheka, mais cela ne leur fit aucun effet. Il était inutile de discuter avec eux, et je dis. « Vous n’êtes pas compétents pour régler mon cas. Envoyez-moi à l’arrière, là on tirera mon cas au clair, on verra si je suis vraiment en mission ou si je suis un espion. Mais je refuse de discuter avec vous ! » J’avais dit cela pour me débarrasser de ces gens déchaînés et leur montrer que je ne craignais pas une enquête poussée. Mais mes paroles eurent l’effet contraire. Ce fut une nouvelle explosion de colère. Un grand cosaque aux traits épais, en pantalon à bandes rouges sur les côtés, frappa du poing sur la table, et hurla. « Voilà, maintenant c’est sûr, c’est bien un gars de Denikine. C’est eux qui ne veulent pas nous parler ! On va te tuer ! » L’affaire prenait mauvaise tournure.
Je ne sais pas comment cela se serait terminé, mais à ce moment se produisit quelque chose d’inattendu. On me demanda si j’avais de l’argent. J’aurais pu mentir, puisque ma tante avait cousu mon argent à l’intérieur de mes bretelles, et qu’ils ne l’y auraient probablement pas trouvé. Mais je me dis que si jamais ils le trouvaient, cela ne ferait qu’aggraver mon cas. Ils me demanderaient pourquoi j’avais menti. C’est pourquoi, j’avouai avoir près de deux mille roubles, cousus à l’intérieur de mes bretelles. J’ôtai ma vareuse (par la tête), ils arrachèrent mes bretelles, déchirèrent les coutures et se mirent à compter l’argent. Nouveaux commentaires. « Eh, il a amassé des roubles-Kerenski. Ça veut dire qu’il voulait rejoindre les Blancs. Et il ne voulait pas qu’on voie l’argent ! » — « Mais c’est moi qui vous l’ai montré ! » — « Et tu crois qu’on ne l’aurait pas trouvé, nous-mêmes ? » dirent les Koubanais avec prétention. « Sais-tu combien de pièces d’or on a récolté, cachées dans des talonnettes ? » Je me mis à renfiler ma vareuse, quand soudain, j’en vis tomber mon portefeuille qui roula sur le sol !
Je compris tout. Quand, au petit matin, dans le wagon, j’avais remis la vareuse qui m’avait servi d’oreiller pendant la nuit, mon portefeuille était allé se coincer, allez savoir comment, dans mon dos, sous la vareuse. Je ne l’avais pas senti se loger là, et comme ma vareuse était étroite, il était resté là sans tomber. Il était petit et mou, c’est pourquoi je ne l’avais pas remarqué. Paniqué, je l’avais cherché partout, mais pas une seconde il ne m’était venu à l’idée d’enlever ma vareuse. Et le voilà qui faisait sa réapparition au moment précis où j’en avais besoin, pour me sauver la vie. « Voilà mes papiers », dis-je en leur tendant mon portefeuille. Les Rouges se précipitèrent dessus pour les lire. Ils étaient malheureusement presque illettrés, et avaient les plus grandes peines à comprendre ce qui y était écrit. Néanmoins, l’effet produit fut concluant. Tout ce que j’avais dit à propos de mon ordre de mission, de mon laissez-passer de la Tcheka, était confirmé. Apparemment, les Koubanais rouges étaient maintenant divisés en deux camps. On continuait de crier. « Tu avais caché ses papiers, tu voulais nous tromper ! » — « Pourquoi les aurais-je cachés, dis-je, dans quel but ? » L’un d’eux voulut prendre la montre que j’avais au poignet, mais un autre l’en empêcha. « Non, tu n’as pas le droit, rends-la-lui ! Trotski a publié un décret qui interdit de tuer les prisonniers ou de confisquer leurs affaires. » On me rendit ma montre. Cependant, le Koubanais aux traits épais me fit signe de le suivre dans la rue, me montra du doigt un break attelé et me dit. « Allons faire un tour ! » — « D’accord », dis-je avec une certaine dose de bravade, pour lui montrer que je n’avais peur de rien. Mais un autre m’arrêta. « Tu te rends pas compte ? Il va t’emmener dans les marécages, et te coupera la tête d’un coup de sabre. Ça ne lui coûte rien, et ça ne serait pas la première fois. » Puis, s’adressant au Koubanais aux traits marqués. « Fiche le camp. Qu’est-ce que tu fais ici ? » L’autre obéit, et disparut sur son break.
Pendant mon interrogatoire, au moment le plus inattendu, Cyrille Dioubine, le président du soviet de district de Snagost, avait fait son entrée. C’était un homme de quarante-cinq ans environ, de grande taille, la barbe courte, portant des bottes montantes. Il était accompagné de deux miliciens de la localité. Leur présence eut un effet modérateur sur les Koubanais, qui étaient d’ailleurs pressés et avaient déjà perdu suffisamment de temps avec moi, alors qu’ils avaient l’ordre de se rendre quelque part de façon urgente. Ils me remirent avec entrain entre les mains de Dioubine et de ses miliciens, ainsi que tous mes papiers et l’argent qui m’avait été confisqué, et se retirèrent. « Ils voulaient me tuer », dis-je à Dioubine. « N’ayez pas peur, répondit-il, ils sont partis, et la milice ne vous fera pas de mal. » — « Qu’allez-vous faire de moi ? » — « Nous allons vous transférer afin de procéder à des vérifications. » Un milicien m’emmena. Nous passâmes à coté de l’église du village. Un bâtiment blanc, de style empire, d’une taille démesurée pour un village (41). J’ai envie de faire un signe de croix, mais je n’osai pas, je ne voulais pas qu’ils comprennent qui j’étais. À ce moment-là, au sud-ouest, on entendit quelques instants, le bruit d’une canonnade. C’était la première de la journée, mais elle semblait s’être encore rapprochée depuis la veille. Elle devait être à cinq verstes. Le milicien eut l’air inquiet. « Dans de telles circonstances, ce n’est pas étonnant qu’on vous ait arrêté », dit-il et il me fit entrer dans le local de la milice du district.
- Ancienne unité de mesure russe. 1 sagène = 2,133 mètres (NdR).
- Et en effet le 30 août, c’est-à-dire deux jours auparavant, l’Armée des Volontaires avait entamé sa dernière grande offensive sur Moscou, offensive qui devait se solder au bout d’un mois par la prise d’Orel. La division Drozdovsky, en marchant sur Rylsk et Dmitriev, prit Soudja le 3 septembre, et Lgov le 7 septembre. Voir V. KRAVTCHENKO, Drozdovtsy ot Yass do Gallipoli [Les Drozdoviens de Iasi à Gallipoli], t. I, Munich, 1973, p. 281.
- En réalité, les Blancs ne devaient prendre Korenevo que quatre jours plus tard. Il aurait été extrêmement dangereux de rester aussi longtemps à la gare. Je me serais immédiatement fait repérer.
- Je n’écris dans mes Mémoires que ce que j’ai personnellement vu et entendu en 1919 des « Koubanais rouges », il s’agit de mes observations à leur sujet. Je voudrais cependant ajouter quelques précisions historiques. Ce régiment avait été formé à l’automne 1918 par l’essaoul du Kouban, V. M. Primakov, et s’était d’abord battu contre Petlioura. Ce n’est que plus tard qu’il devait prendre officiellement le nom de « Brigade des cosaques écarlates », même si la population de la zone de front ne les appelait que « Koubanais rouges » (je n’ai jamais entendu utiliser le terme « cosaques écarlates »). En été 1919, on les transféra sur le front contre Denikine, et ils combattirent dans la région de Tchernigov. À partir de septembre, ils furent incorporés en tant que brigade dans la 14e, et pendant un temps dans la 13e armée soviétique (sous le commandement d’Egorov, Ouborevitch, Gittis) dans le district Korenevo-Rylsk-Dmitriev-Dmitrovsk. Primakov, d’après les récits de ceux qui l’ont connu, était un aventurier, un « paysan rusé », et selon la 2e édition de la Grande Encyclopédie soviétique, un « héros de la guerre civile ». Dans les années trente, il fut le bras droit du commandant en chef du district militaire de Leningrad, en qualité de commandant de corps, puis il fut envoyé en mission de renseignements dans l’Allemagne d’Hitler et, comme presque tous les anciens commandants rouges du front méridional, fut fusillé sur ordre de Staline le 12 juin 1937, avec Toukhatchevski, Ouborevitch et Iakir. Primakov était marié à Lily Brik. Pendant la guerre civile, la presse soviétique chantait les louanges des « Koubanais rouges » et leurs « exploits héroïques ». Voir par exemple, dans la Pravda du 22 novembre 1919, l’article d’une certaine Raïssa Avarkh. « Je chante la folie des téméraires ! » dans lequel elle écrit. « Doucement (?), sans se faire remarquer (!), ils accomplissent la noble tâche de libérer le peuple. » Le général A. V. Tourkoul en donne une image quelque peu différente. « Nous haïssions mortellement la Division écarlate. Nous la haïssions, non parce qu’elle sillonnait l’arrière de nos fronts ou qu’elle avait récemment anéanti notre 2e régiment, mais pour ses mensonges envers la population civile pacifique. afin de démasquer les opposants aux soviets, les Écarlates — cette racaille de forçats — revêtaient nos uniformes… Nous haïssions les Écarlates. Entre eux et nous, c’était une lutte sans merci. » (A. V. TOURKOUL, Dorzdovtsy v ogne. Kartiny grazhdanskoï voïny 1918-1920 gg. [Les drozdoviens au feu. Images de la guerre civile, 1918-1920], 2e éd., Munich, 1948, p. 119-120). Le lecteur pourra se rendre compte, en lisant la suite de mon récit, que cette brigade était détestée non seulement par les populations civiles, mais aussi et tout autant par de nombreux soldats appelés de l’Armée rouge qui les considéraient comme des « voyous », des « brigands » et des « animaux ». Quoi qu’il en soit, il faut reconnaître à la « brigade écarlate » du « camarade Primakov » un rôle déterminant, aux côtés des Lettons, dans l’inversion du rapport de force en faveur des Rouges, lors de la bataille, en automne, contre la division Drozdovsky dans la région de Briansk, puis de Lgov. Suite à cette bataille, Primakov fut décoré, le 13/26 novembre, de l’ordre du Drapeau rouge.
- Les historiens soviétiques n’ont pas pu nier la qualité de combattants de l’Armée des Volontaires. « Au combat, certains détachements et unités de l’Armée des Volontaires étaient d’un assez haut niveau, grâce à la présence dans leurs rangs d’un certain nombre d’officiers de l’armée impériale qui haïssaient le pouvoir soviétique d’une façon fanatique. À partir de l’été 1919, cependant, suite aux pertes subies et à l’enrôlement massif de paysans ou même de prisonniers de l’Armée rouge, ce niveau de compétence militaire chuta fortement » (Voir Bolchaïa sovietskaïa entsyklopedia [Grande Encyclopédie soviétique], 3e éd.. « Denikinschina » [Denikinerie]). J’ajoute que l’indication. « à partir de l’été 1919 » est, selon moi, inexacte. Si l’on en croit les propos — que j’ai cités — des « Koubanais rouges » début septembre, je dirais plutôt « à partir d’octobre ».
- Effectivement, la gare de Gloukhovo était à ce moment précis occupée par un bataillon du 3e régiment de Kornilov, à l’aide de deux trains blindés. C’est de ces trains que venait probablement la canonnade que j’avais entendue la veille de la gare de Korenevo (voir LEVITOV, Kornilovskyi oudarnyi polk [Le régiment de choc de Kornilov], Paris, 1974, p. 317).
- Snagost est l’ancien domaine des princes Bariatynski, reçu par l’un de leurs ancêtres en récompense des services rendus en combattant Stenka Razine au XVIIe siècle. Un autre Bariatynski fut, au XIXe siècle, gouverneur général du Caucase. Ce sont les Bariatynski qui avaient fait construire l’église de Snagost. Mais j’appris tout cela bien plus tard, à l’époque je n’étais au courant de l’existence d’aucun domaine. J’avais d’autres préoccupations, et je ne posai pas de questions à ce propos.

Eh, petite pomme ! Où vas-tu ?
Si la Tcheka te prend, tu ne reviendras plus.
Chanson de l’époque de la guerre civile
Vers neuf heures du soir, nous arrivâmes à Dmitriev. La gare et son bâtiment de bois semblaient déserts. Nous nous mîmes immédiatement en route avec nos affaires, vers la maison des cousins de P. Leur maisonnette se trouvait à la périphérie de la ville, à dix minutes de marche de la gare. Le maître de maison était en déplacement, nous ne trouvâmes que sa mère et sa sœur. Leur accueil fut chaleureux. En guise de lit, on m’attribua une banquette de bois dans la salle à manger. Le lendemain, nous nous rendîmes en ville pour évaluer la situation. Dmitriev était une petite ville de district de la province de Koursk, on n’y voyait que quelques maisons de pierre. Sur les murs et les palissades étaient placardés des communiqués du commandant Egorov (25) de la Ne armée soviétique (26), informant la population que l’état d’urgence était instauré dans la zone de front, qu’il était interdit de sortir de chez soi entre six heures du soir et six heures du matin. Tous les nouveaux arrivants étaient tenus de se faire enregistrer auprès des autorités et il était interdit d’héberger sans autorisation des personnes étrangères à la ville. Les contrevenants étaient passibles des peines en vigueur en temps de guerre. Tout cela compliquait passablement la réalisation de mes plans, et tout particulièrement l’interdiction de sortir la nuit, car j’avais dans l’idée que mon passage chez les Blancs devait être grandement facilité par l’obscurité. Je comprenais que le risque était énorme. Sur la place centrale, nous rencontrâmes un homme que P. connaissait, une personnalité douteuse (d’après celui-ci), devenue après la Révolution un communiste en vue dans la localité. En ce moment, il disposait des pleins pouvoirs dans la ville de Dmitriev, et il le faisait sentir. Alors qu’il était en désaccord avec un homme qui l’avait abordé, il explosa et se mit à hurler. « Faites attention ou je vous ferai tous fusiller ! » P. le salua, lui exposa les raisons de notre venue et me présenta comme son compagnon de mission, mandaté avec lui pour embaucher des menuisiers. Il me regarda avec une certaine méfiance, mais me salua, sans dire grand-chose de particulier. « Quoi de neuf ? », l’interrogea P. L’autre prit un air mystérieux et chuchota. « D’après des rumeurs secrètes, nous avons pris Ekaterinoslav et Kharkov. » Cette information me sembla être pure fiction. Car si ces villes étaient effectivement tombées aux mains des Rouges, cela aurait fait la une de tous les journaux, et non l’objet de « rumeurs secrètes ». Maintenant, je pense qu’il voulait parler des partisans à l’arrière du front blanc, mais même dans ce cas, ses informations étaient erronées (27).
P. se mit en quête d’un attelage qui l’emmènerait, à vingt-cinq verstes environ au sud-ouest de Dmitriev, jusqu’au hameau de Selino dont il était originaire et où nous envoyait notre mission. Il était pressé d’arriver, moins pour commencer l’embauche des menuisiers que pour retrouver sa terre natale où il pourrait se reposer et voir venir les événements. Il me proposa de me prendre avec lui, mais cela n’aurait eu aucun sens pour moi, Selino était trop loin de la ligne de front et il aurait été dangereux d’y rester les bras croisés à attendre les Blancs. De plus, je voulais attendre le retour de notre maître de maison, que j’appellerai M., car je ne me souviens pas de son nom. D’après P., il connaissait bien la région et pourrait m’être utile dans mon entreprise. Il me fallait cependant penser à mon ravitaillement. C’était difficile à cette époque, surtout lors de déplacements en Russie soviétique en général, et dans les zones de front en particulier. À Dmitriev, aussi bien en ville qu’à la gare, il n’y avait pas moyen d’acheter le moindre bout de pain. Les habitants pouvaient s’en procurer une quantité limitée en échange de tickets de rationnement, mes logeurs n’en avaient que très peu ; je n’osai donc pas leur en demander. D’ailleurs ils ne m’en proposaient pas. C’était déjà bien qu’ils acceptent de m’héberger malgré l’énorme risque que cela représentait.
J’appris qu’il y avait, en ville, une cantine réservée aux fonctionnaires et aux gens de passage, et que pour en bénéficier, il fallait obtenir une autorisation du soviet local. C’est à contrecœur que je m’y rendis, et regrettai tout de suite de l’avoir fait. On se mit à m’interroger pour savoir d’où j’arrivais, ce que je venais faire ici, combien de jours j’allais rester, etc. On me délivra finalement un papier m’autorisant à manger à la cantine, mais on me dit que pour le jour même, c’était déjà trop tard, que je ne serais servi que le lendemain, la cantine n’ouvrant qu’une fois par jour, et étant fermée le soir. En un mot, ce jour-là j’allais « faminer » comme disait P. C’est lui, d’ailleurs, qui me tira de ce mauvais pas. En partant pour Selino ce soir-là, il me laissa du pain et quelques vivres.
M., notre hôte, était alors rentré de son déplacement. C’était un drôle de personnage. Habitant du coin, âgé de trente-cinq ans environ, citadin d’extraction modeste, il était plutôt éduqué pour son milieu d’origine, mais je n’irais pas jusqu’à dire qu’il était cultivé. Il circulait beaucoup et son gagne-pain consistait en ce que les bolcheviks appelaient de la spéculation. Il faisait commerce de tout ce qui lui tombait sous la main. Ainsi, peu auparavant, il avait quitté Kiev le jour où la ville était tombée aux mains des Blancs (le 18/31 août). Il raconta. « Nous étions à la gare, que les Rouges tenaient encore, quand les Blancs prirent la ville. J’ai pensé un instant rester chez les Blancs, ce qui aurait été tout à fait faisable, mais j’ai changé d’avis. J’avais bien trop d’activités inachevées à la maison. » À ce qu’il semblait, il savait trouver un langage commun avec les bolcheviks (fondé sur la spéculation). Il avait ramené avec lui un personnage tout à fait étrange (appelons-le K.), un communiste, très actif au niveau local, d’une quarantaine d’années. Apparemment, il aidait M. dans ses voyages et machinations « spéculatives ». K. s’était rendu coupable de quelque faute vis-à-vis de ses supérieurs communistes, je ne sais s’il s’agissait de son « commerce » ou d’une faute à caractère politique, toujours est-il qu’il craignait de gros ennuis (arrestation, jugement, prison), et se cachait chez M., son compère et camarade d’affaires.
P. m’avait chaudement recommandé ce spéculateur rusé de M., il m’avait dit que je pouvais lui faire entière confiance et qu’il pourrait m’être utile ; je ne lui cachai donc pas le véritable but de mon voyage. Il n’y avait d’ailleurs plus rien à cacher, puisque P. et la mère de M. lui avaient déjà presque tout raconté. « Je ne vous comprends pas, dit M. (alors que nous étions seuls), pourquoi diable voulez-vous risquer votre vie pour Tchaïev ? Comment avez-vous pu accepter de lui amener ce rapport, et de l’autre côté du front par-dessus le marché ? Laissez cela, je vous le conseille, et rentrez bien vite chez vous, car ici on peut vous arrêter. Vous vous êtes embarqué dans une affaire dangereuse et risquez d’être fusillé. » En réponse, je décidai de lui dire toute la vérité. « Je suis d’accord avec vous, c’est vrai que traverser le front et risquer sa vie pour un Tchaïev serait d’une grande stupidité. Jamais je n’aurais accepté de faire une chose pareille. Je ne suis pas si bête. Ce n’est pas Tchaïev que je vais retrouver, mais les Blancs. J’ai raconté cette histoire de Tchaïev à P. pour éviter de l’inquiéter. En fait, je vais rejoindre mes parents et trois de mes frères chez les Blancs, et surtout je compte me battre aux côtés des Blancs contre les bolcheviks. »
M. changea immédiatement d’expression. « C’est une tout autre affaire, dit-il, je vous comprends bien. Mais attention ! Votre décision comporte de grands risques et dangers. » — « J’en suis très conscient, mais de toute façon il n’y a pas de vie possible pour moi avec les communistes. » À ce moment-là, son ami le communiste K. entra dans la pièce et M. se mit à discuter avec lui des différents moyens de traverser le front. Pas une seule fois, cependant, il ne lui dit pourquoi ni ne cita mon nom. Mais je n’avais pas prêté attention à cette ambiguïté, et je crus pouvoir parler ouvertement de tout avec K.
Plus tard, je restai seul dans la pièce avec K. Il se mit à me raconter sa vie, comment il était devenu bolchevique révolutionnaire, puis comment il avait été déçu par la Révolution. « J’allais à l’école, j’étais un gamin avide de savoir, mais très vif et insolent. Un jour, j’ai fait quelque chose d’inconvenant. Pour me faire honte, le directeur m’a dit. « C’est la même chose que si tu avais baissé ton pantalon. » « Voulez-vous que je le baisse maintenant ? », ai-je répondu comme un gamin idiot que j’étais. Ils ont considéré ma réponse comme une provocation inouïe, ils m’ont renvoyé de l’école et ont marqué mon passeport (28), ce qui m’a fermé tout accès à l’éducation. Ma vie était brisée ; il ne me restait qu’une chose à faire, me rallier à la Révolution. C’est ce que j’ai fait. Je suis devenu révolutionnaire. J’ai lutté. Mais maintenant, je suis complètement déçu, je vois que je me suis trompé, et je voudrais recommencer une nouvelle vie. » Après ce récit, notre conversation passa aux thèmes d’actualité, aux Blancs, et je lui dis que je m’apprêtais à les rejoindre (et pourquoi). À ce moment-là, on m’appela de la pièce voisine, dont la porte était ouverte. J’y allai. C’était la mère de M., une femme déjà âgée. « Qu’est-ce que vous faites ? Pourquoi racontez-vous à K. que vous voulez rejoindre les Blancs ? On ne peut pas lui faire confiance. C’est un bandit. Il va vous dénoncer. » J’étais estomaqué, mais je retournai néanmoins dans la pièce où se trouvait K. Celui-ci tenta de reprendre notre conversation sur le thème des Blancs, mais je ne lui répondis pas, ou restai vague, et niai même avoir l’intention d’accomplir un acte aussi risqué. Mon interlocuteur remarqua mes hésitations, se vexa, notre conversation prit fin et il sortit.
J’étais très inquiet. Qu’allait-il se passer ? Au bout d’un certain temps, M. rentra. « Vous n’auriez pas dû parler des Blancs à K. », dit-il. — « Mais pourquoi ne m’avez-vous pas prévenu qu’il fallait faire attention avec lui ? D’ailleurs, vous-même avez discuté avec lui des moyens de passer chez les Blancs. Du coup, j’ai cru qu’on pouvait en parler avec lui. » — « Mais moi je parlais en général, sans vous nommer. C’est tout à fait différent. Mais bon, ne vous inquiétez pas, il n’osera pas vous dénoncer. Je le tiens, je sais trop de choses sur lui, il risquerait gros. Et il sait très bien que je les sais. Je vais lui faire peur. Mais vous, à partir de maintenant, faites attention ! »
J’avais déjà élaboré un nouveau plan d’action. Rester à Dmitriev était aussi insensé qu’aller à Selino, le front en était bien trop éloigné. J’allais plutôt avancer vers Lgov, plus au sud, puis de là jusqu’à la gare de Korenevo, en direction de Kiev. Korenevo avait été occupé un moment par les Blancs, puis ils en étaient repartis, mais la localité restait plus proche du front que Selino. De plus, P. m’avait laissé un mot pour un paysan qu’il connaissait dans un hameau des environs de Korenevo. je pouvais y passer une nuit ou deux, et il pourrait m’aider. Korenevo était loin de la destination indiquée sur mon ordre de mission, mais en cas de nécessité je pourrais dire que nous n’avions pas trouvé de menuisiers à Selino, et que j’avais été en chercher plus loin. De plus mon laissez-passer de la Tcheka me donnait l’autorisation d’entrer dans la province de Koursk en général, sans indiquer de destination précise, et Korenevo se trouvait dans la province de Koursk, ma présence là-bas était donc légale. En un mot, je décidai d’aller à Korenevo, mais il n’y avait pas de train pour Lgov ce jour-là, et je dus rester à Dmitriev un jour de plus.
Le lendemain (27 août/9 septembre), je me rendis à la cantine soviétique où l’on me servit — pour une somme modique il est vrai — un très mauvais et maigre repas. Puis, vers le soir, je me dirigeai vers la gare, pour attendre mon train pour Lgov. Dans certains wagons, je vis des soldats de l’Armée rouge blessés. Sur le quai, j’entendis la conversation suivante. « On les a capturés vers Soudja. Ils se rendaient, les salauds, ils levaient les bras et criaient « Pitié camarade, nous sommes des appelés ! » Tu parles ! On les a tous achevés. » — « Ils n’ont pas d’appelés, eux ! Ce sont tous des volontaires (29) ! », répondit l’autre. « Et quand ils t’attrapent, ils sont sans pitié. »
Le train pour Lgov en provenance de Moscou arriva tard. Il y avait un wagon de passagers, mais je préférai monter dans un wagon de marchandises. J’en avais assez de tous ces contrôles. Et c’est vrai que dans notre wagon de marchandises, on nous laissa tranquilles jusqu’à Lgov. Il y avait peu de monde dans le wagon, surtout des paysans. Le sol était recouvert d’un tapis de feutre crasseux. Je m’allongeai. Quelques instants après, je sentis qu’il y avait des bêtes qui se promenaient sur moi. « Ce ne sont tout de même pas des poux ! », me dis-je. Cela ne m’était encore jamais arrivé. Un paysan maigrichon de notre wagon les remarqua lui aussi. « Ah, les poux, les poux ! Ca y est ! Y sont là ! », dit-il avec philosophie. En écoutant les paysans, j’appris qu’ils venaient presque tous de la province d’Orel (« de Dorel », comme ils disent) où il y avait une terrible pénurie de sel, qui du coup est devenu très cher. En Ukraine, dans les districts de Soumy, ou même de Korenevo, il y avait tout le sel qu’on voulait, et il était bon marché, ils allaient donc en chercher. Cela me fit penser que si on me demandait ce que j’étais venu faire à Korenevo, je pourrai répondre que j’étais moi aussi venu chercher du sel ! Parmi les passagers, certains remarquèrent ma belle valise de cuir. Ils me demandèrent. « Tu l’as eue où, ta valise ? » ou encore. « Tu me la vends ? » Cela continua pendant tout le trajet jusqu’à Korenevo. Un « camarade rouge » me dit même. « Tu as tué un officier, et tu lui a pris sa valise. Qu’est ce que tu vas en faire ? Vends-la-moi ! » Je fus très piqué de sa supposition, mais ne répondis rien. Je me dis même que c’était parfait, qu’ils me prenaient pour un des leurs.
Le matin, nous arrivâmes à Lgov. J’appris que le train pour Korenevo partait bientôt. En écoutant les bavardages des bonnes femmes qui attendaient ce même train, j’entendis que, pour me rendre à Korenevo, je devais obtenir une autorisation du commandant de la gare. J’allai le voir. Le commandant était installé dans une petite pièce du bâtiment de la gare de Lgov. Le camarade Kahn ne payait pas de mine, c’était un homme d’âge moyen en uniforme militaire. Il parcourut rapidement mes documents, le laissez-passer de la Tcheka, et me donna un papier dûment signé et tamponné m’autorisant à me rendre jusqu’à la gare de Korenevo, en date du 10 septembre (n. st.) (30) 1919.
Le train était composé de wagons de marchandises découverts. Parmi les passagers, des soldats de l’Armée rouge, des cheminots, des paysannes, des habitants du coin. J’entendis pour la première fois des jurons blasphématoires. Les soldats rouges ne s’exprimaient qu’ainsi. Quand je travaillais à Vesyegonsk, on entendait beaucoup de jurons, mais jamais ni les ouvriers ni qui que ce soit d’autre ne blasphémait. Je ne devais par la suite rien entendre de semblable dans l’Armée blanche. Les jurons blasphématoires étaient en quelque sorte le signe distinctif de l’Armée rouge. En entendant ces jurons, les paysans et leurs femmes semblaient horrifiés et révulsés. « C’est effrayant d’entendre ça, dirent-ils. Si tu veux jurer, tu es libre, mais pourquoi t’en prends-tu aux choses sacrées ? » Un jeune soldat, un gars assez nigaud, raconta aux femmes ses « exploits de guerre ». « C’est ainsi que je les tuais toujours, en les sabrant en croix, comme ça. » Et il fit le geste de frapper un homme à terre. « Mais dis-donc, s’indignèrent les femmes, on n’a pas le droit de faire ça ! »
Personne ne faisait attention à moi. Quelques heures plus tard, nous arrivâmes à Korenevo. Je m’extirpai du wagon. Il faisait un temps splendide, ensoleillé, mais on sentait l’automne approcher. Les nuits étaient froides. Les feuilles commençaient à jaunir. Il y avait relativement peu de monde dans la gare, et peu de wagons sur les voies. Que faire maintenant ? Attendre les Blancs ? Combien de temps ? Sur les murs, il restait bien quelques lambeaux d’affiches arrachées, des ordres et avis à la population édictés par Denikine (reconnaissables immédiatement, car rédigés selon l’ancienne orthographe (31)), que je lus avec un sentiment mitigé de joie et de tristesse, mais le front ne semblait pas très proche. On n’entendait pas de coups de feu. Apparemment, les Blancs avaient dû beaucoup reculer. Où allais-je les attendre ? De quoi allais-je me nourrir ? Déjà, je n’avais quasiment rien mangé depuis le matin. Il fallait essayer de marcher en direction des Blancs, mais il y avait mes bagages, qui étaient lourds. J’essayai de les porter, mais au bout d’un quart d’heure, je n’y tins plus. Et puis cette valise jaune, tout le monde la remarquait. Quelle idée de l’avoir emportée ! Ma décision était arrêtée. j’allais rentrer à Dmitriev, y laisserais toutes mes affaires ou presque, et reviendrais à Korenevo sans bagages. Peut-être que d’ici-là, la situation du front aura changé en mieux.
L’après-midi même, je repris le train pour Lgov. C’étaient les mêmes wagons découverts qu’à l’aller. Cette fois-ci, j’avais pour compagnons de route une dizaine de cheminots de Lgov. Ils se remémoraient la période d’occupation de Korenevo par les Blancs. « Il est impossible que les Blancs gagnent. Ils ne sont qu’une poignée. Regardez. Korenevo fut pris par une unité de trente-deux hommes seulement ! Je ne comprends pas comment ils ont fait pour occuper la moitié de la Russie. Ils n’y resteront pas. D’ailleurs les gens n’en veulent pas au pouvoir (32). » Je ne me mêlai pas à cette conversation.
Nous arrivâmes à Lgov à la nuit tombante. Ici, le décor avait totalement changé. Les voies étaient encombrées de convois de marchandises, la gare et les quais remplis de soldats de l’Armée rouge. À l’intention des soldats qui erraient sur les quais, un gramophone déversait sans interruption toutes sortes de textes de propagande bolchevique. Je me souviens notamment de la déclamation d’un poème de Demian Bedniy (33), au sujet d’un bolchevik et d’un menchevik qui font leur cour à la même jeune fille, lui exposent leur programme politique, et la jeune fille accorde sa sympathie au bolchevik et chasse le menchevik. Je passai la nuit dans le hall de la gare, où des centaines de personnes étaient couchées à même le sol de pierre, si serrées qu’il était difficile de se frayer un passage. C’étaient soit des soldats, soit des revendeurs ambulants.
À trois heures du matin, on nous réveilla. Contrôle des papiers, apparemment on cherchait des déserteurs. Comme d’habitude, le contrôle était fait par un militaire accompagné d’un soldat de l’Armée rouge avec un fusil à l’épaule. Un jeune gars n’était pas en règle, il fut arrêté malgré ses protestations. Le militaire examina attentivement mes papiers, mais n’y trouva visiblement rien à redire. Le matin, je pris le train pour Dmitriev, où j’arrivai après midi. La gare avait changé d’allure. Il y régnait une grande animation, beaucoup de wagons étaient sur les voies, mais surtout un point de ravitaillement pour les soldats de l’Armée rouge était apparu dans la gare, et un kiosque de propagande, où l’on pouvait se procurer les journaux de Moscou. Je n’en avais pas vu depuis mon départ de la capitale. Ils ne m’apprirent rien de nouveau, si ce n’est qu’en direction de Lgov et Vorojba (je ne me souviens pas exactement), il y avait des « combats défensifs ». Dans la langue des communiqués militaires bolcheviks, cela signifiait une offensive des Blancs. Le point de ravitaillement était quasi vide, et n’était d’ailleurs accessible qu’aux soldats de l’Armée rouge. Mais on me prenait pour l’un d’eux et on ne me fit aucune difficulté.
Je m’arrêtai de nouveau chez M. Il n’était pas là, il était encore parti avec le « communiste déçu » K., vaquer à ses affaires commerciales. Le lendemain, en ville, je tombai sur un autre kiosque de propagande qui n’était pas là auparavant, quelque chose comme une librairie improvisée qui vendait et distribuait des brochures bolcheviques. À l’extérieur, près de l’entrée du magasin, était affichée une grande carte de la province de Koursk. Cela me parut très intéressant, j’entrai et en demandai un exemplaire. On m’en vendit sans aucune formalité. C’était une carte à grande échelle, à dix verstes par pouce, mais malheureusement pas très détaillée. N’y étaient indiqués que les points de peuplement importants, villes et villages. Le hameau de Selino, destination de ma mission, n’y apparaissait pas, par exemple. En me fondant sur des indications orales, je m’étais fait une idée erronée de l’endroit où il se trouvait. En réalité, il ne se trouvait pas au nord-ouest du village Fateevka (non loin de la route Dmitriev-Sevsk), comme je le pensais, mais au sud-ouest. Cette erreur aurait pu avoir de graves conséquences.
J’étais tout de même fort satisfait de mon achat, cette carte allait pouvoir m’aider à m’orienter dans la région au moment où je traverserai la ligne de front. Cette carte était éditée par les Soviétiques, cela se voyait à ses légendes, rédigées selon la nouvelle orthographe. Comme elle était de très grande taille, j’en découpai la partie qui me semblait la plus importante (les districts de Lgov-Dmitriev-Korenevo et alentours) et la cachai dans ma poche. J’avais laissé toutes mes affaires, y compris ma malheureuse valise, chez M., et j’avais maintenant pour tout bagage un petit baluchon contenant du linge et une gamelle. Voilà deux jours que j’étais arrivé à Dmitriev, il n’y avait pas eu de trains auparavant, et je ne partis que le soir. Dans le wagon de marchandises où je montai, il y avait à nouveau des paysans de « Dorel ».
Au petit matin, le temps changea. Il faisait gris, il bruinait. Un des paysans jeta un coup d’œil par la porte du wagon et dit. « Ça se septembrise. » Il avait raison, nous étions justement le 1er septembre ancien style (34).
- Ancien colonel de l’armée impériale, A. M. Egorov (ou Iegorov) rejoignit les Rouges en 1918. Nommé à partir de l’été 1919 commandant de la 14e Armée soviétique sur le front méridional, il prit du 18 septembre au 1er octobre le commandement du front méridional contre Denikine. Par la suite, il fut promu maréchal d’Union soviétique. Il fut fusillé par Staline, comme presque tous les dirigeants militaires en vue qui avaient combattu les Blancs sur le front méridional. Les historiens ne sont pas tous d’accord sur la date de sa mort. D’après la Grande Encyclopédie soviétique (3e éd.), il mourut le 23 février 1939 (on ne précise pas qu’il a été fusillé). D’après d’autres sources (voir Robert CONQUEST, La Grande Terreur, Paris, Robert Laffont, 1995, p. 934), il serait mort sous la torture.
- Je sus bientôt qu’il s’agissait de la 14e armée.
- En réalité, les bandes de Makhno passèrent à l’action le 13 septembre, et ce n’est que le 14 octobre qu’elles prirent Ekaterinoslav. Voir A. DENIKINE, Otcherki Rousskoï smouty [Essais sur les troubles russes], Paris, 1923, t. V, p. 235.
- En traduction littérale, on lui donna un « passeport de loup ». Avant la Révolution, on marquait d’un signe particulier les passeports des opposants politiques dangereux (révolutionnaires). Les porteurs de tels passeports n’avaient plus accès à l’enseignement supérieur ni à la fonction publique (NdT).
- C’est inexact. Tout comme les Rouges, les Blancs pratiquaient la mobilisation depuis 1918. Voir M. GREY et J. BOURDIER, Les Armées blanches, op. cit., p. 182-183 (NdR).
- Pour « nouveau style » ; le calendrier julien avait été adopté par le gouvernement bolchevique le 31 janvier 1918. Voir « Avant-propos de l’auteur », n. 2 (NdR).
- Le 2 octobre 1918, le Sovnarkom avait émis un décret de réforme et de simplification de la grammaire et de l’orthographe russes. Certaines lettres avaient notamment été supprimées. Cette réforme n’ayant pas été acceptée par les Blancs, on pouvait aisément distinguer les publications des uns et des autres (NdR).
- Les sources soviétiques donnent des informations intéressantes sur les effectifs de l’Armée blanche dans cette région à ce moment-là. « En direction de Gloukhovo (district Vorojba-Korenevo-Lgov, c’est-à-dire sur une longueur de front de 100 à 150 verstes). 1er et 2e régiments Drozdovsky — 10.800 sabres et baïonnettes. En direction de Dmitriev. régiment de Samourie — 4.960 baïonnettes, 750 sabres. Au total, 18.108 baïonnettes, 4.173 sabres, 245 pièces d’artillerie. » (Voir Grazhdanskaya voïna na Ukraïne [La guerre civile en Ukraine], Moscou, t. II).
- Ephim Alexeïevitch Pridvorov (1883-1945), alias « Demian Bedniy » [Damien le Pauvre], poète, écrivain et propagandiste bolchévique (NdR).
- Voir « Avant-propos de l’auteur », n. 2 (NdR).

Dahin ! Dahin !
Là où mûrissent les oranges.
Parodie de Goethe
Les eaux étant trop basses, les bateaux ne circulaient pas sur la Mologa en été et en automne ; pour se rendre à Moscou, il fallait faire un détour par Vologda. Avec mon compagnon P., nous nous mîmes en route, tard le soir et, à trois heures du matin, prîmes place dans une draisine et partîmes par un segment encore inachevé du tronçon ferroviaire Vesyegonsk-Souda. Puis, nous montâmes à bord d’une locomotive qui nous amena à l’aube du 18/31 août à une station de la voie Petrograd-Vologda-Souda. Outre nous deux et le mécanicien, il y avait avec nous un quatrième homme, ouvrier sans doute. Le mécanicien, un gars tapageur, désinvolte et bavard, nous racontait qu’il lui arrivait souvent de transporter des bolcheviks de haut rang. En citant leurs noms, il les couvrait des pires insultes. « Il y a quelques jours encore, j’ai du transporter un de ces… (un mot très grossier) haut-placés. » Était-ce un genre d’opposition politique ou simplement un comportement de voyou ? C’est difficile à dire, peut-être un peu des deux. Le train en provenance de Petrograd arriva à neuf heures du matin avec plusieurs heures de retard, et nous parvînmes à Vologda aux environs de midi. Grâce à nos ordres de mission, nous pûmes prendre place en première classe. Notre wagon était bondé. Nous dûmes rester debout dans le couloir avec nos bagages pendant tout le trajet… Parmi les nombreux soldats de l’Armée rouge qui voyageaient dans notre wagon, mon attention fut retenue par un jeune officier à l’air aristocratique, portant avec élégance un uniforme de l’Armée rouge et une casquette à étoile rouge. Son visage était triste, il était assis dans le couloir sur ses valises luxueuses et regardait droit devant lui, perdu dans ses pensées. Il me rappelait une connaissance à Petrograd, et j’étais sur le point de le saluer, mais comme je n’étais pas certain, j’hésitai. C’était assez risqué ; je ne savais pas ce qu’il faisait dans l’Armée rouge et peut-être était-il vraiment passé du côté des bolcheviks. De son côté, il s’obstinait à m’ignorer et regardait fixement devant lui, alors que je me tenais juste à côté de lui. Des années plus tard, à Paris, je croisai son père (si cet officier rouge était vraiment la personne que je connaissais) et lui racontai cette rencontre. Le « père » me dit que son fils avait effectivement été appelé dans l’Armée rouge alors qu’il se trouvait à Petrograd, et qu’il avait rejoint le front à peu près au moment que j’évoquais. De nombreuses années s’étaient écoulées, et son fils n’avait plus jamais donné de nouvelles. Ma rencontre avec lui — si c’était bien de lui qu’il s’agissait — était la dernière chose que son père sut de lui.
À Vologda, il fallait prendre le train de Moscou, pour lequel on ne pouvait acheter de billets que sur autorisation. Nous dûmes nous adresser à une administration « tchékiste » qui occupait dans la gare un bâtiment à part. C’était le Service des laissez-passer auprès de l’État-major de la 6e Armée rouge, qui était déployée sur le front d’Arkhangelsk. Un type en uniforme (ils étaient deux dans le service) examina mes papiers et, l’air renfrogné, me remit un laissez-passer pour Moscou. Ce bout de papier allait beaucoup me servir. Nous avions quelques heures devant nous avant le départ du train. Je sortis faire un tour en ville. J’en garde un vague souvenir de vieilles églises, d’un marché sur une grande place. Des petits garçons couraient ça et là, proposant des allumettes par lots de cinq (!), en criant. « Voilà des allumettes ! Qui veut des allumettes ? » Il est intéressant de noter que les bolcheviks avaient rebaptisé cette place en « Place de la lutte contre la spéculation ». C’est ce que proclamait une plaque murale visiblement récente. Mais je ne vis aucun signe de lutte contre la spéculation, qui était florissante sur cette place. Et c’était tant mieux pour la population, pensai-je.
Vers cinq heures, nous prîmes place à bord du train Vologda-Iaroslavl-Moscou. Nous montâmes dans un wagon de privilégiés, cependant assez inhabituel. C’était sans doute une ancienne voiture-restaurant, qui n’était pas divisée en compartiments mais comportait une salle commune où étaient disposées des chaises, sur lesquelles nous nous assîmes. Pour dormir, c’était assez inconfortable. Il y avait beaucoup de monde, mais personne n’était resté debout. Parmi les passagers, l’on distinguait un groupe de six à huit jeunes officiers rouges, à peine sortis de leur école militaire. Ils avaient tous été sur le front nord, et se rendaient maintenant soit en permission, soit sur un autre front. À ma grande déception (il faut bien l’avouer), ils faisaient plutôt bonne impression. C’étaient de jeunes gars d’origine paysanne ou ouvrière, aux visages vraiment russes, ce qui était rare parmi les Rouges, habillés avec soin, ils étaient résolument polis et discrets. On voyait qu’ils étaient drôlement contents d’être officiers, d’être devenus « quelqu’un ». Leur niveau culturel était bien sûr très bas, primitif, on leur avait farci la tête de slogans bolcheviques mélangés à un peu de patriotisme (ils racontaient avec plaisir qu’ils avaient battu les Anglais près de Mezen, et qu’ils en avaient même capturé quelques-uns). Ils bavardèrent avec moi de fort bonne grâce, très aimablement, ils n’avaient pas la moindre idée de mes intentions. Je fus assailli de pensées moroses. il ne serait pas si simple de venir à bout de l’Armée rouge. Ceux-là vont vraiment se battre ! Et en même temps, je fus pris d’une sorte de pitié pour eux. comment ces bons Russes avaient-ils pu se laisser embobiner par les bolcheviks ?
Plus nous approchions de Moscou, et plus il y avait de monde sur les quais des gares, mais on ne laissait personne entrer dans notre wagon, car nous étions des privilégiés. Alors que j’étais sorti une minute sur le quai de la gare d’Aleksandrov, une connaissance de Moscou me héla dans la foule. Il me regardait avec étonnement, se demandant ce que je faisais ici. Sans doute, pensait-il que j’étais parti depuis longtemps rejoindre les Blancs. Et moi, je le regardais avec méfiance, ne sachant pas quelles étaient ses relations avec les « camarades ». J’étais très ennuyé que l’on m’ait reconnu alors que j’étais en route vers le front. En fait, nous ne nous dîmes rien de concret, ne révélâmes pas nos projets et je laissai inassouvie la curiosité de mon interlocuteur qui, de son côté, n’osa pas m’interroger plus avant.
Le 19 août/1 septembre dans l’après-midi, nous atteignîmes Moscou sans encombre. De la gare Iaroslavski, je dus marcher à pied jusqu’à la rue Koudrinaya-Sadovaya (18), où j’allais être hébergé par des cousins qui, depuis, ont émigré en Occident. Il y avait bien des tramways, mais ils étaient pleins à craquer, et il eût été impossible d’y monter avec des bagages. Moyennant une petite somme d’argent, nous déposâmes nos affaires sur un attelage qui allait dans notre direction, nous-mêmes marchant à côté. À cette époque, il y avait encore peu de camions automobiles à Moscou et le recours aux attelages était prédominant. La maison où je devais dormir était en partie réquisitionnée par les représentants de notre chantier ferroviaire. Cela allait beaucoup nous faciliter les démarches administratives à venir. Je ne me souviens pas bien de toutes les administrations qu’il nous fallut visiter pour obtenir les papiers nécessaires à notre départ mais, dans l’ensemble, cela se passa comme suit. Le lundi 21 août/3 septembre, munis de documents officiels complémentaires délivrés par notre administration ferroviaire, qui confirmaient qu’il nous était indispensable d’embaucher des menuisiers, nous nous rendîmes, avec mon compagnon P., au bureau qui délivrait les billets de train pour les voyages en service commandé. Nous demandâmes des billets pour Dmitriev sur la ligne Briansk-Lvov. On nous répondit qu’il fallait préalablement obtenir une autorisation du Tsoupvoso (Direction centrale des liaisons militaires). Nous y allâmes. Le Tsoupvoso occupait un grand immeuble, dans le quartier de l’Arbat, me semble-t-il. On contrôla nos papiers à l’entrée, puis nous prîmes l’ascenseur et pénétrâmes dans une pièce où était accrochée une grande carte avec les lignes de front. Je la détaillai avec intérêt (sans en avoir l’air, bien sûr), mais n’en tirai rien de nouveau par rapport aux communiqués officiels. Je me souviens que les positions des Rouges et des Blancs dans le secteur de la percée de Voltchansk-Koupiansk étaient indiquées en traits épais (19).
Pour autant que je me souvienne, nous n’eûmes pas de difficultés à obtenir le papier que nous étions venus chercher.
En sortant de l’immeuble, je fus à nouveau saisi de mélancolie. quelle administration imposante ! Et quel avantage de pouvoir diriger de façon centralisée toutes les liaisons militaires ! Pouvait-on en dire autant des Blancs ? Non vraiment, nos adversaires n’étaient plus les Gardes rouges de 1917! Nous pouvions maintenant prendre nos billets. Mais là, survint un contretemps inattendu. Les employés nous dirent que nos billets n’étaient pas prêts, qu’on ne pouvait pas les émettre sur-le-champ. « Revenez demain ou même après-demain ! » Cela n’arrangeait absolument pas mes affaires. Mon ordre de mission était valable pour une destination précise qui se trouvait, en ce moment, être relativement proche de la ligne de front. Mais la situation évoluait chaque jour, Denikine pouvait avancer ou reculer, et alors mon projet de passage chez les Blancs serait grandement compromis. Je ne pouvais pas perdre une seule journée. Il va sans dire que je ne leur fis pas part de ces arguments, mais je me mis à leur expliquer avec insistance, en haussant le ton, que l’administration ferroviaire qui m’envoyait poursuivait des objectifs hautement stratégiques, que ce pont devait être construit dans les plus brefs délais et que le moindre contretemps était inadmissible, qu’ils porteraient la responsabilité de mon retard. Mon discours fit son effet. Nos billets furent émis et délivrés sur-le-champ.
Ce succès m’ayant donné des ailes, je me dirigeai avec mon compagnon vers la dernière — et la plus effrayante — des administrations qu’il nous fallait voir. le Service des laissez-passer de la Tcheka pour les zones de front. Peu de temps auparavant, un décret avait été publié par le Sovnarkom (20) instaurant une zone de front d’une largeur de cent cinquante verstes le long de la ligne de front. L’état d’urgence y était déclaré, et l’entrée n’y était autorisée qu’aux personnes détentrices de laissez-passer spéciaux délivrés par la Tcheka. Les contrevenants étaient passibles des peines applicables en temps de guerre. Au Tsoupvoso, on m’avait dit que Dmitriev, notre lieu de destination, se trouvait à l’intérieur de la zone de front. Nous dûmes donc, non sans effroi, nous rendre place de la Loubianka. Nous savions que la Tcheka y avait son siège, mais nous ignorions quel immeuble elle occupait exactement. Grâce à Dieu, je n’avais encore jamais eu affaire à cet organisme. Sur la place, nous demandâmes à un milicien où se trouvait la Tcheka. Sans un mot, il nous montra du doigt un grand immeuble qui donnait sur la place, celui de la compagnie d’assurance Rossia. Nous y pénétrâmes. Il n’y avait pas de vigile à l’entrée, et personne ne nous demanda rien. Nous fîmes quelques pas et gravîmes les quelques marches d’un large escalier de pierre. Nous atteignîmes un palier sur lequel se dressait une sorte de comptoir assez haut, derrière lequel deux hommes étaient assis. « Qu’est-ce qu’il vous faut ? », demanda l’un d’eux quand nous nous fûmes approchés du comptoir. — « Nous avons besoin d’un laissez-passer pour la zone de front. » — « Vos papiers ! » dit le tchékiste. Après les avoir examinés, il nous les rendit en disant. « Ce n’est pas ici, c’est dans la Section d’émission des laissez-passer, dans un autre bâtiment, non loin d’ici. »
Nous ressortîmes et nous dirigeâmes vers le bâtiment indiqué. C’était un hôtel particulier, si mes souvenirs sont bons. Cette fois, il y avait un vigile armé à l’entrée, mais il ne nous posa aucune question. Nous entrâmes dans une salle pleine de gens, apparemment venus, comme nous, chercher des laissez-passer. Derrière un comptoir étaient assis deux hommes. le premier était un Letton chauve d’une cinquantaine d’années qui parlait bien le russe mais avec fort un accent étranger. Le second était un jeune juif au visage très typé, d’allure cultivée. Je me mis à leur expliquer notre situation. « Présentez-nous une attestation de la bourse du travail de Moscou certifiant qu’il n’y a pas de menuisiers spécialisés à Moscou », dit le Letton. Il fallut expliquer à cet idiot que l’administration ferroviaire ne se serait pas mise à envoyer des gens à l’autre bout du pays s’il était possible de trouver des menuisiers à Moscou, que les menuisiers que nous comptions embaucher avaient déjà travaillé à la construction d’un pont, qu’ils connaissaient leur affaire, etc. Par chance, les documents complémentaires que l’on m’avait fournis à Moscou comportaient des précisions à ce sujet. Le tchékiste n’insista pas sur sa bourse du travail, posa encore une question absurde dont je ne me souviens plus et finit par céder. « Remplissez ce formulaire », dit-il. Le formulaire contenait des questions assez détaillées sur les occupations du demandeur avant la Révolution, sa profession actuelle, son niveau d’études, son lieu et sa date de naissance, son adresse à Moscou, les raisons du voyage, etc. Mais la question la plus désagréable, celle des origines sociales, en d’autres termes celle sur vos parents, n’était pas posée. Il n’était pas très compliqué pour moi de remplir ce formulaire. À toutes les questions sur ma profession et mes activités passées ou présentes, je répondis. étudiant, études.
Le formulaire devait être rempli sans ratures, sous les yeux attentifs des tchékistes qui nous surveillaient. Une fois les formulaires remplis, nous les tendîmes au Letton, qui les regarda et dit. « Venez après-demain, dans l’après-midi. » Nous nous mîmes à parlementer pour obtenir nos laissez-passer dans de meilleurs délais, recourûmes à nouveau à l’argument de l’extrême urgence de notre entreprise, mais l’homme fut inébranlable. « Revenez dans deux jours. » Il fallut se résigner à attendre. « Mais ils seront prêts après-demain, c’est sûr ? », demandai-je. « Oui, sûrement », répondit-il.
Ce délai de deux jours m’était désagréable au plus haut point. Les dernières nouvelles du front n’étaient pas bonnes. Les troupes du général Denikine avaient reculé, juste à l’endroit du front qui m’intéressait. Elles avaient abandonné Rylsk et Korenevo, s’étaient éloignées de Lgov et s’étaient repliées sur Soumam et Soudje en direction de Kharkov. Je craignais qu’elles ne s’éloignent encore plus de l’endroit de ma mission. Moscou, cependant, vivait encore dans l’attente de l’arrivée imminente des Blancs. Ma tante (21) m’apporta de son travail La Résurrection de la Russie, une feuille de choux ronéotypée clandestinement. On pouvait y lire des comptes rendus manifestement exagérés des avancées victorieuses des Blancs, on y annonçait par exemple les prises de Briansk et de Koursk. Jamais les Blancs ne prirent Briansk, et Koursk ne fut prise que plus tard. D’autre part, même si je m’abstenais de voir qui que ce soit et ne faisais part de mes projets à personne, mon arrivée à Moscou et mon intention de traverser le front ne pouvaient rester bien longtemps secrètes. Ainsi, un de mes cousins vint me voir pour me prier de l’emmener chez les Blancs. Afin d’éviter son incorporation dans l’Armée rouge, il était entré dans une école d’intendance militaire, mais son départ pour le front était maintenant imminent. À vrai dire, l’Armée blanche ne l’intéressait pas tant que cela (il n’était pas très belliqueux de nature) mais voulait surtout éviter l’incorporation et, par la même occasion, quitter la Russie soviétique. Je lui dis que je n’étais pas en mesure de l’aider car, sans documents soviétiques, on ne pouvait pénétrer dans la zone de front, et que je ne pouvais lui procurer ces documents, ayant obtenu les miens avec la plus grande peine. « Qu’as-tu à craindre d’être envoyé au front ? », ajoutai-je. « De là, tu pourras aisément passer chez les Blancs ! » — « J’ai peur qu’on ne me croie pas. On me prendra pour un communiste et on me fusillera. Va donc prouver que tu n’es pas un agent double ! » Bien sûr, mon cousin n’était pas homme à me dénoncer, mais il était très déplaisant que la rumeur de mon départ se répande dans tout Moscou. De plus, la Tcheka (le service des laissez-passer) connaissait mon adresse de Moscou, pouvait se renseigner et en apprendre de belles sur mon compte. En un mot, j’étais pressé de partir.
Deux jours plus tard, à l’heure dite, nous nous présentâmes à la Tcheka pour prendre nos laissez-passer. Il n’y avait plus de vigile à l’entrée et la maison en général donnait une impression de bouleversement, il y avait toute sorte d’objets et de papiers éparpillés sur le sol… Dans la salle, nous trouvâmes le Letton et le juif derrière le comptoir, mais il n’y avait plus ni demandeurs, ni autres tchékistes. Je demandai nos laissez-passer au Letton. « Aujourd’hui, en raison de notre déménagement dans de nouveaux locaux, répondit-il, nous ne pouvons pas délivrer de laissez-passer. Ils ne sont pas prêts. Vous les aurez demain, rue Tchernychevski. » J’explosai. Encore un contretemps ! « Mais enfin, vous aviez promis que je les aurais aujourd’hui ! » — « C’est tout à fait impossible, nous déménageons. » Hors de moi, me souvenant comment j’avais réussi à obtenir nos billets de train deux jours auparavant, je m’adressai à mon compagnon P., en grommelant dans ma barbe, mais de façon à être entendu de tous. « C’est du pur sabotage ! » L’effet produit fut cependant inattendu. Le Letton bondit de sa chaise et, rouge comme une écrevisse, demanda au tchékiste juif assis à coté de lui. « Vous avez entendu ce qu’il a dit ? » — « Oui », répondit l’autre avec un sourire glaçant. Le Letton frappa de la main sur le comptoir et dit. « Je vous arrête pour outrage envers un collaborateur de la Tcheka. » Et il quitta la pièce en courant.
Nous restâmes tous les deux en compagnie du tchékiste juif, dans un silence pesant. Les événements prenaient mauvaise tournure. Quelques minutes plus tard, le Letton revint et me dit. « Vous avez de la chance, en raison du déménagement, notre fusilier soviétique (c’est-à-dire le vigile de l’entrée) n’est pas là. Sinon, on vous aurait fait passer l’envie d’insulter les collaborateurs de la Tcheka ! » Afin de clore cet incident à la fois stupide et dangereux, je crus bon d’ajouter que j’étais sorti de mes gonds, que notre mission était réellement urgente et que ce contretemps m’avait contrarié. En réponse à cela, le Letton me tint tout un discours, avec son accent étranger, m’expliquant qu’exiger des choses impossibles était une attitude de petit-bourgeois et qu’en tant que personne éduquée je me devais de le comprendre. J’étais sur le point de lui répondre qu’au contraire, demander l’impossible, c’était du romantisme, alors que les petits-bourgeois se contentaient d’accepter la réalité, mais je préférai me taire. Le principal était de sortir des griffes de la Tcheka !
En repensant maintenant à cet épisode dangereux et effrayant, je ne parviens pas à comprendre si le Letton avait vraiment l’intention de m’arrêter ou s’il a joué la comédie pour me faire peur. L’absence de fusilier ressemble plus à un prétexte qu’à une raison pour changer sa décision. Il aurait fort bien pu m’arrêter sans l’aide d’un fusilier. Il avait probablement réfléchi et pensé que retenir un homme qui avait une mission urgente à accomplir pouvait avoir des conséquences désagréables pour lui. J’avais eu la chance de passer pour quelqu’un d’important.
Le lendemain, vers onze heures, nous étions dans les nouveaux locaux du Service des laissez-passer de la Tcheka, rue Tchernychevski (près de la rue Tverskaïa). Encore un ancien hôtel particulier de belles dimensions. Dans la salle d’attente, il y avait beaucoup de gens qui attendaient leurs laissez-passer, mais nous ne vîmes ni le Letton et ni le juif, nos tchékistes de la veille. À leur place, il y avait dune dizaine d’employées, des jeunes femmes qui étaient toutes jolies et élégantes, mais aux visages durs et au ton d’une insolence assez incommodante. Elles parlaient aux demandeurs de façon brusque, grossière même. « Voyez-vous ça ! Monsieur veut voyager, et nous, il faut qu’on se dépêche ! », dit l’une d’elles à sa voisine, l’un des demandeurs ayant insisté pour que son laissez-passer lui soit délivré dans les meilleurs délais. Instruit par l’expérience, je ne fis pas de même et me contentai de dire. « On m’a demandé de venir à onze heures. Mon laissez-passer est-il prêt ? » — « Attendez là, on vous appellera », répondit la tchékiste. C’était une réponse très déplaisante. si l’on m’appelait, pensai-je, cela signifiait que l’on allait m’interroger, examiner mon cas, etc. C’était mauvais signe ! Mais une demi-heure plus tard, un tchékiste en veste de cuir entra dans la salle et se mit à lire la liste des personnes qui avaient obtenu leur laissez-passer. Nos noms étaient sur la liste. Je m’approchai et me nommai. Le tchékiste, sans poser de questions, me tendit mon laissez-passer. Il y était indiqué que le camarade Krivochéiev était autorisé, pour raisons de service, à se rendre dans la zone de front de la province de Koursk pour un mois. C’était signé et tamponné par le service de la Tcheka. Grâce à Dieu, tout allait bien, j’avais réussi à tromper ces tchékistes. Il ne restait plus qu’à prendre le train pour le sud.
Mais des trains en direction de Briansk, il n’y en aurait pas avant vingt-quatre heures, nous dit-on. Nous attendîmes donc jusqu’au lendemain. Je procédai à mes derniers préparatifs de départ. J’avais une valise de cuir de très bonne qualité (trop bonne qualité, j’allais en faire l’expérience), et un sac contenant entre autres du linge et un pantalon, mais pas de vêtements chauds. À Moscou, l’automne ne faisait que commencer (à Vesyegonsk on y était en plein, les feuilles avaient déjà complètement jauni), le temps était ensoleillé, dans la journée il faisait tout simplement chaud. Je me disais que j’aurais rejoint les Blancs bien avant l’arrivée du froid, et que là-bas, on me fournirait tout ce dont j’aurais besoin. Alors à quoi bon s’encombrer de bagages ? Ce raisonnement ne devait se vérifier que sur un point. même si j’avais eu plus de bagages, jamais je n’aurais réussi à garder mes valises jusque chez les Blancs !
Ma tante me donna pour la route deux mille roubles-Kerenski (22) qu’elle cousit à l’intérieur de mes bretelles par précaution. Les roubles-Kerenski avaient plus de valeur que la monnaie soviétique, et avaient l’avantage d’être en circulation même dans les zones d’occupation blanche. Ma tante m’offrit aussi une médaille représentant la sainte martyre Barbara. « Mets-la, me dit-elle, sinon, si tu te retrouves chez les cosaques, ils te prendront pour un sans-Christ et te fusilleront ! » (j’avais perdu ma croix de baptême en or peu auparavant et, dans les conditions de vie soviétique, il n’était pas facile de s’en procurer une nouvelle). N’étant pas très pratiquant à l’époque, je ne savais pas que la sainte martyre Barbara protégeait contre la mort violente, mais maintenant je crois fermement que c’est par son intercession que le Seigneur me sauva de la mort à cette époque. Pendant mon périple vers le front, et ensuite encore, il m’arriva de lui adresser des prières de mon cru.
Ainsi, le 24 août/6 septembre vers trois heures, après un séjour de cinq jours à Moscou, P. et moi, nous nous rendîmes avec nos valises à la gare de Briansk (23). Autour du convoi composé de wagons de marchandises et d’un wagon de troisième classe, c’était la cohue. Naturellement, ceux qui tentaient de monter dans le wagon de passagers étaient nombreux, mais ils étaient repoussés par deux commissaires en vestes « classiques » de cuir noir, armés de révolvers. Ils glapissaient d’une manière tout à fait hystérique sur cette foule de petites gens. Le wagon de passagers était réservé aux communistes « privilégiés », aux fonctionnaires soviétiques en mission, etc. Nous leur montrâmes nos papiers, et les commissaires nous laissèrent immédiatement passer. Le wagon était plein de passagers avec leurs bagages, mais nous trouvâmes tout de même une place assise dans un des compartiments.
Le train partit vers six heures du soir. Le lendemain vers midi, nous arrivâmes à Briansk, d’où le même train continuait (sans correspondance) vers Dmitriev-Lgov sur une ligne à voie unique. Dès avant Briansk, nous avions croisé un train blindé qui remontait vers le nord. Je m’étais réjoui de cette première hirondelle qui annonçait la proximité du front. Il y avait toutes sortes de gens dans le wagon, mais c’étaient surtout des « camarades » de rangs hiérarchiques variés. Des conversations se nouèrent. Je m’efforçais de rester sur ma réserve, et bien entendu ne parlai à personne du but véritable de mon voyage. Les « camarades » me prenaient pour un des leurs. Je me souviens de deux d’entre eux qui me racontèrent qu’ils occupaient des postes à responsabilité dans une ville de district de la province d’Ekaterinoslav (24), et qu’ils avaient dû fuir à l’approche de Denikine. L’un d’entre eux était commissaire au ravitaillement. C’était un partisan convaincu de la réglementation totale de la vie économique, du monopole d’État sur toutes les relations commerciales, du rationnement, etc. Selon lui, le marché libre et la spéculation étaient la source de tous les maux. « Nous avions construit tout un appareil de commerce étatique et éliminé la spéculation. Et voilà Denikine qui arrive, et qui réduit tous nos efforts à néant », disait-il. — « Mais comment fonctionnait votre appareil ? » lui demandai-je. « N’y avait-il aucun problème de ravitaillement ? » — « Malheureusement, si. Notre appareil fonctionnait mal », avoua-t-il. « Tous les produits avaient disparu. Mais c’est parce que nous n’avons pas eu le temps d’arranger ça. Et puis, les spéculateurs nous mettaient des bâtons dans les roues. » L’autre « habitant d’Ekaterinoslav » ressemblait plutôt à un tchékiste. « Où allez-vous, demandai-je, l’Ukraine n’est-elle pas presque entièrement aux mains des Blancs ? » — « On m’envoie mettre sur pied des unités de partisans à l’arrière des Blancs. » — « Mais n’est-il pas très difficile de traverser le front ? » demandai-je. Cette question m’intéressait particulièrement. — « Tout seul, c’est difficile, mais avec l’aide des nôtres sur le front, c’est très simple. Les armées connaissent parfaitement la ligne de front, et savent prédire les mouvements des troupes. » Et il se mit à raconter comment il allait organiser ses unités de partisans. « Notre commandement tient beaucoup aux mouvements de partisans et à l’espionnage à l’arrière du front ennemi. »
Pendant ce temps, mon compagnon de route P. était plongé dans une conversation très animée avec ses voisins qui l’écoutaient bouche bée. Il était en train de raconter comment, en 1916, il avait participé à la répression de l’émeute des « Sartes » (c’est ainsi qu’on les appelait avant la Révolution). Il s’agit d’un fait historique peu connu. en 1916, quand le gouvernement du tsar décréta la mobilisation des populations indigènes du Turkestan (qui, jusque-là, étaient exemptées de service militaire), ces indigènes se révoltèrent et égorgèrent près de trois mille colons russes. Bien entendu, l’armée écrasa cette révolte dans le sang. Et voilà que mon compagnon P. s’était mis à raconter qu’à cette époque, il travaillait sur la voie ferrée du Turkestan et, comme il connaissait bien la région, il avait guidé l’armée dans les villages de montagne, lui indiquant les endroits où on avait massacré des Russes. Il racontait les représailles que l’armée avait fait subir aux populations indigènes. J’étais horrifié en l’écoutant parler et lui donnai quelques coups de pied pour essayer de le faire taire. J’étais convaincu que les « camarades » qui composaient son auditoire allaient se jeter sur lui et l’arrêter comme bourreau tsariste, contre-révolutionnaire, qui écrasait les révoltes « anti-tsaristes » des peuples minoritaires. Mais il n’en fut rien ! À mon grand étonnement, les « camarades » étaient captivés par son récit, et l’écoutaient avec approbation et sympathie.
Une fois seul avec P., je lui demandai. « Pourquoi leur avez-vous raconté cela ? On aurait pu vous arrêter pour avoir participé à une expédition punitive sous l’ancien régime. Et on m’aurait arrêté aussi par la même occasion. Soyez plus prudent à l’avenir. » P. parut très surpris. « Mais qu’ai-je dit de mal ? Ces Sartes, ils ont tué des Russes. » Apparemment, les « camarades » raisonnaient de la même manière. Il est intéressant de noter que dans toutes ces conversations de train, personne ne mentionnait jamais les événements du front.
À partir de Briansk, la proximité du front et de la guerre commença de se faire sentir. La gare de Briansk, où notre train resta deux heures à l’arrêt, était occupée par des soldats de l’Armée rouge, de cent cinquante à deux cents hommes. Les cantiniers étaient en train de leur distribuer leur repas. La plupart des soldats étaient assis par terre sur le quai et mangeaient à même leurs gamelles. D’autres déambulaient dans la gare. On ne voyait pas d’officiers. Ensuite on les rassembla, et ils embarquèrent dans un convoi militaire qui partait vers le front. Ils avaient l’air assez peu disciplinés. Après Briansk, il y eut un contrôle des billets. Comme j’avais un billet de service, le contrôleur demanda à voir mon passeport. Bien entendu, je n’en avais pas ; je lui montrai mon ordre de mission, mon laissez-passer de la Tcheka et mon permis de séjour délivré par l’université de Moscou (unique pièce d’identité en ma possession, en dehors de mes documents de voyage). Mais le contrôleur ne fut pas satisfait. « Il me faut un document avec photographie. C’est une nouvelle règle. Il y a des gens qui utilisent des billets de service qui ne sont pas à leur nom. » J’eus les plus grandes peines du monde à me défaire de ce fonctionnaire zélé. De quelles photographies parlait-il ? Où les aurais-je prises, alors que tout était fermé, et même la Tcheka n’en demandait pas ? De toute façon, il n’était pas très dangereux ; ce n’était pas un tchékiste.
La nuit tombait. Nous entrâmes en gare de Deriugino, dernière station avant Dmitriev. Cette fois, c’est un militaire qui monta dans le wagon, accompagné d’un soldat de l’Armée rouge qui avait un fusil à l’épaule. Le militaire tenait à la main une lanterne. Notre wagon était très peu éclairé, quant aux wagons de marchandises, ils ne l’étaient pas du tout (d’ailleurs, je me rendis compte par la suite qu’on ne les contrôlait quasiment pas). Ils se mirent à contrôler nos laissez-passer. Nous entrions en zone de front. Le militaire examina longuement mes papiers à la lumière de sa lanterne (il semblait lire avec difficulté). Puis il me les rendit sans un mot et poursuivit sa progression dans le wagon.
- En réalité la rue Sadovo-Koudrinskaya (NdT).
- En août 1919, un effectif assez important de l’Armée rouge, composé notamment de troupes transférées du front sibérien, réussit à percer profondément le front des Blancs dans la région Valouïki-Koupiansk-Voltchansk, à la jonction des Armées du Don et des Volontaires, et à menacer Kharkov. Les Rouges parvinrent à trente verstes de Kharkov, mais essuyèrent une défaite et leur offensive fut réduite à néant.
- Acronyme de « Soviet des commissaires du peuple ». Appellation du gouvernement soviétique de 1917 à 1946 (NdR).
- Voir « Chapitre 1. Les journées de février 1917 à Petrograd », n. 10 (NdR).
- Billets émis par le Gouvernement provisoire dirigé par le socialiste A. Kerenski (juillet-novembre 1917) (NdR).
- Aujourd’hui, gare de Kiev (NdR).
- Rebaptisée « Dniepropetrovsk » à l’époque soviétique (NdR).

La décision de rejoindre l’Armée blanche (2) et de me battre contre les bolcheviks mûrit en moi durant l’hiver 1918-1919. À ce moment-là, tout m’était devenu intolérable et odieux au sein du système soviétique, dans lequel j’avais, en outre, pris conscience qu’il n’y avait pas de place pour moi. Jamais je ne pourrais y vivre, au sens littéral du terme. Et bien que je fusse loin d’être certain de l’issue victorieuse du combat des Blancs, y prendre part devint pour moi une nécessité vitale. Je ne pouvais pas rester les bras croisés. Cependant, mon souhait n’était pas si facile à réaliser. J’avais laissé échapper le moment propice où la faiblesse et la désorganisation généralisée du pouvoir soviétique rendaient relativement aisé le passage vers les Blancs à travers l’Ukraine de l’Hetman (3). Par familles entières, les gens avaient alors fui Moscou vers les régions méridionales de la Russie occupées par les Allemands et, de là, ceux qui le désiraient pouvaient rejoindre les Blancs. Maintenant, la situation avait changé du tout au tout. Le pouvoir soviétique s’était renforcé, on contrôlait systématiquement les voyageurs dans les trains, une zone de front avait été délimitée dont l’accès était interdit sans autorisation spéciale de la Tcheka (4). Sans pièces d’identité soviétiques, il était devenu impensable d’approcher la ligne de front, a fortiori de la traverser.
Je vivais alors à Moscou, où j’étudiais à la Faculté d’histoire et de philologie de l’université. J’avais eu dix-huit ans durant l’été 1918 (5). En juillet de cette même année, mon père (6) avait réussi à s’évader alors qu’il était assigné à résidence, et à gagner le sud. Il se trouvait maintenant dans la zone contrôlée par les Blancs. Aucun contact avec lui n’était possible. Basile et Oleg, mes frères aînés (7) — tous deux officiers — se trouvaient aussi, depuis l’été 1918, dans l’Armée des Volontaires (8). Quant à mon troisième frère Igor (9), il avait réussi, par relations, à être embauché sur le chantier de construction d’un chemin de fer dans le nord de la Russie, ce qui lui évitait un enrôlement dans l’Armée rouge. Au printemps 1919, ma mere (10) et Cyrille (11), mon frère cadet, partirent sous un nom d’emprunt se réfugier à Kiev, alors sous occupation bolchevique, et y restèrent jusqu’à l’arrivée des Blancs. Moi aussi, je partis à ce moment-là pour Kiev, dans l’espoir de rejoindre l’Armée blanche, mais convaincu que c’était quasi impossible, et ne pouvant rester à Kiev sans danger, je rentrai en mai à Moscou. Avant cela, j’avais vécu à Moscou chez des parents, sans travailler, me contentant d’aller à l’université. Je n’avais aucun lien avec des organisations antisoviétiques qui auraient pu, pensais-je, m’aider à rejoindre les Blancs en me fournissant les papiers d’identité nécessaires. Et sans papiers, il était impensable de tenter quoi que ce soit. Mais pour avoir des papiers, il n’y avait — paradoxalement — pas d’autre moyen que de travailler pour les Soviétiques. Une telle occasion se présenta fin mai de cette année, quand je réussis, par relations moi aussi, à être engagé comme ouvrier qualifié sur le chantier de construction ferroviaire où travaillait mon frère aîné.
Décrire en détail cette période n’entre pas dans mon propos. Je dirai brièvement que la construction de la voie ferrée Ovinichtche-Souda avait été entamée en 1916, puis interrompue après la Révolution, et reprise par les bolcheviks durant l’automne 1918. Cette voie ferrée avait une grande importance stratégique car elle reliait Petrograd à Moscou, doublant ainsi la voie Nicolaïevski. Le chantier à proprement parler ne s’étendait que sur un tronçon assez court de quatre-vingt dix verstes (12), qui comportait un pont de bois (on manquait de métal) sur la rivière Mologa près de la ville de Vesyegonsk, à la frontière entre les provinces de Tver et de Novgorod. C’est là que je fus affecté.
Avant la Révolution, le constructeur de cette voie ferrée avait été le célèbre ingénieur et entrepreneur Tchaïev, mais en 1918 les bolcheviks avaient confié la direction du chantier à l’ingénieur Boudassi, bras droit de Tchaïev, ce dernier ayant pris le parti des Blancs. Parmi les employés et ouvriers du chantier, bon nombre avaient auparavant travaillé pour Tchaïev. Grâce à Boudassi, non seulement je fus embauché sur le chantier, mais j’obtins les papiers dont j’avais besoin.
Pourquoi m’aida-t-il ? C’est avant tout par opportunisme, me semble-t-il. Boudassi travaillait pour les bolcheviks, et se trouvait lié à eux. Or, cet été 1919 était incertain. qui allait l’emporter, des Rouges ou des Blancs ? Boudassi voulait avoir quelques protecteurs chez les Blancs, pour le cas où ceux-ci sortiraient vainqueurs. Peut-être, prit-il aussi en considération les relations personnelles de Tchaïev avec mon père. Quoi qu’il en soit, je passai cet été à travailler à Vesyegonsk, attendant mon heure. C’était la période de l’avancée tumultueuse de l’armée du général Denikine (13) sur le front méridional. Kharkov venait de tomber, les Blancs approchaient de Koursk, Soumam et Kiev. Ces succès renforçaient mon impatience de rejoindre l’Armée blanche. S’il m’était arrivé, précédemment, de douter de l’issue victorieuse du combat des Blancs avant que je les rejoigne, maintenant je « craignais » surtout qu’ils ne gagnent sans moi ! Cependant, je restais conscient de la gravité et de la difficulté de ce combat contre les bolcheviks.
Mon heure finit bientôt par arriver. Vers la mi-août, l’ouvrier qualifié P., un « ancien » du temps de Tchaïev, reçut de l’administration du chemin de fer un ordre de mission pour se rendre dans la province de Koursk, au hameau de Selino du district de Dmitriev, afin d’y embaucher des menuisiers spécialisés en vue de la construction du pont de bois sur la rivière Mologa, près de Vesyegonsk. Cette mission n’avait rien de fictif. Il y avait réellement un pont en construction sur la Mologa, on manquait effectivement de menuisiers spécialisés sur le chantier, on n’en trouvait pas sur place et il y en avait effectivement dans la province de Koursk. P. lui-même était originaire du hameau de Selino où on l’envoyait, il y avait été récemment et savait avec certitude qu’il pourrait y recruter de bons menuisiers. Le côté fictif de l’affaire commençait par le fait qu’on m’avait affecté en qualité d’assistant et accompagnateur de P. Il est vrai qu’il était fréquent que l’on envoie deux personnes pour des missions de cette nature, mais dans le cas présent, P. n’avait pas besoin de moi, et je ne pouvais lui être d’aucune utilité en raison de mon inexpérience et de ma totale ignorance en matière de menuiserie. Mais cet ordre de mission arrangeait mes affaires au-delà de toute espérance.
La ligne de front passait alors par la province de Koursk, en direction de Korenevo et Dmitriev, un peu au sud du lieu où l’on m’envoyait. Cette mission me permettait de pénétrer dans la zone de front, pour tenter d’en traverser les lignes. C’est pourquoi, je me sentis au comble de l’allégresse quand, aux environs du 15/28 août, on me remit une attestation de l’administration des chemins de fer, au contenu à peu près suivant. « Le porteur de la présente, Vsévolod Alexandrovitch Krivochéiev (c’est ainsi qu’on avait modifié mon nom), ouvrier qualifié, a ordre de se rendre au hameau de Selino du district de Dmitriev de la province de Koursk pour procéder au recrutement de menuisiers spécialisés en vue de la construction d’un pont de chemin de fer en bois sur la rivière Mologa, près de la ville de Vesyegonsk. Cette voie ferrée étant d’une importance capitale stratégique et militaire, nous demandons la collaboration de toutes les administrations concernées afin de faciliter la tâche de l’ouvrier qualifié Krivochéiev. En tant qu’employé d’un chantier de haute importance stratégique, V. A. Krivochéiev est exempté de service dans l’Armée rouge. » Ce papier portait un tampon, et était signé de Boudassi. Mon compagnon P. reçut une attestation en tous points semblable (14).
Il était cependant indispensable, pour le succès de mon entreprise, d’en informer — fut-ce partiellement — mon compagnon de route. On m’avait assuré que P. était un homme sûr, que je pouvais lui faire confiance et qu’il ne me trahirait pas. Mais après en avoir discuté entre nous, nous décidâmes de ne pas avouer à P. que le but de mon voyage était de m’enrôler dans l’Armée blanche (ce qui aurait pu l’effrayer), mais de lui raconter que Boudassi m’envoyait faire un rapport à Tchaïev, son ancien « maître », sur l’état d’avancement des travaux. Il faut dire que P. avait été un employé de Tchaïev, et lui était personnellement dévoué comme à une sorte de « barine (15) ». Grâce à Tchaïev, il était devenu « quelqu’un », et était tout à fait disposé à assister une expédition de ce genre. De plus, il pensait probablement, lui aussi, que Tchaïev pouvait revenir un jour, et qu’il pouvait être avantageux de lui rendre service. Toujours est-il que P. se révéla un compagnon fidèle, toujours prêt à m’aider. Il m’était surtout précieux par les amis et parents qu’il avait dans la localité où nous nous rendions (16).
Ainsi, au soir du 17/30 août, ayant fait mes adieux à mon frère Igor (17), mon laissez-passer en poche, un imperméable Macintosh sur le dos, muni d’une valise de cuir et coiffé d’une casquette de cheminot, j’étais prêt à partir pour le sud, rejoindre les Blancs. Mon rêve le plus cher était en train de se réaliser, mais le plus dur et le plus pénible était encore à venir.
Je venais à peine d’avoir dix-neuf ans.
- Texte publié à compte d’auteur en 1975, puis édité dans. ARCHEVEQUE BASILE (KRIVOCHEINE), Vospominaniya. Pis’ma [Mémoires. Correspondance], Nijni-Novgorod, Éd. de la Fraternité-Saint-Alexandre-Nevski, 1998, p. 34-197 et dans. ARCHEVEQUE BASILE (KRIVOCHEINE), Spasenniy Bogom [Sauvé par Dieu], Saint-Pétersbourg, Éd. Satis, 2007 (texte de référence), p. 33-202 (NdR).
- Armée blanche. nom donné aux armées, formées après la révolution d’octobre 1917, qui combattirent l’Armée rouge durant la guerre civile russe de 1917 à 1921. Voir M. GREY et J. BOURDIER, Les Armées blanches, Paris, Stock, 1968 (NdR).
- Hetman ou Ataman (de l’allemand Hauptmann. chef). Appellation usitée dès le XVIe siècle en Russie, Pologne et Lituanie pour désigner un commandant d’armée cosaque. En avril-décembre 1918, le titre est porté par le chef du gouvernement ukrainien indépendant, P. Skoropadsky (NdR).
- « Tcheka » ou « Vetcheka ». acronyme pour « Commission extraordinaire panrusse pour la répression de la contre-révolution et du sabotage », police politique soviétique créée le 20 décembre 1917 (NdR).
- Le 17/30 juillet 1918 (NdR)
- Voir « Chapitre 1. Les journées de Février 1917 à Petrograd », n. 20 (NdR).
- Mon frère aîné Basile (né en 1892) mourut du typhus au Kouban dans les rangs de l’Armée des Volontaires, en février 1920. Mon frère Oleg (né en 1894) fut torturé et tué par les Rouges à peu près au même moment et au même endroit.
- Armée des Volontaires. l’une des premières armées blanches de la guerre civile russe, qui opéra principalement dans le sud-est de la Russie de 1918 à 1920 (NdR).
- Voir « Chapitre 1. Les journées de Février 1917 à Petrograd », n. 9 (NdR).
- Voir « Chapitre 1. Les journées de Février 1917 à Petrograd », n. 37 (NdR).
- Cyrille Alexandrovitch Krivochéine (1904-1977). Émigre avec sa mère en France en 1919, résistant durant la Seconde Guerre mondiale (NdR).
- Ancienne unité de mesure russe. 1 verste = 1066 mètres (NdR).
- Anton Ivanovitch Denikine (1872-1947), officier russe, commandant en chef des armées « blanches » durant la guerre civile russe. Commandant de front lors de la Première guerre mondiale, cofondateur de l’Armée des Volontaires (novembre 1917), succède au général Kornilov à la tête des forces armées blanches du sud de la Russie (avril 1918). En avril 1920, transmet ses pouvoirs au général Wrangel et émigre. Voir M. GREY, Mon père, le général Denikine, Paris, Perrin, 1985 (NdR).
- Dans les années 1920, les bolcheviks démontèrent eux-mêmes le tronçon achevé de Ovnichtchi-Souda, et en affectèrent les rails et autres matériaux à la construction du Turksib. Boudassi fut de nouveau nommé à la tête du chantier. On dit alors en plaisantant qu’il était à la tête d’une troupe ambulante de constructeurs ferroviaires.
- Barine (contraction de boyarine, boyard). seigneur, noble, propriétaire (NdR).
- Boudassi acquit par la suite une triste célébrité sur le chantier du canal mer Baltique-mer Blanche (Belomorkanal). Arrêté pour sabotage et envoyé sur le canal pour travailler à sa construction, il réussit à s’attirer les bonnes grâces des bolcheviks, en devançant les normes de construction aux dépens de la vie des détenus qui lui étaient subordonnés. Dans un livre consacré à la construction du canal et publié en 1934 à Moscou, on trouve un portrait de Boudassi, avec la légende suivante. « Il fut escroc, profiteur, spéculateur, etc., mais le travail socialiste le racheta, il se repentit, connut une seconde naissance, et devint un « héros du travail ». » Je lui conserve cependant ma reconnaissance, car c’est lui qui me permit de sortir de Russie soviétique.
- Un mois après mon départ, mon frère Igor réussissait lui aussi, et sans aventures particulières, à quitter Vesyegonsk pour rejoindre l’Armée des Volontaires.


Dans la Révolution et la guerre civile
Avant-propos de l’auteur (1)
Il n’est pas facile de raconter des événements vieux de plus d’un demi-siècle. Et si tout ce que j’ai vécu, vu et entendu à l’époque cruelle de la révolution et de la guerre civile en Russie a laissé une trace indélébile dans ma mémoire, le temps en a estompé certains éléments, noms et dates en particulier. Parfois aussi les expériences ultérieures d’une longue vie ont comme déteint sur les émotions et les sensations de cette lointaine époque. J’en suis très conscient, et cependant j’écris ces mémoires, même si le passé que j’y décris peut sembler très lointain, voire totalement étranger à ma vie actuelle, à mes domaines d’intérêt spirituels et intellectuels. J’écris car je ne peux pas ne pas écrire. J’ai besoin de dire ce que j’ai sur le cœur, car le passé — quoi qu’on en dise — reste vivant. Il m’a été donné de vivre bien des choses, et j’en ai à raconter. Ces choses ne relèvent pas, bien sûr, de la grande histoire ; j’étais bien jeune alors, et ma position était par trop insignifiante pour pouvoir prendre part aux événements historiques. Mais ce que j’ai vu, entendu et vécu, je vais essayer de le relater, si ce n’est objectivement, du moins de façon véridique et sincère, sans rien cacher, même si ce ne sera pas du goût de tous. Je vais raconter le mois de février (2) 1917 à Petrograd (3), les débuts de la révolution et un moment crucial de la guerre civile en Russie à l’automne 1919, des deux côtés du front. Je veux aussi révéler comment Dieu m’a — plus d’une fois — sauvé d’une mort qui semblait certaine.
Le seul ajout qu’il m’a paru opportun de faire à ces « Mémoires », ce sont des notes à caractère historique qui viennent apporter des éclaircissements sur les conditions dans lesquelles se sont déroulés les événements décrits, et facilitent la compréhension de mon récit (4).
Les journées de février 1917 à Petrograd (5)
Le jeudi 23 février (6) 1917, je rentrai de l’université vers quatre heures de l’après-midi. Notre appartement était situé au 36 de la rue Serguievskaya, presque au coin de la perspective Voskressenski. Malgré mon jeune âge, j’étais étudiant en première année à la faculté d’histoire et de philologie de l’université de Petrograd (7). D’après mes souvenirs, j’étais rentré ce jour-là à pied, ce que j’aimais faire de temps en temps, d’autant que les tramways étaient généralement bondés au point d’en devenir impraticables. C’était une journée ensoleillée, il ne faisait que quelques degrés au-dessous de zéro (8) et je ne remarquai rien de particulier en ville. De l’université à notre maison, il y en avait environ pour une heure de marche, cela m’avait fatigué, et je m’allongeai sur mon lit dans la chambre que je partageais avec mon frère aîné Igor (9), lieutenant dans l’artillerie montée de la Garde impériale. Il servait alors dans la batterie de réserve de Pavlovsk, mais ces jours-là, se trouvait en permission à Petrograd. Au moment dont je parle, il était sorti. J’étais allongé depuis une demi-heure, une heure peut-être (je ne saurais le dire avec certitude), quand ma tante Olga Vassilievna Krivochéine (10) fit irruption dans la pièce avec toute l’énergie qui la caractérisait, et s’écria. « Tu dors ? Comment peux-tu traîner au lit ? Tu ne sais donc pas ce qui se passe ? En ville, c’est la révolte, la révolution, et monsieur est au lit ! »
Ma tante avait coutume d’ironiser et de persifler. Et c’est exactement ce qu’elle était en train de faire à mes dépens. on se considère comme un grand « révolutionnaire » (c’est vrai que j’avais de tels sentiments à cette époque), mais le jour où la révolution se produit, on paresse, on se repose. En ce qui concernait ma tante, ses convictions n’étaient certes pas de gauche, mais elle ne me prenait pas au sérieux, et ne prêtait d’ailleurs pas grande importance aux désordres qui étaient en train de se produire en ville.
« Comment ? Quelle révolution ?, demandai-je, en bondissant hors de mon lit. J’étais en ville à l’instant, et je n’ai rien vu. » — « Mais c’est que tu ne remarques jamais rien, dit ma tante sur le même ton moqueur, en ville, c’est la révolte. Les cosaques (11) sont en train de se déployer sur la perspective Liteïny. Je viens de les voir de mes propres yeux. » Je m’habillai en hâte, et me dirigeai vers la porte. — « Dis-donc ! Où vas-tu ? Reste là ! Tu ne vas nulle part ! », s’écria ma tante en me voyant faire, et elle tenta de me retenir, mais je désobéis et sortis de la maison d’un pas rapide.
Je pris la rue Serguievskaya vers la droite en direction de la perspective Liteïny qui la croisait à environ dix minutes à pied [depuis ma maison]. La rue Serguievskaya n’était pas une rue particulièrement passante, mais elle semblait encore plus déserte que la normale. Je débouchai sur la Liteïny. Contrairement à ce qu’avait dit ma tante, je ne vis pas l’ombre d’un cosaque. Mais la perspective Liteïny, toujours si animée, semblait totalement abandonnée. Je fus surtout frappé par l’absence de tramways. Pas le moindre policier en vue, non plus. en principe il y en avait toujours un au coin de la perspective et de la rue Serguievskaya, mais maintenant il n’y avait personne. Tout cela suscitait un sentiment trouble et inquiétant, même s’il n’y avait pas d’autre signe évident de révolte ou de révolution ; j’étais déçu. « Je me suis déplacé pour rien », me dis-je. Je restai planté là quelques minutes, et m’apprêtais à rentrer chez moi, mais décidai finalement de remonter un peu plus la rue Serguievskaya pour voir ce qui se passait dans le quartier. Au coin de cette rue et de la perspective, en direction du Jardin d’Été, se dressait à l’époque l’usine Liteïny, une grosse fabrique d’armement. J’en longeai le mur par la rue Serguievskaya, sur laquelle donnaient les grandes portes en bois de l’usine. Et juste à ce moment-là, les battants s’ouvrirent et déversèrent une foule dense d’ouvriers, parmi lesquels beaucoup d’hommes barbus d’âge moyen ou d’âge mûr. Ils avançaient en silence, sans échanger le moindre mot. Ils avaient l’air sérieux, décidé et presque sombre, me sembla-t-il. Ils sortaient de l’usine en un flot constant, puis se dispersaient dans les rues avoisinantes, sans s’attarder. Qu’était-ce ? La fin de leur journée de travail ? La relève ? Ou le début d’une grève (12) ? — me demandai-je. Je rebroussai chemin vers la Liteïny. Toujours aussi déserte, toujours pas de policier. Soudain, je remarquai, le long de la perspective Liteïny, un détachement de cosaques à cheval, une quinzaine d’hommes qui s’avançaient depuis la perspective Nevski. Ils marchaient au pas, et lorsqu’ils eurent atteint la rue Serguievskaya, ils tournèrent, puis s’arrêtèrent. Le soir tombait. Les cosaques descendirent de cheval, déposèrent leurs fusils et entreprirent d’allumer un feu de camp au beau milieu de la rue. Apparemment, ils s’apprêtaient à bivouaquer. Je rentrai chez moi.
Le jour suivant, vendredi 24 février (13), je quittai la maison vers neuf heures du matin en déclarant que j’allais à l’université comme d’habitude. C’était la vérité et j’avais bien l’intention d’y aller, mais avant tout je voulais voir ce qui se passait en ville, et peut-être même participer d’une façon ou l’autre aux événements. Je pensais qu’à l’université j’apprendrais du nouveau, qu’il y aurait certainement un meeting d’étudiants auquel il serait intéressant d’assister. Comme beaucoup d’autres, sans doute, je ne me rendais pas compte du sérieux des événements qui se préparaient en Russie. Il s’avéra cependant impossible d’atteindre l’université. Arrivé à la Liteïny, je constatai qu’il n’y avait pas plus de policiers ni de tramways en circulation que la veille. Il y avait beaucoup de monde sur la perspective, les gens marchaient en direction de la perspective Nevski. Ils allaient en grands groupes, silencieux, marchant sur les trottoirs, mais débordant de plus en plus sur la chaussée. En travers de celle-ci, j’aperçus bientôt des détachements de cosaques à cheval de plusieurs dizaines d’hommes chacun, ainsi que des détachements, moins nombreux, de police montée en capotes grises. À la vue des cosaques, la foule tressaillit et hésita, mais constatant que les cosaques restaient au milieu de la rue et ne s’en prenaient à personne, s’enhardit et reprit sa marche.
Une sorte de procession continue s’était formée, il y avait des milliers de personnes, ouvriers pour la plupart, mais aussi beaucoup d’étudiants. On entendait çà et là des chants révolutionnaires. Les cosaques avaient, manifestement, reçu l’ordre de disperser la foule. Ils partirent au galop sur la large perspective Liteïny, en brandissant leurs fouets. La foule eut à nouveau un mouvement de recul, mais voyant que les cosaques ne les touchaient pas, se contentant de passer au galop sur la chaussée, les gens reprirent à nouveau courage. On entendit des cris joyeux. « Les cosaques avec nous ! » et même. « Vivent les cosaques ! ». Aux policiers, on criait par contre. « Pharaons (14) ! Pharaons ! À bas les pharaons ! »
Ces cris devinrent en quelque sorte les slogans de la révolution. Il semblait cependant que la route vers la perspective Nevski était coupée par des barrages de cosaques ou de policiers à la hauteur de la rue Basseïnaya, et la foule (ou du moins le groupe dans lequel je me trouvais) tourna à droite, et reprit son avancée vers la perspective en direction de la cathédrale Notre-Dame-de-Kazan. Soudain, avec des cris et des hululements, les cosaques nous chargèrent. La foule se mit à courir et fut acculée aux pieds des maisons, mais on comprit rapidement que les cosaques ne fouettaient pas vraiment les gens, se contentant de faire claquer leurs fouets en l’air. De nouveau, la panique céda la place à un sentiment de victoire. « Vivent les cosaques ! » criait la foule.
Puis il y eut cette autre scène. Cette fois, c’est un détachement de policiers montés qui fondit sur une foule de plusieurs centaines de personnes. Les policiers étaient très peu nombreux, cinq à dix personnes tout au plus, mais la foule néanmoins s’enfuit, et acculée aux murs, se recroquevilla pour ne se présenter que de dos aux policiers qui cravachaient ceux qui se trouvaient à leur portée. Je me souviens d’un petit étudiant, couché non loin de moi. Un policier fouettait son dos avec zèle, le visage de l’étudiant exprimait clairement la panique et la peur, mais certainement pas la douleur. Et en effet, il me confirma par la suite que le policier avait retenu ses coups.
La répression policière fut cependant de courte durée. Surgis d’on ne sait où, les cosaques que nous avions vus auparavant se mirent à fouetter les policiers ! Et ceux-ci disparurent aussitôt. Nouveaux cris de victoire, les jeunes cosaques souriaient, contents d’eux-mêmes. La foule parvint finalement à atteindre la perspective Nevski, où elle se joignit à une autre foule qui avait envahi toute la perspective. On commença les meetings, les discours d’orateurs, mais les émeutiers ne purent, ce jour-là, arriver jusqu’à la place de la cathédrale Notre-Dame-de-Kazan. Il faut avouer cependant que les événements de cette journée chargée se mêlent quelque peu dans ma mémoire à ceux qui eurent lieu le lendemain sur la même perspective Nevski. Essayer d’atteindre l’université à travers la cohue de la perspective Nevski semblait insensé, et de toute façon il m’avait fallu de longues heures pour arriver jusqu’à la perspective, où j’étais resté assez longtemps. Fatigué, affamé (je n’avais rien mangé de la journée), je rentrai à la maison en fin d’après-midi. La perspective Liteïny que je pris pour rentrer était maintenant quasi déserte. Apparemment, tout le monde était massé sur la perspective Nevski, mais on peut aussi supposer que certains étaient rentrés chez eux. J’étais troublé, accablé, mais plus que tout je me sentais épuisé.
Le jour suivant, samedi 25 février (15), je quittai de nouveau la maison dès le matin en direction de la perspective Nevski, pour ensuite, si possible, continuer de là jusqu’à l’université. Je ne me rappelle pas des détails, mais globalement la situation était pareille à celle de la veille. Personne dans la rue Serguievskaya, mais une multitude de gens sur la Liteïny, se dirigeant vers la perspective Nevski. Ni tramways, ni policiers, de nombreux magasins et échoppes fermés, aucun journal en vente (ils avaient cessé de paraître depuis les premiers incidents). De plus, contrairement à la veille, il n’y avait pas trace des cosaques ni de la police montée. Ils avaient vraisemblablement été redéployés autour de la perspective Nevski, et la foule avançait donc sans obstacles. Sur la perspective même, près de la cathédrale Notre-Dame-de-Kazan, était rassemblée une quantité innombrable de gens. Il y avait plusieurs dizaines de milliers de personnes, je ne saurais être plus précis. Des drapeaux rouges firent leur apparition pour la première fois (ou alors ne les avais-je pas remarqués la veille ?). Ils étaient étranges, de petite taille, « portatifs », on pouvait facilement les cacher dans sa poche. Certains étaient fixés sur des petits bâtons. Ils étaient brandis au-dessus de la foule par des personnes qui criaient des slogans révolutionnaires. « À bas le gouvernement ! À bas l’autocratie ! À bas les pharaons ! » Ces cris étaient parfois accompagnés d’un autre, moins assuré. « À bas la guerre ! »
Il était évident que, contrairement à la veille, il y avait aujourd’hui dans la foule des agitateurs et révolutionnaires « professionnels », qui cherchaient à canaliser à leurs propres fins les masses révoltées. Dans leur très large majorité, ces masses étaient composées du petit peuple citadin, des ouvriers principalement, d’âges divers. Mais on voyait aussi de nombreux étudiants, reconnaissables à la casquette de leur uniforme. La foule était presque exclusivement masculine, il n’y avait quasiment pas de femmes du peuple, mais il y avait un certain nombre d’étudiantes. Les étudiants se mirent à « fraterniser » démonstrativement avec les ouvriers (ce qui, malgré mes convictions « de gauche », me sembla du sentimentalisme artificiel). Un ouvrier par exemple prit la casquette d’un étudiant, la mit sur sa tête, et lui donna en échange sa casquette d’ouvrier. « Vivent les étudiants, ils sont toujours avec le peuple ! » cria une voix dans la foule. Plus loin, un jeune gars, probablement un apprenti, beau garçon à l’air vulgaire, ayant pris le bras d’une jeune étudiante bien en chair, au visage agréable, qui portait une pelisse et des vêtements bien coupés, marchait ainsi avec elle en clamant à la cantonade. « Vous ne pouvez pas vous imaginer comme je me sens plein de force. Si on m’en donnait la possibilité, par le diable, j’en ferais des choses ! Mais je ne peux pas ! L’autocratie et les capitalistes nous étouffent, nous écrasent. Nous sommes les esclaves du capital. Sinon, par le diable, je serais capable de faire de ces choses ! ». Il répéta ainsi de nombreuses fois son invocation « diabolique ». Je voyais que l’étudiante écoutait ces déclarations avec une certaine gêne (il n’était visiblement pas dans ses habitudes de se promener dans les rues au bras d’un apprenti), mais elle était fière de servir ainsi la révolution.
Puis un meeting s’organisa, grandiose, une véritable mer de têtes. Un orateur se hissa sur un support en hauteur et se lança dans un discours. c’était un homme d’une quarantaine d’années en manteau brunâtre, la barbe ébouriffée, l’air plutôt russe quoique très brun. Il parlait sans hésitation, ses paroles semblaient couler d’elles-mêmes, c’était manifestement un orateur confirmé. Son discours était haineux, maussade, au début sans passion ni flamme particulière, mais à la fin, il parvint habilement à galvaniser la foule. La première partie de son discours avait pour thème. « À bas l’autocratie ! », la deuxième. « À bas la guerre ! » Il répéta ces slogans durant tout son discours. La foule lui répondait par des hurlements d’approbation, des applaudissements, mais il faut souligner que le slogan. « À bas l’autocratie ! » rencontrait un succès bien supérieur à celui de. « À bas la guerre ! » Ce dernier slogan était trop inhabituel, on sentait qu’il ne correspondait pas exactement aux aspirations de la majorité.
Soudain, il y eut comme un moment de confusion, un mouvement dans la foule. On entendit des cris. « Un provocateur ! Un provocateur ! On a attrapé un provocateur ! » En fait, d’après la foule du moins — personnellement, je n’avais rien pu voir en raison du monde —, quelqu’un avait essayé de photographier l’orateur avec un appareil photographique miniature. On l’avait surpris, on lui avait arraché l’appareil des mains pour le réduire en morceaux ; quant au « provocateur », il succomba à la justice populaire. Il fut tué ! « Ça fait longtemps qu’on le connaît, il est connu », criait-on dans la foule. Peu après, nouvelle scène de meurtre. Non loin de moi, je vois une mêlée, un homme est en train de se faire rouer de coups, mais d’autres crient. « Ne le tuez pas ! Ne le tuez pas ! Il ne faut tuer personne ! » Les opinions se divisent. Je m’approche. Sur le sol, je vois un officier de police en capote d’uniforme, mort. Un commissaire ou un inspecteur, je ne connais pas grand-chose à ces grades. Son visage est jeune, blême et verdâtre. Il a les yeux clos. De sa tempe coule un filet de sang, de son nez aussi, de sa bouche ouverte, de la salive. Ses traits expriment la souffrance et la douleur. On voit qu’il a été battu à mort. C’est la première fois que je vois un tué. Mais comment a-t-il pu se trouver ainsi en uniforme, seul, dans une foule révoltée de plusieurs milliers de personnes ? On me dit qu’il avait l’intention d’arrêter l’orateur. C’est assez difficile à croire. On emporta le corps.
La foule avance sur la perspective Nevski, en direction de la gare Nicolaïevski (16). Cette fois personne ne lui barre la route. Il y a de plus en plus de drapeaux rouges. On voit apparaître de grandes banderoles rouges, portant les slogans habituels. « À bas l’autocratie ! », « À bas la guerre ! » La foule recouvre presque toute la largeur de la perspective Nevski, et s’étend loin à l’horizon. Mais toutes les personnes présentes ne marchent pas avec la procession. Il y a beaucoup de monde sur les trottoirs. Surtout des gens de l’intelligentsia, « correctement » habillés, mais pas seulement. il y a aussi des gens simples, de petites gens de Petrograd, des employés, des commerçants… Ils se tiennent immobiles, silencieux, le visage tourné vers la foule. L’air attentif, sérieux, ils la regardent passer mais n’expriment aucune opinion, ni approbation, ni réprobation. Ce qui irrite les manifestants. « Qu’est-ce que vous faites sur le trottoir, leur crie-t-on de la foule, descendez, venez nous rejoindre ! » Mais les gens du trottoir ne réagissent en aucune manière. Les cris dans la foule reprennent de plus belle. « Descendez des trottoirs, bourgeois ! Descendez des trottoirs ! » Mais les gens des trottoirs ne bougent pas et, l’air maussade, continuent à regarder les manifestants. Manifestement, les exhortations ne les impressionnent pas.
La foule poursuit son chemin. Nous passons devant le siège du Jour, journal de Petrograd le plus à gauche, parmi les périodiques autorisés. Les employés du journal, une quinzaine de personnes, sont massés sur le balcon du premier étage. Ils agitent des mouchoirs, des chiffons noirs ; apparemment, ils n’avaient pas prévu de drapeaux rouges. Ils acclament les manifestants. En réponse, quelques rares. « Vive le journal Le Jour ! » (le journal n’avait pas les faveurs des bolcheviks. Il était de tendance menchevik).
J’entends des conversations absurdes, je suis frappé par l’ignorance qu’elles dénotent (et ce, malgré ma sympathie pour les événements en cours). « Maintenant, aucun bourgeois ne sortira dans la rue sans un revolver en poche. » Ou alors. « La guerre, ça ne fait qu’enrichir les bourgeois. Le moindre épicier empoche plus de 800% de bénéfice sur sa marchandise. » Mais on entend aussi des remarques plus sensées. Un vieil ouvrier au visage intelligent, un type bien — cela se voit tout de suite — dit. « À mon avis, les Allemands avec leur Guillaume doivent être bien contents de ce qui se passe ici. Cela les arrange bien. Ce n’est pas bien d’organiser des manifestations pendant la guerre. Mais on n’y peut rien. C’est la faute de tous ces Stürmer (17) si on en est là. On ne peut leur confier la conduite de cette guerre (18) ! » Nous approchons de la place Znamenski en face de la gare Nicolaïevski. Du côté de la perspective Ligovka passe une unité d’infanterie, fusil en bandoulière, équipement de campagne au dos. Ils marchent en rang vers la gare. À leurs côtés, des officiers. Ce sont des recrues sur le point d’embarquer pour le front. Tous sont d’âge mûr, beaucoup portent la barbe. Des agitateurs dans la foule essaient sur eux leur propagande, les interpellent. « À bas la guerre ! », mais les soldats ne leur prêtent aucune attention. En silence, toujours en rang, ils poursuivent leur chemin.
Il était environ trois heures de l’après-midi. La foule s’était arrêtée sur la place Znamenski. Un nouveau meeting commença. Les orateurs se juchèrent sur le piédestal du monument à Alexandre III, et de là par des discours enflammés s’efforcèrent de galvaniser la population. Je les entendais à peine, mais il s’agissait apparemment des thèmes révolutionnaires habituels. Soudain, sans crier gare, sortis de Dieu sait où (probablement de la rue Znamenskaya), surgirent cinq ou six policiers à cheval brandissant des sabres dénudés et chargèrent au galop les orateurs qui se tenaient près du monument. Je revois encore clairement l’un des policiers, probablement leur chef, son sabre levé très haut au-dessus de sa tête. Une panique indescriptible s’empara de la foule. « Ils sabrent ! Ils sabrent ! », entendit-on. On courut se réfugier dans les rues attenantes à la place et à la perspective Nevski, la rue Znamenskaya entre autres. C’est là que je courus également.
Je dois dire que je partageais tout à fait la panique générale. Ce n’était pas tant la peur de mourir que la conscience de l’absurdité et de l’inutilité de mourir ainsi sans trop savoir pourquoi. Ou plutôt pour rien ! Il n’y avait là rien qui justifie le sacrifice d’une vie, une mort héroïque. Je ressentais cela de tout mon être — consciemment ou inconsciemment, je n’en sais trop rien — mais avec une force invincible. C’est pourquoi je courus avec les autres et me retrouvai dans la rue Znamenskaya. Là je m’arrêtai, et vis que les autres s’arrêtaient aussi. À ce moment là (ou peut-être pendant que je courais), nous entendîmes, provenant de la place, une clameur de triomphe, puis les cris d’une foule en liesse. Il s’était produit quelque chose d’imprévu. Nous rebroussâmes chemin vers la place, d’abord timidement, puis d’un pas plus assuré. On me dit (je n’avais rien vu), qu’un cosaque avait bondi vers l’un des policiers à cheval, et l’avait abattu d’un coup de feu. Les autres policiers s’étaient enfuis. C’était une victoire pour la révolution !
Peu après, fatigué, je rentrai chez moi par la rue Znamenskaya, ce qui faisait une demi-heure de marche. Ce jour là, je ne ressortis plus. La situation en ville semblait toujours aussi confuse, il n’y avait encore eu aucun affrontement sérieux avec les forces armées gouvernementales, à l’exception des cosaques qui ne manifestaient pas un grand désir d’en découdre, que du contraire. Les événements étaient impressionnants par leur ampleur et par leur tournure, chaque jour plus menaçante, mais il était difficile d’imaginer une victoire des masses révoltées. Cela paraissait invraisemblable. La foule était bien trop timorée, elle cédait trop facilement à la panique.
Le jour suivant, le 26 février (19), était un dimanche. Mon père Alexandre Vassilievitch Krivochéine (20) était alors rentré de Minsk, car le lundi 27 février (21), était prévue une session de la Douma et du Conseil d’État (22). Après son départ du poste de ministre de l’Agriculture, mon père servait sur le front occidental en tant que représentant de la Croix-Rouge, et était membre ex officio du Conseil d’État. Un dimanche matin, je ne pouvais sortir de la maison en invoquant le prétexte de l’université, et je dus rester à la maison jusqu’au déjeuner, vers une heure. Nous déjeunâmes en famille, dans une atmosphère tendue, nous parlions très peu, mais je pense qu’aucun de nous n’avait encore compris que nous étions à la veille d’événements qui allaient bouleverser toute la Russie. Vers deux heures, je sortis néanmoins de chez moi et me dirigeai comme les jours précédents vers la Liteïny et la perspective Nevski. C’était toujours le même tableau. Ni police, ni tramways, ni armée (23). Seul élément nouveau, des affiches étaient placardées sur les maisons, portant la signature de Khabalov (24), le commandant militaire, qui informaient la population qu’ « en raison de la persistance des troubles à l’ordre public, l’état d’urgence est déclaré à Petrograd (ou était-ce l’état de siège ? — je ne me rappelle plus exactement). Manifestations et attroupements sont interdits ; en cas de désobéissance, l’armée a l’ordre d’ouvrir le feu. »
Je ne me souviens pas bien de mon trajet jusqu’à la perspective Nevski, n’ayant rien remarqué de particulier, ni manifestation ni cortège. Mais sur la perspective, la population était à nouveau en train d’affluer en masse, même si cette foule me sembla plus clairsemée que les jours précédents.
Peut-être le décret de général Khabalov en avait-il dissuadé quelques-uns. Un cortège assez imposant se forma néanmoins qui s’ébranla de la cathédrale Notre-Dame-de-Kazan en direction de la gare Nicolaïevski. Il devait être trois heures de l’après-midi. Soudain, de façon tout à fait inattendue (en tous cas pour moi et pour ceux qui se trouvaient autour de moi), on entendit, près de la place Alexandrovski et du monument à Catherine II, une fusillade assez nourrie. L’on ne voyait pas les tireurs, et j’ignore qui ils étaient. Le bruit courut par la suite qu’il s’agissait des soldats du régiment Pavlovski (25). Aux premiers coups de feu, la foule reflua depuis la perspective Nevski vers la petite rue qui longe le jardin où se dresse le monument à Catherine, en direction du théâtre Aleksandrinski. La fusillade dura cinq à dix minutes, et j’avais l’impression qu’on tirait sur les manifestants en fuite. Mais bizarrement, non seulement on ne voyait ni tués ni blessés, mais on n’entendait pas non plus de balles siffler ou percuter la chaussée, ce qui semblait indiquer que l’on tirait à blanc. Ou peut-être en l’air. La foule finit par s’en apercevoir. Jusque-là tout le monde courait et, quand la fusillade devenait plus nourrie, se couchait sur le trottoir le long des grilles du jardin avant de reprendre sa course. Mais voyant qu’il n’y avait pas de morts, les gens se redressèrent et cessèrent de courir, pressés seulement de se disperser et se mettre à l’abri. La petite rue se trouva soudainement désertée.
À cet instant, je fus abordé par un étudiant juif que je ne connaissais pas. « Collègue, dit-il, voyant mon émotion, ces gredins vous ont fait peur. Ils tirent sur la foule ! Vous habitez loin, peut-être ? » Je répondis que j’habitais rue Serguievskaya. « C’est loin, dit l’étudiant, venez chez moi, j’habite tout près. Nous attendrons que les choses se calment, et si vous le voulez, vous pourrez passer la nuit chez moi. » — « Non, je dois être chez moi ce soir », répondis-je, mais j’acceptai finalement son offre de nous rendre chez lui, sans grand enthousiasme, il est vrai, car la fusillade ayant cessé, je ne voyais pas la nécessité d’une telle invitation.
L’étudiant habitait dans le quartier, dans une rue près de la Sadovaya. Nous pénétrâmes dans une grande pièce au premier étage, pleine d’un fouillis de meubles et d’objets. Je crois me souvenir qu’il y avait une table au milieu. D’autres gens arrivaient et nous fûmes bientôt une dizaine de personnes, tous étudiants, dont trois femmes. Tous étaient juifs, cela se voyait autant à leur physique qu’à leur façon de parler. Ils étaient tous de tendance révolutionnaire, mais néanmoins assez oppressés par les événements. Il y avait parmi eux deux ou trois personnes d’une trentaine d’années, les autres étaient plus jeunes. Mon compagnon me présenta : « Je viens avec un camarade, il a bien failli se faire fusiller dans la rue. »Je fus accueilli aimablement, quoiqu’avec retenue. La conversation se concentra naturellement sur les événements du jour, et le fait que l’on venait de tirer sur la foule. L’un d’eux dit. « Il paraît que Nicolas II a pris peur et a filé au quartier général (26). » « Oui, reprit un autre, mais avant de partir, il a donné l’ordre de tirer (27), et regardez le résultat ! Il a suffi de quelques coups de feu pour disperser tout le monde ! » Quelqu’un essaya de protester. « Oui, mais demain tout peut recommencer. »
« Non, non ! », dirent-ils tous. « La révolution est vaincue. Demain, tout sera rentré dans l’ordre, personne ne descendra plus dans la rue. » — « Personne n’aurait cru que Nicolas oserait tirer sur le peuple. Eh bien il a osé, et tout le monde s’est enfui ! » — « Il ne fallait pas se lancer dans cette aventure, puisque le peuple est incapable de faire une révolution. L’autocratie n’en sortira que renforcée. »
On se mit à parler des sionistes. L’on en disait le plus grand mal, les traitait de traîtres, s’indignant de leur refus de participer au mouvement révolutionnaire. « J’ai rencontré Gricha (28), racontait l’un des juifs, vous savez, le fils à sa maman, le sioniste. Il me dit. « Cette révolution ne nous concerne pas, nous les juifs, puisque nous ne sommes pas Russes. » Le misérable ! » En dépit de la présence des femmes, quelqu’un se mit à raconter des histoires grivoises. Mais on le fit taire, peut-être à cause de ma présence. Ils sentaient que je n’étais pas de leur milieu. Quant à moi, j’étais frappé par le faible niveau culturel de ces étudiants, par leur manque d’information.
Ayant passé quelques heures en leur compagnie, fatigué par ces conversations et la tête alourdie par la fumée de leurs cigarettes, je décidai de rentrer chez moi. L’étudiant qui m’avait amené ici, le plus sympathique de tous, essaya de m’en dissuader, mais je ne me laissai pas convaincre, et après l’avoir remercié pour son hospitalité, je me retrouvai dans la rue. Il devait être neuf heures du soir. Le temps avait changé. Les jours précédents, il avait fait plutôt bon, autour de zéro degrés, avec un ciel couvert, sans neige. Mais soudain, il avait gelé. Par des rues totalement désertes, j’atteignis rapidement la perspective Nevski à la hauteur de la rue Nadejdinskaya. Là, je tombai sur un obstacle. Disposée en deux rangs au beau milieu de la perspective, se tenait une troupe. Les rangs étaient si serrés qu’il était impossible de les traverser. Des feux de camp flambaient à intervalles réguliers, leurs flammes rougeoyantes éclairant les rangs de soldats. Des officiers passaient devant les rangs. Des civils étaient rassemblés en petits groupes sur le trottoir, et on les entendait crier. « À bas l’officier ! » Je me souviens d’un officier qui faisait les cent pas sans prêter la moindre attention à ces cris. Mais un autre, en entendant les mêmes cris, se retourna brusquement. Le petit groupe de civils sursauta et eut un mouvement de recul.
Pour rentrer chez moi, il me fallait traverser la perspective Nevski, et je tentai de passer à travers les rangs de soldats, mais on ne me laissa pas faire, exigeant une autorisation. Je m’adressai à l’officier le plus proche, lui expliquant que je désirais rentrer chez moi. Il me donna l’autorisation nécessaire, je passai entre les soldats, ce qui ne fut pas aisé. Je dus me faufiler à travers leurs rangs, tant ils étaient serrés. Une demi-heure plus tard, j’étais rentré chez moi, sans avoir rencontré âme qui vive sur mon chemin. À la maison, j’appris qu’un bataillon du régiment Pavlovski s’était révolté (29), mais que la mutinerie avait été écrasée par d’autres unités du même régiment, que les instigateurs de la révolte avaient été arrêtés et qu’ils allaient passer en cour martiale.
Le lendemain, lundi 27 février (30), je sortis de chez moi vers neuf ou dix heures du matin. Igor, mon frère officier qui se trouvait à ce moment-là en permission, sortit avec moi. Je ne sais pas pourquoi il était sorti, mais nous prîmes ensemble la rue Serguievskaya en direction du jardin de Tauride. Ayant traversé la rue Serguievskaya, nous parvînmes au coin tout proche de la perspective Voskressenski. Et là, au coin de la rue Serguievskaya et de la perspective Voskressenski, nous entendîmes des hurlements ou plutôt une clameur insistante provenant apparemment de la rue Kirotchnaya. On entendait de loin des cris émis — à ce qu’il semblait — par des centaines ou des milliers de gorges. C’était une clameur prolongée, ininterrompue, qui tantôt se renforçait tantôt faiblissait. C’était des hommes qui criaient, et pourtant leurs cris étaient aigus, éperdus, déchirants, pouvant aussi bien exprimer la joie que l’exaspération. Et cela durait, durait. « Qu’est-ce que cela peut être ? Qui crie ainsi et pourquoi ? », nous demandions-nous avec mon frère.
À ce moment-là, un jeune sous-officier, grand, le visage avenant, s’approcha de mon frère. Avec prestance, il se mit au garde-à-vous, claqua des talons et salua mon frère en disant. « N’allez pas là-bas, Votre Noblesse (31) ! C’est le régiment de Volhynie qui s’est révolté rue Kirotchnaya (32). On pourrait vous tuer ! » Sa voix était pleine de sollicitude et d’inquiétude pour la vie d’un officier qu’il ne connaissait pourtant pas personnellement. Nous savions maintenant ce que signifiaient les cris en provenance de la rue Kirotchnaya. Mon frère blêmit, mais conserva son sang-froid. Sur son visage apparut un mélange de tristesse et de douleur, comme s’il voyait périr sous ses yeux quelque chose qui lui était cher. Il remercia le sous-officier et rebroussa chemin. Je voulais, quant à moi, poursuivre ma route, mais mon frère exigea que je rentre à la maison. Ni lui ni moi ne nous attendions à une mutinerie dans l’armée, et avions peine à y croire ! Mais, contrairement à mon frère, j’en éprouvai de la joie. C’était enfin la vraie révolution russe qui commençait. Et cette perspective me semblait alors excitante, envoûtante. L’atmosphère à Petrograd avait réellement été cauchemardesque, ces derniers temps, et c’est avec impatience que l’on attendait un changement radical, une solution. C’est impossible à comprendre pour celui qui n’a pas connu Petrograd à ce moment-là. Arrivait ce qui devait arriver, et on ne change pas le passé ni ses conséquences, mais l’histoire se déroulait devant mes yeux.
Mon père m’interdit sévèrement de sortir de la maison. Quelques heures plus tard, je voulus sortir à nouveau, mais ma tante me surprit et alla en prévenir mon père. Aucun de nous n’aurait jamais envisagé de désobéir à mon père, je restai donc à la maison deux jours d’affilée et ne vis pas de mes propres yeux les développements ultérieurs de la révolution. Je pourrais terminer ici mon récit, mais j’y ajouterai néanmoins quelques petits faits dont je fus malgré tout témoin.
À un moment, par les fenêtres de notre appartement qui donnaient sur la rue Serguievskaya, nous entendîmes la rumeur de nombreuses voix. Nous nous précipitâmes aux fenêtres malgré les protestations de notre vieille femme de chambre qui me tirait en arrière en disant. « Ne regardez pas ! S’ils vous voient à la fenêtre, ils tireront, et vous tueront ! Ils sont capables de tout ! Ces émeutiers ont perdu tout sentiment humain ! »
Je vis en effet un groupe de cent cinquante à deux cents soldats qui marchaient en désordre en direction du Liteïny. C’était apparemment le régiment révolté de Volhynie, ou du moins une partie de celui-ci. Fusil en bandoulière, en désordre et sans officiers, les soldats marchaient en foule au beau milieu de la rue, parlant fort et s’arrêtant de temps à autre. Enfin, quelqu’un cria. « En avant ! » et ils se mirent en route dans la rue Serguievskaya. Mais très vite, on cria. « Demi-tour ! » et la horde de soldats reflua pour disparaître au coin de la perspective Voskressenski.
Le plus frappant dans tout cela était l’absence totale de réaction de la part des forces gouvernementales. « Je vois la révolution, mais je ne vois pas de contre-révolution », fit remarquer mon père, alors qu’il regardait par la fenêtre les soldats mutins.
Ces jours-là, il se mit à neiger de petits flocons serrés sur Petrograd. Arriva alors le ministre de l’Agriculture Rittich (33), un proche de mon père et l’un de ses anciens collaborateurs. Il n’avait pas pu atteindre son ministère, et venait chez nous dans l’espoir de joindre les institutions gouvernementales par téléphone pour obtenir des éclaircissements sur la situation et tenter, d’une façon ou l’autre, d’organiser une résistance. Malgré la révolution, le téléphone fonctionnait quasi normalement, mais toutes ses tentatives demeurèrent vaines. Selon les endroits, on lui répondait qu’il n’y avait personne, ailleurs le téléphone sonnait sans réponse, ailleurs encore des « comités (34) » avaient déjà été formés. Bredouille, Rittich ne tarda pas à s’en aller. Il était indigné de la déliquescence si rapide du gouvernement, de l’incompétence et la veulerie des dirigeants tant civils que militaires.
Bientôt, nous vîmes arriver des réfugiés d’un genre particulier, qui pensaient trouver dans notre appartement un refuge sûr. En réalité, cela faisait plus d’un an et demi que mon père avait quitté son poste de ministre de l’Agriculture et n’était plus au pouvoir, mais on avait regretté son départ car l’opinion publique l’appréciait. Et comme il ne faisait pas figure d’ « odieux personnage », de nombreuses personnes se sentaient en sécurité chez nous. Bien sûr, c’était là pure illusion de leur part.
Le premier à venir ainsi fut le baron Romain Disterlo (35), ami de mon père, membre du Conseil d’État aux opinions résolument conservatrices. Mon père l’accueillit volontiers, mais, pointant du doigt la rue où déambulaient des soldats en armes, lui dit. « Voyez à quoi nous ont mené vos mesures insensées et votre opposition aux réformes nécessaires pour la Russie. Vous êtes responsables de ce qui est en train de se passer ! » Le baron Disterlo ne répondit pas. C’était un homme intelligent, et il comprenait que la remarque de mon père était fondée. Mais si la visite du baron Disterlo était compréhensible (malgré leurs divergences, mon père et lui étaient amis), celle de l’ancien Premier ministre A. Trepov (36) fut, en revanche, tout à fait inattendue. Il n’était absolument pas proche de mon père, et en politique, ils étaient même opposés. Cela révéla un intéressant trait de son caractère. Lorsqu’il était au pouvoir, et toute sa vie au demeurant, Trepov avait été partisan des mesures les plus brutales et définitives, mais à peine la révolution s’était-elle déclarée, qu’il prit terriblement peur, et n’envisagea pas une seconde d’y opposer la moindre résistance. Il était trop absorbé par le problème de sa sécurité personnelle et passa quelques jours chez nous !
Pendant cette journée, on n’entendit presque pas de coups de feu, et nous ne savions pas exactement ce qui se passait en ville. Dans l’après-midi, nous aperçûmes dans le ciel des nuages de fumée noire. Comme nous devions l’apprendre par la suite, c’était le tribunal municipal sur le Liteïny qui brûlait, non loin de chez nous. Le soir, on sonna à notre porte. Un détachement de soldats armés — composé de cinq à six personnes sous les ordres d’un civil — fit irruption dans notre appartement. « Il paraît qu’il y a un officier chez vous, nous dirent-ils, nous devons le voir, vérifier s’il est en possession d’une arme, car quelqu’un est en train de tirer à la mitrailleuse du toit de votre maison. » Bien sûr, c’était un pur mensonge, personne ne tirait à la mitrailleuse. Ils demandèrent à voir notre frère Igor. Notre mère Hélène Guennadievna (37) fut prise de panique. « Vous allez le tuer ! », s’exclama-t-elle. — « Mais non, ne vous inquiétez pas, répondit le civil, nous voulons seulement vérifier qu’il n’a pas d’arme. »
Mon frère était dans notre chambre. Nos visiteurs lui demandèrent de rendre ses armes. Mon frère blêmit, serra les dents, mais rendit son revolver. Il eût été insensé de résister. Il n’avait pas d’autre arme. Les soldats se mirent à discuter pour savoir s’ils devaient ou non emmener mon frère avec eux, mais l’avis qu’il fallait le laisser ici l’emporta. Les soldats repartirent. Il est probable qu’ils avaient été intimidés par la présence de ma mère.
J’atteins la fin de mon récit. Raconter des événements dont je n’ai pas été le témoin direct n’aurait aucun sens. D’ailleurs les journées de février étaient terminées, on était en mars (38).
- Rédigé en 1975 par l’auteur comme avant-propos au récit « L’année 1919 » dans ARCHEVEQUE BASILE (KRIVOCHEINE), Vospominaniya. Pis’ma [Mémoires. Correspondance], Nijni-Novgorod, Éd. de la Fraternité Saint-Alexandre-Nevski, 1998, p. 32-33, et repris comme avant-propos général dans ARCHEVEQUE BASILE (KRIVOCHEINE), Spasenniy Bogom [Sauvé par Dieu], Saint-Pétersbourg, Éd. Satis, 2007, p. 10-11 (texte de référence).
- Dans le récit « Les journées de février 1917 à Petrograd », les dates sont données en calendrier julien (utilisé par l’État russe jusqu’au 28 février 1918 et par l’Église orthodoxe russe jusqu’à nos jours), qui accuse un retard de treize jours sur le calendrier grégorien. Dans « L’année 1919 », elles sont indiquées selon les deux calendriers.
- Au début de la guerre de 1914, la capitale de l’empire russe avait été rebaptisée Petrograd, au lieu du nom — jugé trop allemand — de Saint-Pétersbourg.
- Ces notes rédigées par l’auteur ne concernent cependant que le chapitre « L’année 1919 », p. 29-152. Partout ailleurs, les notes ont été ajoutées par nous (NdR).
- Texte publié à compte d’auteur en 1976, puis édité dans. ARCHEVEQUE BASILE (KRIVOCHEINE), Vospominaniya. Pis’ma [Mémoires. Correspondance], Nijni-Novgorod, éd. de la Fraternité St Alexandre Nevski, 1998, p. 10-28 et dans. ARCHEVEQUE BASILE (KRIVOCHEINE), Spasenniy Bogom [Sauvé par Dieu], Saint-Pétersbourg, éd. Satis, 2007 (texte de référence), p. 12-30. Ces souvenirs furent repris, presque sans changement, par A. SOLJENITSYNE dans La Roue rouge, 3e nœud. Mars Dix-sept, Paris, Fayard, 1986, chapitres 47 et 85.
- Le 23 février 1917 correspond au 8 mars selon le calendrier grégorien. Voir « Avant-propos de l’auteur », n. 2. En fait, la révolution de février (mars) 1917 commença par des manifestations à l’occasion de la Journée internationale des femmes, qui dégénérèrent à la suite de la rumeur — fausse — d’une pénurie dans l’approvisionnement en pain de la capitale.
- Voir « Avant-propos de l’auteur », n. 3.
- Cette circonstance climatique — après un temps glacial qui avait retenu la population chez elle — allait également jouer un rôle non négligeable dans les événements ultérieurs.
- Igor Alexandrovitch Krivochéine (1899-1987). Frère de l’auteur. Ingénieur, officier dans l’artillerie montée de la Garde impériale, combattant de la première guerre mondiale et de la guerre civile russe. Émigré à Paris en 1920, résistant, prisonnier des camps nazis, retourne en URSS en 1947, prisonnier des camps soviétiques (1949-54). Rentre à Paris en 1974. Voir N. JALLOT, Piégés par Staline, Paris, Belfond, 2003.
- Olga Vassilievna Morozova, née Krivochéine (1866-1953). Sœur d’Alexandre Vassilievitch Krivochéine [père de l’auteur]. Émigre à Paris en 1920.
- Depuis la fin du XIXe siècle, les cosaques, cavaliers légers de l’armée russe, participaient aussi au maintien de l’ordre dans les villes.
- Le 20 février (5 mars), l’usine d’armement Poutilov (plus grande entreprise de Petrograd), en rupture d’approvisionnement, ferma ses portes, ce qui mit des dizaines de milliers d’ouvriers en chômage technique et les jeta dans la rue. D’autres ouvriers en grève se joignirent aux manifestations.
- Le 9 mars selon le calendrier grégorien. Ce jour-là, cent cinquante mille ouvriers grévistes convergent vers le centre-ville.
- Surnom méprisant des policiers ; le peuple orthodoxe était habitué à entendre, à l’église, maudire le « pharaon persécuteur » [d’Israël].
- Le 10 mars selon le calendrier grégorien.
- Aujourd’hui, gare de Moscou.
- Boris Vladimirovitch Stürmer (1848-1917), homme politique russe. Protégé de Raspoutine, président du Conseil des ministres (1916), fonction qu’il cumule avec celle de ministre de l’Intérieur, puis des Affaires étrangères. Après la Révolution de février, arrêté et emprisonné. Meurt en prison.
- En pleine guerre avec l’Allemagne, le nom de famille allemand du Premier ministre sonnait comme une provocation.
- Le 11 mars selon le calendrier grégorien.
- Alexandre Vassilievitch Krivochéine (1857-1921), juriste et homme d’État russe, père de Vassili, Oleg, Vsévolod [Basile], Cyrille et Igor Krivochéine. Proche collaborateur du Premier ministre Stolypine, il fut vice-ministre des Finances (1906), ministre de l’Agriculture (1908-1915), et Premier ministre du gouvernement « blanc » du général Wrangel en Crimée (1920). Émigre à Paris.
- Le 12 mars selon le calendrier grégorien.
- Cette réunion n’aura jamais lieu, le tsar ayant, le 25 février (10 mars), suspendu les travaux de la Douma et du Conseil d’État. La Douma refusera et constituera un Comité provisoire pour le maintien de l’ordre, qui se transformera en Gouvernement provisoire après l’abdication du tsar le 2(15) mars 1917.
- Face aux événements, l’autorité militaire avait lancé en aide à la police et aux cosaques les troupes de réserve des régiments de la Garde impériale, stationnées dans la ville ou ses environs.
- Serge Sémionovitch Khabalov (1858-1924), officier russe. Général commandant la Région militaire de Petrograd (1916-17). Arrêté après la Révolution de février, puis libéré, émigre.
- Régiment Paul Ier de la Garde impériale.
- Ce n’est pas vrai. c’est le 22 février (7 mars), soit avant le début des événements, que Nicolas II avait quitté la capitale pour rejoindre son quartier général à Moguilev.
- C’est aussi inexact ; ce n’est que le 25 février (10 mars) que le tsar envoya un télégramme au général Khabalov, lui ordonnant de « faire cesser dès [le len]demain les désordres dans la capitale ».
- Diminutif de Grégoire.
- Le 4e bataillon du régiment.
- Le 12 mars selon le calendrier grégorien.
- Titre donné à tous les officiers de l’armée russe.
- Ce matin-là, le détachement d’instruction du bataillon de réserve du régiment de Volhynie (de la Garde impériale) avait tué son commandant et s’était soulevé, entraînant le reste du régiment, ainsi que les régiments de Lituanie et Préobrajenski de la Garde. La mutinerie des régiments d’élite de l’armée russe, traumatisés d’avoir tiré sur leurs « frères ouvriers », fera basculer la situation. Le 27 février (12 mars), soldats et ouvriers fraterniseront, et occuperont les points stratégiques de la ville. À la fin de la journée, la capitale sera aux mains des insurgés.
- Alexandre Alexandrovitch Rittich (1868-1930), homme politique russe. Dernier ministre de l’Agriculture (1917) du tsar Nicolas II.
- Comités révolutionnaires.
- Romain Alexandrovitch Disterlo (1859-1919), homme politique russe. Fonctionnaire au ministère de la Justice (1886), sénateur (1912), membre du Conseil d’État (1914).
- Alexandre Féodorovitch Trepov (1862-1928), homme politique russe. Ministre des Transports (1917), puis président du Conseil des ministres (1917). Émigre en France.
- Hélène Guennadievna Krivochéine, née Karpova (1871-1942). Épouse d’Alexandre Vassilievitch Krivochéine et mère de Vassili, Oleg, Vsévolod [Basile], Cyrille et Igor Krivochéine. Émigre à Paris en 1919.
- Voir « Avant-propos de l’auteur », n. 2.
« Mémoire des deux mondes » De la révolution à l’Église captive
Par Basile Krivochéine
Les Éditions du CERF — 2010
Préface du Métropolite Hilarion (Alfeyev) de Volokolamsk, président du département des relations extérieures du patriarcat de Moscou — Traduction du russe de Nikita Krivochéine, Serge Model, Lydia Obolensky — Présentation, révision et notes de Serge Model

Une étude de la tradition manuscrite des œuvres de saint Syméon le Nouveau Théologien (949-1022) montre qu’elles sont parvenues jusqu’à nous dans un état satisfaisant de texte — d’autant qu’il s’agit de ses écrits authentiques —, réunis dans des grandes collections par leurs éditeurs. Cependant, sa personnalité était trop puissante et sa spiritualité si peu banale que des essais de les rendre plus acceptables, ou en tout cas moins choquantes pour le goût d’un lecteur moyen, furent entrepris depuis les temps anciens. Ainsi, parallèlement à ses Catéchèses, apparaissent depuis le XI-XIIe siècle les 33 Discours, qui consistent en grande partie des extraits des Catéchèses reproduisant quelques fois des pièces entières mais en les morcelant généralement et en les réarrangeant de telle manière que les passages personnels et mystiques sont omis (1). En outre, le nom de Syméon le Nouveau Théologien — à qui sont attribués ces Discours — est quelque peu modifié par l’addition de la conjonction « et » [καὶ], de sorte qu’au lieu de « Nouveau Théologien » — ce qui pouvait choquer le conservatisme théologique pour qui toute nouveauté théologique était un synonyme d’hérésie —, on lit. « le Jeune et le Théologien » (ὁ Νέος καὶ Θεολόγος) (2). Bref, ces Discours nous donnent une image appauvrie du grand mystique qu’était Syméon, plus acceptable cependant pour le public.
Si les éditeurs des 33 Discours procédaient plutôt par voie d’omissions, on peut voir depuis le XII-XIIIe siècle des essais contraires de compléter les écrits de Syméon par ce qui leur semblait manquer. Nous avons en vue la Méthode de la prière et de l’attention ou sur les trois manières de prier (3) qui traite de la prière à Jésus et des moyens respiratoires qui l’accompagnent. Comme on le sait, dans ses écrits authentiques Syméon ne parle jamais ni de ces exercices respiratoires ni de la prière à Jésus. Il connaît bien la prière intérieure intellectuelle ininterrompue (4), mais ces courtes invocations continuelles sont soit le Kyrie eleison (5), soit la prière du publicain. « Ô Dieu, sois-moi propice, à moi pécheur (6) » et non l’invocation du Seigneur Jésus-Christ comme dans la Méthode (7). En général, tout esprit de « méthode » est étranger à la spiritualité si spontanée de l’authentique Syméon. Plus important, cette crainte de tomber dans l’erreur par des fausses visions de lumière, si fortement exprimée dans la Méthode, est étrangère à la spiritualité de Syméon pour qui toute vision de lumière porte en soi la certitude de son authenticité, de sorte qu’en douter constituerait un blasphème contre le Saint-Esprit. En outre, les grandes collections des œuvres de Syméon ne connaissent pas la Méthode, elle y apparaît pour la première fois dans un manuscrit daté de 1729 (8). Néanmoins, d’une manière isolée, la Méthode a connu une large diffusion dans des recueils ascétiques et a ainsi contribué à créer une image d’un Syméon stylisé en hésychaste athonite (9). On pourrait même dire que la Méthode a à peu près remplacé les autres écrits de Syméon. Ainsi saint Grégoire Palamas. l’unique fois où il parle de Syméon dans ses traités théologiques, mentionne la seule Méthode (10).
Une période nouvelle commence avec la première édition imprimée des œuvres de Syméon qui parut à Venise à la fin du XVIIIe siècle (1790) (11). L’éditeur, Dionysios Zagoraios, se borne à publier une traduction de ses écrits en grec populaire de son temps, excepté pour les Hymnes dont il donne le texte original. Quant aux pièces traduites, Dionysios ne fait aucune distinction entre les différents types des écrits de Syméon — catéchèses, discours théologiques, etc. —, et les intitule tous « Discours » (Λόγοι) de sorte que les écrits non authentiques ne peuvent plus être reconnus. Ainsi la Méthode de prière devient le Discours 67, éditée entre deux catéchèses et définitivement intégrée dans la tradition (12). La traduction de Dionysios, bien que ne rendant pas la beauté de l’original et tendant vers la périphrase, est généralement bonne et assez exacte, au moins quand il le veut. C’est que son édition fait partie de cette grande entreprise des spirituels grecs du XVIIIe siècle, avec saint Macaire de Corinthe et saint Nicodème l’Hagiorite en tête, qui voulaient redécouvrir et faire connaître les écrits spirituels des Pères anciens dont les manuscrits dormaient dans les bibliothèques du Mont Athos et de Patmos, restant ainsi inconnus au peuple pieux et même aux moines qui ignoraient leur propre tradition spirituelle. Leur but était avant tout pratique, missionnaire même, et leur critère était le profit de l’âme de leurs lecteurs, si bien qu’ils se croyaient en droit d’omettre tout ce qui leur paraissait dangereux ou, plutôt, susceptible d’être mal compris ou faussement interprété. Tel était le principe aussi suivi par Dionysios dans son édition de Syméon. C’est par omission des passages qui n’étaient pas de son goût qu’il procède surtout. Ainsi, par exemple, dans la Catéchèse 34, le passage suivant est omis :
Tel un pauvre plein d’amour fraternel, qui demandant l’aumône à un miséricordieux ami du Christ et en ayant reçu quelque monnaie, accourrait avec joie vers ses compagnons de misère pour leur annoncer en secret. « Courez, dépêchez-vous, pour avoir aussi quelque chose ! », leur montrant du doigt et leur désignant celui qui lui a donné la monnaie et, s’ils ne veulent pas le croire, ouvrant le creux de la main pour la leur montrer, pour qu’ils croient, se dépêchent et se hâtent d’accrocher cet homme miséricordieux, — de même dans ma bassesse, moi pauvre dépouillé de tout bien et esclave de votre sainteté à vous tous, j’ai fait l’expérience de l’amour de Dieu pour les hommes et de sa compassion et, m’approchant pour ainsi dire de lui par la pénitence et, grâce à l’intercession de saint Syméon, votre Père et le mien, ayant reçu la grâce, indigne que j’étais de toute grâce, je ne peux supporter de rester seul pour la cacher dans les replis de mon âme, mais c’est à vous tous, mes Frères et mes Pères, que je dis les dons de Dieu et, ce talent qui m’a été donné, je vous fais voir — autant qu’il dépend de moi — en quoi il consiste et par la parole je vous le découvre comme au creux de ma main. Et je ne vous parle pas comme en cachette et en secret, mais je crie à haute voix. « Courez, frères, courez ! » et je ne me contente pas de crier, mais je vous désigne le Maître qui me l’a donné, étendant devant vous, en guise de doigt, mes paroles (13).
Ce passage se trouve dans tous les manuscrits des Catéchèses du Mont Athos utilisés par Dionysios. Il l’a donc délibérément omis. Pourquoi ? Selon toute vraisemblance, parce qu’il le trouvait trop personnel et la comparaison que faisait Syméon de ses sermons avec des monnaies d’or lui paraissait osée et pouvant scandaliser un lecteur ordinaire. Quoi qu’il en soit, Dionysios a ainsi omis un des plus beaux passages des Catéchèses, si important pour comprendre la personnalité de ce « pauvre aimant ses frères » qu’était Syméon. Des motifs semblables ont vraisemblablement poussé Dionysios à omettre tout le commencement de la Catéchèse 9 où Syméon affirme d’être inspiré dans ses sermons par le Saint Esprit et se compare à un instrument musical mis en action par l’air, c’est-à-dire l’Esprit. Il faut donc l’écouter comme si c’était Dieu lui-même qui parlait. C’est la crainte de choquer les gens par l’audace prophétique de Syméon qui incite Dionysios à supprimer ce long passage (14). Il omet de même toute la belle Catéchèse 21 sur la mort du moine Antoine, frère et ami de Syméon. Dionysios croyait évidemment qu’un ascète ne devait pas avoir d’amitiés et se plaindre de son isolement, comme Syméon le fait d’une manière si émouvante dans cette oraison funèbre. Quoi qu’il en soi, en excluant cette catéchèse de son édition, Dionysios prive Syméon de ses traits humains (15).
Dionysios procède d’une manière analogue dans sa traduction des Discours éthiques de Syméon, mais ici c’est surtout la crainte de visions mystiques et l’assurance de Syméon de les avoir eues qui font omettre des passages entiers. Ainsi, c’est toute la fin du Discours 4, où Syméon raconte son expérience personnelle des biens divins, qui est supprimée par Dionysios. Nous citons partiellement cette omission :
Tel est le bienheureux sort, confesse Syméon, […] que nous avons mérité de subir à force de prières, par l’amour et la grâce de Dieu. C’est par lui que nous avons acquis mystérieusement, de manière sentie, vue et connue [ἐν αἰσθήσει καὶ ὁράσει καὶ γνώσει μυστικῶς] l’expérience de tout ce que nous avons dit et que, ayant reçu en même temps cette expérience pour aider et encourager ceux qui veulent chercher et trouver Dieu, nous l’avons livrée par écrit. […] Oui, certainement, [Dieu] m’unira de plus, il m’associera manifestement et daignera me fondre consciemment moi tout entier à lui tout entier et à vous, dans une fusion sans confusion et une étreinte inexprimable (16).
Ou bien dans un autre passage du Discours éthique 8 où Syméon parle d’une vision lumineuse trinitaire. « Alors celui qui est en cet état se rend compte de sa vision ; il voit et c’est de la lumière, une lumière qui lui paraît avoir son origine d’en haut. Il cherche donc et il découvre qu’elle n’a […] ni début, ni degré intermédiaire et […] voici que se montre en elle une triple réalité. par qui, en qui et dans qui. En les voyant, il demande à savoir et il entend distinctement. « Me voici, l’Esprit, par qui et en qui le Fils » et « Me voici, le Fils, dans qui le Père » (17) ». C’est la témérité de cette vision trinitaire, surchargée en même temps de termes théologiques, où les trois personnes divines parlent séparément avec Syméon, qui aura choqué Dionysios, aussi préféra-t-il omettre tout le passage. Par ailleurs, sur quatre épîtres de Syméon qui se trouvent dans les manuscrits du Mont Athos, Dionysios omet de traduire et d’inclure dans son édition la première épître, « Sur la Confession », où sa doctrine sur le pouvoir de lier et délier sans avoir le sacerdoce est particulièrement affirmée. C’est une sorte de censure théologique de la part de l’éditeur (18).
Pour les Hymnes, la question de traduction ne se pose pas, puisque Dionysios les édite en langue originale. Néanmoins, il y procède de la même manière en éliminant ce qui ne conviendrait pas aux buts de son édition. Ainsi il omet entièrement deux longs hymnes. l’Hymne 21, qui est la réponse de Syméon au métropolite Étienne de Nicomédie — dont parle Nicétas dans sa vie de Syméon et où ce dernier ne se borne pas à répondre d’une manière irréprochable aux questions théologiques du métropolite mais, selon sa manière, « contre-attaque » et accuse, en la personne d’Étienne, les évêques qui osent parler de la théologie sans avoir une expérience spirituelle personnelle et dont la vie n’est pas en accord avec ce qu’ils enseignent. Dionysios a préféré omettre complètement ces critiques d’un moine contre la hiérarchie, bien qu’ailleurs il édite des passages de Syméon presque aussi violents. Quant à l’Hymne 15, unique dans la littérature patristique, ce sont ses images osées et réalistes de l’union de l’homme avec Dieu dans une expérience mystique et de l’amour divin en général, ainsi que les conséquences que tire Syméon du fait de l’incarnation pour la divinisation de l’homme entier avec tout son corps qui ont probablement incité Dionysios à omettre complètement l’hymne que certains théologiens catholiques-romains ont d’ailleurs jugé scandaleux !
Pour le monde de l’orthodoxie russe, c’est la traduction de l’évêque Théophane (Govorov) vers la fin du XIXe siècle qui a rendu accessible l’œuvre du grand mystique byzantin (19). Il faut cependant noter que l’évêque Théophane n’a pas eu accès aux manuscrits de Syméon et se base exclusivement sur l’édition de Dionysios avec toutes ses omissions et compléments. C’est donc la traduction d’une traduction ou, plutôt la périphrase d’une périphrase. Mais Théophane est allé encore plus loin dans son travail d’élimination. il n’a pas voulu traduire du tout les hymnes de Syméon édités par Dionysios, car il les jugeait trop élevés spirituellement et donc dangereux !
Si nous nous arrêtons si longtemps sur ces traductions tardives des XVIII-XIXe siècles, c’est qu’elles réussirent à imposer à la piété orthodoxe une image appauvrie, dépersonnalisée et quelquefois même déformée de Syméon incluant dans ses écrits des pièces qui ne lui appartiennent pas, de sorte qu’on peut prévoir que la découverte d’un Syméon authentique rencontrera une opposition de l’opinion publique orthodoxe. Il ne faut cependant pas exagérer. Les omissions de Dionysios constituent ensemble moins de 10% de l’œuvre de Syméon. Bien que leur tendance soit claire — supprimer ce qui paraît trop mystique, personnel, choquant même dans les écrits de Syméon —, le travail du rédacteur n’est pas systématique. tout en omettant des passages qui lui semblaient capables de troubler le lecteur, il en laissait d’autres qui ne leur cédaient presque en rien. L’essentiel de la spiritualité de Syméon apparaît malgré tout. Et le grand mérite de Dionysios et de Théophane demeure. grâce à leurs traductions, saint Syméon le Nouveau Théologien n’est pas devenu une pièce de musée, mais continue d’être une réalité vivante de la spiritualité orthodoxe. Espérons qu’il le deviendra encore davantage dans sa forme authentique retrouvée…
* Exposé présenté à la VIIIe Conférence patristique internationale (Oxford, 1979) et publié dans le Messager de l’exarchat du patriarche russe en Europe occidentale, n° 101-104 (1979), p. 27-32.
- Sur les relations entre les Catéchèses et les Discours, voir notre introduction au tome I des Catéchèses [Cat.], Paris, Éd. du Cerf, coll. « Sources chrétiennes » [SC] n° 96, 1963, 2006², p. 172-174 et nos articles dans « The Writings of Saint Syméon the New Theologian », Orientalia Christiana Periodica, t. XX (1954), p. 298-328.
- Voir The Writings…, p. 322-325.
- Texte grec édité par Irénée HAUSHERR, « La Méthode d’oraison hésychaste », Orientalia Christiana, t. IX-2 (1927), p. 150-172.
- Cat., XXII, 278, dans Catéchèses, t. II, Paris, Éd. du Cerf, coll. « Sources chrétiennes » n° 104, 1964, p. 387; Hymnes, LVIII, 354, Paris, Éd. du Cerf, coll. « Sources chrétiennes » n° 196, 1973, p. 305.
- Cat., XXII, 64, loc. cit., p. 371.
- Cat., XXII, 88-90, loc. cit., p. 371-373.
- Méthode, 169, 11-12.
- Voir Catéchèses, t. I, loc. cit., Introduction, p. 86.
- On est tenté de voir dans la description critique de la première manière de prier par l’auteur de la Méthode une mise en garde à ceux qui voudraient imiter les procédés mystiques de Syméon sans avoir ses dons exceptionnels ou sans directeur spirituel. Quoiqu’il en soit, la première manière de prier de la Méthode reproduit les prières extatiques du jeune Syméon. fixation du regard au ciel, lumière qui y apparaît d’en haut, voix qu’on entend et avec qui on parle, sentiment de douceur et de béatitude, possession de biens divins, perte de la réalité qui entoure, etc. C’est seulement la vision des puissances célestes qui manque chez le Syméon authentique. L’auteur de la Méthode ne rejette pas cependant entièrement une telle manière de prier, mais il la trouve dangereuse surtout chez les débutants et sans profit spirituel. Il est significatif qu’une telle correction de la doctrine de Syméon aurait été faite au nom de Syméon lui-même. Et c’est en cette qualité qu’elle devint une composante de la tradition. C’est peut-être une réaction hésychaste au mysticisme enthousiaste du Nouveau Théologien.
- GREGOIRE PALAMAS, Défense des saints hésychastes, éd. Jean Meyendorff, Louvain, 1959, 1973², p. 98.
- 2e éd.. Smyrne, 1886; 3e éd.. Volos, 1960; nous nous référons à la 2e édition.
- Τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Συμεὠν τοῦ Νέου Θεολόγου τὰ εὑρισκόμενα [Œuvres complètes de notre saint père théophore Syméon le Nouveau Théologien], éd. Dionysios ZAGORAIOS, Smyrne, 1886, p. 364-369.
- Cat., XXXIV, 32-57, dans Catéchèses, t. III, Paris, Éd. du Cerf, coll. « Sources chrétiennes » n° 113, 1965, p. 275-277; Discours 89 dans l’éd. de Dionysios, l’omission est à la p. 507.
- Cat., IX, 9-25, op. cit., p. 105-107; Discours 21 dans l’éd. de Dionysios, p. 114.
- Cat., XXI, 1-106, ibid., p. 351-359; manque complètement dans l’éd. de Dionysios.
- Éth., IV, 925-945, dans Traités théologiques et éthiques, t. II, Paris, Éd. du Cerf, coll. « Sources chrétiennes » n° 129, p. 75-77; Discours 4 dans l’éd. de Dionysos, p. 485.
- Éth., VIII, 99-123, loc. cit., p. 209; Discours 58 dans l’éd. de Dionysos, p. 303.
- Or, cette épître se trouve dans le manuscrit Vatopedi 667, f. 291-295, que Dionysios a certainement utilisé.
- Moscou, 1882, 1890 (2).
Suite « Dieu, l’homme, l’Église » Lecture des Pères Par Basile Krivochéine Les Éditions du « CERF » Paru en. Décembre 2010, 302 pages

J’avais d’abord donné à mon exposé le titre. « La simplicité divine selon saint Grégoire de Nysse », mais j’ai cru nécessaire de le modifier et de le compléter ensuite pour qu’il rende mieux la terminologie et même le contenu de la doctrine de saint Grégoire sur Dieu. D’abord parce que l’expression « simplicité divine » aurait pu être comprise comme voulant dire « simplicité de Dieu ». Or, Grégoire n’affirme jamais (ou à peu près jamais) dans ses écrits que Dieu est simple, mais que sa nature et son essence sont simples. En tout cas, il précise toujours que Dieu est simple selon sa nature, ou bien, quand il le nomme « simple », emploie l’expression τό θείον (le « divin » ou la « déité ») au lieu du mot « Dieu ». J’ai donc préféré parler dans mon titre de simplicité de la nature divine et non de simplicité divine tout court. J’ai également voulu, par cette addition, souligner le fait que ce terme « nature » (φύσις) est bien plus fréquent chez Grégoire que celui d’ « essence » (οὐσία) (1). Enfin, j’ai ajouté les mots « et distinctions en Dieu », car il est impossible de parler de la simplicité de la nature divine selon Grégoire de Nysse sans mentionner les distinctions qu’il discerne en Dieu. On pourrait même dire que sa doctrine sur ces distinctions est plus caractéristique de sa théologie que son affirmation de la simplicité de la nature divine.
Cependant, la première question qu’on devrait se poser dans une étude comme la nôtre, serait celle de la possibilité même de connaître Dieu, selon saint Grégoire de Nysse. Dieu est-il accessible à notre connaissance ? Bien que la réponse de Grégoire soit assez nuancée, on peut dire d’une manière générale qu’il affirme fortement l’incognoscibilité divine. C’est l’éternité de Dieu en tant qu’être incréé et ne donnant, par conséquent, aucun appui à notre pensée, qui le rend inaccessible à la connaissance rationnelle, « il en résulte que celui qui exerce sa curiosité sur ce qui est plus ancien que les siècles et qui remonte jusqu’au point d’origine de ce qui existe ne peut s’arrêter nulle part dans ses raisonnements, car ce qu’il cherche s’éloigne toujours plus loin et n’offre aucun point fixe où la curiosité de son esprit puisse s’arrêter (2) ».
Malgré cette incognoscibilité du divin — Grégoire, en l’évoquant, utilise le genre neutre. « ce qui est plus ancien que les siècles » (τό αἰώνων πρεσβύτερον) —, il y distingue toujours l’essence ou la nature, qu’il considère comme inconnaissable. Cette incognoscibilité est le trait caractéristique de la nature de l’essence divine. « Elle se situe, dit-il, au-delà de tout commencement et ne présente pas de trait distinctif de sa propre nature, et elle n’est connue que comme ne pouvant pas être comprise (3). » Elle est incompréhensible non seulement aux hommes, mais aussi aux anges, bien que cette dernière affirmation soit exprimée avec une certaine prudence. « La nature humaine ne possède pas en elle-même la faculté d’une compréhension exacte de l’essence (4) de Dieu. Cependant, il ne faudrait peut-être pas se limiter à dénier cette possibilité à la seule nature humaine, mais quelqu’un qui dirait que même la création incorporelle n’est pas tout à fait assez haute pour saisir et embrasser par la connaissance la nature infinie ne se tromperait pas absolument (5). » Ce n’est donc pas par un effort d’ascension intellectuelle et de dépassement qu’on peut connaître la nature divine, mais c’est par une foi simple et pure qu’on peut l’approcher, comme c’était le cas pour Abraham. « Pour toutes les […] choses, qu’il comprenait à mesure qu’il progressait dans sa réflexion, que ce soit la puissance ou la bonté ou le fait d’être sans commencement ou le fait d’être défini par aucune limite ou encore toute autre notion qui se présente à l’esprit au sujet de la nature divine [περὶ τὴν θείαν φύσιν], il en faisait des moyens d’approche et des marchepieds pour une progression vers en haut, s’appuyant toujours sur ce qu’il avait trouvé et toujours tendu vers l’avant, […] et dépassant tout ce qu’il avait compris par ses propres forces, comme étant plus petit que ce qui était recherché (6) » et, « après qu’il eut parcouru toute l’étendue des représentations [ὑπολήψεσι] de la nature de Dieu, liée à un nom dans les conjectures [ὑπονοιών] au sujet de Dieu, ayant purifié la pensée de telles suppositions et ayant adopté une foi pure de toute notion [ἑννοίας] terrestre, il fixa comme signe infaillible et manifeste de sa connaissance de Dieu le fait de croire que Dieu est plus grand et plus sublime que tout signe propre à le faire connaître (7) ». Ou encore. « Il n’est pas possible de l’approcher autrement que si la foi joue le rôle d’intermédiaire, en ajustant par elle-même à la nature incompréhensible l’esprit qui cherche à l’atteindre (8). » La foi est opposée par Grégoire à la gnose (9), mais la foi elle-même ne nous découvre pas la nature et l’essence de Dieu, mais seulement la puissance et la grandeur de ce « qui est observé au sujet de Dieu (10) ». Identifier un concept quelconque, comme, par exemple, celui d’« inengendré », avec l’essence de Dieu, serait de l’idolatrie (11). L’incognoscibilité de la nature divine ne signifie cependant pas que Dieu soit absolument inaccessible à la connaissance ; il faut seulement éviter les deux extrêmes. affirmer son inaccessibilité totale ou, au contraire, la possibilité de le contempler clairement par l’intellect. Il existe, néanmoins, une connaissance par l’inconnaissance. « La divinité, dit-il, quelle que soit sa nature, est intangible et incompréhensible, et transcende toute capacité de saisie par le raisonnement, mais la pensée humaine, pratiquant la recherche et l’investigation par voie de raisonnement dans les limites de ses possibilités, arrive à atteindre et à toucher [en quelque sorte] la nature élevée et inaccessible, sans avoir cependant la vue assez perçante pour voir clairement ce qui est invisible et sans être, d’autre part, absolument coupée de toute approche, au point de ne pouvoir parvenir à aucune représentation au sujet de l’objet de la recherche. D’une part, certains aspects de ce qui est recherché sont établis par conjecture moyennant le toucher des raisonnements, d’autre part, du fait même de ne pas pouvoir voir Dieu, l’intelligence humaine connaît celui-ci d’une autre manière, en ce sens qu’elle acquiert en quelque sorte une connaissance claire du fait que ce qui est recherché se situe au-delà de toute connaissance (12). »
Dans ses écrits spirituels, Homélies sur le Cantique des Cantiques ou sur les Béatitudes, Grégoire nous parle du côté existentiel de cette impossibilité de connaître ou de contempler la nature divine. Cette impossibilité radicale produit en nous une tristesse « métaphysique », un sentiment d’être séparé du bien suprême. « Plus nous avons conscience que le bien de sa nature échappe à notre recherche et plus nous nous attristons, parce que ce bien dont nous sommes privés est si grand de par sa nature que même sa connaissance nous échappe (13). » Grégoire nous invite à cesser de pareilles recherches, parce qu’inutiles, bien que cette impossibilité d’atteindre « ce que nous cherchons » nous donne « une idée de la grandeur de ce que nous cherchons (14) ». C’est de nouveau la connaissance par l’inconnaissance. Il oppose aussi la contemplation et la vision, en niant la possibilité de la dernière. « Comment, demande-t-il, et par quelle considération nous mettre sous les yeux ce bien qui voit et est invisible (15) ? »
Quoiqu’il en soit, la nature de celui-ci est incompréhensible et inaccessible à nos pensées. « La nature de Dieu, dit-il, en elle-même [αὐτὴ καθ’ αὑτήν], en sa propre essence, dépasse toute représentation [καταληπτικὴς ἐπινοίας]. nul ne peut l’approcher, elle se dérobe à tout essai de formulation [στοχαστικαίς] […]. Aussi le grand apôtre dit-il des voies de Dieu qu’elles sont « impénétrables » [Rm 11, 33], indiquant par là que la route qui mène à la connaissance divine est fermée à nos esprits (16). » Grégoire ajoute cependant une phrase qui montre que, pour lui, l’incognoscibilité de la nature divine ne veut pas dire que Dieu soit totalement inconnaissable ou inaccessible. « Puisque l’être de Dieu transcende tout être, il est d’autres façons de voir et de saisir celui qui ne se laisse ni voir ni saisir (17). » Il s’agit probablement de la connaissance de Dieu par une analogie « purifiée » avec la nature humaine (18), par une illumination intellectuelle indicible (19), de la connaissance dans le miroir de l’âme (20), par les vertus (21), à travers les énergies divines, etc., la nature et l’essence divine restant cependant telles qu’elles sont, c’est-à-dire inconnaissables, en tout cas immédiatement.
L’affirmation de l’incognoscibilité de la nature divine n’empêche pas saint Grégoire d’affirmer avec insistance sa simplicité. On peut même dire que cette affirmation constitue, elle aussi, un des traits caractéristiques de sa doctrine sur Dieu. Il ne cesse de l’exprimer pour défendre la doctrine trinitaire orthodoxe de la consubstantialité du Fils dans sa polémique contre Eunome (22) et, dans ses écrits contre les macédoniens, de la divinité du Saint Esprit (23). On aurait cependant tort de réduire cette insistance sur la simplicité de la nature divine aux besoins de la polémique. Pour Grégoire, il s’agit ici d’une doctrine acceptée par tout le monde. « Nous pensons, dit-il, que même ceux qui sont très frustes et simples d’esprit ne nieront pas le fait que la nature divine et bienheureuse qui dépasse toute pensée est simple. Comment pourrait-on supposer multiforme et composée la nature (divine) sans forme et sans figure, exempte de toute grandeur et quantité mesurables (24) ? » La simplicité est donc comprise ici comme absence de formes et de complexité. Ce n’est pas d’ailleurs ici que se situe le désaccord de Grégoire avec Eunome qui, d’après Grégoire, reconnaissait aussi, au moins formellement, la simplicité de l’essence divine (25). Mais ailleurs, Grégoire accuse Eunome d’enseigner que Dieu est « une entité complexe et composée, une combinaison d’éléments contraires (26) ». Cependant, cette affirmation fondamentale de la simplicité de la nature divine pose beaucoup de problèmes, car Grégoire (suivant d’ailleurs la tradition théologique de l’Église et l’enseignement de son frère aîné Basile en particulier) fait beaucoup de distinctions en Dieu, ou quand il parle de Dieu. Par exemple, entre l’essence divine et les hypostases trinitaires, entre la nature ou l’essence divine et ses énergies ou ses attributs, entre la nature divine et ce qui est contemplé « autour d’elle », etc. Quelle est donc la nature de ces distinctions, à quoi correspondent-elles en Dieu, comment coexistent-elles avec la simplicité de la nature divine et comment Grégoire comprend-il cette simplicité ?
Il n’est pas dans nos intentions d’examiner ici la doctrine trinitaire de saint Grégoire dans son ensemble. Disons seulement qu’il affirme clairement la réalité des distinctions hypostatiques, tout comme il distingue les hypostases de l’essence divine, de sorte que celui qui est réellement (ὄντως ὄντος) est en même temps un et non-un. Il nous faut donc « nous en tenir à l’appellation de Père, de Fils et de Saint Esprit, en vue de l’intelligence de l’être qui est réellement, qui est en même temps un et non-un (27) ». Et il explique comment il faut comprendre cette « unité — non-unité » antinomique. « En raison de son essence, l’[être] est un, et c’est pourquoi le Maître prescrit de fixer notre regard sur un nom unique ; mais par les propriétés propres à faire connaître les hypostases [γνωριστικοῖς τῶν ὑπωστάσεων ἰδιώασιν], la foi distingue entre le Père, le Fils et le Saint Esprit, divisés sans séparation et unis sans confusion (28). » Plus loin, Grégoire souligne encore davantage la distinction des personnes dans la Sainte Trinité et l’unité de son essence, et affirme en même temps qu’aucune appellation ne concerne la nature et n’y introduit de division (29). Quant à la nature divine, elle reste au-dessus de tout nom. « Seule la nature incréée, crue dans le Père, dans le Fils et dans le Saint-Esprit, dépasse toute désignation par un nom (30). » « Il est clair, ajoute-t-il encore, que l’appellation de Père ne fait pas comprendre son essence, mais indique la relation au Fils. Il s’ensuit que s’il eut été possible au genre humain d’être instruit de l’essence de Dieu, celui qui veut que tous les hommes soient sauvés et viennent à la connaissance de la vérité, n’en aurait pas celé la connaissance. Mais, par le fait qu’il n’a rien dit au sujet de l’essence, il a montré que la connaissance en est impossible (31). » La question de la simplicité de la nature divine n’est certes pas directement abordée dans ces passages trinitaires, mais elle y est incontestablement présupposée, comme dans l’œuvre de saint Grégoire dans son ensemble. On peut donc à juste titre déduire que, pour lui, la simplicité de la nature divine est compatible avec les distinctions hypostatiques réelles — bien qu’antinomiques — en Dieu, et qu’elles n’introduisent pas de complexité dans sa nature.
Ce même problème se pose aussi si nous examinons ce que dit Grégoire à propos de la nature ou de l’essence divine dans leurs relations avec ce qu’il désigne par les termes d’ « énergie » ou d’autres expressions analogues. On peut même se poser la question de savoir si ces deux termes de « nature » et d’ « essence » ont, pour Grégoire, un sens absolument identique dans leur application à Dieu. Le terme « nature », plus fréquent (comme nous l’avons déjà remarqué) chez Grégoire, semble avoir, pour lui, une nuance davantage ontologique, tandis qu’ « essence » est plutôt employé dans le domaine de la connaissance. Ils sont cependant interchangeables, comme on peut le voir quand Grégoire écrit que l’essence du Père ne se distingue pas de la nature du Monogène (32), ou que ceux dont la notion (λόγος) de l’essence coïncide ne peuvent aucunement avoir des natures différentes (33). Comme pour saint Basile, l’incognoscibilité de la nature divine n’est pour lui qu’un cas particulier de l’impossibilité de connaître la nature des choses. « S’il n’a pas encore saisi par la connaissance la nature de la fourmi qui est si petite, dit-il, comment se vante-t-il d’avoir saisi par le raisonnement celui qui contient la totalité de la création (34) ? » Il existe cependant une différence énorme et infranchissable entre la nature créée et incréée. « L’intervalle qui entoure, comme par une enceinte, la nature incréée et qui la sépare de la nature créée est grand et infranchissable. Cette dernière est limitée, la première est illimitée ; celle-ci est enfermée dans ses propres mesures […], celle-là a comme mesure l’infinité. Celle-ci s’étend comme une extension par intervalles et est enfermée de toutes parts par le temps et l’espace, celle-là transcende toute notion d’intervalle et se dérobe à la curiosité, quel que soit l’aspect auquel on applique son esprit (35). » Inconnu donc dans son essence à cause de son infinité, Dieu nous devient connu par son énergie créatrice et dans ses créations, selon l’expression de saint Grégoire. « Dieu, dont le fait d’être ce qu’il est selon l’essence, quelle qu’elle soit, échappe à toute tentative de saisie et à toute curiosité indiscrète. […] C’est à partir de la grandeur et de la beauté des choses créées, selon une certaine analogie avec les choses connues, que nous parvenons à la connaissance de l’existence de Dieu, lui qui nous accorde seulement la foi à travers ses énergies (36), mais non pas la connaissance de ce qu’il est (37). » La connaissance par les énergies est donc comprise ici, non comme une connaissance de Dieu tel qu’il est, mais comme une connaissance de son existence à travers ses créatures, bien que cette énergie divine créatrice soit distinguée des créatures qu’elle crée. Remarquons encore que, quand Grégoire parle dans un contexte trinitaire, il emploie le terme « énergie » au singulier, ayant en vue l’énergie commune aux trois personnes divines. « Qui ne sait pas, dit-il […] que la puissance vivifiante procède sous forme d’énergie du Père et du Fils semblablement (38). » Ou. « Toute énergie d’origine divine qui se répand sur la création et qui est nommée suivant les multiples notions, part du Père, progresse par le Fils et trouve son achèvement dans l’Esprit Saint (39). » Elle est aussi nommée vie. « La même vie qui est aussi bien mise en énergie [ἐνεργείται] par le Saint Esprit, préparée de la part [παρά] du Fils et suspendue à la volonté du Père (40). » Ou, comme il dit. « Il y a une seule progression et transmission de la volonté bonne, qui se propage depuis le Père par le Fils jusqu’à l’Esprit (41). » Il s’agit ici de « volonté », mais comme Grégoire l’explique ailleurs, « il est clair qu’il ne peut exister aucune différence entre la volonté et l’énergie dans la nature divine (42) ».
En même temps, la doctrine de saint Grégoire à propos des noms peut, sans doute, éclairer ses conceptions de la nature de Dieu et de ses énergies, tout comme le problème de la connaissance de Dieu en général. On peut dire qu’elle est opposée à celle d’Eunome qui, prolongeant la ligne philosophique du Cratyle de Platon et influencé par le magisme de la mystique païenne tardive, développe toute une philosophie des noms comme ayant une origine divine et exprimant la nature des choses (43). Grégoire rejette radicalement ces théories d’Eunome. Sans vouloir examiner ici l’enseignement de Grégoire dans son ensemble, nous nous arrêterons particulièrement sur les points qui ont un rapport direct avec notre thème. Tandis qu’Eunome identifie, selon Grégoire, le nom au sujet (44), notre auteur considère que les noms et les paroles expriment un mouvement de notre pensée et nous sont nécessaires pour une certaine connaissance de Dieu, « pour pouvoir comprendre un peu quelque chose de ce que nous pouvons penser pieusement à son sujet [περὶ αὐτόν νοουμένων] (45) ». Les choses sont créées par Dieu, tandis que les noms le sont par notre puissance rationnelle (λογικὴν δύναμιν), bien que cette puissance elle-même, ainsi que la nature rationnelle, soient « l’œuvre de Dieu (46) ». Ils (les noms) désignent les puissances naturelles des choses (47). Quant à Dieu, il est au-dessus de tout nom, car « le seul nom approprié à Dieu est au-dessus de tout nom [Ph 2, 9]. En effet, le fait d’être au-delà de tout mouvement de pensée et d’échapper à la délimitation par un nom constitue pour les hommes une preuve de sa majesté ineffable (48) ». Les noms du Christ aussi (comme « Porte », « Pasteur », etc.) ne désignent pas son essence ou sa nature, mais ses « énergies ». « Aucun de ses noms, dit Grégoire, ne constitue ni la nature du Monogène, ni sa divinité, ni un caractère spécifique [ἰδίωμα] de son essence ; néanmoins le Monogène porte ces titres et l’appellation a un sens pertinent. […] Du moment que le Seigneur a exercé sa bienveillance de multiples manières au profit de la vie des hommes, chaque aspect de ses bienfaits est connu, de façon appropriée, grâce à chacun des noms de ce genre — les énergies (49) observées en lui étant exprimées sous forme de noms. Nous, nous disons que de tels noms sont attribués par nous, par voie de pensée conceptuelle [κατ’ ἐπίνοιαν τρόπου] (50). » Grégoire insiste beaucoup sur le fait que les noms ne s’appliquent pas à la nature divine, mais désignent Dieu selon ses énergies, car autrement il serait complexe. « Eh bien !, s’exclame-t-il, Est-ce qu’Eunome veut soutenir que ces appellations désignent la nature [divine] même ? Dans ce cas, il affirme donc que la nature divine est quelque chose de multiforme et de composé, et qu’elle révèle la complexité qui est la sienne par la différence des aspects signifiée par ces noms. […] Donc ils [ces noms] ne désignent pas la nature, mais nul n’osera dire que la dénomination liée à ces noms est impropre et privée de signification. Si donc le Seigneur est ainsi nommé, mais non pas selon la nature, et si tout ce qui est dit de lui par l’Écriture lui est appliqué de façon pertinente [κύριον], quelle autre explication pour l’application appropriée de telles appellations au Monogène Dieu reste-t-il, en-dehors du procédé de la conceptualisation [τοῦ κατ’ ἐπίνοιαν τρόπου] ? Car il est clair qu’on a formé des noms [ὀνοματοποιεῖται] pour le divin en fonction de la variété de ses énergies selon leurs différentes significations, et le divin se trouve nommé tel que nous l’avons conçu (51) ». Les noms sont donc des appellations des énergies diverses et, en ce sens, ils se distinguent de celles-ci. Comme appellations des énergies divines, les noms nous aident cependant à connaître Dieu, bien que pas selon sa nature.
Il est très important de noter ici que, tout en admettant que par un acte intellectuel nous nommions Dieu selon les énergies, Grégoire insiste sur le fait que ces noms ne sont pas seulement un pur produit de notre intellection mais, d’une certaine manière, correspondent à une réalité qui existe en Dieu. En tout cas, chaque nom désigne quelque chose de particulier en Dieu, car « si aucun de ces noms n’est compris selon un sens propre et si tous ces noms sont mélangés les uns avec les autres en raison de l’absence de distinction, il serait vain d’utiliser beaucoup de dénominations à propos du même sujet, puisqu’aucune différence de signification ne distingue les noms les uns des autres (52) ». C’est au contraire Eunome qui veut montrer qu’ « il n’existe aucune différence entre les divers noms en ce qui concerne la signification (53) ». Les noms permettent d’exprimer certaines notions contemplées dans la vie divine (54), comme « l’incorruptibilité » ou « l’infini », par exemple. Ils les constatent mais ne les créent pas ; ils ne rendent pas la vie divine incorruptible, mais indiquent qu’elle est ainsi (55). Grégoire distingue ici le « sujet » (ὑποκείμενον), la « notion » (νόημα) et le « nom ». « Par conséquent, le fait que la vie divine est illimitée dans les deux sens est une propriété du sujet, mais le fait que les notions observées dans le sujet sont exprimées de telle ou telle façon concerne uniquement le mot qui manifeste la pensée qui est signifiée. […] Par conséquent, le fait que le sujet est ce qu’il est se situe au-delà de tout nom et de toute pensée, mais le fait qu’il existe sans cause et qu’il n’aboutit jamais à la non-subsistance est exprimé par le sens contenu dans ces noms (56). » Par une multitude de noms, nous essayons de cerner ce qui est au-dessus de la connaissance, « puisque nous signifions moyennant des dénominations uniquement les choses connues et qu’il n’est pas possible de déterminer moyennant des appellations significatives les choses qui dépassent la connaissance, […] du fait que nous ne pouvons trouver aucune appellation appropriée par nature à ces choses et capable de désigner le sujet (57) de façon adéquate, nous sommes forcés de recourir, dans la mesure du possible, à des mots nombreux et variés, pour révéler la conception [ὑπόνοιαν] qui est née en nous à propos de la divinité (58). » Grégoire paraît donc admettre ici de nouveau que les noms nous aident à découvrir le Dieu inconnaissable. Mais, en soi, les noms n’ont aucune réalité, ils ne sont que des signes (59). Même l’appellation « Dieu » ne désigne pas son essence, mais une de ses énergies, comme Grégoire le dit lui-même. « Nous avons aussi compris que le nom de « Dieu » a prévalu en raison de l’activité d’observation. […] Par conséquent, nous avons appris à connaître par là une énergie (60) partielle de la nature divine, mais par cette appellation nous ne sommes pas parvenus à la compréhension de l’essence divine en elle-même (61). »
Comme nous avons pu le voir, Grégoire dit souvent, en parlant des noms et de leur application à Dieu, qu’ils sont employés κατ’ ἐπίνοιαν, « par intellection ». Il faut examiner ce que Grégoire entend par cette expression. Il le dit lui-même. « L’activité conceptuelle [ἐπίνοια] est la méthode [ἔφοδος] pour découvrir les choses ignorées ; au sujet de l’objet de la recherche, elle utilise ce qui est lié à une première appréhension et à ce qui en découle pour découvrir la suite. En effet, après avoir entrevu quelque chose de ce qui est l’objet de la recherche, nous ajustons ensemble la première idée et ce qui en résulte grâce à des notions que nous avons élaborées progressivement, et ainsi nous menons à son terme l’opération de recherche (62). » C’est donc un processus de connaissance graduelle. Grégoire a la plus haute idée de cette faculté intellectuelle qui, en dernier ressort, est d’origine divine, puisque c’est Dieu qui est le créateur de l’intellect. « À ce qu’il me semble, dit-il, il ne s’écarte pas, par erreur, d’un jugement droit celui qui estime que parmi tous les biens qui ont été produits par nous dans cette vie et qui existe dans nos âmes grâce à la divine Providence, le plus précieux en quelque sorte est l’intelligence conceptuelle (63). » Et il ajoute. « Toutes les choses, quelles qu’elles soient, qui ont été découvertes au cours de la vie humaine […] n’ont pas d’autre origine en nous que notre intelligence qui réfléchit et qui découvre chaque chose d’une manière appropriée à notre nature. Or, l’intelligence est l’œuvre de Dieu. donc tout ce qui nous est procuré par l’intelligence nous vient de Dieu (64). » Néanmoins, insiste Grégoire, l’intellection est incapable de saisir l’insaisissable et de connaître la nature divine. « Nous n’avons été amenés en rien à discerner ce que l’essence elle-même, qui existe en tant qu’inengendrée, est selon sa propre nature. En effet, selon toute vraisemblance, l’intelligence conceptuelle avec ses raisonnements ne saurait posséder une telle force spéculative qu’elle nous élève au-dessus des limites de notre nature et qu’elle nous donne accès à des choses incompréhensibles, si bien que nous pourrions embrasser par nos connaissances les choses à la compréhension desquelles il n’existe pas d’accès (65). » Mais le fait que l’ἐπίνοια (l’activité conceptuelle) soit « une énergie (66) de notre intelligence (67) » n’empêche pas qu’on puisse en faire un usage pieux dans notre connaissance de Dieu selon ses énergies, en lui appliquant des noms κατ’ ἐπίνοιαν, « selon l’intellection », mais qui n’expriment pas sa nature ineffable (68). Ainsi, par exemple, Dieu est nommé selon des intellections différentes (κατὰ διαφόρους ἐπινοίας), « lumière », « vie », « incorruptibilité », et par d’autres noms de ce genre (69). On pourrait donc dire que Grégoire admet que notre connaissance de Dieu s’effectue, en partie du moins, par un acte intellectuel humain, l’ἐπίνοια, ou intellection comme il aime à s’exprimer, que c’est un procédé normal et pieux qui nous permet de connaître Dieu selon ses actions ou dans ses énergies différentes, de les nommer par des noms qui correspondent à une réalité en Dieu, mais sans jamais saisir ce que Dieu est en soi, dans son essence et sa nature incompréhensible, inabordable et ineffable. On pourrait même dire que, pour Grégoire de Nysse, il y a en Dieu, d’un côté, quelque chose d’inconnaissable et d’inabordable — pour toute créature du moins — et de cognoscible et d’accessible, de l’autre.
Nous voudrions nous arrêter encore sur ces distinctions en Dieu. C’est dans sa lettre à Ablabius (70) que Grégoire en parle clairement. Il y emploie, comme d’ailleurs dans ses autres écrits, l’expression importante pour comprendre sa doctrine. « autour de la nature divine [τὰ περὶ τὴν θεῖαν φύσιν] (71) ». Ainsi, Grégoire écrit, en résumant en quelques lignes ses convictions théologiques. « Or, nous qui suivons les préceptes de l’Écriture, nous avons appris que la nature divine est innommable et ineffable, et nous disons que tout nom, qu’il soit inventé par l’usage des hommes ou transmis par les Écritures, est l’interprète des pensées que l’on se fait autour de la nature divine [τῶν περὶ τὴν θεῖαν φύσιν νοουμένων], sans saisir la signification de la nature elle-même (72). » Deux choses paraissent claires dans ce passage. une distinction existe entre la nature divine et ce qui l’entoure ; cette distinction est aperçue par un acte intellectuel mais confirmée par l’Écriture, elle est donc traditionnelle. Et Grégoire continue. « Nous trouvons que, par chacun des noms, peut se penser et se dire un certain sens externe qui concerne la nature divine, sans que celui-ci ne signifie ce qu’est la nature par essence (73). » L’impossibilité de donner un nom à la nature divine est, selon Grégoire, la conséquence du fait qu’elle est illimitée. « Car nous croyons que la nature divine est illimitée et incompréhensible, nous n’y appliquons aucun nom, mais nous affirmons que la nature doit de toute manière être pensée au moyen de l’infinité. Or, le totalement infini n’est limité ni d’un côté ni d’un autre, car l’infinité échappe de partout à la limite. Ce qui est donc hors de toute limite ne peut assurément pas non plus être limité par un nom. C’est pourquoi, de manière à ce que subsiste la notion de l’illimité dans tout ce qui concerne la nature divine, nous disons le divin au-dessus de tout nom ; or, la « divinité » est un des noms. Il n’est donc pas possible de penser que la même réalité est un nom, et qu’elle est au-dessus de tout nom (74). » « Il a été établi, dit encore Grégoire, que le nom de la divinité signifie l’énergie et non la nature (75). » La distinction que fait ici Grégoire entre la nature divine et l’énergie est claire. La première est au-dessus de tout nom, la deuxième peut être nommée. Et Grégoire peut donc s’exclamer. « Un seul nom est significatif de la nature divine. l’étonnement qui surgit indiciblement dans notre âme devant elle (76). » Quant à l’expression « autour de la nature divine », Grégoire dit que tout ce qui est contemplé autour du divin a la même qualité d’inchangeabilité que le divin lui-même. « Il faut croire — pensons-nous — que seul ce qui est éternel et illimité selon son être est véritablement divin, et que tout ce qui est contemplé autour de lui existe toujours de la même manière, sans augmentation ni diminution (77). » Dans ses Homélies sur les Béatitudes, Grégoire parle aussi de « ce que nous pouvons percevoir de la nature divine » et qui « dépasse les limites de notre condition (78) ». Il s’agit donc d’un terme familier à Grégoire qu’il emploie dans ses écrits théologiques et spirituels et qui évidemment veut dire quelque chose. Grégoire en donne certaines explications dans son Discours catéchétique. Parlant des buts de la création il dit. « Sa lumière ne devait pas rester invisible, ni la gloire sans témoins, ni la bonté sans bénéficiaires, ni toutes les autres qualités que nous voyons attachées à la nature divine demeurer inefficaces, du fait qu’il n’y aurait eu personne pour y participer et en jouir (79). » À noter que parmi les choses contemplées « autour de la nature divine », Grégoire compte la gloire et la lumière.
Comment donc, dans cette doctrine sur Dieu, se pose le problème de la simplicité de la nature divine ? Car il s’agit d’un des points importants de la théologie de Grégoire et il y revient constamment. C’est un dogme fondamental de l’Église, partagé, comme nous l’avons vu plus haut (80), même par les personnes de l’intelligence la plus terre-à-terre. « Mais, dans l’Église de Dieu, il n’existe pas, dit-il encore, […] une doctrine de ce genre qui enseigne que celui qui est simple et non composé apparaît non seulement multiforme et complexe, mais composé d’éléments contraires. En effet, la simplicité de la doctrine de vérité propose Dieu tel qu’il est réellement, lui qui ne peut être délimité ni par un mot, ni par une pensée, ni par quelque autre mode d’appréhension, non seulement humain, mais aussi angélique, et reste toujours au-delà de toute compréhension supraterrestre, étant ineffable et indicible et supérieur à tout ce que les mots peuvent exprimer, ayant un nom qui fait connaître sa propre nature, le seul nom au-dessus de tout nom (81). » C’est un des rares passages où Grégoire semble parler de la simplicité de Dieu et non de la simplicité de sa nature divine, comme il le fait généralement. Mais à y regarder de plus près, comme il parle de Dieu « tel qu’il est » et achève en disant que la nature divine est au-dessus de tout nom, le sens semble être à peu près le même. En général, comme on le verra plus loin, Grégoire de Nysse, en défendant la simplicité de la nature divine, ne croit pas nécessaire de nier toute distinction en Dieu. Au contraire, il les admet, mais il veut les comprendre, les expliquer et démontrer surtout qu’elles ne contredisent pas la simplicité de sa nature.
Pour rendre plus claire sa conception de simplicité de la nature divine, Grégoire recourt à une comparaison avec l’âme humaine et ses nombreuses et différentes facultés et activités, qui ne la rendent cependant pas composée de beaucoup de parties, bien que les appellations de ces activités ne signifient pas la même chose. Ce qui est d’autant plus vrai de Dieu. « Si donc l’esprit humain ne subit aucun préjudice sous le rapport de la simplicité en raison de la multiplicité des noms qui lui sont appliqués, comment quelqu’un pourrait-il penser que Dieu, lorsqu’il est appelé sage, juste, bon, éternel ou autres dénominations dignes de Dieu, ou bien devienne un composé d’éléments variés ou acquière pour lui-même la plénitude de sa nature par participation à ces notions, si l’on n’admet pas l’unicité de signification pour toutes les dénominations (82) ? » Bien que Grégoire affirme ici que les noms divins sont donnés par les hommes, ils correspondent à des réalités existantes en Dieu, bien que différentes. Il est vrai cependant que l’âme humaine à cause de sa faiblesse ne peut pas clairement voir cette « unité dans la diversité » de Dieu et a tendance à perdre de vue la simplicité de sa nature. « La nature divine, écrit Grégoire, quelle qu’elle soit selon l’essence, est une, simple, uniforme et non composée, et que, d’aucune manière, elle ne peut être considérée comme composée d’éléments variés ; par contre, l’âme humaine, qui se tient au niveau de la terre et est enfouie dans les profondeurs de cette vie terrestre, du moment qu’elle ne peut percevoir distinctement ce qu’elle cherche, tend vers la nature ineffable, de diverses manières, sous maintes formes et à l’aide de nombreuses notions, sans pouvoir atteindre le mystère caché en faisant appel à une seule conception (83). » Grégoire insiste aussi sur le fait que les « qualités » contemplées en Dieu ne sont pas quelque chose d’acquis à quoi il participe, mais qu’il est ce qu’il possède. « En effet, celui pour qui la bonté n’est pas acquise de l’extérieur, mais qui, par nature, est bon en tant que tel [καθό ἐστι τοιοῦτον πέφυκεν], ne connaît aucun manque en fait de sagesse ou de puissance ou de quelque autre bien. C’est pourquoi, celui qui prétend percevoir des essences plus ou moins grandes dans la divine nature, établit à son insu que la divinité est composée d’entités dissemblables, en sorte qu’il faut considérer comme une chose le sujet, comme autre chose ce à quoi il participe. ainsi ce qui ne possédait pas la bonté par nature devient bon par participation (84). » Par ce texte important, dirigé contre l’affirmation d’Eunome que le Fils est plus petit que le Père, Grégoire veut montrer que ce sont des distinctions qualitatives et surtout quantitatives qui introduisent une composition en Dieu. Dieu est ce qu’il possède et nous devons le penser comme un tout, comme Grégoire le souligne de nouveau dans le texte suivant. « Désirer le bien et avoir ce qu’on a voulu, tout est pensé ensemble et en même temps, dans le cas de la nature simple et toute puissante (85). » C’est aussi l’inchangeabilité de Dieu qui est mise en connexion avec sa simplicité. « Dieu, dit Grégoire, étant le bien un, regarde toujours, en sa nature simple et non composée, dans le même sens, et ne change jamais par les impulsions de sa volonté, mais il veut toujours ce qu’il est et, incontestablement, est ce qu’il veut (86). » Ici de nouveau, nous voyons que la simplicité est plutôt comprise comme absence de contradiction et comme indivisibilité de Dieu. D’ailleurs toutes ces notions sont issues de l’essence divine et sont contemplées en elle. « Laquelle des notions dignes de Dieu ne s’attache-t-elle pas à l’essence même du Fils, comme le fait d’être juste, bon, éternel […] ? Existe-t-il quelqu’un qui dise que quelque chose de bon a été acquis (de l’extérieur) par la nature divine, et non que tout ce qui est bon provient de celle-ci et est constaté en elle (87) ? » Ces notions se distinguent cependant de l’essence divine elle-même. « L’idée d’inengendré est une chose, affirme Grégoire, et la nature [λόγος] de l’essence divine est autre chose [ἄλλο τι] (88). »
Et chaque nom désigne quelque chose de différent en Dieu. « Chacun de ces termes a un sens spécifique (89). » Grégoire parle ailleurs, dans sa polémique contre Eunome, de « différences de qualités ou de propriétés, telles qu’elles sont conçues par l’intelligence qui raisonne au sujet de l’essence [τῷ λόγῳ τῆς ἐπινοίας] » et qui « sont autre chose que le sujet (90) qui en est doué (91) ». Et il explique. « L’objet de la présente enquête [est] le sujet (92) même, auquel revient le nom d’« essence » au sens propre (93). »Il est vrai que Grégoire a ici en vue les choses créées, « ce qui concerne le corps ou l’âme (94) ». Cependant, comme nous l’avons vu, Grégoire considère que l’âme avec ses facultés est une image de la simplicité divine, qui nous permet de comprendre cette dernière, et donc le passage cité ne perd pas sa valeur, même appliqué à l’essence divine. Quoiqu’il en soit, Grégoire démontre que toutes ces distinctions ne contredisent pas la simplicité de la nature divine. « Nous ne divisons pas le sujet en lui-même par de telles pensées, dit-il, mais nous croyons que, quelle que soit son essence, il est un, et nous admettons que ce que l’on pense de lui a un rapport d’affinité avec toutes ces notions (95). » Il comprend l’unité divine comme absence de contradictions. « Les noms ne sont pas en conflit les uns avec les autres selon le mode naturel des opposés, au point que si l’un existe l’autre ne peut être envisagé en même temps (96). » C’est la différence selon l’essence qui est incompatible avec la simplicité. « Puisque la nature divine, simple et immuable, repousse loin d’elle toute altérité d’essence, tant qu’elle reste une, elle n’admet pas pour elle-même de signification plurielle (97). » « Comment un mélange avec une réalité différente pourrait-il être supposé dans ce qui est simple ? En effet, ce qui est conçu comme étant associé à quelque chose ne serait plus simple (98). » Ailleurs, Grégoire identifie le simple avec l’immuable. « Ce qui est simple par nature, dit-il, n’est pas composé de parties et n’est pas complexe, et quoi qu’il soit, l’est entièrement, ne devenant pas différent par un changement quelconque à partir de quoi que ce soit d’autre, mais demeurant pour l’éternité dans ce qu’il est (99). » C’est Eunome qui « greffe chacun des noms concernant la divinité sur l’essence de Dieu (100). » Maintes fois, nous voyons que la simplicité divine est comprise par Grégoire comme l’absence de contradictions en Dieu. « Si [les eunomiens] conviennent que [le Monogène] est simple, comment est-il possible de contempler dans la simplicité du sujet un concours de contraires (101) ? », comme le font les eunomiens en attribuant à sa divinité des attributs contraires, par exemple « créé » et « incréé ». Et Grégoire remarque. « Tel est le Dieu d’Eunome, quelqu’un de double nature ou multicomposé, divisé lui-même contre lui-même, ayant une puissance qui ne s’accorde pas avec sa puissance (102) ». Comme on peut le voir, ce n’est pas le fait d’avoir une puissance qui produit la composition, mais d’avoir des puissances qui se contredisent. « Car ce qui est simple par nature ne se déchire pas par des propriétés contraires (103). » Et. « À qui manque la simplicité, on y trouve à l’évidence le varié et le composé (104). » Grégoire ne dit cependant jamais que la simplicité divine pourrait signifier l’absence de toute distinction ou différence ontologique en Dieu. Au contraire, comme nous avons tâché de le montrer déjà, il admet des distinctions pareilles, non seulement entre la nature divine et les hypostases trinitaires et les hypostases entre elles, mais aussi entre la nature divine et ce qui est « autour » d’elle, entre la nature et les « énergies », entre les noms qui désignent ces énergies et l’essence inexprimable. Des distinctions, communiquées par l’Écriture ou découvertes en Dieu par notre intellection, perceptibles seulement d’une manière partielle à cause de la faiblesse de l’intellect humain, mais qui existent néanmoins en Dieu ou, en tout cas, qui correspondent à la réalité divine et qui ne diminuent en rien la simplicité de la nature divine. Donnons encore quelques exemples, pour éclaircir la question.
Grégoire note souvent que ce que nous distinguons en Dieu, comme par exemple, qu’il est appelé « lumière », n’est pas une simple construction de notre intelligence mais correspond à une certaine réalité divine. « Nous pensons, dit-il, que l’appellation de « lumière » n’est pas attribuée à la nature divine comme un simple mot, séparé de toute signification, mais qu’elle renvoie à un certain substrat (105) » (le Père et le Fils dans le cas présent). Et si cette lumière se caractérise par des adjectifs différents. « lumière inaccessible » pour le Père, « lumière véritable » pour le Fils, cela ne diminue en rien la simplicité de l’essence divine, car ces qualificatifs n’expriment pas l’essence divine, mais ce qui est contemplé autour d’elle. « Par ces expressions, l’Écriture ne nuit en rien à la simplicité, car le commun et le particulier ne sont pas l’essence, de sorte que même leurs concours pourrait indiquer que le sujet est composé. L’essence en soi reste ce qu’elle est selon la nature, étant ce qu’elle est elle-même. Et toute personne qui dispose d’intelligence dira que cela concerne ce qu’on pense, ou contemple, autour de l’essence (106). » De même, la communion de Dieu avec l’homme dans l’appellation « bon » ne rend pas de Dieu composé. « Dieu n’est pas composé parce qu’il a l’appellation « bon » en commun avec l’homme. Par là, l’on confesse donc clairement qu’autre est la notion [λόγος] de communion et autre celle de l’essence ; cela ne créée cependant pas, pour la nature simple et non quantifiée, de complexité et de multicomposition, que ce qui est contemplé autour d’elle soit considéré de manière individuelle ou cela ait une signification commune (107). »
La notion d’énergie (ou énergies) divine occupe une place encore plus importante dans la théologie de saint Grégoire de Nysse, bien que semblable à l’expression « autour de la nature divine ». Parfois, suivant les traces de saint Basile (108), il parle de « l’énergie de Dieu qui seule descend jusqu’à nous (109) » (en la distinguant évidemment de la nature divine). Une autre fois, parlant des œuvres de Dieu dont témoignent les prophètes dans les Écritures, il précise, distinguant « nature », « puissance » et « énergie ». « C’est une partie, assurément, de l’énergie divine, dit-il, que de telles allégories grandioses expriment dans le texte du Prophète ; quant à la puissance elle-même dont est issue cette énergie — pour ne pas parler de la nature dont est issue cette puissance ! — il ne l’a pas exprimée, il n’était pas en situation de le faire (110). » Ailleurs, Grégoire distingue clairement l’énergie et l’être divin. « De même qu’en disant que « Dieu est juge », nous entendons par le mot « jugement » une certaine énergie autour de lui et par le mot « est » nous dirigeons notre intellect vers le sujet, montrant clairement par là que nous estimons que la notion [λόγος] de l’être [τοῦ εἶναι] n’est pas identique à celle de l’énergie, de même, en disant qu’ « il est engendré » ou « inengendré », nous divisons notre pensée en une double affirmation, en entendant par le « est » le sujet, et par « engendré » ou « inengendré », ce qui est ajouté au sujet (111). » Les énergies divines sont nombreuses et variées, et c’est selon ces énergies que nous appliquons par un acte d’intellection des noms variés à Dieu, mais qui correspondent à une réalité en lui. Ces énergies relèvent de la nature (112) et — ce qui est d’une importance capitale pour comprendre ce que Grégoire entend par la notion de simplicité divine — leur multitude n’empêche pas le Fils de Dieu être un dans sa nature inconnaissable. Ainsi, dit Grégoire, en s’appropriant un passage d’Eunome, « le Seigneur aussi est en lui-même ce qu’il est selon sa nature, quelle qu’elle soit, mais s’il est dénommé en fonction de ses différentes activités, il ne possède pas uniquement une seule dénomination s’appliquant dans tous les cas ; mais il change de nom conformément à chaque notion née en nous en fonction de telle ou telle activité. […] Il est possible d’attribuer au Fils de Dieu, qui est unique selon son être profond, de nombreux noms en fonction de ses différentes activités et de la relation aux effets obtenus grâce à ces activités, de même que le blé, tout en étant un, reçoit en partage de différentes appellations selon les idées variées que l’on peut se faire à son sujet (113) ». Le désaccord entre Eunome et Grégoire concerne, semble-t-il, le « sens des noms », à savoir « s’ils désignent la nature ou s’ils sont attribués en fonction de la pensée conceptuelle à partir des énergies (114) ». Grégoire réfute l’accusation calomnieuse d’Eunome contre Basile qui, selon Eunome, identifiait l’essence et l’énergie du Monogène (115). Par contre, Grégoire affirme que le sens (λόγος) de l’essence et de l’énergie n’est pas le même et que ce que désignent ces deux expressions est différent (116). Le caractère réel de cette distinction entre l’essence et l’énergie est exprimé ici clairement.
Dans les nombreux passages de Grégoire que nous avons examinés jusqu’ici, les problèmes de la simplicité de la nature divine et de l’essence et des énergies en Dieu sont traités sur un plan plutôt intellectuel. Il serait intéressant de les étudier aussi du point de vue spirituel, dans ses œuvres en général et dans ses écrits sur la vie spirituelle en particulier. La frontière entre l’intellectuel et le spirituel est cependant difficile à tracer chez Grégoire. Il conteste en général l’efficacité de la méthode intellectuelle de la connaissance de Dieu par voie de syllogismes, et lui oppose une illumination par le rayon de la grâce qui nous réchauffe, sans nous donner, toutefois, de saisir l’insaisissable. « [Les eunomiens] qui voient la divine puissance éclairer les âmes par les dispositions de la Providence et les merveilles de la création, répandant en quelque sorte les rayons et la chaleur émanant naturellement du soleil, ils n’admirent pas cette grâce et n’adorent pas celui à qui ces réalités font penser ; mais, outrepassant la capacité de compréhension de l’âme, ils cherchent à enserrer celui qui est impalpable dans les filets de leurs sophismes et ils estiment le tenir dans leurs mains grâce à leurs syllogismes (117). » La grâce — Grégoire le dit d’ailleurs aussi à propos de l’énergie (118) — est pour lui une force divine qui descend vers nous, une manifestation de Dieu qui, par amour des hommes, se conforme à notre faiblesse, une théophanie de lumière qui laisse cependant inconnaissable et incommunicable la nature divine. Ce n’est pas seulement une intellection par laquelle nous nous élevons vers Dieu, mais aussi une condescendance de Dieu envers nous. Grégoire en parle souvent dans le langage traditionnel de la mystique patristique et byzantine. Nous en donnerons quelques exemples. « Nous affirmons que la philanthropie est la raison pour laquelle Dieu a accepté d’avoir des relations familières avec l’homme. Mais puisque la petitesse de la nature ne peut pas outrepasser ses propres limites et atteindre à la condition élevée de la nature suprême, pour ce motif, Dieu lui-même abaisse sa puissance bienveillante pour les hommes jusqu’au niveau de notre faiblesse et il dispense sa grâce et son aide, autant qu’il nous est possible de les recevoir (119). » Et Grégoire cite l’exemple du soleil dont les rayons et la chaleur sont adoucis par l’air, lui-même cependant restant de par sa nature inaccessible à notre faiblesse (120). De même, la puissance divine inaccessible condescend vers nous dans les théophanies, et nous la perçevons dans les voies de la providence. « La puissance divine […] tout en surpassant infiniment notre nature et tout en étant inaccessible à une pleine communauté [μετουσίαν] de notre part, joint, comme une mère compatissante, ses balbutiements aux cris inarticulés dépourvus de sens des petits enfants, et donne à la nature humaine ce qu’elle est capable de recevoir ; c’est pourquoi, dans des apparitions variées aux hommes, Dieu prends une apparence conforme à celle des hommes et parle à la manière des hommes […] de façon que, à travers ce qui est en affinité avec nous, nous soyons comme conduits par la main dans notre vie qui ressemble à celle des petits enfants et qui est en contact avec la nature divine à travers les paroles de la Providence (121). » Comme nous voyons, dans tous ces exemples il s’agit d’une puissance divine qui descend vers nous, se conforme à notre faiblesse pour pouvoir être reçue et qui nous fait « frôler » la nature divine inaccessible.
Grégoire parle ici de la grâce comme d’une manifestation divine. Ailleurs, il parle de la lumière comme d’une des appellations de Dieu, dont témoigne l’Écriture. Il l’appelle « nom » pour montrer que cela ne s’applique pas à la nature divine elle-même. « Moïse, voyant Dieu dans la lumière [Ex 3, 2], écrit-il, Jean qui le nomme la « vraie lumière » [Jn 1, 9] et de la même manière, Paul, lors de la première manifestation divine, entouré de lumière et entendant ensuite à partir de cette lumière la voix qui disait. « Je suis Jésus que tu persécutes » [Ac 9, 5], n’est-ce pas là un témoignage suffisant (122) ? » Grégoire parle aussi de la gloire « indicible » et « pré-éternelle » de Dieu Monogène et s’indigne contre les eunomiens qui la considèrent comme quelque chose de créé. « Ils sont impies, dit Grégoire, car en abaissant, autant que possible, la gloire indicible de Dieu Monogène, ils la rabaissent et l’assimilent à la création (123). » « Ils ne sont pas en état de produire l’opinion d’un seul saint, qui suggérerait de contempler la gloire d’avant les siècles de Dieu Monogène ensemble avec la création assujettie (124). » Ceci est clair, car il ne peut y avoir rien de créé dans ce qu’on peut contempler en Dieu. « Il est évident, pour tous sans exception, que le Dieu qui est au-dessus de toute chose n’a en lui-même rien de créé ou d’introduit du dehors, ni puissance, ni sagesse, ni lumière, ni verbe, ni vie ni vérité, ni en général rien de ce qui est contemplé dans la plénitude du sein divin (et tout cela est le Dieu Monogène qui est dans le sein du Père). Le nom de créature ne pourrait donc être appliqué d’une manière convenable à rien de ce qui est contemplé en Dieu (125). » Et Grégoire revient ici à sa distinction entre la nature divine et ce qui est « autour » d’elle, en les examinant du point de vue du degré de leur cognoscibilité. « La prophétie proclame que la grandeur divine n’a pas de limites, et prêche d’une manière explicite qu’il n’y a pas de limite à sa magnificence, sa gloire, sa sainteté. Si donc ce qui est autour de lui est sans limites, bien davantage lui-même, selon l’essence — quoiqu’il puisse être —, ne peut être saisi en aucune de ses parties par une définition (126). » Notons ici que Grégoire classe la gloire divine parmi ce qui se trouve « autour de la nature divine ». Quant à ce qu’il dit sur le fait qu’elle n’appartient pas à l’ordre du créé, il faut avoir en vue que, pour Grégoire, la plus grande distinction qui puisse exister est celle entre le créé et l’incréé, comme il le dit lui-même. « La division la plus fondamentale entre tout ce qui existe est la coupure entre le créé et l’incréé. L’un est la cause de tout ce qui vient à exister, l’autre tire son origine du premier (127). » Et entre l’incréé et le créé, il n’y a aucun intermédiaire. « La raison ne connaît rien d’intermédiaire entre les deux, de sorte qu’une nature particulière, nouvellement constituée à la frontière entre créé et incréé, soit conçue comme intermédiaire entre les deux, si bien qu’elle participerait à l’un et à l’autre mais ne serait parfaitement aucun de deux (128). » Et, en parlant de Dieu, Grégoire emploie l’expression de « puissance incréée » (ἀκτίστου δυνάμεως) (129).
Dans son traité Sur le Saint Esprit, Grégoire de Nysse développe davantage sa doctrine sur la grâce et la gloire comme énergies trinitaires, communes aux trois hypostases, distinctes de la nature divine et appartenant à ce que Grégoire appelle généralement « autour de la nature divine ». « L’Écriture enseigne, dit-il notamment, que la foi dans le nom du Père, qui vivifie tout […], précède, afin que la grâce vivifiante, qui a en lui son origine [ἀφορμηθεῖσαν] comme d’une source qui fait jaillir la vie, par le Fils Monogène — lequel est la vie véritable —, au moyen de l’action de l’Esprit, rende parfait ceux qui en sont dignes (130). » C’est un mouvement trinitaire dirigé vers les hommes. « La grâce, qui coule inséparablement du Père par le Fils et l’Esprit sur ceux qui en sont dignes (131). » Et ayant en vue Jean 17, 15 sur la gloire du Fils auprès du Père, Grégoire parle de la gloire circulaire de la Sainte Trinité. « Vois-tu le mouvement circulaire de la gloire ? Le Fils est glorifié par l’Esprit. Le Père est glorifié par le Fils. De nouveau le Fils reçoit la gloire d’auprès du Père et le Monogène devient la gloire de l’Esprit. Car par quoi sera glorifié le Père sinon par la gloire véritable du Monogène ? Et en quoi de nouveau le Fils sera-t-il glorifié, si ce n’est dans la magnificence de l’Esprit ? Ainsi la parole, en retour, glorifie le Fils par l’Esprit et le Père par le Fils (132). » Néanmoins, toute cette gloire n’est que ce qu’on distingue « autour de la nature divine », laquelle demeure invisible et inaccessible. Grégoire le dit nettement. « [Le prophète] n’a pas loué la nature. Comment aurait-il pu louer ce qu’il ignore ? Mais il a glorifié quelque chose qu’on peut contempler autour d’elle (133)… Tu vois comment l’étonnement du prophète a été rendu complet par les choses contemplées autour de la nature divine ? Mais celle-ci, en ce qu’elle est la puissance divine et bienheureuse, reste inaccessible et invisible aux pensées, ayant laissé bien plus bas, plus éloignés que sont nos corps des étoiles, toute curiosité d’esprit, toute puissance du discours, tout mouvement du cœur, tout élan des sentiments (134). » Cette distinction que fait Grégoire entre ce qui peut être contemplé « autour de la nature divine » (la grâce, la gloire, etc.) et la nature divine inaccessible elle-même ne brise pas l’unité de Dieu, justement parce que sa puissance trinitaire est une. « Ne pas diviser la foi en une multitude de puissances et divinités, mais croire en une seule puissance, une seule bonté, une seule force vivifiante, une seule divinité, une seule vie », ainsi formule-t-il son attitude théologique (135). Il résume ainsi cette antinomie du visible et de l’invisible en Dieu. « Invisible en sa nature, Dieu se manifeste en ses énergies, apparaissant dans certains environnements de lui-même (136). » Dans le langage de l’expérience spirituelle, Grégoire s’exprime ainsi. « pureté, sainteté, la simplicité, lumineux rayons jaillis de la nature divine, qui nous montrent Dieu (137). » D’ailleurs, il y a deux manières de voir Dieu. l’une — intellectuelle — de connaître sa nature, chose impossible, l’autre — mystique — d’être uni à lui, la seule valable. « Cette promesse de voir Dieu offre deux sens, écrit saint Grégoire dans ses Homélies sur les Béatitudes. d’une part, il s’agit de connaître la nature transcendante, et de l’autre de se joindre à elle par une vie pure. L’Écriture nous apprend que l’un de ces modes de connaissance est impossible, mais le Seigneur promet l’autre à tous les hommes. « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu » [Mt 5, 8] (138). » La distinction entre le connaissable et l’inconnaissable en Dieu paraît donc être surpassée dans l’union mystique avec lui. C’est la déification selon la grâce, quand « l’homme sort de sa propre nature, de mortel il devient immortel, de périssable impérissable, d’éphémère éternel et en somme, d’homme il devient Dieu (139) ». Ou, comme il s’exprime dans les mêmes Homélies sur les Béatitudes. « À quoi te convie la béatitude, sinon à devenir Dieu, en portant l’empreinte propre de la divinité (140). » En mentionnant ici les « propriétés divines », Grégoire semble indiquer qu’il ne s’agit pas d’une déification selon la nature. La tristesse de ne pas connaître Dieu selon la nature reste donc en nous, bien que nous soyons abondamment consolés selon la promesse du Seigneur. « Bienheureux les affligés car ils seront consolés [Mt 5, 5] (141). »
C’est cependant dans les Homélies sur le Cantique des Cantiques, et notamment dans la onzième, sur l’Époux et sa main, que se trouve exposée avec le plus de netteté la distinction entre la nature divine et ses énergies, et que le caractère réaliste de cette distinction est le plus marqué. Ainsi, après avoir mentionné que ce n’est plus la voix de l’Époux qui frappe à la porte du cœur de l’épouse, mais la main divine elle-même qui s’introduit à l’intérieur de l’habitation par la fente de la porte (142), Grégoire souligne que la main n’est pas l’Époux lui-même, bien qu’elle lui appartienne. « [L’ouverture] par laquelle n’est pas passé l’Époux, mais seulement sa main, à grand-peine, pour pénétrer à l’intérieur et toucher celle qui désire le voir, en lui donnant comme seule satisfaction de reconnaître que c’est la main de l’être désiré (143). » Grégoire explique plus loin (selon une expression basilienne qu’il emploie plus d’une fois comme nous l’avons vu plus haut (144)) que la main symbolise la grâce de Dieu qui descend jusqu’à nous. « L’âme humaine […] mettant en œuvre tous raisonnements et toute faculté d’investigation des concepts, travaillant à saisir l’objet de sa recherche, met comme limite à son entendement la seule énergie de Dieu qui descend jusqu’à nous et qui nous est perceptible à travers notre vie (145). » Ce que nous semble le plus frappant dans ce passage, c’est le double mouvement qui aboutit à notre communion avec Dieu. la condescendance divine, l’énergie qui descend vers nous, et notre vie (plus que l’intellection qui paraît ne pas mener à grand chose) qui nous permet de ressentir cette descente de l’énergie divine. Grégoire revient de nouveau sur ce thème en soulignant que c’est seulement par ses actions que Dieu est connu. « Quand [l’âme humaine] se tend depuis les réalités terrestres vers la connaissance des réalités transcendantes, elle comprend les merveilles de l’énergie divine, mais elle ne peut pas avancer plus loin par sa seule activité débordante. Elle admire et vénère celui dont elle découvre qu’il est la source unique de son activité [δι’ ὧν ἔνεργει] (146). » Il faut cependant remarquer que, dans ce passage, comme dans celui qui suit, l’expression « énergie » change quelque peu de sens. Ce n’est plus une manifestation divine qui nous unit à Dieu, mais plutôt sa puissance créatrice qui nous fait connaître qu’il existe. « Quand elle voit cela et tout ce qui révèle l’énergie créatrice de Dieu, l’âme, dans l’admiration des apparences, remonte par le raisonnement de la pensée jusqu’à celui dont l’existence se révèle par les œuvres (147) ». Comprenant donc ici la connaissance de Dieu par ses énergies comme connaissance du créateur par ses œuvres, Grégoire admet que cette vision non immédiate et partielle est due à notre faiblesse et qu’elle est propre à la vie terrestre, mais aussi que l’on peut espérer dans la vie future une connaissance autre et plus haute. Une telle affirmation paraît être en contradiction avec d’autres passages de ses écrits où il parle de l’incognoscibilité radicale de Dieu selon son essence ou nature, même dans le monde à venir, même pour les anges et toute autre créature (148). Ainsi, dit-il. « Peut-être dans le temps à venir, quand […] nous émigrerons vers cette autre vie […], ne découvrirons-nous plus comme maintenant la nature du bien de manière partielle et à travers ses œuvres, et le transcendant ne sera-t-il plus conçu à travers la force qui agit dans le monde visible ; non, c’est d’une autre manière que sera saisie dans sa plénitude la nature de la béatitude indicible. Toute différente sera la manière de jouir qui maintenant n’a pas une nature lui permettant de « monter au cœur de l’homme » [1 Co 2, 9] (149). » Cette contradiction apparente pourrait être expliquée par le fait que Grégoire ne donne pas au mot « énergie » un sens toujours identique dans ses écrits, comme nous le voyons dans le cas présent. action créatrice de Dieu et donc connaissance analogique de Dieu par ses œuvres, ou bien « condescendance » de Dieu, manifestation divine qui nous révèle Dieu et nous unit avec lui par ses « énergies », sans que sa nature devienne connue ou accessible. Selon saint Grégoire de Nysse, c’est seulement la connaissance analogique qui sera dépassée dans le monde à venir. Nous aurons alors une autre manière, plus directe, de connaître Dieu. Mais, quoi qu’il en soit, pour le moment, la seule manière de connaître Dieu passe par ses « énergies », symbolisées par la « main ». « Jusqu’à présent, dit-il, la limite pour l’âme de l’indicible connaissance, c’est l’énergie créatrice qui apparaît dans les êtres, et qui est désignée ici par l’image de la main (150). » Tout en expliquant ceci par notre faiblesse, Grégoire insiste de nouveau sur la différence entre l’ « Époux » et la « main ». « L’âme pure […] s’attend à accueillir l’Époux en personne tout entier dans sa demeure et se trouve bien contente de voir seulement sa main par laquelle se manifeste sa puissance agissante. […] Car la pauvreté humaine ne peut recevoir en elle la nature illimitée et infinie (151). » Il semble qu’il s’agisse ici plutôt d’une expérience mystique que de connaissance analogique. Cependant, Grégoire propose encore une autre explication de l’image de la main. elle symbolise la grâce de l’Évangile et les miracles du Verbe incarné, par lesquels la divinité du Christ s’est manifestée, « car nous appelons main sa puissance capable de réaliser des miracles (152) ». Il trouve toutes ces explications utiles à l’âme, car « d’un côté, on part du principe que la nature divine, étant absolument impossible à saisir ou à imaginer, est connue seulement par ses énergies. De l’autre, on dit que la grâce évangélique est annoncée [prophétiquement] (153). »
Nous aurions pu continuer assez longtemps à citer saint Grégoire, éclaircissant sa doctrine sur Dieu en général et sur la simplicité de la nature divine et les distinctions en Dieu en particulier, mais pour ne pas prolonger démesurément notre exposé, nous nous limitons à ce qui a été mentionné plus haut. Cela paraît suffisant pour tirer quelques constatations et conclusions. Au sujet la simplicité de la nature divine, tout d’abord. Il faut essayer de comprendre ce que Grégoire de Nysse entend par cette notion. Comme nous l’avons vu, il en parle fréquemment, en lui donnant des sens assez différents — bien qu’à notre avis, plutôt complémentaires que contradictoires. Ainsi, la simplicité est comprise comme opposée à la complexité, à quelque chose qui est composé de parties dont l’ensemble fait un tout et qui, en raison de sa nature composée, est sujet à la dissolution. Par contre, la nature divine est simple, il n’y a pas de parties en elle ; elle est donc indissoluble et ne peut subir de décomposition. Ensuite elle est simple, car elle n’a aucune forme, aucune figure qui l’exprimerait et la limiterait en même temps. Le simple est compris ici comme l’illimité. Nous voyons que Grégoire identifie souvent la simplicité de la nature divine avec son infinité, avec l’absence de toute limitation quant à l’espace ou au temps, avec son éternité. C’est ce qui distingue radicalement la nature divine de tout ordre créé. Ailleurs, Grégoire entend la simplicité de la nature divine comme son unité, c’est-à-dire le fait que cette nature ne peut contenir de contradictions internes qui briseraient son unité, et donc sa simplicité. On ne peut pas donc attribuer à la nature divine des qualités contradictoires, et Grégoire fait beaucoup d’efforts pour démontrer que ce que nous discernons en Dieu n’est pas contradictoire, mais complémentaire. Simplicité veut dire aussi qu’il n’y a pas en Dieu de qualités acquises, mais qu’il est ce qu’il possède comme qualités. Ajoutons encore qu’on ne trouve pas, dans les écrits de Grégoire, de notion de la simplicité divine en tant qu’absence de toute distinction ontologique. Cette idée, familière à la scolastique médiévale latine, paraît être étrangère à saint Grégoire de Nysse.
Quant à ce que Grégoire distingue en Dieu — qu’il s’agisse des distinctions trinitaires entre les hypostases, des distinctions entre celles-ci et la nature divine ou, surtout, entre la nature divine d’une part et ce qui est « autour de la nature divine » (énergies, noms, lumière, gloire, grâce) de l’autre — il n’y a pas d’indications nettes, dans ses écrits, sur leur caractère, et il serait anachronique de lui poser directement de pareilles questions. Néanmoins, il ressort suffisamment clairement de ses écrits que, pour lui, ces distinctions, bien que perçues par un procédé intellectuel qu’il nomme « intellection » (ἐπίνοια), ne sont pas subjectives, mais correspondent à une réalité en Dieu. On peut même dire que chaque « nom » que nous appliquons à Dieu désigne en lui quelque chose de particulier qui correspond à une des manifestations spécifiques de son énergie. Ces noms ne désignent cependant pas sa nature, qui reste incognoscible et inaccessible. Cette distinction entre la nature, ou l’essence, incognoscible de Dieu et les énergies par lesquelles nous est accordée une certaine connaissance et participation à Dieu, constitue un trait fondamental de la théologie de Grégoire de Nysse. Il insiste cependant sur le fait que notre esprit humain soit incapable de saisir Dieu tel qu’il est, de le contempler comme une unité, et soit enclin à le diviser. En réalité, cependant, ces distinctions entre la nature et les énergies ne rompent pas la simplicité de la nature divine, comprise comme absence de formes et de limites et comme absence de contradictions. En outre, les énergies ne sont pas contradictoires entre elles et n’introduisent pas de complexité dans la nature divine, d’autant qu’elles ne sont pas cette nature, mais ce qui est autour de celle-ci. La nature divine reste donc simple. La distinction entre la nature divine et ses manifestations est exprimée par Grégoire de Nysse encore plus nettement sur le plan de l’expérience mystique. C’est la main qui est autre que l’Époux, la grâce qui descend sur nous, la lumière, la gloire, les puissances divines par lesquelles l’homme est déifié. En Dieu, comme le souligne saint Grégoire de Nysse, il n’y a rien de créé, autrement il serait composé. Voilà pourquoi la déification de l’homme par la grâce divine est authentique et, en même temps, constitue un processus dynamique infini qui n’aboutit pas à une confusion de natures, car les énergies divines ne s’identifient pas avec la nature divine inaccessible.
* Exposé présenté à la VIe Conférence patristique internationale (Oxford, 1975) et publié dans le Messager de l’exarchat du patriarche russe en Europe occidentale, n° 91-92, 1975, p. 133-158. Pour une étude récente de ces questions, voir B. POTTIER, Dieu et le Christ selon Grégoire de Nysse. Étude systématique du Contre Eunome avec traduction inédite des extraits d’Eunome, Namur, Éd. Culture et Vérité, 1994.
- Le contraire pourrait être dit de saint Basile, il préfère le terme « essence » à celui de « nature ».
- Contre Eunome [Eun.], I, 364, dans Gregorii Nysseni Opera [GNO], éd. W. Jaeger, Éd. Brill, Leiden, 1960, vol. I, p. 134, 22-26.
- Eun., I, 373, dans GNO, vol. I, p. 137, 3-6.
- Ou « substance ». Si, généralement, B. Krivochéine suit les traductions françaises existantes, il s’en écarte quelquefois, quand il les estime erronées ou non conformes à un vocabulaire théologique établi. Dans ces cas-là, nous respectons ses choix (NdR).
- Eun., II, 67, dans GNO, vol. I, p. 245, 19-24.
- Eun., II, 89, dans GNO, vol. I, p. 253, 1-10.
- Eun., II, 89, dans GNO, vol. I, p. 253, 10-17.
- Eun., II, 91, dans GNO, vol. I, p. 253, 25-28.
- Eun., II, 91, dans GNO, vol. I, p. 254, 1-2.
- Eun., II, 102, dans GNO, vol. I, p. 256, 22.
- Eun., II, 100, dans GNO, vol. I, p. 256, 4-7.
- Eun., II, 138-139, dans GNO, vol. I, p. 265, 26-266, 6.
- Les Béatitudes [Beat.], III, 5, trad. fr.. J.-Y. Guillemin, J. Parent, Éd. Migne, coll. « Les Pères dans la foi », 1997, p. 52.
- Beat., III, 5, ibid..
- Beat., III, 4, ibid.
- Beat., VI, 3, p. 84.
- Beat., VI, ibid.
- Eun., III, 1, 76, dans GNO, vol. II, p. 30, 25-31, 3.
- Eun., III, 1, 16, dans GNO, vol. II, p. 9, 14-18.
- Le Cantique des cantiques, XV, Paris, Éd. Migne, coll. « Les Pères dans la foi », 1992, p. 295.
- Ibid., p. 90, 19-91, 14.
- Eunome, évêque de Cyzique (355 — ca 395), théologien néo-arien, enseignait la transcendence absolue de Dieu et la non-consubstancialité du Fils au Père. Auteur d’une Apologie dénoncée par saint Basile de Césarée dans le Contre Eunome, et d’une réponse (Apologie de l’Apologie) réfutée par saint Grégoire de Nysse dans son Contre Eunome (NdR).
- Partisans de Macédonius, patriarche de Constantinople († ca. 370), arien, qui enseignait que l’Esprit était différent du Père par essence (NdR).
- Eun., I, 231, dans GNO, vol. I, p. 94, 17-22.
- Eun., I, dans GNO, vol. I, p. 5, titre du chapitre 19. Ce n’est probablement pas Grégoire lui-même qui est l’auteur de ce titre, mais il exprime bien sa pensée.
- Eun., I, 682, dans GNO, vol. I, p. 222, 12-14.
- Refutatio confessionis Eunomii [Ref.], 5, dans GNO, vol. II, p. 314, 24-26.
- Ref., 6, dans GNO, vol. II, p. 314, 26-315, 3.
- Ref., 12, dans GNO, vol. II, p. 317, 17-318, 2.
- Ref., 15, dans GNO, vol. II, p. 318, 15-18.
- Ref., 16-17, dans GNO, vol. II, p. 319, 1-7.
- Eun., III, 2, 85, dans GNO, vol. II, p. 81, 3-4.
- Eun., III, 2, 34, dans GNO, vol. II, p. 63, 5-7.
- Eun., III, 8, 4, dans GNO, vol. II, p. 239, 24-27.
- Eun., II, 69-70, dans GNO, vol. I, p. 246, 14-29.
- Ou « activités », voir la n. 5.
- Eun., II, 12-13, dans GNO, vol. I, p. 230, 24-30.
- Eun., III, 10, 33, dans GNO, vol. II, p. 302, 14-15.
- Ad Ablabium. Quod non sint tres Dii [Tres dii.], dans GNO, vol. III/1, éd. F. Müller, Éd. Brill, Leiden, 1958, p. 47, 24-48, 2.
- Tres dii, dans GNO, vol. III/1, p. 48, 16-19.
- Tres dii, dans GNO, vol. III/1, p. 48, 22-49, 1; ibid., p. 50, 20-51, 16.
- Eun., II, 228, dans GNO, vol. I, p. 292, 17-19.
- Voir, sur les sources philosophiques et « magiques » de la « théologie des noms » d’Eunome, l’intéressante étude du cardinal Daniélou. Platonisme et théologie mystique. Essai sur la doctrine spirituelle de saint Grégoire de Nysse, Paris, Aubier, 1944.
- Eun., II, 178, dans GNO, vol. I, p. 276, 14-16.
- Eun., II, 168, dans GNO, vol. I, p. 273, 28-274, 5.
- Eun., II, 246, dans GNO, vol. I, p. 298, 11-17.
- Eun., II, 271, dans GNO, vol. I, p. 306, 10-11.
- Eun., II, 587, dans GNO, vol. I, p. 396, 26-28.
- Ou « activités », voir la n. 5.
- Eun., II, 298-299, dans GNO, vol. I, p. 314, 8-19.
- Eun., II, 302-304, dans GNO, vol. I, p. 315, 10-13, 19-26.
- Eun., II, 474, dans GNO, vol. I, p. 364, 26-31.
- Eun., II, 480, dans GNO, vol. I, p. 366, 15-16.
- Eun., II, 507, dans GNO, vol. I, p. 374, 16-18.
- Eun., II, 512, dans GNO, vol. I, p. 376, 6-8.
- Eun., II, 513, dans GNO, vol. I, p. 376, 8-12, 16-20.
- Ou « susbtrat », voir la n. 5.
- Eun., II, 577, dans GNO, vol. I, p. 394, 27-395, 3.
- Eun., II, 589, dans GNO, vol. I, p. 398, 16-19.
- Ou « activité », voir la n. 5.
- Eun., II, 585-586, dans GNO, vol. I, p. 397, 8-9, 19-21.
- Eun., II, 182, dans GNO, vol. I, p. 277, 20-26.
- Eun., II, 183, dans GNO, vol. I, p. 277, 32-278, 4.
- Eun., II, 186, dans GNO, vol. I, p. 278, 20-26.
- Eun., II, 194-195, dans GNO, vol. I, p. 281,13-21.
- Ou « activité », voir la n. 5.
- Eun., II, 334, dans GNO, vol. I, p. 323, 9.
- Eun., II, 304, dans GNO, vol. I, p. 315, 26-29; ibid., 356, p. 330, 7-13.
- Beat., VI, 4, op. cit., p. 87.
- Voir la n. 40.
- Notons qu’il faut distinguer chez Grégoire quand il emploie ces mots « nature divine » à l’accusatif et quand il les emploie au génétif (περὶ τῆς θείας φύσεως). C’est seulement dans le premier cas qu’on peut traduire l’expression par « autour de la nature divine » et qu’elle aurait une signification théologique particulière. Au génitif, elle veut dire simplement « de la nature divine ».
- Tres dii., dans GNO, vol. III/1, p. 42, 19-43, 2.
- Tres dii., dans GNO, vol. III/1, p. 43, 17-20.
- Tres dii., dans GNO, vol. III/1, p. 52, 15-53, 2.
- Tres dii., dans GNO, vol. III/1, p. 46, 6-8.
- Eun., III, 6, 4, dans GNO, vol. II, p. 187, 9-11.
- Eun., III, 6, 3, dans GNO, vol. II, p. 186, 12-15.
- Beat., I, 4, p. 32.
- Discours catéchétiques, V, Paris, Éd. du Cerf, coll. « Sources chrétiennes », n° 453, 2000, p. 163-165.
- Voir la n. 24.
- Eun., I, 683, dans GNO, vol. I, p. 222, 15-25.
- Eun., II, 503, dans GNO, vol. I, p. 373, 2-8.
- Eun., II, 475, dans GNO, vol. I, p. 364, 32-365, 8.
- Eun., I, 234, dans GNO, vol. I, p. 95, 12-20.
- Eun., III, 6, 17, dans GNO, vol. II, p. 192, 1-4.
- Eun., III, 1, 125, dans GNO, vol. II, p. 45, 27-46, 3.
- Eun., II, 377-378, dans GNO, vol. I, p. 23-29.
- Eun., II, 380, dans GNO, vol. I, p. 337, 11-13.
- Eun., II, 385, dans GNO, vol. I, p. 338, 26.
- Ou « substrat », voir la n. 5.
- Eun., I, 181, dans GNO, vol. I, p. 80, 4-7.
- Ou « substrat », voir la n. 5.
- Eun., I, 182, dans GNO, vol. I, p. 80, 10-11.
- Eun., I, 182, dans GNO, vol. I, p. 80, 9.
- Eun., II, 477, dans GNO, vol. I, p. 365, 18-22.
- Eun., II, 478, dans GNO, vol. I, p. 365, 22-25.
- Tres dii, dans GNO, vol. III/1, p. 55, 13-16.
- Eun., II, 489, dans GNO, vol. I, p. 369, 7-9.
- Eun., III, 8, 48, dans GNO, vol. II, p. 257, 6-10.
- Eun., II, 606, dans GNO, vol. I, p. 403, 15-16.
- Eun., III, 8, 49, dans GNO, vol. II, p. 257, 15-17.
- Eun., III, 7, 10, dans GNO, vol. II, p. 218, 19-21.
- Eun., III, 8, 50, dans GNO, vol. I, p. 258, 1-3.
- Eun., III, 8, 35, dans GNO, vol. I, p. 252, 6-7.
- Eun., III, 10, 47, dans GNO, vol. I, p. 308, 1-4.
- Eun., III, 10, 48, dans GNO, vol. II, p. 300, 14-20.
- Eun., III, 10, 49, dans GNO, vol. II, p. 300, 29-309, 6.
- BASILE DE CESAREE, Lettre CCXXXIV, 1, 23-25, dans Lettres, Y. Courtonne (éd.), Paris, Les Belles Lettres, 1966, t. III, p. 42.
- XIe Homélie dans Le Cantique des cantiques, loc. cit., p. 233.
- Beat. VII, 1, loc. cit., p. 94.
- Eun., III, 5, 58, dans GNO, vol. II, p. 181, 13-21.
- Eun., II, 338, dans GNO, vol. I, p. 325, 5-6.
- Eun., II, 353, dans GNO, vol. I, p. 329, 8-17.
- Eun., II, 354, dans GNO, vol. I, p. 329, 20-22. Ou « activités », voir la n. 5.
- Eun., II, 359, dans GNO, vol. I, p. 331, 12-16.
- Eun., I, 420, dans GNO, vol. I, p. 149, 3-5.
- Eun., II, 81, dans GNO, vol. I, p. 250, 19-26.
- Voir la n. 110.
- Eun., II, 417-418, dans GNO, vol. I, p. 348, 10-17.
- Eun., II, 419, dans GNO, vol. I, p. 348, 17-21.
- Eun., II, 419, dans GNO, vol. I, p. 348, 22-349, 1.
- Eun., II, 349, dans GNO, vol. I, p. 327, 24-29.
- Eun., III, 1, 64, dans GNO, vol. II, p. 26, 13-15.
- Eun., III, 1, 65, dans GNO, vol. II, p. 26, 20-23.
- Eun., III, 1, 48, dans GNO, vol. II, p. 20, 10-16.
- Eun., III, 1, 103-104, dans GNO, vol. II, p. 38, 21-26.
- Eun., III, 6, 66, dans GNO, vol. II, p. 209, 19-21.
- De Spiritu Sancto, contra Macedonianos [Maced.], dans GNO, vol. III/1, p. 104, 8-12.
- Eun., I, 375, dans GNO, vol. I, p. 137, 17-19.
- Maced., dans GNO, vol. III/1, p. 106, 3-8.
- Maced., dans GNO, vol. III/1, p. 106, 30-32.
- Maced., dans GNO, vol. III/1, p. 109, 7-13.
- Maced., dans GNO, vol. III/1, p. 114, 23-24.
- Maced., dans GNO, vol. III/1, p. 114, 29-115, 4.
- Maced., dans GNO, vol. III/1, p. 115, 23-26.
- Beat., VI, 3, loc. cit., p. 85.
- Beat., VI, 4, loc. cit., p. 87.
- Beat., VI, 5, loc. cit., p. 88.
- Beat., VII, 1, loc. cit., p. 95.
- Beat., V, 2, loc. cit., p. 70.
- Voir les n. 14 et 15.
- XIe Homélie dans Le Cantique des cantiques, loc. cit., p. 232.
- Ibid., p. 233.
- Voir la n. 110.
- XIe Homélie dans Le Cantique des cantiques, loc. cit., p. 233.
- Ibid.
- XIe Homélie dans Le Cantique des cantiques, loc. cit., p. 234.
- Voir la n. 6.
- XIe Homélie dans Le Cantique des cantiques, loc. cit., p. 234.
- Ibid.
- XIe Homélie dans Le Cantique des cantiques, loc. cit., p. 234.
- Ibid., p. 235.
- Ibid., p. 236.
Suite « Dieu, l’homme, l’Église » Lecture des Pères Par Basile Krivochéine Les Éditions du « CERF » Paru en. Décembre 2010, 302 pages

Il serait superflu d’insister sur l’importance de la notion d’« essence » (οὐσία), la grande place qu’elle occupe dans la pensée théologique des saints Pères et la variété de significations et d’applications qu’elle y a. Il suffit de jeter un regard sur A Patristic Greek Lexicon du professeur G. W. H. Lampe pour constater qu’elle y occupe, avec ses dérivés, seize colonnes de citations patristiques grecques dont onze consacrées au mot οὐσία lui-même, avec ses subdivisions théologiques, christologiques, trinitaires, générales, spirituelles et même matérielles.
Et ceci pour une période embrassant seulement les huit premiers siècles de la patristique grecque (1). Et, en vérité, qu’on prenne les écrits des apologètes (Athénagore par exemple), saint Irénée, la théologie spirituelle de Clément d’Alexandrie ou d’Origène, la défense de l’ὁμοούσιον par saint Athanase ou la polémique anti-eunomienne des Cappadociens, la théologie mystique de Denys l’Aréopagite, les controverses christologiques monophysites et monothélites, la spiritualité d’Évagre et de Macaire, saint Maxime le Confesseur, la crise iconoclaste et la réponse orthodoxe, saint Photius et le Filioque, sans parler déjà de saint Grégoire Palamas qui appartient à une époque ultérieure à saint Syméon, on y trouve partout le problème de l’οὐσία divine et de ses manifestations, le paradoxe du Dieu transcendant et de la déification de l’homme, en bonne place dans l’expérience des Pères et leurs réflexions sur le mystère chrétien. Rien de plus naturel que de trouver une chose semblable chez saint Syméon le Nouveau Théologien, bien qu’exprimée avec une originalité qui lui est propre (2).
Suivant la ligne des saints Pères, saint Basile (3) et saint Grégoire de Nysse (4) en particulier, Syméon emploie le même mot οὐσία pour désigner l’essence de Dieu et des choses créées. Et c’est toujours par opposition à Dieu créateur qu’il parle des essences créées. Ainsi il emploie ce mot au pluriel, αἱ οὐσίαι, pour parler des anges quand il dit que Dieu est « au-dessus des Essences intellectuelles » — car elles aussi sont « [s]on œuvre (5) ». D’ailleurs, c’est une terminologie patristique qu’on retrouve en particulier chez saint Grégoire de Nazianze et Denys l’Aréopagite quand ils parlent des anges. Syméon parle aussi de l’essence des créatures visibles pour insister, comme le faisait saint Basile (6), sur son incognoscibilité à l’intelligence humaine. « Et si tu pouvais connaître la hauteur du ciel », écrit-il dans sa lettre à Étienne de Nicomédie, « ou indiquer quelle est l’essence (7) du soleil, de la lune et des étoiles (8). » Mais le plus souvent c’est à la créature comme telle, l’homme créé et son âme, que s’applique le terme οὐσία, accompagné par des adjectifs comme « créée », « terrestre », « humaine », etc. « Oh, quelle est cette réalité cachée à toute essence créée ! Qu’est-ce que cette lumière intelligible, que personne ne voit (9) ? », s’exclame Syméon, opposant tout ce qui est créé à la lumière intelligible. Ou, par opposition au feu divin. « En ce que tu purifies les âmes souillées, tu illumines l’esprit et tu te saisis d’une essence terrestre et matérielle (10). » L’essence créée est incapable de connaître les mystères car « par nature ils sont inexprimables, totalement indicibles, interdits aux hommes, inconnaissables même aux anges et incompréhensibles à toute autre créature [en grec, οὐσία] (11) ». Ici, la notion d’ « essence créée » englobe les hommes et les anges. Elle s’applique aussi à l’âme et au corps et, malgré sa nature créée, cette essence peut, comme des herbes sèches, s’enflammer par le feu divin. « Merveille étrange. ma chair, c’est-à-dire l’essence de mon âme, oui, et de mon corps, participe à la gloire divine et resplendit d’un éclat divin (12). » « Le feu en effet, lorsqu’il s’est emparé d’une essence semblable au bois sec, comment ne brûlerait-il pas, […] comment n’y produirait-il pas des souffrances inévitables (13) ? » Ou. « Cette flamme qui atteignait le ciel et qui en moi brûlait fortement, mais ne consumait pas ces herbes sèches qui étaient dans mes entrailles. Ô chose étrange ! Elle les transformait tout entières en flames (14). » Néanmoins, l’abîme ontologique entre Dieu et toute « essence terrestre » n’est pas supprimé. « Car Dieu est incréé, mais nous tous, créatures […] ; Lui esprit au-dessus de tout esprit en tant que créateur des esprits et leur maître — nous, chair tirée de la poussière, essence (15) terreuse [γεώδης οὐσία] (16). » Et. « Quelle comparaison établir de l’ombre à la réalité ou encore — dis-moi — d’un esprit subordonné et voué à notre service à l’esprit du Maître, esprit tout puissant et divin qui affermit et fortifie toute essence créée [κτιστὴν οὐσίαν] (17) ? » On peut donc dire en résumant que pour Syméon l’expression « essence » (οὐσία) employée par rapport au monde créé (anges-hommes, âme-corps) se distingue radicalement de l’essence divine dont nous parlerons tout de suite, par son caractère créé opposé au Dieu-Créateur, sa qualité terrienne, son incapacité de saisir intellectuellement non seulement Dieu, mais aussi les essences des autres créatures, mais en même temps capable de recevoir le feu divin et de s’enflammer par lui sans en être anéantie. On peut dire aussi que cette notion de l’οὐσία prend dans ces occurrences chez Syméon un sens concret, identique à peu près aux choses qu’elle désigne, dans ce qu’elles ont de plus profond. On peut dire aussi que Syméon n’envisage jamais l’ « essence créée » d’un point de vue théorique, mais toujours en rapport avec Dieu et sa propre vie spirituelle.
Mais c’est surtout l’essence incréée de Dieu, son οὐσία, dont nous voudrions parler dans notre étude présente sur Syméon. Sans essayer d’en donner une définition théologique ou philosophique, chose qui serait d’ailleurs impossible selon lui, Syméon insiste sur la témérité de la scruter, surtout pour des personnes dépourvues de l’Esprit Saint. « C’est pour moi un sujet d’étonnement », dit-il dans ses Traités théologiques, « que la plupart des hommes, avant d’être nés de Dieu et d’avoir obtenu le titre d’enfants, ne redoutent nullement de s’adonner à la théologie et de parler de Dieu. C’est précisément pour cela que, si je viens à entendre certains d’entre eux philosopher sur des sujets divins et inaccessibles, faire de la théologie en état d’impureté et expliquer les vérités de Dieu et ce qui le touche [τὰ περὶ Θεοῦ καὶ τὰ κατ’αὐτόν] sans l’Esprit qui donne l’intelligence, je tremble en esprit et je me mets comme hors de moi, rien que de calculer et de considérer combien la divinité est incompréhensible pour tous et comment, ignorant ce qui est à nos pieds et nous ignorant nous-mêmes (18), nous n’avons rien de plus pressé que de philosopher, sans crainte de Dieu et avec témérité, sur ce qui nous est inaccessible, et cela, tout en étant vides de l’Esprit qui éclaire ce domaine et nous le dévoile. nous nous mettons en faute du fait même que nous parlons de Dieu. Il est déjà malaisé à chacun de se connaître soi-même et peu y réussissent en vrais philosophes. […] De plus, il est tout à fait contraire à la raison et au bon sens de scruter la nature et l’essence de Dieu (19). » Et il continue. « Eh ! vous-là, pourquoi renoncez-vous de mettre de l’ordre chez vous pour scruter les choses de Dieu et ce qui le touche [περὶ Θεοῦ καὶ τῶν θείων] ? Il nous faut avant tout passer de la mort à la vie, c’est la condition […] pour attirer l’Esprit dans nos entrailles et énoncer, grâce à sa lumière, ce qui concerne Dieu, dans la mesure où cela est possible et où nous sommes illuminés par Dieu [καθόσον οἷόν τε καὶ ἀπό Θεοῦ ἐλλαμπόμεθα] (20). » Ces passages sont très importants pour comprendre ce qu’on peut appeler la gnoséologie de saint Syméon. Comme on le voit, la connaissance des choses terrestres et même de soi-même est déjà toute relative, quant à la connaissance de l’essence divine, il est absurde de vouloir même la scruter. Le plus important, toute « théologie », c’est-à-dire la connaissance « des vérités de Dieu et ce qui le touche » — terme traditionnel pour désigner les attributs et les activités de Dieu (21) — présuppose une sanctification et une illumination et leur est proportionnée dans le cadre des capacités humaines. Toute cette argumentation est très « basilienne », si ce n’est la possibilité d’une connaissance mystique qui est plus développée chez saint Syméon que chez saint Basile.
Cette nécessité de la grâce pour une communion avec Dieu est exprimée d’une manière négative dans l’hymne suivant. « Comment l’âme supporterait-elle la nature de ce feu intolérable, alors qu’elle est toute remplie des épines des passions et du péché ? Comment contiendrait-elle l’essence que rien absolument ne peut contenir ? Comment, étant elle-même ténèbres, se mêlera-t-elle à la lumière inaccessible et ne sera-t-elle pas anéantie par sa presence (22) ? » Comme on le voit, même dans la présence de la lumière l’essence divine reste « absolument » incirconscriptible. Syméon l’appelle « essence cachée » (κρυπτὴ οὐσία). « Ô Nature immaculée, essence cache (23), bonté inconnaissable à la plupart des hommes, pitié invisible à ceux qui vivent comme les insensés, essence immuable, indivisible, trois fois sainte (24). » Syméon la compare cependant à un feu immatériel divin. « Écoutez, vous », s’écrie-t-il, « qui comme moi avez péché contre Dieu, hâtez-vous, courez énergiquement, par vos œuvres, pour recevoir et saisir la matière du feu immatériel — et en disant. matière, c’est l’essence divine que je t’indique —, pour allumer la lampe spirituelle de votre âme, afin de devenir des soleils qui brillent dans le monde (25). » Et, une fois, il l’identifie même avec l’amour. « Car », dit-il, « la charité n’est pas un nom, c’est l’essence même de Dieu (26). »
Cependant, le terme οὐσία ne satisfait pas Syméon quand il veut parler de Dieu. Suivant donc la ligne apophatique de saint Cyrille d’Alexandrie, de Denys l’Aréopagite, de saint Maxime le Confesseur et de saint Jean Damascène (27), il dit dans une série de textes que Dieu est supérieur à toute essence, et préfère l’appeler « suressentiel » (ὑπερούσιος). Il se demande si on peut nommer Dieu essence. « Oui, si véritablement tu es absolument inexprimable, invisible, inaccessible et incompréhensible, intangible, impalpable, absolument insaisissable, Sauveur, comment te donnerons-nous un nom, comment, même celui d’essence — quelle essence et de quelle sorte ? — oserons-nous te l’appliquer ? Puisque véritablement tu n’es aucun des êtres, ô mon Dieu (28). » Et il insiste sur le fait que Dieu transcende toute essence. « La nature suressentielle, [la nature] divine et incréée, c’est en tant qu’elle transcende l’essence de tous les êtres créés qu’elle est appelée suressentielle ; toutefois elle possède une essence, elle est hypostatique (29), au-dessus de toute essence, et par rapport à une hypostase (30) créée, elle est conçue comme absolument incomparable, car elle est tout entière incirconscriptible par nature (31). » La même transcendance absolue de Dieu par rapport à toute créature est exprimée dans les lignes suivantes. « Tu emplis entièrement tout, toi qui es tout entier en dehors de tout, au-dessus de tout, ô Maître, au-dessus de tout principe, au-dessus de toute essence, au-dessus de la plus native nature, au-dessus de tous les siècles, au-dessus de toute lumière, ô Sauveur, au-dessus des essences intellectuelles — car elles aussi sont ton œuvre (32). » Remarquons que ce Dieu suressentiel et au-dessus de tout est invoqué par Syméon dans ce passage, comme dans celui cité plus haut (33), comme « Sauveur ». C’est le paradoxe chrétien qui est au centre de sa spiritualité et qui la distingue radicalement de la mystique plotinienne. Et l’incarnation est l’expression de ce paradoxe chrétien. « Car c’est celui qui, suressentiel et incréé auparavant, a pris chair et s’est montré à moi comme creature (34). »
Cette « essence suressentielle (35) » est trine, Syméon parle beaucoup de son aspect trinitaire. « Lumière est le Père, lumière le Fils, lumière l’Esprit Saint. […] Les trois en effet sont une seule lumière, unique, non séparée […]. Dieu en effet est parfaitement indivisible par nature, et par son essence il dépasse véritablement toute essence. […] Il se laisse voir tout entier en effet comme une lumière simple. […] Les trois une seule nature, essence et divinité (36). » Ailleurs, c’est l’immuabilité de l’essence trinitaire qui est indiquée. « Ô Trinité, créatrice de l’Univers, ô mon Dieu unique pour l’unique, dont la nature ne peut être circonscrite, dont la gloire est incompréhensible, les œuvres inexplicables, l’essence immutable (37) ! » Parfois Syméon emploie l’expression « suressentiel » pour désigner l’indicible et l’incompréhensible des relations trinitaires. « À propos de l’existence divine qui n’est pas existence [ἀνυπάρκτου ὑπάρξεως], de la génération qui n’est pas génération, de l’hypostase non hypostasiée (38), du don de l’essence suressentiel [ὑπερουσίου οὐσιώσεως], et je ne sais quoi encore […] il est absolument impossible d’énoncer, d’exprimer et de concevoir les propriétés de la nature divine suressentielle et l’intelligence humaine ne peut les comprendre (39). »
L’« essence » chez Syméon a aussi un sens christologique quand, fidèle aux dogmes du concile de Chalcédoine, il parle de deux natures et deux essences [οὐσίαι] du Christ en une seule hypostase. « Je suis donc le Dieu unique et l’homme accompli », dit le Christ lui-même dans les Hymnes, « achevé, parfait, chair, âme, esprit et raison, tout entier homme et Dieu dans mes deux essences, comme dans mes deux natures et mes deux energies (40) et mes deux vouloirs dans une seule hypostase (41). À la fois Dieu et homme, je suis un de la Trinité (42). » Ailleurs, Syméon exhorte les pécheurs au repentir « afin de devenir comme des dieux, possédant au-dedans de vous la gloire tout entière de Dieu en deux essences, oui, en deux natures, en deux energies (43) et en deux volontés (44). » La déification serait donc l’union complète de nos deux essences, âme et corps, avec les deux essences du Christ. « Je deviens moi-même aussi dieu […]. L’âme donc et le corps […] sont un même être en deux essences. Eux donc, qui sont un et deux parce qu’ils ont communié au Christ et bu son Sang, unis aux deux essences et aussi aux deux natures de mon Dieu, deviennent dieu par leur participation (45). »
Tout en insistant, comme nous l’avons vu, sur le caractère caché et immuable de l’essence divine, Syméon parle aussi de ses manifestations. De la lumière de sa gloire d’abord. « Tu as brillé, tu as manifesté, comme lumière de gloire la lumière inaccessible de ton essence, Sauveur, et tu as illuminé une âme plongée dans les ténèbres (46). » L’essence est distinguée de la force divine. « J’ai modelé », dit Dieu, « la poussière pour former un corps et j’y ai insufflé une âme, non à partir de mon essence, mais de ma puissance (ἰσχύος) (47). » Mais son unité est affirmée. « Dieu de l’Univers, adoré dans la trinité des hypostases et l’unité d’essence (48). » Bien plus souvent Syméon parle des « énergies » (ἐνεργείᾳ) de la divine essence, terme traditionnel et classique depuis saint Basile (49) et même bien plus avant puisque l’apologète Athénagore l’emploie déjà (50), mais devenu célèbre avec saint Grégoire Palamas. Ainsi, saint Syméon dit que ces « énergies » (ou « opérations », « activités », mais ces traductions ne rendent pas toute la richesse du terme) sont inconnaissables. « Comment [alors] scruter la nature du créateur de tout ? Et ses energies (51) aussi, comment prétends-tu me les expliquer (52) ? » Il est vrai que Syméon parle ici non de l’essence mais de la nature de Dieu, mais dans un autre passage il identifie ces deux notions. « Point de division en effet entre tes [propriétés], point de séparation, ta nature est ton essence et ton essence ta nature (53). »
Cependant, dans ses visions les plus élevées, Syméon maintient la distinction entre l’essence et les énergies de Dieu. « Accorde-moi de voir ton visage, ô Verbe, et de jouir de ta beauté inexprimable, d’observer et de m’abandonner à ta vision, vision ineffable, vision invisible, vision redoutable ; pourtant, accorde-moi de dire non son essence mais ses energies (54) [τὰς ἐνεργείας αὐτῆς, οὐ τὴν οὐσίαν] (55). » Pour être exact, il faut noter que la distinction est faite ici plutôt entre l’essence et les énergies de la vision divine qu’entre l’essence et les énergies de Dieu lui-même, mais la différence ne paraît pas être importante puisqu’il s’agit de la vision du Verbe même. Syméon explique l’impossibilité de voir l’essence par le fait que Dieu est suressentiel. Il éprouve le reflet de la gloire divine comme une lumière simple qui s’unit à lui. « Car tu es au-delà de la nature, au-delà de toute essence tout entier, toi, mon Dieu, mon créateur, mais le reflet de ta gloire divine se laisse voir à nous. c’est une lumière simple, une lumière douce ; lumière elle se révèle, lumière elle s’unit tout entière, je pense, avec nous tout entiers, tes serviteurs, lumière que l’on contemple en esprit et de loin, lumière qui se découvre soudain à l’intérieur de nous (56). »
Dans ses Traités éthiques, Syméon va encore plus loin. Ainsi, en parlant du mystère de la résurrection et en affirmant que ce mystère « s’est réalisé en chacun des saints d’autrefois et se réalise sans cesse jusqu’à maintenant (57) », il dit. « En recevant en effet l’Esprit de notre Maître et Dieu, nous devenons participants de sa divinité et de son essence [συμμέτοχοι αὐτοῦ τῆς Θεότητος καὶ τῆς οὐσίας γινόμεθα] ; et, en mangeant sa chair immaculée, je veux dire les divins mystères, nous devenons en réalité intégralement incorporés et apparentés à lui (58). » La participation à l’essence divine est liée ici à l’eucharistie et au don du Saint Esprit. Le passage n’est d’ailleurs qu’une paraphrase de « participants de la nature divine » de la deuxième épître de saint Pierre (59). Cependant, dans les lignes qui suivent Syméon réduit quelque peu la portée de cette participation, insistant sur le fait qu’il s’agit d’une ressemblance avec Dieu selon la grâce. « Une fois parvenus à cet état, nous devenons semblables selon la grâce à Dieu lui-même […], restaurés que nous sommes et renouvelés dans notre âme, rendus incorruptibles et vivant comme ressuscités des morts ; c’est-à-dire que nous voyons celui qui a daigné devenir semblable à nous et qu’il nous voit, nous qui avons été admis à devenir semblables à lui, de la même façon que quelqu’un voit à distance le visage d’un ami avec lequel il converse, auquel il adresse la parole et dont il entend la voix (60). » Il ne s’agit donc aucunement d’une identification essentielle avec Dieu, mais d’une communion « à distance » (μακρόθεν) bien que réelle et englobant tout notre être.
Avant de poursuivre plus loin cette étude sur l’essence divine chez Syméon, il faudra s’arrêter sur l’emploi qu’il en fait sous la forme de κατ’ οὐσίαν (« selon l’essence ») et τῇ οὐσίᾳ (« par essence », au datif). Le terme « selon l’essence » a en premier lieu une application trinitaire où il a à peu près le sens de « consubstantiel », « authentique », « réel ». Ainsi, pour désigner le Père. « il est inengendré par essence (61) », c’est-à-dire que l’attribut hypostatique du Père n’est pas un « accident », mais appartient à son être même. Ou pour le Fils, pour désigner son égalité réelle avec le Père. « Dieu égal au Père et par essence et par la nature et par la puissance et par la forme [κατα μορφὴν] vraiment, comme par la notion [κατ’ ἰδέαν] et par la durée jamais séparé du Père (62). » Remarquons que « par essence » est distingué ici de « par la puissance », etc. Ou pour exprimer la divinité authentique de l’Esprit Saint. « Il connaît tout, il remplit tout, car il est Dieu par essence (63). » Ou pour désigner le caractère essentiel des attributs divins. « Comment deviens-tu rayon et te fais-tu voir à moi comme une flamme et brûles-tu la matière, toi qui es immatériel par essence (64). » À cette demande de Syméon, le Christ répond. « Moi, par nature je suis inexprimable, infini, parfait, inaccessible, invisible à tous, intangible, impalpable, immuable par essence [τὴν οὐσίαν] (65). » Par cette accumulation d’attributs essentiellement apophatiques, Syméon montre la grandeur du mystère chrétien, comment ce même Dieu invisible et immuable se « fait voir », brûle notre âme et se mêle à son essence (66). Sa transcendance absolue est de nouveau affirmée dans ces termes. « [Le feu divin] est insaisissable, incréé, invisible, […] hors de toutes les créatures, matérielles et immatérielles […]. Il est extérieur à toutes ces créatures par sa nature et son essence certes, mais aussi par sa puissance (67). » Ailleurs, Syméon dit que la nature créatrice divine ou sa sagesse est hors de tout et en même temps présente « selon l’essence » partout. « L’ouvrière de l’univers, la nature divine et la sagesse, sans être en eux tous — comment en effet le serait ce qui n’est aucun de tous les êtres et qui est la cause de tous ? — elle est partout et en tous et elle remplit entièrement tout par son essence, par sa nature, par son hypostase aussi (68). » Il illustre ce paradoxe de Dieu invisible « par essence » et visible aux saints par l’antithèse du soleil et de ses rayons. « Il se fait voir à ceux qui en sont dignes. ils ne voient pas celui qui remplit tout [ὁ πλήρης], mais ils le voient de manière invisible, comme un unique rayon de soleil, et pour eux il est saisissable, lui, l’insaisissable par essence (69). C’est le rayon qu’on voit — le soleil, lui, aveugle plutôt — et son rayon est pour toi saisissable (70). » Enfin, l’âme, parce que créée à l’image de Dieu, possède aussi ses puissances « par essence ». « De même, par suite, mon âme est à son image à lui. Elle a donc intelligence et raison, celles-ci font partie de son essence, sans séparation ni confusion, elles sont aussi consubstantielles (71). » On voit qu’ici les mêmes expressions « par essence » et « consubstantiel » sont appliquées tant à la Trinité qu’à l’âme dont elle est l’image, sans que la différence radicale entre le prototype incréé et son image créée soit mise au clair. D’ailleurs, beaucoup de Pères anciens ont fait la même chose pour éclairer le mystère de la Sainte Trinité (72). Mais ce qui intéresse ici Syméon n’est pas le dogme trinitaire lui-même, mais la révélation de l’image divine dans l’âme par l’Esprit Saint.
Quant à l’expression τῇ οὐσίᾳ « par essence » ou « à l’essence » (ablatif ou datif), on la rencontre souvent chez Syméon pour désigner l’invisibilité radicale de Dieu et son inaccessibilité, ce qui n’empêche pas paradoxalement que Dieu se mêle véritablement à nous. « Car, si par ton essence », dit Syméon « tu es pour eux [les anges] invisible et inaccessible par ta nature, mais qu’à moi tu te montres, c’est bien que, par l’essence de ta nature, tu te mêles à moi ; point de division en effet entre tes propriétés [τὰ σά], point de séparation, ta nature est ton essence et ton essence ta nature (73). » Cette supériorité de la participation essentielle à Dieu qu’ont les hommes par rapport aux anges, Syméon la fonde sur la communion eucharistique. « Ainsi, communiant à ta chair, je participe à ta nature et je prends réellement ma part de ton essence, communiant à ta divinité, bien plus en devenant héritier dans mon corps, je me vois supérieur aux incorporels, je deviens fils de Dieu comme tu l’as dit non pour les anges, mais pour nous, nous appelant dieux en ces termes. « J’ai dit. ‘Vous êtes des dieux et les fils du Très-Haut, vous tous’ » [Ps 81, 6] (74). » C’est le texte de Syméon où la participation à l’essence divine dans l’eucharistie est affirmée de la manière la plus explicite. Nous verrons cependant qu’ailleurs Syméon, désirant s’exprimer plus exactement et en théologien, limite sensiblement cette affirmation. Ainsi, tout en affirmant que Dieu est avec nous par essence, il se demande si ce terme est vraiment applicable à Dieu puisqu’il est suressentiel. « Toi qui es là-haut avec le Père et te trouves avec nous — non, comme d’aucuns le croient par ta seule énergie (75), ni comme beaucoup le pensent par ton seul vouloir, ni par ta seule puissance, mais aussi par ton essence, s’il faut oser parler, à ton propos, s’il faut oser penser essence, ô immortel, suressentiel, unique (76) ! » On voit que Syméon maintient ici la distinction entre présence par essence et présence par énergie ; et ce qu’il nie, c’est la présence par énergie seule, ainsi que par essence seule. Ailleurs, Syméon parle d’une telle union du feu divin avec l’essence même de l’âme que les deux deviennent un. « Alors il se mélange à elle sans se mélanger et s’unit de manière ineffable, par son essence [ἐνούσιως] à l’essence de cette [âme], tout entier à elle tout entière […] et, je ne sais comment l’exprimer, les deux ne deviennent plus qu’un. l’âme avec son créateur et dans l’âme est son créateur (77). » Cette union ineffable, mélange sans mélange, que Syméon se trouve en difficulté de caractériser, s’étend aussi au corps. « Merveille étrange. ma chair, c’est-à-dire l’essence de mon âme, oui, et de mon corps, participe à la gloire divine et resplendit d’un éclat divin (78). » C’est d’une participation du corps à la gloire divine qu’il s’agit ici.
Devant toutes ces réalités inexprimables, tâchant tout de même de saisir le mystère du Dieu trinitaire en termes théologiques, saint Syméon décrit ainsi ses apories. « Seigneur notre Dieu, Père, Fils et Esprit, toi dont la forme [μορφῇ] est sans contour [ἀνείδεος] mais dont la vision est toute beauté et qui, dans la splendeur inconcevable, obscurcis tout [autre] spectacle, tu dépasses vraiment dans ta séduction la vue de tout [le reste] […], tu es dans ton essence au-delà de toute essence, les anges même ne te peuvent connaître. Que tu existes, nous le savons d’après tes energies (79) puisque tu t’es nommé toi-même le Dieu qui est vraiment (80) ; nous appelons cela ton essence, nous le nommons ton hypostase (81) — ce qui n’est pas ne possède ni essence ni hypostase (82) — et c’est pourquoi avec audace nous disons que tu possèdes une essence [ἐνούσιον], nous disons que tu as une hypostase (83), toi que nul n’a jamais vu, le Dieu en trois hypostases, l’unique principe sans principe. Autrement comment oser t’appeler une essence ou glorifier en toi trois hypostases distinctes (84) ? » Et il continue en soulignant l’incognoscibilité de Dieu. « Et comment la créature penserait-elle le mode de ton existence ou de la génération de ton Fils, Dieu et Verbe, ou encore de la procession de ton Esprit divin, pour pouvoir connaître ton union et contempler ta séparation et avoir une idée claire de la vue de ton essence [οὐσίας σου τὸ εἶδος] ? Jamais personne n’a rien vu de ces choses [mystères] dont j’ai parlé. Il est impossible à un autre de devenir Dieu par nature pour pouvoir aussi sonder dans ta nature à toi, l’essence, l’idée et la forme ou l’hypostase (85), mais tu es toi-même en toi-même seul Dieu, Trinité […]. Mais toi ! de quelle qualité, de quelle sorte est ton essence ou comment as-tu une fois engendré et engendres-tu continuellement […] Il connaît tout, il remplit tout, car il est Dieu par essence […]. Mais nul d’entre les anges n’a jamais vu, ni jamais aucun homme, n’a vu ou connu ta substance [ὕπαρξιν] — car tu es incréé (86). »
Enfin, dans l’Hymne I où Syméon décrit en détail son expérience mystique, ainsi que son impuissance à l’exprimer en paroles, il affirme nettement qu’il s’agit d’une vision non par essence, mais par participation. « Quel est ce redoutable mystère qui s’accomplit en moi ? », s’interroge-t-il en premier lieu, « La parole ne peut l’exprimer, ni ma main l’écrire […]. Si en effet ce qui s’accomplit en moi, l’enfant prodigue, est indicible, inexprimable, comment Celui qui en est le dispensateur et l’auteur, comment, dis-moi, aurait-il besoin de recevoir de nous louange ou gloire ? […] Ici, ma langue manque de paroles et ce qui s’accomplit, mon intelligence le voit, mais ne l’explique pas. elle contemple, elle désire le dire et elle ne trouve pas de mots. ce qu’elle voit est invisible, entièrement dépourvu de forme, simple, sans aucune composition, infini en grandeur (87). » Tout de même, il tâche de comprendre. « En effet, elle ne voit pas de commencement, ne découvre jamais de fin et ignore toute espèce de milieu. comment donc dirait-elle ce qu’elle voit ? C’est l’ensemble, récapitulé, à mon avis [δοκῶ], qu’on voit, non certes par essence, mais par participation [οὐ τῇ οὐσίᾳ πάντως δέ, ἀλλά τῇ μετουσίᾳ] (88). »
Pour rendre plus compréhensible cette vision par participation Syméon recourt à l’analogie du feu matériel. « En effet, tu allumes un feu à un feu, c’est le feu tout entier que tu prends, et pourtant le feu reste, non partagé, sans avoir rien perdu, bien que le feu transmis soit séparé du premier et passé à beaucoup de lampes, car c’est un feu matériel. Mais celui-ci est spirituel, il est indivisible, absolument impossible à séparer et à partager. Non pas un feu qu’on transmet et qui en forme plusieurs autres, mais à la fois il demeure indivisible et se trouve en moi (89). » Suit la description mystique concrète de la manifestation divine. « Il se lève en moi, au-dedans de mon pauvre cœur, tel le soleil, ou tel le disque solaire il se montre sphérique, oui, tel une flamme. Je ne sais — je le répète — ce que je puis en dire et je voulais me taire — si seulement j’avais pu (90) ! »
Dans l’Hymne 50, la communion avec Dieu non par essence mais par participation, est proclamée comme signe de l’orthodoxie. « Tu sais, en effet », dit-il comme de la part du Christ, « que je suis avec les saints moi-même, moi tout entier, par essence — de façon sensible (91) [αἰσθήσει] (92) et la contemplation — et aussi par participation, avec mon Père et l’Esprit divin et que je prends mon repos de manière évidente en eux (93), […] mais si c’est sciemment, effectivement et consciemment que Dieu a pris la condition humaine totale, je suis devenu dieu tout entier par la communion à Dieu, sensiblement et sciemment [ἐν αἰσθήσει καὶ γνώσει], non par essence mais par participation, comme on doit absolument le croire pour être orthodoxe (94). » Il est difficile d’être plus catégorique. quoiqu’il puisse dire ailleurs (95), ici Syméon affirme que la déification se fait non par essence mais par participation. Et cette affirmation acquiert une importance particulière puisque Syméon en fait un test d’orthodoxie. Cependant, dans le même hymne, Syméon, en poursuivant ses confessions et en prolongeant ses réflexions mystiques et théologiques, admet que l’essence immatérielle divine se fait voir en nous intérieurement et nous pénètre entièrement. « Alors », c’est-à-dire après avoir suivi le Christ sur la voie de ses commandements et souffrances, « tu verras briller haut et clair la lumière dans l’atmosphère de l’âme toute baignée de sa clarté, [tu verras], de façon immatérielle, l’Essence immatérielle distinctement, traverser véritablement de part en part toute l’âme (96). » Il n’y a pas de contradiction quant au fond entre ces derniers passages puisque l’οὐσία se répand dans l’âme comme une lumière, c’est-à-dire dans une manifestation et non telle qu’elle est en soi, ou, comme dirait Syméon, « par essence ». Ce dernier terme a chez lui un sens particulièrement fort.
Il faut maintenant, pour achever notre étude, examiner un terme dérivé de l’οὐσία, l’adverbe οὐσιωδῶς, « essentiellement ». Il est très caractéristique pour Syméon, surtout pour ses Traités théologiques et éthiques où il se rencontre fréquemment. On peut dire d’une manière générale que par cet adverbe οὐσιωδῶς, Syméon veut exprimer la réalité de l’union de l’homme avec Dieu et la manière dont elle se produit. C’est ainsi qu’il l’emploie pour désigner notre participation à la divinité, fruit de l’incarnation qui est elle-même la manifestation de l’amour divin. « Cette charité, autrement dit, la tête de toutes les vertus, est le Christ Dieu, qui précisément est descendu sur terre et devenu homme en prenant part à notre chair faite de terre, afin de nous donner part essentiellement (97) à sa divinité [ἵνα μεταδῷ τῆς αὐτοῦ Θεότητος οὐσιωδῶς ἡμῖν] et, après nous avoir rendus spirituels et tout à fait incorruptibles, de nous élever aux cieux (98). » Dans un autre passage, Syméon parle du feu de la divinité qui brûle notre âme et consume, comme du bois mort, ses passions. « Lorsque tout cela est enfin anéanti et que l’essence de l’âme seule reste, débarrassée des passions, alors le feu divin et immatériel s’unit aussi à elle essentiellement, aussitôt elle s’enflamme, devient translucide et participe, comme le four, à ce feu sensible. C’est ainsi que le corps, lui aussi, devient un brasier en participant [κατὰ μέθεξιν] à la lumière divine et ineffable (99). » Le mot « essentiellement » désigne dans ces textes une participation réelle et profonde de l’ « essence » de notre âme à la divinité qui transforme tout notre être, comme Syméon le dit lui-même. « C’est la communication et la participation de sa divinité [μετουσία καὶ μέθεξις τῆς Θεότητος αὐτοῦ] qui font notre union avec Dieu (100). » C’est un grand mystère qui fait l’étonnement de Syméon. « Comment Dieu est-il hors de l’univers par son essence et sa nature, par sa puissance et sa gloire, et comment aussi habite-t-il partout et en tous, mais d’une manière spéciale dans ses saints, et comment dresse-t-il sa tente en eux d’une manière consciente et essentiellement (101) [γνωστῶς καὶ οὐσιωδῶς], lui qui est totalement suressentiel (102) ? » Cette habitation divine consciente et sa vision sont une vraie union avec Dieu. « Une fois qu’ils sont unis essentiellement », dit Syméon, « à ce Dieu même et qu’ils méritent de le voir et de participer à lui, ce n’est plus l’image de ses œuvres ni l’ombre des choses visibles qui attirent leur désir […]. Du moment, en effet, que leur pensée séjourne de préférence dans les réalités qui transcendent la sensation, comme fondue en elles et revêtue de l’éclat de la nature divine, ils n’ont plus comme auparavant la sensibilité tournée vers les choses visibles (103). » Ici l’union οὐσιωδῶς est liée avec le revêtement de la lumière de la nature divine.
Dans une autre série de textes, c’est l’Esprit Saint surtout qui agit en nous « essentiellement ». Ainsi, dans une invective contre ceux qui « ignorent la douceur et le charme de la purification totale », Syméon dit qu’ « ils n’y croient pas et se persuadent eux-mêmes qu’il est impossible à un homme de se purifier complètement des passions et de recevoir tout entier essentiellement (104) [ὅλον οὐσιωδῶς] en lui le Paraclet (105). » On peut dire que le mot « essentiellement » caractérise ici une habitation de l’Esprit totale et consciente. Ailleurs, cette présence de l’Esprit « essentiellement » est identifiée à son « énergie », ce qui fait penser qu’il ne s’agit pas d’une habitation « par essence ». « Or l’amour [πόθος] est une énergie (106) de l’Esprit ou plutôt sa présence même, qui, essentiellement et hypostatiquement (107), se fait voir en moi [comme] lumière ; c’est une lumière incomparable, elle est totalement inexprimable (108). » Mais dans un autre passage, c’est plutôt le fait que l’Esprit Saint est un bien en soi qui est souligné et, par conséquent, tous les biens qu’il donne, il les donne essentiellement. « Tu n’as pas à nous procurer cela », dit-il dans une prière au Saint Esprit, « en le prenant du dehors, étant toi-même justement (109) [αὐτὸ ὲκείνο ὑπάρχον] tout ce qu’il peut y avoir de bien ; ceux en qui tu viendras résider, en effet, possèdent essentiellement (110) en eux-mêmes tout le bien (111). » Ici c’est plutôt l’authenticité et la plénitude des dons du Saint Esprit, ainsi que la réalité de leur possession, qui sont mises en avant. Une autre fois cette union avec l’Esprit est considérée dans un contexte trinitaire par analogie avec la structure tripartite de l’homme. « Ô merveille ! », s’exclame Syméon, « l’homme est uni avec Dieu à la fois spirituellement et corporellement, puisque l’âme ne se sépare pas de l’intelligence, ni le corps de l’âme, mais en l’unité d’essence [τῇ οὐσιωδῶς ἑνώσει] l’homme lui aussi devient triple hypostase [τρισυπόστατος] par grâce, et un seul dieu par disposition [θέσει] (112). »
C’est cependant l’incarnation qui reste le fondement de l’union de Dieu avec l’homme. C’est elle qui la rend possible dans l’Esprit Saint de sorte qu’avant la venue du Christ il était exclu que Dieu s’unisse à l’homme « essentiellement ». Marchant sur les traces de saint Grégoire de Nazianze (113), Syméon dit dans ses Hymnes que Dieu « parlait » avant l’Incarnation « par l’intermédiaire de l’Esprit divin et par les energies (114) de celui-ci réalisait ses merveilles, mais jamais, au grand jamais, Dieu ne s’est essentiellement (115) uni à personne avant que ne fut devenu homme le Christ mon Dieu. c’est lui qui, ayant pris un corps, a donné son Esprit divin et, par lui, s’unit essentiellement (116) à tous les croyants, et il se fait entre eux une union inseparable (117). » Elle a eu lieu d’abord dans le sein de la Vierge Marie, mère de Dieu, dont s’est incarné et est né le Dieu-homme, Jésus Christ, et tous les croyants y participent par le Saint Esprit. L’hypostase divine s’unit à l’essence humaine. Dieu, écrit Syméon, « ayant pris de la sainte Mère de Dieu et toujours Vierge Marie une chair animée […] l’a unie à sa divinité incompréhensible et inaccessible ; ou plutôt c’est à notre essence [οὐσία] qu’il unit en essence [οὐσιωδῶς] l’hypostase (118) entière de sa divinité ; mêlant sans confusion celle-ci à celle-là, l’humaine à la sienne propre, il l’a édifiée comme un temple saint pour lui-même ; sans mutation ni altération, le créateur d’Adam est devenu lui-même homme parfait (119). » Et la réalité de cette union hypostatique dans la Vierge Marie est aussi exprimée chez Syméon par le même adverbe οὐσιωδῶς. « La première, Marie, la mère de Dieu, reçoit de l’ange la bonne nouvelle ; elle ajoute foi au dessein de Dieu […] et elle consent […]. Et alors, la première elle reçut en elle essentiellement (120) le Verbe de Dieu, qui racheta en vérité son âme de [la sentence] antérieure de mort éternelle (121). » Au moment de l’Annonciation, elle reçoit « essentiellement (122) l’Esprit de Dieu, afin que, comme de la côte d’Adam est née la femme et d’elle tous les hommes mortels, ainsi de la chair de la femme, l’homme, le Christ-Dieu prenne naissance et que de lui tous les hommes acquièrent le privilège de l’immortalité (123). » Et il conclut. « Le Verbe Dieu a donc pris chair de la sainte Mère de Dieu [ἁγνῆς Θεοτόκου] et il a donné en échange non une chair mais l’Esprit essentiellement saint (124). » Comme on le voit, dans ces passages sur l’incarnation, Syméon exprime par le même terme la réalité de l’union divino-humaine en Christ, la plénitude de la descente de l’Esprit Saint sur la Vierge Marie, ainsi que la réalité de la naissance du Verbe en nous, tout en faisant une distinction importante, à savoir que cette naissance n’est pas corporelle comme l’incarnation du Logos. « En réalité », dit-il, « nous le concevons non pas corporellement, comme l’a conçu la Vierge mère de Dieu, mais à la fois spirituellement et essentiellement (125) ; nous possédons dans nos cœurs celui-là même que la Vierge pure a conçu (126). » Ici, c’est l’identité du Christ, né corporellement de la vierge Marie et spirituellement conçu en nous, qui est soulignée par le mot οὐσιωδῶς. Cette authenticité de la formation du Christ en nous se manifeste, pour Syméon, par son caractère conscient et il la distingue des apparitions illusoires. Syméon l’explique par un exemple. « Prenons la lumière de la lampe qui apparaît dans le miroir. ce n’est pas ainsi qu’est [le Christ] dans une image sans support [ἀνυποστάτῳ], mais il apparaît hypostatiquement et essentiellement (127) [ἐνυποστάτως καὶ οὐσιωδῶς] dans la lumière, dans une forme sans forme et dans une figure sans figure que l’on voit invisiblement et que l’on comprend incompréhensiblement (128). » L’incompréhensibilité et même l’inaccessibilité de Dieu sont affirmées paradoxalement par Syméon en même temps qu’une participation à lui « essentiellement ».
Parlant enfin de l’eucharistie, Syméon désigne avec le même adverbe, « essentiellement », le mystère de notre communion au corps et au sang du Seigneur. « Tu as accordé », écrit-il, « que je la [cette chair qui est identiquement ta chair] prenne et que je la mange essentiellement (129) et que je boive ton sang très saint (130). » Évidemment, Syméon veut exprimer ici l’authenticité de la communion eucharistique. De même, dans le passage suivant, où Syméon insiste aussi sur l’authenticité et la réalité de la déification qui nous est octroyée par l’eucharistie. « Par nature je suis homme », dit-il, « mais par grâce je suis dieu. Vois quelle grâce est, selon moi, l’union avec lui [qui se fait] d’une manière sensible et intelligible, essentielle et spirituelle. Cette union intelligible, je te l’ai exprimée de manière différente et variée, mais pour l’union sensible je parle de celle qui vient des mystères [μυστηρίων]. Car, purifié par le repentir et par les torrents de larmes, communiant à un corps divinisé [σώματος τεθεωμένου], comme à Dieu lui-même, je deviens moi aussi dieu dans cette union inexprimable. Vois quel mystère ! L’âme donc et le corps, […] parce qu’ils ont communié au Christ et bu son sang, […] deviennent dieu par leur participation ; ils sont appelés du même nom, de son nom à lui, auquel ils ont participé essentiellement [οὖ οὐσιωδῶς μετέσχον] (131). »
En essayant de résumer notre étude sur l’οὐσία divine dans les écrits de saint Syméon le Nouveau Théologien, nous pouvons constater que, de même que pour l’essence créée, il ne s’agit pas chez lui d’une doctrine théorique et systématique sur l’essence et ses attributs, avec tous les problèmes que cela pose (simplicité de Dieu, etc.), que Syméon aurait élaborée pour l’intérêt qu’elle présenterait en soi d’un point de vue théologique, mais plutôt de remarques et de constatations courtes et dispersées un peu partout dans ses œuvres et motivées par un besoin vital de rendre compte de son expérience mystique, de comprendre autant que possible ses données, d’exprimer l’inexprimable. Toute investigation théorique sur l’essence divine serait d’ailleurs à ses yeux une témérité et un blasphème. Le besoin de défendre sa spiritualité contre les attaques de ses adversaires qui l’accusaient d’hérésie pourrait être invoqué comme un second motif des développements théologiques de Syméon sur l’essence de Dieu. Ensuite — et ceci découle de ce que nous venons de remarquer —, il manque à Syméon une terminologie rigoureuse et conséquente, un développement logique des arguments. Plus encore, on peut trouver parmi ses affirmations sur l’essence des divergences et des contradictions, au moins apparentes, qui de prime abord déroutent. Ainsi, il parle souvent, dans un esprit d’apophatisme absolu (132), de l’incognoscibilité totale de Dieu (133), ailleurs il dit que celui-ci devient connu d’une manière consciente (134). Parfois, il parle de l’ « essence » divine, ailleurs il nie que ce terme puisse être appliqué à Dieu (135). Il dit que Dieu n’a pas de nom (136), mais l’appelle « Sauveur (137) »et son essence « amour (138) ». Dieu est à la fois visible et invisible (139). Syméon affirme la simplicité de Dieu, identifie sa nature et son essence (140), dit qu’en Dieu il n’y a pas de divisions (141), mais il distingue l’essence, la force (142), la puissance et l’énergie enfin (143). Quelquefois, il affirme l’incognoscibilité de Dieu, non seulement par essence (144), mais aussi selon ses énergies qu’il nomme inconnaissables (145). Plus souvent cependant, tout en insistant sur le caractère caché et l’incognoscibilité de l’essence, il dit que Dieu est visible selon les énergies, que nous en avons une vision partielle selon elles, comme des rayons d’un soleil inaccessible par son éclat (146). Dans certains passages, il va même plus loin et affirme que nous participons de Dieu essentiellement (147) et que nous devenons même participants de sa nature et de son essence, dans le mystère de l’eucharistie en particulier (148). Il dit même une fois qu’on peut avoir la vision de l’essence de Dieu (149). Mais dans d’autres passages, il nie formellement qu’on puisse s’unir à Dieu par essence, mais seulement par participation [οὐ τῇ οὐσίᾳ, ἀλλά τῇ μετουσίᾳ] et, ce qui est important, il considère ceci comme un signe d’orthodoxie (150).
Sans vouloir forcer les choses et faire de Syméon un théologien systématique, nous croyons cependant pouvoir dire qu’il ne s’agit pas ici de contradictions réelles et que Syméon n’est nullement un faible d’esprit incapable de penser conséquemment, mais que la plupart de ses « contradictions » s’expliquent par le caractère paradoxal et antinomique du mystère chrétien qui rend si difficile, sinon impossible, son expression en langage logique et conséquent, surtout si on approche ce mystère d’une manière concrète et existentielle, comme c’était le cas chez Syméon. Ceci est particulièrement vrai quand il s’agit de la transcendance de Dieu et de sa présence en nous. Ce que voulait dire Syméon par ces notions d’ « essence » et de « suressence », et les expressions « selon l’essence », « par essence » et « essentiellement », c’est la dernière réalité de sa vision mystique, de son union avec Dieu qui, tout en s’unissant avec nous « essentiellement », reste un Dieu « suressentiel » et inaccessible en soi. On peut dire que Syméon suit ici, avec l’intensité et le réalisme mystique qui lui sont propres, le grand courant de la spiritualité patristique grecque et byzantine depuis les temps les plus anciens jusqu’à saint Grégoire Palamas. Évidemment, il ne possède pas la rigueur terminologique de ce dernier, son vocabulaire est souvent différent, on peut même trouver chez lui des affirmations contraires à la doctrine de Palamas (comme, par exemple, sur la participation à l’essence divine), mais elles sont « corrigées » par d’autres, affirmées d’une manière catégorique au nom de l’orthodoxie. D’un autre côté, les thèmes centraux de la polémique palamite et anti-palamite (simplicité de Dieu, caractère des distinctions en lui, nature de la lumière du Thabor, etc.), ne constituaient pas des problèmes à l’époque de Syméon et ne sont abordés par lui que de manière incidente. De même, la prière de Jésus (151) qui est à la base de la spiritualité de Palamas n’est pas mentionnée dans les écrits authentiques de Syméon.
Néanmoins, avec toutes ces réserves, saint Syméon, avec son enseignement existentiel sur l’οὐσία cachée de Dieu et les rayons de sa gloire qui nous illuminent, est bien plus près de saint Grégoire Palamas que de ses adversaires.
* Publié dans le Messager de l’exarchat du patriarche russe en Europe occidentale, n° 75-76 (1971), p. 151-170. Sur ce sujet, voir aussi Archevêque BASILE (KRIVOCHEINE), Dans la lumière du Christ. Saint Syméon le Nouveau Théologien (949-1022). Vie, spiritualité, doctrine, Chevetogne, Éd. de Chevetogne 1980, chap. XIV. « Dieu inconnaissable et manifesté », p. 194-209 (NdR).
- Voir G. W. H. LAMPE (éd.), A Patristic Greek Lexicon, Oxford, Clarendon Press, 1961, p. 980-988.
- L’édition critique des œuvres de saint Syméon le Nouveau Théologien (949-1022) qui paraît depuis 1957 dans les « Sources chrétiennes » permet de faire une étude exacte de la terminologie de Syméon et de son sens théologique. Nous avons, pour la présente étude, eu accès l’ensemble de ses œuvres authentiques, notamment ses Catéchèses (Cat.), t. I-III (Paris, Éd. du Cerf, coll. « Sources chrétiennes », n°96 [1963, 20062], 104 [1964] et 113 [1965]), ses Actions de Grâce (Euch., Paris, Éd. du Cerf, coll. « Sources chrétiennes », n°113), ses Traités théologiques et éthiques (Théol. Éth.), t. 1 et 2 (Paris, Éd. du Cerf, coll. « Sources chrétiennes », n°122 [1966] et 129 [1967]), ses Hymnes, t. I (Hymnes I à XV, Paris, Éd. du Cerf, coll. « Sources chrétiennes », n°156 [1969]), t. II (Hymnes XVI à XL, Paris, Éd. du Cerf, coll. « Sources chrétiennes », n°174 [1971]) et t. III (Hymnes XLI à LVIII, Paris, Éd. du Cerf, coll. « Sources chrétiennes », n°196 [1973]). Pour les œuvres non encore éditées, Lettres (Ep.), nous avons pu les consulter et utiliser dans leurs épreuves grâce à l’amabilité de leurs éditeurs.
- Voir notre exposé à la Ve Conférence d’études patristiques d’Oxford en 1967: « Le problème de la cognoscibilité de Dieu. Essence et énergie chez saint Basile », publié (en russe) dans Messager de l’exarchat du patriarche russe en Europe occidentale, n° 61 (1968), p. 48-55.
- Voir « Simplicité de la nature divine et distinctions en Dieu chez Grégoire de Nysse », p. XX-XX (NdR).
- Hymnes, XV, 69, op. cit., p. 283.
- « Le problème de la cognoscibilité… », p. 48.
- Ou « nature ». Si, généralement, B. Krivochéine suit les traductions françaises existantes, il s’en écarte quelquefois, quand il les estime erronées ou non conformes à un vocabulaire théologique établi. Dans ces cas-là, nous respectons ses choix (NdR).
- Hymnes, XXI, 122-124, loc. cit., p. 141.
- Hymnes, XVI, 1-2, loc. cit., p. 11.
- Hymnes, XX, 236-237, loc. cit., p. 129.
- Hymnes, XXII, 205-207, loc. cit., p. 187.
- Hymnes, XXX, 263-267, loc. cit., p. 359.
- Hymnes, XXIV, 25-27, loc. cit., p. 229.
- Hymnes, XXVIII, 150-153, loc. cit., p. 307.
- Ou « substance », voir la n. 8.
- Hymnes, XLII, 113-117, loc. cit., p. 47.
- Hymnes, LI, 71-74, loc. cit., p. 191.
- Voir. « Ces gens qui ne savent même pas quelle est la nature de la terre qu’ils foulent de leurs pieds, se vantent de pénétrer dans la substance du Dieu de l’univers » (BASILE DE CESAREE, Contre Eunome, I, 13, Paris, Éd. du Cerf, coll. « Sources chrétiennes » n° 299, 1982, p. 219).
- Théol., II, 33-47, 53-55, loc. cit., p. 133-135.
- Théol., II, 55-62, loc. cit., p. 135.
- Expressions semblables chez BAS., Eun. I, 14, op. cit., p. 221, 223 et 225.
- Hymnes, LV, 132-136, loc. cit., p. 265.
- Dans ce texte précis, le mot grec n’est pas κρυπτή mais κεκρυμμένη (NdR).
- Hymnes, XIII, 37-40, loc. cit., p. 259-261.
- Hymnes, XIII, 12-16, loc. cit., p. 257.
- Hymnes, LII, 13, loc. cit., p. 201.
- Voir G. W. H. LAMPE, op. cit., col. 1441, sous l’entrée « ὑπερούσιος ».
- Hymnes, XLVII, 37-42, loc. cit., p. 125.
- Voir la n. 8.
- Ibid.
- Hymnes, LII, 21-26, loc. cit., p. 201.
- Hymnes, XV, 65-69, loc. cit., p. 283.
- Voir la n. 32.
- Hymnes, XV, 46-47, loc. cit., p. 203.
- Hymnes, XLIV, 10, loc. cit., p. 73.
- Hymnes, XXXIII, 1-12, loc. cit., p. 413-415.
- Hymnes, XXIII, 1-6, loc. cit., p. 189.
- Ou bien. « de la substance qui n’est pas substance », voir la n. 8.
- Théol., I, 65-68, 79-81, loc. cit., p. 101-103.
- Ou « activités », voir la n. 8.
- Ou « personne », voir la n. 8.
- Hymnes, XXXII, 99-104, loc. cit., p. 409.
- Voir la n. 41.
- Hymnes, XIII, 18-21, loc. cit., p. 259.
- Hymnes, XXX, 471-483, loc. cit., p. 373.
- Hymnes, XXI, 1-3, loc. cit., p. 131.
- Hymnes, LIII, 90-92, loc. cit., p. 219.
- Hymnes, XLIV, 6-8, loc. cit., p. 71.
- BAS., Lettre CCXXXIV, 1, 27 (voir SAINT BASILE, Lettres, Y. Courtonne (éd.), Paris, Les Belles Lettres, t. III, 1961, p. 42).
- ATHEN., Res., I (PG 6, col. 976 A).
- Ou « opérations », voir la n. 8.
- Hymnes, XXIII, 174-177, loc. cit., p. 201.
- Hymnes, VII, 28-29, loc. cit., p. 211.
- Voir la n. 52.
- Hymnes, XXIV, 6-11, loc. cit., p. 227.
- Hymnes, XXIV, 12-19, loc. cit., p. 229.
- Éth., I, 3, 80-82, loc. cit., p. 201.
- Éth., I, 3, 82-86, loc. cit., p. 203.
- 2 Pierre 1, 4.
- Éth., I, 3.90-98, loc. cit., p. 203.
- Hymnes, XXI, 203, loc. cit., p. 147.
- Hymnes, XXI, 231-234, loc. cit., p. 149.
- Hymnes, XXXI, 58, loc. cit.,. 389.
- Hymnes, XXII, 33-34, loc. cit., p. 173.
- Hymnes, XXII, 50-52, loc. cit., p. 175.
- Voir la n. 64.
- Hymnes, XXX, 18-32, loc. cit., p. 343.
- Hymnes, XXIII, 185-194, loc. cit., p. 201.
- Ou « par essence », voir la n. 8.
- Hymnes, XXIII, 230-239, loc. cit., p. 205.
- Hymnes, XLIV, 43-48, loc. cit., p. 75.
- Par exemple PSEUDO-GR. NYSS., Imag. (PG 44, col. 1340 C) ; EULOG., Sr. Trin. 2.5.
- Hymnes, VII, 25-29, loc. cit., p. 211.
- Hymnes, VII, 30-31, loc. cit., p. 211.
- Ou « opération », voir la n. 8.
- Hymnes, XLVII, 31-36, loc. cit., p. 123-125.
- Hymnes, XXX, 156-165, loc. cit., p. 351-353.
- Hymnes, XXX, 263-267, loc. cit., p. 359.
- Voir la n. 51.
- Exode 3, 14.
- Ou « ta substance », voir la n. 8.
- Idem.
- Ou « que tu as une substance », voir la n. 8.
- Hymnes, XXXI, 1-15, loc. cit., p. 387.
- Voir la n. 82.
- Hymnes, XXXI, 33-64, loc. cit., p. 387-389.
- Hymnes, I, 1-8, 21-25, loc. cit., p. 157-159.
- Hymnes, I, 26-29, loc. cit., p. 159.
- Hymnes, I, 30-37, loc. cit., p. 159-161.
- Hymnes, I, 38-42, loc. cit., p. 161.
- Ou « dans le sentiment », voir la n. 8.
- Sur αἰσθητῶς, voir Catéchèses, t. I, (Introduction), p. 151-154.
- Hymnes, L, 56-60, loc. cit., p. 161.
- Hymnes, L, 198-202, loc. cit., p. 171.
- Voir les n. 62 et 63.
- Hymnes, L, 238-241, loc. cit., p. 175.
- Ou « substantiellement », voir la n. 8.
- Éth., IV, 548-554, loc. cit., p. 47-49.
- Éth., IV, 532-537, loc. cit., p. 195.
- Éth., IV, 556-557, loc. cit., p. 49.
- Ou « substantiellement », voir la n. 8.
- Hymnes, XXIX, 162-170, loc. cit., p. 327. Ou bien. « au-delà de la substance », voir la n. 8.
- Éth., IV, 917-924, loc. cit., p. 75.
- Voir la n. 102.
- Éth., IX, 352-355, loc. cit., p. 245.
- Voir la n. 76.
- Voir la n. 102.
- Hymnes, LII, 3-5, loc. cit., p. 199.
- Voir la n. 102.
- Idem.
- Théol., III, 66-69, loc. cit., p. 159.
- Cat., XV, 73-76, loc. cit., p. 229.
- GR. NAZ., Or., 41.11 (PG 36, col. 444 C).
- Ou « l’opération », voir la n. 8.
- Voir la n. 102.
- Idem.
- Hymnes, LI, 136-142, loc. cit., p. 197.
- Voir la n. 82.
- Éth., I, 3.8-18, loc. cit., p. 197.
- Voir la n. 102.
- Éth., II, 7.125-132, loc. cit., p. 375-377.
- Ou « en substance », voir la n. 8.
- Éth., II, 7.153-157, loc. cit., p. 377-379.
- Éth., II, 7.210-212, loc. cit., p. 381.
- Voir la n. 102.
- Éth., I, 10.17-20, loc. cit., p. 253-255.
- Ou bien. « en substance et en essence », voir la n. 8.
- Éth., X, 885-889, loc. cit., p. 323-325.
- Mot absent dans la traduction officielle, voir la n. 8.
- Hymnes, XX, 58-60, loc. cit., p. 115.
- Hymnes, XXX, 457-488, loc. cit., p. 373-375.
- Voir la n. 40.
- Voir la n. 32.
- Voir la n. 103.
- Voir la n. 29.
- Ibid.
- Voir les n. 29 et 33.
- Voir la n. 27.
- Voir la n. 56.
- Voir la n. 54.
- Voir les n. 74 et 88.
- Voir la n. 48.
- Voir la n. 56.
- Voir la n. 87.
- Voir la n. 53.
- Voir la n. 71.
- Voir la n. 99.
- Voir les n. 59 et 101.
- Voir la n. 97.
- Voir la n. 95.
- Sur celle-ci, voir notamment l’exposé de Basile (Krivochéine) à la Ie Conférence patristique internationale (Oxford, 1951). « Date du texte traditionnel de la « prière de Jésus » », publié dans le Messager de l’exarchat du patriarche russe en Europe occidentale, n° 7-8 (1951), p. 55-59 (NdR).
Suite « Dieu, l’homme, l’Église » Lecture des Pères Par Basile Krivochéine Les Éditions du « CERF » Paru en. Décembre 2010, 302 pages

Le thème de l’ivresse spirituelle ou divine (θεία μέθη), équivalent à peu près à celui de l’extase et de la joie mystique, est assez répandu dans la littérature religieuse, chrétienne ou non. Sans entrer dans les détails (1), je mentionnerai seulement le fait qu’il se rencontre déjà dans la littérature poétique et religieuse païenne grecque (2), chez Plotin (3), ainsi que chez les gnostiques (4), d’où il semble avoir été emprunté par Philon qui l’utilise souvent dans son exégèse allégorique de la Bible. Philon paraît être aussi l’inventeur du célèbre oxymoron « ivresse sobre » (μέθη νηφάλιος) (5), qui a fait florès dans la littérature patristique chrétienne. Dans cette dernière, le thème de l’ivresse spirituelle apparaît pour la première fois chez Origène, bien que l’oxymoron philonien ne se rencontre pas dans ses écrits, en tout cas dans ceux parvenus jusqu’à nous (6). C’est Eusèbe de Césarée qui emploie ce dernier pour la première fois dans la littérature patristique (7), mais c’est chez saint Grégoire de Nysse surtout qu’il atteint son plus grand développement et approfondissement mystique (8). On trouve des passages sur l’ivresse spirituelle, « sobre » chez quelques-uns, dans les Catéchèses de saint Cyrille de Jérusalem (9), chez saint Jean Chrysostome (10), dans les Homélies spirituelles attribuées à Macaire (11) et, parmi les Latins, chez saint Cyprien de Carthage (12), saint Ambroise (13) et saint Augustin (14).
Un thème semblable, bien que très différent en même temps, est longuement développé dans la Catéchèse XXIII du grand mystique byzantin saint Syméon le Nouveau Théologien (15). Dans cette œuvre, intitulée « Sur la pénitence et la crainte de Dieu » et composée dans une belle prose rythmique, Syméon décrit sous les traits d’un malade éprouvant une douleur terrible dans son cœur et isolé par sa souffrance du monde entier, l’état d’un pécheur qui se repent de ses fautes. « Quel est l’homme », dit-il, « qui, le cœur atteint par le poison, frappé et torturé par une souffrance interne aiguë, se préoccupera de petites blessures à la surface de son corps et s’en fera du souci (16) ? » — « C’est sans plaisir qu’il boira son vin, ayant la souffrance à satiété (17). » Par contraste avec sa propre souffrance, toutes les créatures lui paraîtront heureuses et il sera incapable de faire des distinctions entre elles ou de porter sur elles un jugement. « Tout homme, […] ainsi que toute bête et tout reptile qui rampe sur la terre, et tout ce qui a le souffle de vie, il le proclamera bienheureux en ces termes. « Oh, que bénies sont toutes les œuvres de Dieu, dont l’existence s’écoule dans la joie de leur âme et de leur vie, et moi seul je suis chargé du fardeau de mes fautes et jugé d’un jugement de feu et accablé, moi seul, sur la terre ! » Il tiendra le même compte de n’importe quelle âme et la vénérera comme sainte pour le Seigneur, et il gardera devant tous une crainte religieuse. Il ne fera pas de différence entre le juste et l’injuste, mais mettra tous les hommes sur le même plan, purs aussi bien qu’impurs. Il est seul, retranché de toute la création qui est sous ciel (18). » La mort au cœur et isolé de tous, un tel homme implore le Seigneur dans une prière ardente en le suppliant de lui donner la santé et la résurrection. « Il pleurera », dit Syméon, « dans la douleur de son âme et criera dans son désespoir vers le Seigneur tout-puissant. « Eh bien, tu vois, Seigneur, et rien n’échappe à tes yeux ! […] J’ai ressenti ton jugement, et pour me défendre, pas une parole ne m’est venue à la bouche ! […] Le péché, c’est la mort, et quel est l’homme qui mourra par le péché et de lui-même ressuscitera ? Personne, sûrement. Car c’est toi seul qui, mort, es ressuscité, parce que tu n’as pas commis le péché […]. Je ne suis plus tout entier qu’une blessure […] et l’enfer m’a englouti vivant. […] Toi seul peux me faire remonter et guérir la souffrance de mon cœur, parce que puissante est ta main pour tout faire et elle atteint les extrémités de l’abîme, agissant en tout à ton gré. Dire. ‘Aie pitié de moi’, je n’ose, car j’en suis indigne — mais toi, Seigneur, tu considères (19) ! » ».
« Aussi le Dieu compatissant », continue Syméon — et ce qui suit est très caractéristique pour sa spiritualité —, « ne tardera pas à l’exaucer et se hâtera de lui accorder le soulagement de sa douleur et la délivrance de la peine de son cœur (20) ». Bien plus, « il répandra sur lui aussi sa propre bonté et changera en joie sa peine, l’amertume de son cœur acquerra grâce à lui la douceur d’un vin doux [είς γλυκὺ γλεῦκος μεταποιήσει] et il fera vomir le venin du dragon qui rongeait ses entrailles (21) ». La santé, que Dieu lui donne maintenant, fait oublier à l’homme tout ce qu’il a souffert auparavant. « Et il ne se souviendra plus désormais de ses peines d’antan, ni de tous ces maux qu’il a soufferts […]. Car le Dieu très-haut lui donnera une santé qui dépassera tous les trésors de la terre, et la santé causera une joie indicible en son cœur […], et cette joie à son tour chassera toute souffrance (22) ». Syméon oppose cette joie « indicible » et cette santé à la joie et à la santé ordinaires, car elles sont produites par la souffrance antérieure sous l’action de l’Esprit Saint. « Ce n’est pas de la gloire », dit-il, « qu’elle [la joie que la santé procure à son âme] lui est venue, ni de l’abondance des richesses, ni de la santé du corps, […] ni d’aucune autre chose sous le ciel, mais c’est de la peine et de l’amertume de son âme qu’elle a résulté, et de la rencontre avec l’Esprit de Dieu qui est au-dessus des cieux. Car, pressé et décanté par lui [Διυλισθεῖσα γὰρ δι’αὐτοῦ καὶ ἐκπιεσθεῖσα], le cœur de cet homme a donné naissance à une joie sincère et sans mélange d’affliction. […] Elle sera comme un vin décanté face au soleil et qui brille au contraire et resplendit et fait ressortir la pureté de sa couleur en étincelant joyeusement sur le visage de celui qui le boit en face du soleil (23). »
« Mais à ce sujet », continue Syméon, à la première personne maintenant (preuve qu’il s’agit d’une expérience mystique réelle et personnelle), dans son développement des thèmes du soleil et du vin, « il y a une chose que je ne puis comprendre. je ne sais ce qui me réjouit davantage, la vue et le charme des purs rayons du soleil, ou bien de boire et de goûter le vin qui [coule] en ma bouche. Je voudrais dire que c’est le second, et le premier m’attire et m’apparaît plus doux. et lorsque je me tourne vers le premier, voilà qu’à son tour la douceur du goût m’est encore plus suave, et je ne peux ni me lasser de regarder, ni me rassasier de boire. Car lorsque je crois avoir bu tout mon soûl [τοῦ πίνειν χορτασθῆναι δοκήσω], voilà que la beauté des rayons qui en jaillissent redouble ma soif, et je me trouve à nouveau altéré. mais j’ai beau m’efforcer de plus belle de rassasier mes entrailles, autant et dix fois plus brûle ma bouche et je suis consumé de soif et d’avidité pour la cristalline liqueur [τοῦ διειδέστερον πίνοντος] (24). » « Sa soif », continue Syméon en retrouvant la troisième personne, « ne cessera pas dans l’éternité, ni ne lui manquera la suave liqueur aux clairs reflets [τό ἡδύ καὶ λευκολαμπές πόμα] ; la suavité de la boisson et l’éclat joyeux que rayonne le soleil chassent toute tristesse de son âme, et mettent cet homme dans une joie continuelle ; nul n’aura le droit de lui nuire, et il n’aura personne pour l’empêcher de se rassasier à cette coupe comme à une source (25). » Et Syméon, sans parler directement d’un état d’ivresse, décrit dans les termes suivants l’effet de ce vin et de cette lumière. « Le reflet du vin et le rayon du soleil qui jettent tout leur éclat sur le visage de celui qui boit passent jusqu’à ses entrailles, jusqu’à ses mains et ses pieds, jusqu’à son dos, et rendant le buveur tout entier de feu, ils lui donneront de pouvoir brûler et de faire fondre les ennemis qui l’attaquent de toutes parts. Et il devient le bien-aimé de la lumière du soleil, l’ami du soleil et comme un fils chéri pour le vin au clair reflet (26). » Syméon conclut ce passage en revenant à nouveau sur l’effet salutaire du vin et la soif insatiable qu’il produit. « La boisson est pour lui nourriture et purification de l’infection de ses chairs putréfiées, la purification est pour lui santé complète, et la santé ne lui permet de se nourrir d’aucun autre aliment malsain, mais au contraire allume en lui un désir infini, brûlant de boire de ce vin, de se purifier, et de trouver dans [cette] boisson la santé. Car de la beauté d’[un corps] sain et du charme d’une bonne mine produite par la santé, on ne se lasse pas [χόρον οὐκ ἔχει] (27) ».
Par rapport au thème traditionnel de l’ivresse spirituelle, ces descriptions mystiques de saint Syméon le Nouveau Théologien constituent un développement sensible et une variation personnelle et originale qui distingue Syméon de ses prédécesseurs. D’abord, si on fait une comparaison formelle, les écrivains anciens (qu’il s’agisse de Philon ou des auteurs chrétiens) partent de la Bible, et ce qu’ils disent sur l’ivresse spirituelle apparaît généralement comme une exégèse de nombreux passages, de l’Ancien Testament surtout, où il est question de l’ébriété, de la coupe, du banquet, etc., ainsi que de certaines scènes bibliques (l’ivresse de Noé, par exemple), qu’ils interprètent dans un sens allégorique ou symbolique (28). Syméon, au contraire (si on omet une allusion à Ac 2, 13 qu’on pourrait voir dans sa mention du « vin doux » [γλεῦκος] et une autre à la « coupe » [ποτήριον] du Ps 22, 5) est indépendant de toute source scripturaire et n’emprunte pas à la Bible ses images et ses expressions pour décrire l’ivresse spirituelle. Il part directement de son expérience mystique qu’il veut exprimer par les symboles du vin, de son goût et de sa couleur, etc. C’est l’expérience mystique et non l’exégèse biblique qui l’intéresse au premier chef (29). En accord avec cette attitude, ses descriptions du phénomène mystique de l’ivresse spirituelle sont, sans aucune comparaison, plus développées que chez ses prédécesseurs. Elles ont un caractère plus réaliste, plus personnel, plus vécu et contiennent plus de détails psychologiques (comme, par exemple, l’hésitation de donner la préférence au goût du vin ou à sa couleur). D’un autre côté, Syméon est complètement étranger dans son traitement du thème de l’ivresse spirituelle aux préoccupations apologétiques ou polémiques qui jouaient un rôle si important dans les écrits des auteurs anciens qui ont écrit sur le même sujet (30).
Les traits originaux de Syméon dans sa description du phénomène de l’ivresse mystique sont bien plus importants. À vrai dire, il ne s’agit pas chez lui, à strictement parler, d’une « ivresse », qu’elle soit « sobre » ou « divine », qu’importe. Toutes ces expressions manquent chez Syméon, comme nous l’avons vu dans les textes cités plus haut. Il nous parle plutôt d’un malade qui a recouvré la santé et qui éprouve une soif insatiable. Mais cet homme est en même temps un connaisseur qui aime à déguster du vin. Il admire son goût et sa couleur au soleil et ne peut pas facilement décider ce qu’il doit préférer, le goût ou la couleur. Une telle image ne se rencontre chez aucun autre écrivain patristique. Comme Philon, qui identifie à peu près son « ivresse sobre » avec une joie extatique (31), Syméon parle aussi de la joie indicible de celui qui boit le vin. Mais tandis que chez Philon cette joie est le fruit de la gnose, chez Syméon elle est un don de l’Esprit Saint donné à celui qui se repent et implore Dieu. Syméon ajoute en plus l’image du soleil dont les rayons se reflètent dans le vin. Cette union d’images du vin et du soleil, unique aussi dans la littérature patristique, constitue la particularité la plus frappante du langage symbolique de Syméon. Il faut ajouter aussi que Syméon, tout en évitant de parler directement d’ivresse, décrit avec force et réalisme l’effet du vin qui pénètre l’homme entier et l’embrase corps et âme. C’est l’idée de la participation totale de l’homme dans la vie mystique et de sa transformation par le Saint Esprit. On peut donc dire que le mystique est comparé par Syméon à un connaisseur, qui admire le vin et le déguste « en face du soleil », mais poussé par sa soif insatiable et qui augmente toujours plus il boit, s’enivre sans s’en apercevoir. C’est un état nettement extatique où le buveur devient « l’ami du soleil et le fils aimé du vin », expressions qui montrent bien qu’il ne s’agit pas ici d’une identification « panthéistique » avec le divin, mais d’une amitié et filiation avec le Christ et le Saint Esprit, le soleil et le vin étant leurs symboles. Si cette interprétation est juste, le Christ-soleil se refléterait dans le chrétien et s’unirait avec lui par l’Esprit Saint, comme le soleil se reflète dans le vin qui pénètre entièrement celui qui le boit.
Quelle est l’origine de ces images et quelles sont les sources que Syméon aurait pu utiliser ? Il est difficile de répondre à ces questions. Syméon n’a certainement pas emprunté l’ensemble de ses images (le vin, sa couleur, le reflet du soleil dans le vin, l’hésitation du « dégustateur », etc.) chez les écrivains ecclésiastiques anciens, puisqu’elles ne se trouvent pas dans leurs écrits. Peut-être fut-il influencé par la poésie populaire byzantine (quelque chanson du peuple ?) d’où il aurait pu emprunter ces images en les transposant sur un plan spirituel et mystique (32)? Je ne pourrais répondre à cette question. Il est néanmoins bien plus probable que Syméon ait créé lui-même son langage symbolique et l’ensemble de ses images, dans le but d’exprimer son expérience mystique personnelle de l’extase et de l’union avec Dieu — une variante particulière du thème ancien de l’ivresse spirituelle. Mystique authentique et écrivain doué, il en était capable. Et innovant de la sorte ce thème traditionnel de la théologie mystique, saint Syméon aurait encore une fois justifié l’appellation de « Nouveau Théologien » qui lui a été donnée par ses contemporains.
* Exposé présenté à la IIIe Conférence patristique internationale (Oxford, 1959) et publié dans le Messager de l’exarchat du patriarche russe en Europe occidentale, n° 35 (1960), p. 10-18.
- Une étude historique détaillée du thème de l’ivresse spirituelle a été faite par Hans Lewy dans un livre intéressant. Sobria Ebrietas. Untersuchungen zur Geschichte der antiken Mystik (« Beiheft zur Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft und die Kunde der älteren Kirche », n° 9), Giessen, 1929. Saint Syméon n’y est toutefois pas mentionné.
- Voir H. LEWY, op. cit., p. 42-54 et p. 66-72.
- Plotin en parle dans les termes suivants. « [L’intelligence] hors d’elle-même et enivrée de nectar [μεθυσθεὶς τοῦ νέκταρος], devient intelligence aimante en se simplifiant pour arriver à cet état de plénitude heureuse. et une telle ivresse vaut mieux pour elle que la sobriété [καὶ ἔστιν αὐτῷ μεθύειν βέλτιον ἢ σεμνοτέρῳ εἶναι τοιαύτης μέθης] » (Enn. VI, 7 [38] 35, 24-27, texte établi et traduit par É. Bréhier, Paris, Les Belles Lettres, 1938, p. 109).
- Voir LEWY, op. cit., « Philon und die Gnosis », p. 73-103.
- Voir LEWY, op. cit., chap. 1, p. 3-41. Philon parle souvent de l’"ivresse sobre" dans ses œuvres, toujours en connexion avec des passages bibliques (1 R 1, 14-15, par exemple) qu’il interprète dans un sens allégorique.
- Voir LEWY, op. cit., p. 119-128. Les passages les plus importants sur l’ivresse divine se trouvent, chez Origène, dans son Commentaire sur saint Jean, 1, 30 (SC 120bis) ; dans son Commentaire sur l’Évangile selon Matthieu (SC 162), ainsi que dans ses Homélies sur le Lévitique (SC 286-287) et Commentaire sur le Cantique, 3 (SC 375-376).
- Voir LEWY, op. cit., p. 129-132. Eusèbe emploie cette expression dans son Commentaire sur les Psaumes, 35, 9-10 et 36, 4 (PG 23, col. 321 AB et col. 325 C).
- Voir LEWY, op. cit., p. 132-137 et Jean DANIELOU, Platonisme et théologie mystique. Essai sur la doctrine spirituelle de saint Grégoire de Nysse, Paris, Aubier, 1944, p. 290-302; saint Grégoire de Nysse parle de cette « ivresse » dans ses Homélies sur le Cantique des cantiques (Hom. V dans 2, 13, PG 44, col. 873 B ; Hom. X dans 5, 1, ibid., col. 989 C-992 B) et dans son Discours sur l’Ascension du Christ (PG 46, col. 692 B).
- CYRILLE DE JERUSALEM, Cat. XVII, 19 dans De Spiritu Sancto, II (PG 33, col. 989 C-992 B, sur Act. 2, 12 f.) ; voir LEWY, op. cit., p. 85, n. 4.
- Hom. adv. Ebriosos, II (PG 50, col. 435-436), voir LEWY, op. cit., p. 127, n. 7; PSEUDO-CHRYSOSTOME, In Sanctam Pentecosten, II (PG 52, col. 807-810), voir LEWY, op. cit., p. 5, n. 3.
- MACAR., Hom., VIII, 2 (PG 34, col. 529 A), voir LEWY, op. cit., p. 124, n. 2.
- Voir LEWY, op. cit., p. 138-146. CYPRIEN, Lettre 63 à Caecilius (CSEL III, 701 f.).
- Dans son hymne Spendor paternae gloriae, qui contient les mots suivants. « laeti bibamus sobriam — ebrietatem Spiritus » (PL 16, col. 1411) ; voir LEWY, op. cit., p. 146-157.
- Voir LEWY, op. cit., p. 157-164. En particulier. Ennaratio in psalmum 35 (Éd. du Cerf, 2007, p. 462-481).
- Cette catéchèse (éditée dans Catéchèses, t. III, Paris, Éd. du Cerf, coll. « Sources chrétiennes » n°113, 1965) a dû être écrite par saint Syméon vers la fin du Xe siècle, quand il était supérieur du monastère de Saint-Mamas à Constantinople.
- Cat., XXIII, 9-12, loc. cit., p. 15.
- Cat., XXIII, 25-26, loc. cit., p. 15.
- Cat., XXIII, 36-49, loc. cit., p. 17.
- Cat., XXIII, 64-94, loc. cit., p. 19-21.
- Cat., XXIII, 95-97, loc. cit., p. 21.
- Cat., XXIII, 104-107, loc. cit., p. 21.
- Cat., XXIII, 109-117, loc. cit., p. 21-23.
- Cat., XXIII, 146-157, loc. cit., p. 25.
- Cat., XXIII, 158-170, loc. cit., p. 25-27.
- Cat., XXIII, 173-180, loc. cit., p. 27.
- Cat., XXIII, 185-192, loc. cit., p. 27.
- Cat., XXIII, 193-200, loc. cit., p. 27-29.
- Les loci classici de la Bible sur l’ivresse et le vin, qu’on interprétait souvent dans un sens spirituel, sont principalement les suivants. Gn 10, 20-21 (L’ivresse de Noé) ; 1 R 1, 14-15 (La prière d’Anne) ; Ps 22, 5 (La coupe qui enivre) ; Ps 35, 9 (« Ils s’enivrent de la graisse de ta maison ») ; Ps 103, 15 (« Le vin qui réjouit le cœur de l’homme ») ; Ct 5, 1 (« Je bois mon vin et mon lait. Mangez, amis, buvez, enivrez-vous mes bien-aimés ») ; Pr 9, 2-5 (Le banquet de la Sagesse et le cratère. « Venez, mangez mon pain et buvez le vin que j’ai dissout ») ; et dans le Nouveau Testament. Ac 2, 13 (L’ivresse des Apôtres à la Pentecôte) ; Ep 5, 18 (« Ne vous enivrez pas de vin… mais remplissez-vous de l’Esprit ») et quelques fois Mt 26, 27 (La Cène).
- Les seuls auteurs anciens qui ne partent pas de textes bibliques dans leurs passages sur l’ivresse spirituelle et ne sont pas dominés par les intérêts exégétiques sont, à notre connaissance, saint Ambroise (dans son hymne citée plus haut, voir n. 14) et le pseudo-Macaire qui dit, dans ses Homélies spirituelles, qu’un homme en extase « lorsqu’il est illuminé davantage, est incandescent dans son ivresse de l’amour de Dieu » (voir n. 12). Dans les deux cas, il s’agit avant tout de descriptions spirituelles et non d’exégèse scripturale. Saint Ambroise cependant, ne parle pas, dans le passage mentionné, d’un état mystique et extatique, mais plutôt d’une vie nouvelle et d’un état de grâce fondé sur les sacrements et commun à tous les chrétiens. Il n’est donc pas, à strictement parler, dans la lignée spirituelle de saint Syméon. On peut dire aussi que chez saint Grégoire de Nysse l’intérêt spirituel et mystique équivaut au moins à l’intérêt exégétique, bien que ses passages sur l’ivresse sobre appartiennent presque tous à ses Homélies sur le Cantique des cantiques et sont basés sur cet écrit de l’Ancien Testament. Le texte biblique, comme on le sait, servait souvent pour saint Grégoire de simple point de départ pour ses méditations théologiques et spirituelles. On pourrait donc dire que saint Syméon le Nouveau Théologien se trouve à la fin d’un développement qui commence par Grégoire de Nysse et le pseudo-Macaire et au cours duquel l’intérêt exégétique pour les passages de la Bible sur l’ivresse et le vin cède la place à une description d’un phénomène spirituel et mystique, plus ou moins indépendante de sources scripturales.
- Ces préoccupations apologétiques se rencontrent, par exemple, assez souvent chez Philon. Comme on le sait, il a composé des traités moraux contre ceux qui s’enivrent [Kατὰ μεθυόντων], inspirés, partiellement en tout cas, par des diatribes stoïciennes sur le même sujet. Or, il se trouve dans l’Ancien Testament de nombreux passages qui parlent de l’ivresse, du banquet, de la coupe, etc. (voir n. 29). Philon tâche donc de montrer dans ses traités qu’il faut comprendre ces passages bibliques dans un sens spirituel et qu’il ne s’agit pas d’une ivresse physique, mais de l’ivresse sobre, entièrement différente par sa nature et ses effets de l’ivresse ordinaire, et que par conséquent on ne peut pas justifier par la Bible un emploi excessif du vin. Saint Syméon distingue aussi le vin « physique » du vin « mystique » lorsqu’il dit que l’homme malade, qu’il décrit « buvant son vin sans plaisir, ayant la souffrance à satiété » (voir n. 18), tandis que le vin « mystique », tout en lui donnant la santé, provoque en même temps une soif insatiable. Mais Syméon argumente ainsi sans aucun souci de combattre le vice de l’ivrognerie. Il décrit simplement des états spirituels et les distingue des états ordinaires. S’il a un but moral, c’est d’attirer les hommes à la pénitence en montrant les fruits spirituels qu’elle porte (santé, joie, « ivresse », etc.). Chez saint Cyprien, au contraire c’est plutôt le souci polémique qui le fait parler de l’ivresse spirituelle. Dans sa lettre à Caecilius (voir la n. 13), il polémique contre les Aquarii qui célébraient l’Eucharistie avec de l’eau au lieu de vin. Cyprien combat leur erreur et défend l’usage eucharistique du vin en se basant (entre autres arguments) sur les passages de l’Ancien Testament concernant la coupe qui enivre, le banquet, etc., en les interprétant aussi dans un sens symbolique, comme préfigurations de l’Eucharistie et justification de l’emploi du vin dans ce sacrement. C’est seulement dans cette connexion liturgique et dans ce souci polémique que saint Cyprien parle de l’ivresse spirituelle. Quant à saint Syméon le Nouveau Théologien, il est difficile de dire si ses passages sur le vin et son action se rapportent à l’Eucharistie. Ce n’est pas exclu, c’est même probable, mais en premier lieu ils ont en vue, certainement, l’état extatique intérieur, créé par l’Esprit-Saint dans l’âme du pénitent.
- Voir LEWY, op. cit., p. 34-41.
- Dans ce cas il existerait une certaine analogie entre saint Syméon le Nouveau Théologien et Plotin qui s’inspirait davantage dans son langage mystique des poètes que des écrivains religieux. D’autre part, on ne peut pas nier qu’il existe une certaine ressemblance sur le thème de l’ivresse spirituelle entre saint Syméon et quelques poètes mystiques arabes et perses, Ibn al-Farid (1182-1235) en particulier. Voir R. A. NICHOLSON, Studies in Islamic Mysticism, Cambridge, 1921, chap. III. « The Odes of Ibnu’l-Farid », p. 162-266. Notamment les vers suivants. « La main de mon œil m’a donné à boire le vin fort de l’amour, lorsque ma coupe était la face de Celle qui transcende la beauté. Et, dans mon ivresse, par le moyen d’un regard, j’ai fait imaginer mes camarades que c’était le fait d’avoir bu à grands traits leur vin qui a réjoui mon âme intérieure. Bien que mes yeux m’ont rendu indépendant de ma coupe et mon ébriété fut dérivée des qualités d’Elle, et non de mon vin » (NICHOLSON, op. cit., p. 199). Malgré la très grande différence du style, des images et des idées, ce qui frappe chez Ibn al-Farid, comme chez Syméon, c’est cette connexion entre le fait de boire du vin et de contempler en même temps quelque chose (le reflet des rayons du soleil dans le vin chez Syméon, la face et les qualités de « Celle qui transcende la beauté » chez Ibn al-Farid). Il faut néanmoins remarquer qu’Ibn al-Farid appartient à une époque postérieure à Syméon. Donc toute possibilité de son influence sur Syméon est exclue, a priori. Une influence inverse de Syméon sur les mystiques arabes semble aussi extrêmement invraisemblable pour des raisons historiques et culturelles d’ordre général et vue la diffusion comparativement restreinte des idées et des écrits de Syméon dans l’empire byzantin, même avant le XIVe siècle. D’un autre côté, la différence dans le traitement du même thème de l’ivresse spirituelle chez Syméon et dans la mystique arabe reste très grande malgré certaines ressemblances qu’on trouve généralement entre les phénomènes mystiques. L’image du soleil, de ses rayons et de leur reflet dans le vin manque chez Ibn al-Farid. Plus important encore, les idées centrales de Syméon — la filiation et l’amitié avec le vin et le soleil —, compréhensibles dans les cadres d’une théologie chrétienne trinitaire, manquent également chez Ibn al-Farid, qui parle plutôt d’une identification avec une essence divine féminine et d’une immersion en elle. Enfin, les idées du péché comme maladie et souffrance, et de la pénitence qui donne la santé et la joie, développées par Syméon avec une telle force dramatique, ne se retrouvent non plus dans la mystique d’Ibn al-Farid. Malgré ce résultat plus ou moins négatif de la comparaison entre ces deux grands représentants de la mystique byzantine et arabe, il faut souhaiter qu’une étude comparative plus poussée de ces deux mystiques soit entreprise par une personne plus qualifiée que moi pour cette tâche…
Suite « Dieu, l’homme, l’Église » Lecture des Pères Par Basile Krivochéine Les Éditions du « CERF » Paru en. Décembre 2010, 302 pages

Notice (2)
Une partie considérable des œuvres de saint Grégoire Palamas reste à ce jour inédite. La publication de toutes ses œuvres (ainsi que de celles de ses disciples et de ses adversaires) représenterait un préliminaire nécessaire à la poursuite de l’étude de ses doctrines, de sa vie et de ses activités. Dans le présent travail (qui ne prétend nullement constituer une recherche exhaustive), nous avons pris en considération les textes suivants de saint Grégoire Palamas :
a) « Λόγος εἰς θαυμαστὸν καὶ ἰσάγγελον βίον τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Πέτρου τοῦ ἐν Ἁγίῳ Ὄρει τῷ Ἄθῳ ἀσκήσαντος [Discours sur la vie admirable et angélique de notre père saint et théophore Pierre qui a accompli ses exploits à la sainte montagne de l’Athos] », Migne, coll. « Patrologia Graeca » (PG) n° 150, col. 996-1040.
b) « Περὶ προσευχῆς καί καθαρότητος καρδίας » [Sur la prière et la pureté du cœur] (Περὶ προσευχῆς), PG 150, col. 1117-1122.
c) « Πρός Ξένην μοναχήν » [Lettre à la moniale Xénée], PG 150, col. 1043-1088.
d) Extraits des écrits polémiques contre Barlaam. « Ὑπὲρ τῶν ἱερῶς ἡσυχαζόντων [Sur les saints hésychastes] », PG 150, col. 1101-1117; voir aussi Év. PORPHYRE (USPENSKIJ), Istorija Afona [Histoire du mont Athos], Saint-Pétersbourg, 1892, 3e partie, chap. II, p. XXVII-XLIV et p. 688-691.
e) Introduction au traité « Contre Akindynos », Operum Gregorii Palamae argumenta ex codicibus Coislianis, PG 150, col. 799-814.
f) « Ὁμιλίαι [Homélies] » (Ὁμιλ.), PG 151, col. 10-550.
g) « Τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Γρηγορίου Ἀρχιεπίσκοπου Θεσσαλονίκης τοῦ Παλαμᾶ Ὁμιλίαι [Homélies de notre père parmi les saints Grégoire Palamas, archevêque de Thessalonique] », 22, Éd. Sophoclès Οikonomos, Athènes, 1861 (Ὁμιλ. Σοφ.).
h) « Θεοφάνης ἢ περὶ Θεότητος [Théophane, ou de la divinité] » (Θεοφ.), PG 150, col. 910–960.
i) « Κεφάλαια φυσικά, θεολογικά, ἠθικά τε καὶ πρακτικὰ 150 [150 chapitres physiques, théologiques, éthiques et pratiques] » (Κεφ.), PG 150, col. 1121-1225.
j) « Ὁμολογία τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως [Confession de la foi orthodoxe] », PG 151, col. 763-768.
Nous avons aussi utilisé certains actes ecclésiastiques de l’époque de saint Grégoire composés avec son aide et exprimant sa doctrine :
— « Ἁγιορειτικός Τόμος ὑπὲρ τῶν ἱερῶς ἡσυχαζόντων [Tome hagioritique sur les saints hésychastes] », PG 150, col. 1225-1236.
— Actes des conciles de 1341-1352 (PG 151, col. 679-692, 717-762; PG 152, col. 1273-1284 et P. USPENSKIJ, op. cit., p. 728-737, 741-780, 780-785).
On trouvera la liste la plus complète des œuvres de saint Grégoire, publiées ou inédites, dans l’article du P. M. JUGIE dans le Dictionnaire de théologie catholique, Paris, Letouzey & Ané, t. XI, 1932: « Palamas », col. 1742-1750. Parmi les ouvrages relativement abondants (bien qu’insuffisants) concernant Grégoire Palamas, les suivants sont les plus intéressants :
— l’ouvrage le plus général et le plus substantiel sur saint Grégoire Palamas est. Grégoire PAPAMICHAÏL, Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, Ἀρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης [Saint Grégoire Palamas, archevêque de Thessalonique], Alexandrie, 1911 (un livre très utile, mais Papamichaïl n’accorde pas assez d’attention à la doctrine de Grégoire Palamas) ;
— Ph. MEYER, Palamas, dans Realencyklopädie für Protestantische Theologie, vol. 3, 1904, p. 599-601;
— W. GASS, Ph. MEYER, Hesychasten, ibid., vol. 8, 1900, p. 14-18;
— J. BOIS, « Les débuts de la controverse hésychaste », Échos d’Orient, n° 5 (1902), p. 353-362; « Le Synode hésychaste de 1341 », ibid., n° 6 (1903), p. 50-60;
— G. OSTROGORSKY, Afonskiè isihasty i ih protivniki [Les hésychastes athonites et leurs adversaires], Notes de l’Institut scientifique russe de Belgrade, t. V, 1931, p. 349-370;
— Martin JUGIE, « Palamas, Grégoire », dans Dictionnaire de théologie catholique, loc. cit., col. 1735-1776; « Palamite (Controverse) », ibid., col. 1777-1818. Les articles de Jugie sont remarquables en raison de ses connaissances des sources de l’époque et du traitement philosophico-théologique du sujet.
D’autres ouvrages traitant plus particulièrement de la doctrine de saint Grégoire Palamas sont ceux de :
— K. F. RADCHENKO, Religioznoye i literaturnoye dvijeniye v Bolgarii v epohu pered turetskim zavojevaniyem [Le Mouvement religieux et littéraire en Bulgarie dans la période précédant la conquête turque], Kiev, 1898 — un ouvrage intéressant bien que l’auteur révèle, à l’occasion, une totale incompétence en tant que théologien ;
— Év. ALEXIS (DOBRYNITSYNE), « Vizantijskie tserkovnye mistiki XIV veka [Les mystiques de l’Église byzantine au XIVe siècle] », Pravoslavniy Sobesednik, Kazan, 1906.
— Sébastien GUICHARDON, Le problème de la simplicité divine en Orient et en Occident aux XIVe et XVe s.: Grégoire Palamas, Duns Scott, Georges Scholarios, Lyon, 1933 — l’auteur examine l’enseignement de saint Grégoire du point de vue de la philosophie thomiste. Une critique de ce livre. V. GRUMEL, « Grégoire Palamas, Duns Scott et Georges Scholarios devant le problème de la simplicité divine », Échos d’Orient, t. XXXVIII (1935), p. 84-96.
— M. JUGIE, De theologia palamitica, dans sa Theologia dogmatica christianorum orientalium, t. II, Paris, 1933, p. 47-183 (JUGIE, Theol. Dogm.).
Un exposé plus détaillé des points essentiels de l’enseignement de saint Grégoire Palamas et des listes d’autres ouvrages seront donnés par la suite. La liste la plus complète de la littérature sur saint Grégoire Palamas et les hésychastes se trouve chez Papamichaïl. Certains suppléments se trouvent chez Jugie, Guichardon et Ostrogorsky. Théodore Uspenskij rend compte de façon intéressante de l’arrière-plan culturel et des courants intellectuels de l’époque dans son Otcherki po istorii vizantijskoy obrazovannosti [Essais sur l’histoire de la culture byzantine], Saint-Pétersbourg, 1891. Mais il ne traite pas de façon satisfaisante de la controverse hésychaste elle-même.
Enfin, des informations d’ordre plus général sur l’histoire byzantine de l’époque se trouvent chez A. A. VASSILIEV, Histoire de l’Empire Byzantin, Paris, 1932, vol. II, « La chute de Byzance » (p. 253-439).
Addendum
Moyennant quelques légères corrections, nous reproduisions ici l’article de Basile Krivochéine tel qu’il a paru en 1936. Cependant, la publication des œuvres de Grégoire Palamas, de même que les études à son sujet, se sont poursuivies depuis cette époque.
Ainsi, pratiquement tous les écrits de Grégoire Palamas ont été édités :
— Συγγράματα [Écrits], P. Chrestou (éd.), Thessalonique, 1962-1988, 4 tomes.
— Ἅπαντα τὰ ἔργα [Œuvres complètes], édité et traduit en grec moderne par P. Chrestou, Thessalonique, 1981-1987, 11 tomes.
Parmi les œuvres de Grégoire Palamas traduites en français, citons :
— Défense des saints hésychastes, introduction, texte critique, traduction et notes par J. Meyendorff, coll. « Spicilegium sacrum Lovaniense. études et documents », n° 30-31 (2 vol.), Louvain, 1959, 19732.
— Deux homélies sur la Transfiguration du Seigneur, dans Joie de la Transfiguration d’après les Pères d’Orient, Éd. Abbaye de Bellefontaine, coll. « Spiritualité Orientale », n° 39, 1985, p. 237-256.
— Douze homélies pour les fêtes, introduction et traduction de J. Cler, Paris, Éd. O. E. I. L./YMCA-Press, 1987.
— De la déification de l’être humain, traduit par M.-J. Monsaingeon et J. Paramelle, Lausanne, L’Âge d’Homme, 1990.
— Traité apodictiques sur la procession du Saint Esprit, introd. par J.-C. Larchet, trad. et notes par E. Ponsoye, Paris-Suresnes, Éd. de l’Ancre, 1995.
— Lettre à la moniale Xénée, Décalogue, Sur les saints hésychastes, Sur la prière et la pureté du cœur, 150 chapitres physiques, théologiques, éthiques et pratiques, Tome hagioritique sur les saints hésychastes, dans Philocalie des Pères nêptiques. À l’école mystique de la prière intérieure, t. B, vol. 3: De Grégoire Palamas à Calliste et Ignace Xanthopouloi, introd., trad. et notes par J. Touraille, Éd. Abbaye de Bellefontaine, 2005, p. 435-541.
Parmi les recherches récentes sur le théologien hésychaste, le lecteur ne pourra négliger les travaux suivants :
— HALLEUX (de), A., « Palamisme et Scolastique. Exclusivisme dogmatique ou pluriformité théologique ? », Revue théologique de Louvain, n° 4 (1973), p. 409-442.
— HALLEUX (de), A., « Palamisme et Tradition », Irénikon, n° 48/4 (1975), p. 479-493.
— LISON, J., L’Esprit répandu. La pneumatologie de Grégoire Palamas, Paris, Éd. du Cerf, 1994.
— MEYENDORFF, J., Introduction à l’étude de Grégoire Palamas, Paris, Éd. du Seuil, 1959.
— MEYENDORFF, J., « Palamas (Grégoire) », dans Dictionnaire de spiritualité, Paris, Beauchesne, 1984, t. XII/I, col. 81-107.
— MEYENDORFF, J., Saint Grégoire Palamas et la mystique orthodoxe, Paris, Éd. du Seuil, 1959, 2002 (2).
***
I. La base ascético-gnoséologique de la doctrine de saint Grégoire Palamas
Qu’on la comprenne comme communion de l’homme avec Dieu ou comme perception de Dieu par l’homme, la vie religieuse peut être décrite comme relation mutuelle et interaction entre Dieu et l’homme, entre le Créateur et sa créature. C’est pourquoi, si l’on veut comprendre la doctrine de tout maître spirituel, dans le cas présent celle de saint Grégoire Palamas (1296 — 27 novembre 1359), il faut d’abord découvrir comment ce maître conçoit la possibilité d’une communion entre Dieu et l’homme, ce qu’il pense des moyens d’appréhender Dieu et de la capacité de l’homme pour une telle perception. C’est cela qui va constituer, pourrait-on dire, la base ascético-gnoséologique du système de théologie qui nous intéresse (3). Examinons donc les traits essentiels de cette partie de l’enseignement de saint Grégoire avant d’aborder ses doctrines proprement théologiques (4).
La question de la possibilité et des moyens d’appréhender Dieu occupe une place relativement importante dans l’œuvre de Grégoire Palamas. Mais il convient de noter dès l’abord qu’il commence par affirmer l’impossibilité de saisir Dieu par la raison et de l’exprimer par des mots. Cette idée que Dieu ne peut pas être rationnellement connu est liée à la doctrine de saint Grégoire sur la nature divine, mais nous nous bornerons ici à l’aspect gnoséologique de la question. Il n’y a, toutefois, rien de nouveau dans cette affirmation. Grégoire se situe — et cela est tout à fait caractéristique de l’orthodoxie orientale — au plan de la théologie apophatique, dans la droite ligne de la tradition de saint Grégoire de Nysse et de Denys l’Aréopagite. Comme eux, il souligne l’impossibilité de définir Dieu ou de l’exprimer par un nom quelconque. Ainsi, ayant dit de Dieu qu’il était un « abîme de grâce (5) », il apporte immédiatement un correctif. « mais plus justement celui qui contient même cet abîme, transcendant toute chose à laquelle on peut penser ou que l’on peut nommer (6) ». Une véritable connaissance de Dieu ne peut donc être atteinte ni par l’étude du monde créé visible, ni par l’activité intellectuelle de l’esprit humain. Les discours philosophiques ou théologiques les plus abstraits et les plus subtils eux-mêmes ne peuvent donner une véritable vision de Dieu ou la communion avec lui. « Même lorsque nous réfléchissons théologiquement ou philosophiquement à des questions tout a fait séparées de la matière », écrit saint Grégoire, « nous approchons la vérité mais nous restons cependant très éloignés de la vision de Dieu, et aussi étrangers à la communion avec lui que la possession est distincte de la connaissance. Parler de Dieu et communier avec lui [συντυγχάνειν] cela n’est pas la même chose (7). » Ceci explique son attitude à l’égard des différentes formes des disciplines scientifiques, qu’elles soient logiques ou empiriques ; il reconnaît leur valeur relative pour ce qui est de l’étude du monde créé, et dans ce domaine il justifie leurs méthodes — syllogismes, preuves logiques, exemples tirés du monde visible. Mais en ce qui concerne la connaissance de Dieu, il affirme leur insuffisance et pense même qu’elles ne doivent en aucun cas être utilisées (8).
Le fait que Dieu ne peut être rationnellement connu ne conduit cependant pas saint Grégoire à conclure qu’il est entièrement inconnaissable et inaccessible à l’homme. Il fonde la possibilité d’une communion de l’homme avec Dieu sur les propriétés de la nature humaine et sur la place de l’homme dans l’univers. Examinons donc d’un peu plus près l’enseignement de saint Grégoire sur l’homme. Son idée fondamentale, qui se retrouve souvent dans ses œuvres, est que l’homme a été créé à l’image et à la ressemblance de Dieu et qu’il occupe dans l’univers une place centrale. L’homme, créé à l’image de Dieu et réunissant en lui-même (puisqu’il est composé d’une âme et d’un corps) les mondes matériel et immatériel, apparaît à saint Grégoire comme une sorte de monde en réduction, un microcosme qui reflète l’univers et l’unit en lui-même en un seul tout. Il écrit. « L’homme, ce monde plus vaste contenu dans un monde plus petit, concentre tout ce qui est en un tout complet et couronne la création de Dieu. C’est pourquoi il a été créé après tout le reste, de même que nous mettons une conclusion à la fin de nos paroles, car nous pouvons appeler cet univers l’œuvre de la Parole hypostatique (9). » Cet enseignement sur l’homme (dont les éléments se trouvent déjà chez Grégoire de Nysse) est développé par Grégoire Palamas en liaison avec le problème de la relation entre les natures angélique et humaine et celui de la valeur du corps humain. Contrairement à l’idée largement répandue selon laquelle l’ange, en tant que pur esprit, serait supérieur à l’homme, Grégoire enseigne que l’homme possède la ressemblance divine dans une plus grande mesure que l’ange. Il écrit. « Bien que les anges soient supérieurs à nous à beaucoup d’égards, […] ils sont cependant en dessous de nous à certains […], [c’est-à-dire] que nous avons été créés à la ressemblance de Dieu dans une plus grande mesure (10). » Le fait que l’homme possède une plus étroite ressemblance avec Dieu se manifeste premièrement en ce que, alors que les anges se bornent à exécuter les ordres de Dieu, l’homme, en tant précisément qu’être terrestre et psycho-physique, est destiné à être le seigneur de toute la création et à régner sur elle. « Alors que les anges sont nommés pour servir le créateur, et ont pour seule mission d’être sous autorité (il ne leur est pas donné de régner sur des êtres inférieurs, sauf lorsqu’ils sont envoyés pour ce faire par le Sauveur de toutes choses), l’homme, lui, est destiné non seulement à être gouverné, mais à gouverner tout ce qui est sur la terre (11). » Cette idée (de l’homme doué d’une ressemblance divine à un degré plus élevé) est encore développée dans l’enseignement concernant le corps humain et sa signification dans la vie spirituelle de l’homme. Il faut noter que Grégoire Palamas était violemment hostile à la théorie selon laquelle le corps, en tant que tel, est un principe mauvais et la source du péché. Une telle opinion lui semblait être une calomnie à l’égard de Dieu, le créateur du corps, et provenir d’une dépréciation manichéenne, dualiste, de la matière. Il composa même un curieux dialogue, rédigé en un style éblouissant (12) contre la spiritualité manichéenne, unilatérale, selon laquelle l’âme serait conduite au péché par le corps et que ses rapports avec le corps seraient la cause de l’état de péché de l’âme. Dans ce dialogue, il soutient avec force que le corps, comme l’âme, a été créé par Dieu et que l’homme n’est pas seulement esprit, mais l’union du corps et de l’esprit. « L’homme n’est pas seulement une âme, ni seulement un corps, mais les deux ensemble, créés à la ressemblance de Dieu (13). » Nous rencontrons souvent dans l’œuvre de Grégoire Palamas cette idée. le corps aussi bien que l’âme reflète l’image divine, ce qui rejoint son point de vue que l’homme, précisément parce qu’il a un corps, est plus véritablement marqué du sceau de la ressemblance divine que les natures angéliques purement spirituelles ; il est plus proche de Dieu (en tant que créature, qu’intention divine), bien qu’ayant perdu cette ressemblance après la chute et étant en ce sens tombé plus bas que les anges. Le fait même de posséder un corps permet à l’homme de communier avec Dieu d’une manière qui est impossible aux anges. « Quel ange pourrait imiter la passion et la mort du Seigneur comme l’homme l’a fait (14) », demande saint Grégoire. Il écrit encore. « La nature angélique est pourvue de l’intelligence ainsi que de la parole qui procède de cette intelligence et qu’on peut appeler esprit, mais cet esprit ne donne pas la vie puisqu’il n’a pas été joint à un corps et n’a donc pas reçu le pouvoir de donner la vie et de la maintenir. Mais l’âme, créée avec un corps matériel, a reçu de Dieu cette faculté de donner la vie et, étant seule à être douée d’intelligence [νοῦν], d’une parole [λόγον] et du pouvoir de donner la vie, seule, plus que les anges, elle est créée à l’image de Dieu (15). » Certes, l’image divine est considérée ici non dans le corps lui-même, mais dans l’esprit donateur de la vie qui appartient à l’homme ; mais loin d’être un obstacle, le corps offre même l’occasion à cet esprit de se manifester, alors que les anges, en tant qu’êtres incorporels, sont dépourvus de cet esprit. Dans ce sens, la ressemblance divine n’a pas été perdue même après la chute. « Après le péché de nos ancêtres, nous avons cessé d’être comme Dieu ; mais nous n’avons pas cessé de refléter l’image de Dieu (16). » En règle générale, il « convient aux hérétiques » de voir un principe mauvais dans le corps ; « ils disent que le corps est mauvais et création du malin (17) », mais pour les orthodoxes ce corps est « le temple du Saint Esprit » et la « demeure de Dieu (18) ». Ainsi pouvons-nous comprendre, selon Grégoire Palamas, comment le corps, sous l’influence de l’âme, peut être « spirituellement disposé » (19), et comment l’impassibilité elle-même n’est pas simple mise à mort des passions physiques, mais constitue une « nouvelle et meilleure énergie » du corps (20) ; d’une manière générale, le corps participe à la vie surnaturelle de l’âme non seulement après la résurrection, mais dès à présent. « Si le corps doit alors partager la richesse infinie de l’âme, il ne fait aucun doute qu’il peut y participer dès maintenant et qu’il aura l’expérience du Divin ; mais les passions de l’âme doivent d’abord être changées et sanctifiées sans être pour autant détruites (21). »
De plus, il faut noter, dans le contexte de la doctrine de saint Grégoire sur l’homme, le rôle qu’il accorde au cœur dans la vie intellectuelle et spirituelle. Il considère le cœur comme le centre de la vie spirituelle de l’homme, comme l’organe utilisé par l’esprit pour contrôler le corps et même comme la source et le soutien de l’activité intellectuelle de l’homme (22). « Nous savons de façon certaine que le cœur est l’organe de la pensée ; nous l’avons appris non de l’homme mais du créateur de l’homme qui dit dans l’Évangile. « les pensées procèdent du cœur » ; le cœur est donc le « trésor des pensées (23) » et en même temps le centre du corps (24). »
L’enseignement selon lequel l’homme est à la ressemblance de Dieu et manifeste cette ressemblante divine dans toute sa personnalité psycho-physique, qu’il est une sorte de microcosme, explique comment une communion réelle est possible entre lui et Dieu, et comment on peut atteindre une connaissance de lui plus profonde que celle qui vient de la seule activité intellectuelle ou de l’étude du monde extérieur. En fait, en partant lui-même du principe de la ressemblance divine dans l’homme, saint Grégoire affirme que l’homme peut atteindre la communion avec Dieu avant tout en observant ses commandements ; ce faisant, il restaure et révèle l’image divine contenue en lui, image qui a été obscurcie par le péché, et s’approche ainsi de l’union à Dieu et de la connaissance de Dieu dans la mesure où il en est capable, lui qui est une créature. Cette voie (celle de l’observation des commandements) doit être suivie par tous et peut, en bref, être décrite comme l’amour de Dieu et du prochain. L’idée que les commandements ont une valeur universelle et que tous les hommes sont tenus de les observer, est le point central de tout l’enseignement ascétique de Grégoire (il a même écrit un commentaire des dix commandements (25)). Il considère cela à tel point évident qu’il omet souvent de le répéter expressément en certaines parties de son enseignement sur les voies de la vie intérieure. Mais dans son interprétation des commandements et de la manière dont on doit les observer, saint Grégoire, comme tous les penseurs les plus profonds de l’Église orthodoxe, accorde une importance primordiale non à l’action extérieure, ni non plus à l’acquisition de telle ou telle vertu, mais à la purification intérieure des passions. Pour atteindre à cette pureté du cœur nous devons nous engager sur la voie du repentir et de l’humilité, manifestant ainsi notre haine du péché et notre amour pour le Seigneur qui nous a aimés. « Revêtons-nous des œuvres du repentir, des humbles pensées, de l’humilité et de la tristesse spirituelle, de la douceur d’un cœur plein de miséricorde, aimant la vérité et recherchant la pureté […] car le royaume de Dieu — non, plutôt le roi du ciel — […] est au-dedans de nous et nous devons nous attacher à lui par les œuvres de pénitence, en l’aimant autant que nous le pouvons, lui qui nous a tant aimés (26). »
Pour saint Grégoire, un moyen plus efficace de purification intérieure ainsi qu’une expression plus vive de notre amour pour Dieu et notre prochain se trouve pourtant dans la prière (jointe, bien entendu, au reste de l’activité intérieure de l’homme, et généralement à toute sa vie). La prière est pour lui plus élevée que la pratique de quelque vertu que ce soit. Reconnaissant que l’union avec Dieu peut se réaliser soit par la communion dans la vertu (27) ou par la communion dans la prière (28), Grégoire attache plus d’importance à la prière et affirme que c’est seulement par sa puissance que la créature peut réellement s’unir à son Créateur. « La force de la prière accomplit mystérieusement cette union, étant le lien entre la créature raisonnable et Dieu (29). » Plus loin, saint Grégoire, comme Denys l’Aréopagite, parle d’une opération trine de l’esprit par laquelle il monte vers Dieu. Dans le même traité sur la prière, on lit. « Lorsque l’un de l’esprit devient trois en restant un, alors l’esprit entre en communion avec la divinité trine (30). » Cette action trine consiste en ceci. l’esprit, qui d’ordinaire contemple les objets extérieurs (1re opération), rentre en lui-même (2e opération) et s’élève vers Dieu par la prière (3e opération). « L’un de l’esprit devient trois tout en restant un lorsque l’esprit retourne en lui-même et de là s’élève vers Dieu (31). »
Ces deux dernières opérations sont aussi appelées « enroulement » (comme on enroule un parchemin) et « étirement vers le haut (32) ». On explique que le fait pour l’esprit de se tourner, de revenir à lui-même, est ce qui le préserve, alors que sa montée vers Dieu se réalise par la prière (33). Dans cet état, l’esprit humain « atteint l’inouï » et « goûte au monde à venir (34) ». Mais il ne faut pas attacher trop d’importance à l’illumination qui est atteinte au début car elle peut être trompeuse, dans la mesure où elle ne s’accompagne pas d’une complète purification de l’âme. Il nous faut nous limiter au début de la vie ascétique à la vision de l’état de péché de notre propre cœur qui nous est révélé par cette illumination de l’esprit. Mais la purification complète de l’être humain ne peut être réalisée que lorsque chacune des puissances de l’âme a reçu le remède spirituel approprié. Ainsi, « c’est seulement en purifiant sa [puissance] active par les œuvres, sa [puissance] cognitive par la connaissance et sa [puissance] contemplative par la prière (35) » que l’homme peut atteindre la pureté nécessaire à la connaissance de Dieu. « Personne ne peut y atteindre sauf par la perfection des œuvres, la persévérance [dans la voie ascétique], par la contemplation et la prière contemplative (36). » De même, il faut savoir qu’il est nécessaire et spirituellement fécond pour l’esprit non seulement d’arriver à cette opération trine, mais de se maintenir et de persévérer longtemps dans cette activité qui produit un certain « sens intellectuel [αἴσθησις νοερά] (37) ». En même temps, saint Grégoire insiste sur la nécessité de garder constamment l’esprit dans les limites du corps. À l’appui de cette règle ascétique, il cite la phrase bien connue de saint Jean Climaque. « Le silencieux est celui qui aspire à circonscrire l’incorporel (l’esprit) dans une demeure corporelle (38). » Comme lui, il voit dans cette inhabitation de l’esprit dans le corps le trait essentiel du véritable hésychaste. D’autre part, l’esprit, demeurant hors du corps, lui apparaît être la cause de toutes les illusions. « L’envoi de l’esprit hors du corps pour chercher à l’extérieur des visions intellectuelles est la plus grande des illusions hellénistiques, la racine et la source de toute fausse pensée (39). » Saint Grégoire conçoit que sa doctrine sur la garde de l’esprit dans le corps, et même sur son « envoi » dans ce corps, peut soulever des objections de la part de ceux qui pensent qu’une telle tâche est inutile et même impossible, puisque l’esprit, étant par nature uni à l’âme qui réside dans le corps, s’y trouve donc déjà sans la coopération de notre volonté. Mais Grégoire explique qu’il s’agit ici d’une confusion entre l’essence de l’esprit et son activité (40). Par essence, l’esprit est, bien entendu, joint au corps, mais la tâche de l’hésychaste est aussi de diriger son activité en ce sens.
Cette manière de garder l’esprit par la prière nécessite toutefois beaucoup d’efforts, de concentration et de labeur. Saint Grégoire écrit. « L’exercice de toute autre vertu est léger et très facile en comparaison avec celui-ci (41). » Nous voyons combien sont dans l’erreur ceux qui voient dans la prière mentale des hésychastes une tentative de trouver une voie de facilité vers le salut, d’éviter de pratiquer les vertus et arriver, pour ainsi dire, à un état d’enthousiasme mystique (42), « à peu de frais et mécaniquement ». En réalité, il ne peut être question d’une voie aisée, et Grégoire montre que la prière mentale est la voie la plus dure, la plus étroite et la plus douloureuse vers le salut, mais celle qui conduit aux niveaux les plus élevés de la perfection spirituelle, à condition que la pratique de la prière soit en harmonie avec tout le reste de l’activité de l’homme (cette condition absolue du succès de la prière révèle bien qu’il n’y a en elle rien de « mécanique »). C’est pourquoi, bien que conseillant cette voie à tous ceux qui désirent être sauvés, étant persuadé qu’elle est accessible à tous, Grégoire souligne que seule la vie monastique, éloignée comme elle l’est du monde, offre les conditions qui lui sont favorables. « Il est, bien sûr, possible à ceux qui vivent dans l’état de mariage, d’œuvrer pour atteindre cette pureté, mais seulement au prix de très grandes épreuves (43). »
Nous avons délibérément accordé une large place aux idées de Grégoire Palamas sur la signification du cœur et du corps dans la vie spirituelle de l’homme de façon générale (idées qui se trouvent déjà chez les auteurs ascétiques antérieurs, mais que saint Grégoire développe avec plus de clarté et d’une manière systématiquement philosophique qui est très caractéristique) parce que cela permet de comprendre plus aisément la signification véritable de l’aspect le plus original de sa doctrine ascétique, celui qui traite de la prière mentale prétendument « artistique (44) » et de ses méthodes. Il n’existe pour ainsi dire pas de témoignages sur les méthodes de la prière artistique chez les anciens Pères, bien que l’on puisse en trouver des indications assez tôt chez Jean Climaque (VI-VIIe s.) (45) ou Hésychius du Sinaï (VII-VIIIe s.) (46). La description la plus complète se trouve dans le Traité sur les trois modes de la prière de Syméon le Nouveau Théologien (début du XIe s.) (47), chez Nicéphore le Moine (env. XIIIe siècle) (48) et chez saint Grégoire le Sinaïte (XIIIe s.) (49). On peut expliquer le silence des premiers Pères à ce sujet de différentes manières (que ces méthodes aient ou non existé, ou qu’elles aient été le sujet d’une instruction personnelle directe des anciens aux disciples, et n’ont donc pas été mises par écrit jusqu’à ce que — avec la disparition graduelle des anciens — apparût le danger de les voir oubliées et qu’alors elles furent mises par écrit par ceux qui en avaient fait l’expérience (50)), mais une chose est claire. ces méthodes étaient assez largement répandues dans l’Orient orthodoxe et faisaient partie de la tradition ascétique longtemps avant Grégoire Palamas et les hésychastes du mont Athos du XIVe siècle. Il est fort peu probable, aussi bien du point de vue historique que du point de vue religio-psychologique, que ces méthodes aient été l’"invention" individuelle de quelque personne privée et probablement presque contemporaine de saint Grégoire (comme certains ont pu le penser (51)). Pour ce qui est de l’incompréhension quant à leur signification, si fréquente même parmi les érudits orthodoxies (52), elle provient principalement du fait que ce qui constitue en réalité des opérations secondaires et accessoires a été pris pour la partie essentielle de cette sorte de prière (53). Là aussi nous devons nous souvenir que ces auteurs ascétiques qui traitaient de la prière artistique ne tentèrent pas de donner dans un tel ou tel ouvrage un exposé exhaustif de la doctrine ascétique orthodoxe dans sa totalité, mais qu’ils se sont habituellement bornés à en présenter certaines parties qui n’avaient pas été suffisamment expliquées par d’autres ou qui, pour une raison quelconque, soulevaient des questions. En tout cas, ce serait une erreur d’imaginer que de telles règles particulières (en l’occurrence celles de la prière artistique) pouvaient assumer à leur yeux la place de la totalité de l’enseignement ascétique de l’Église. En réalité, ils tenaient pour généralement connu cet enseignement qui forme un tout harmonieux, et ils ne pensaient pas qu’il était nécessaire de s’y référer continuellement lorsqu’ils traitaient de la question particulière qui les intéressait (54). Enfin, il faut se souvenir que les contradictions apparentes entre tel ou tel traité sur l’ascétisme sont souvent dues au fait qu’ils ont été écrits pour des personnes se trouvant à différents niveaux de développement spirituel.
Passons maintenant de ces remarques générales à l’enseignement même de saint Grégoire Palamas sur les méthodes de la prière artistique. Il faut cependant noter qu’il n’en donne nulle part un exposé détaillé tel qu’on le trouve dans les œuvres de ses prédécesseurs (saint Syméon le Nouveau Théologien, Nicéphore le Moine ou Grégoire le Sinaïte). Cela ne lui semblait probablement pas nécessaire étant donné que cet enseignement était à l’époque largement connu dans les milieux monastiques. On trouve cependant, chez saint Grégoire, une défense ascético-philosophique brillante, des plus intéressantes, de quelques-unes de ces méthodes. L’occasion immédiate de la rédaction de cette défense fut l’attaque lancée contre les hésychastes athonites par Barlaam qui, en raison de l’intérêt porté par ces hésychastes à la prière mentale, les appela omphalo-psychiques, c’est-à-dire gens censés enseigner que l’âme est située dans l’estomac. Mais, bien que rendue nécessaire par les besoins de l’époque, l’œuvre apologétique de saint Grégoire a acquis un intérêt propre par rapport au reste de ses positions sur l’ascétisme. Cette défense repose sur l’idée, déjà évoquée, selon laquelle puisque le corps n’est pas en soi mauvais mais a été créé par Dieu pour être le temple de l’Esprit qui demeure en nous, il est tout à fait naturel d’avoir recours à son aide d’une manière accessoire pour faciliter l’œuvre de la prière. De ces méthodes subsidiaires en rapport avec la nature physique de l’homme, Grégoire examine plus spécialement les deux suivantes. 1) le lien entre la prière et la respiration (ἀναπνοή — plus exactement l’inspiration) qui aide à garder l’esprit à l’intérieur et à l’unir au cœur ; 2) l’attitude corporelle particulière adoptée pendant la prière (τὸ ἔξω σχῆμα) (55), qui est généralement la position assise, la tête inclinée et les yeux dirigés vers la poitrine ou plus bas même jusqu’à l’estomac (56).
Pour ce qui est de la première méthode fondée sur la respiration (57), saint Grégoire enseigne que son rôle est tout à fait secondaire. elle est destinée à aider l’homme (surtout le débutant) à garder son esprit à l’intérieur, sans distraction, dans la région du cœur qui occupe, on le sait, une place centrale dans toute sa vie spirituelle. L’utilité d’établir une telle relation entre la respiration et la prière afin d’arriver à la concentration peut être contestée. Notons, toutefois, qu’il ne semble en théorie y avoir là rien d’impossible ; cela semble même tout à fait vraisemblable en vue des rapports entre phénomènes physiques et phénomènes psychiques, rapports que nous connaissons dans la vie de tous les jours et qui sont confirmés par la psychologie. Quant à ce qui se passe réellement, cela ne peut être connu que par l’expérience dans là prière. Saint Grégoire le souligne. « Pourquoi continuer à parler de cela, s’exclame-t-il, ceux qui en ont eu l’expérience ne rient-ils pas de ceux qui contredisent par inexpérience ? Car le critère en cela n’est pas la parole, mais l’œuvre, et l’expérience acquise par l’œuvre (58). » Ainsi, en s’appuyant sur cette expérience qui est aussi bien celle de la personne que celle de l’Église, Grégoire soutient qu’"il n’est pas inutile, surtout lorsqu’il s’agit de débutants, de leur enseigner à regarder en eux-mêmes et d’envoyer leur esprit vers l’intérieur par la respiration (59)« . Sinon, l’esprit du débutant ira continuellement errer à l’extérieur et sera distrait, enlevant de ce fait sa fécondité à la prière. Il est donc recommandé de lier la prière à la respiration, surtout au début, tant que l’hésychaste n’est pas encore fermement enraciné par la grâce de Dieu dans le recueillement et la contemplation divine ; en d’autres termes, « jusqu’à ce que, avec l’aide de Dieu, il se soit perfectionné en ce qui est meilleur et, gardant son esprit fixé immuablement en soi et détaché de tout, il puisse le rassembler parfaitement en un tout (60) » (ἑνοιδῆ συνέλεξιν — terminologie de Denys l’Aréopagite). Ayant atteint cet état de recueillement, le silencieux s’y maintient facilement par la grâce de Dieu, mais l’atteindre exige grand labeur et patience comme preuve et conséquence de notre amour de Dieu. « Aucun débutant, écrit saint Grégoire, ne peut réaliser ces choses sans labeur (61). » Mais chez ceux qui sont avancés et « dont l’âme est parfaitement retirée en elle-même, tout cela arrive nécessairement sans labeur ni souci (62) ». Ce qui vient d’être dit devrait suffire pour expliquer l’attitude de Grégoire à l’égard de la « méthode de respiration » dans la prière.
Notons enfin pour conclure. 1) que cette méthode n’est pas une obligation pour tous ceux qui souhaiteraient atteindre la perfection dans la prière, mais qu’elle est seulement recommandée et cela surtout aux débutants ; 2) Grégoire souligne que cette méthode est entièrement accessoire ; elle est destinée à faciliter le recueillement ; 3) le succès de la prière dépend en dernier ressort de Dieu (σὺν Θεῷ ἐπί τῷ χρεῖττον προϊόντες), et non pas seulement de nos efforts ; 4) nos efforts manifestent notre amour de Dieu ; 5) cette méthode de prière est très ardue.
Une autre méthode de prière artistique, qui a été qualifiée d’"omphaloscopie« , est traitée par saint Grégoire relativement plus longuement. Comme nous l’avons déjà dit, cette méthode fut attaquée et raillée par Barlaam et ses partisans avec animosité. Ces attaques continuent aujourd’hui encore. on accuse les hésychastes de faire de la prière mentale uniquement une contemplation de l’estomac (« omphaloscopie ») et de croire que l’âme de l’homme se situe dans l’estomac (d’où le nom ironique d’"omphaloscopes" inventé par Barlaam et utilisé par Léo Allatius (63)). Mais si nous laissons de côté ces polémiques et examinons la question objectivement, nous nous apercevons qu’"omphaloscopie" avait un sens tout à fait différent dans la pratique du monachisme oriental. Premièrement, il serait difficile d’y voir un élément essentiel de la prière mentale, ne serait-ce que parce que cette pratique n’est que rarement mentionnée dans les écrits ascétiques. Sauf erreur, l’omphaloscopie n’est mentionnée, en dehors de Grégoire Palamas, que par Syméon le Nouveau Théologien dans son Traité sur les trois méthodes de prière (64). Ni Nicéphore le Moine, ni saint Grégoire le Sinaïte, qui ont étudié de façon détaillée la méthode respiratoire, ne la mentionnent. Néanmoins, l’omphaloscopie était certainement pratiquée par les ascètes de l’époque en tant que méthode accessoire de prière et c’est pourquoi Grégoire Palamas jugea nécessaire de la défendre contre les attaques de Barlaam. Cette défense reposait sur les mêmes conceptions fondamentales que celles qui sous-tendent son apologie de la méthode de « respiration » (bien que les arguments soient développés assez différemment). L’idée centrale est encore celle du rapport entre le psychique et le physique, et de l’importance de ce lien pour concentrer et maintenir l’attention. Il écrit. « Compte tenu du fait que, depuis la chute, il est naturel que l’homme intérieur corresponde en tout point aux formes extérieures, il ne peut être que très utile pour celui qui veut se recueillir, qu’au lieu de laisser aller son regard ici et là ; il le pose comme sur une sorte de support sur la poitrine ou l’estomac (65). » Ce texte exprime avec justesse la véritable signification de l’omphaloscopie, il montre que le but est le recueillement et que garder son regard fixé sur un point (plutôt que de le laisser errer) est un moyen servant à cette fin. Notons l’expression « utile » (συντελέσειε), qui montre clairement qu’une importance secondaire — et non primordiale — est attachée à cette méthode ; de même le fait de garder le regard fixé sur l’estomac ne vient qu’après les mots « sur la poitrine », ce qui indique bien qu’il s’agit d’une alternative. Il faut également noter que, pour Grégoire Palamas, en dehors de la direction du regard, la position du corps, penchée et humble, est significative ; en priant ainsi, l’homme s’identifie au moins extérieurement au publicain qui n’osait pas lever les yeux, ou au prophète Élie qui, en priant, posait la tête sur les genoux (66). De même, il y a dans cette posture quelque chose qui correspond au mouvement cyclique de l’esprit dont parle Denys l’Aréopagite (67). En vue de tout cela, la « forme extérieure » (τὸ ἔξω σχῆμα), c’est-à-dire la position adoptée pendant la prière, paraît à saint Grégoire, selon son expérience, utile non seulement aux débutants, mais aussi à ceux qui sont plus avancés ; il écrit. « Sans parler des débutants, certains, même parmi les plus avancés, en utilisant cette forme de prière ont été entendus de Dieu (68). » (Notons « certains » [τῶν τελειωτέρων οἱ], donc pas tous). Interprétant ainsi la signification de la prière artistique, Grégoire réfute la fable ridicule répandue par Barlaam, prétendant que selon les hésychastes l’estomac était le siège de l’âme. Écrivant contre les barlaamites qui surnommaient les hésychastes « omphalo-psychiques », il dit. « [Cette appellation] est évidemment une calomnie, car quel est celui qui parmi [les hésychastes] a jamais prétendu que l’âme ait été dans l’estomac (69) ? »
Tel est, succinctement, l’enseignement de Grégoire Palamas sur les méthodes de la prière mentale « artistique ». Dans certains textes écrits pour la défense des moines du mont Athos, ces méthodes sont exposées longuement, alors que dans d’autres, d’un caractère ascétique et moral plus général (par exemple les épîtres à la moniale Xénia, les homélies, etc.), il n’en est pas question du tout. Nous pensons que, si saint Grégoire a accordé tant d’attention à la description et à la défense d’une telle sorte de prière, ce fut en réponse à des attaques faites à l’époque par les adversaires de la vie contemplative. Il était nécessaire de défendre la vérité et de combattre les déformations tendancieuses et caricaturales.
Mais les écrits de Grégoire Palamas sur la prière ascétique ont une valeur propre indépendamment des besoins du moment ; on y trouve pour la première fois dans la littérature ascétique un exposé théologique et psychologique systématique de ces méthodes qui sans aucun doute avaient été pratiquées bien avant lui.
Ces œuvres apologétiques sont parmi les contributions les plus originales de Grégoire Palamas à la littérature ascétique orthodoxe. Ce serait toutefois une grave erreur de penser que pour saint Grégoire ces méthodes — accessoires, bien que fort utiles — constituent l’essence et le contenu principal de la prière mentale. Ce n’est pas telle ou telle action ascétique mais « l’élévation de l’esprit vers Dieu et sa relation avec lui » que Grégoire et tous les autres mystiques orthodoxes au cours de l’histoire ont considéré être le but et le contenu de toute vraie prière spirituelle (70). L’union de l’esprit avec Dieu était pour Grégoire le fondement et le sommet de la vie spirituelle de l’homme tout entière, et sa rupture lui paraissait être la cause de toutes ses chutes. Il écrit avec une vigueur caractéristique. « L’esprit qui s’est séparé de Dieu devient soit bestial, soit satanique (71). »
Dans cet état d’union directe avec le créateur, quand notre esprit sort du cadre de nos activités habituelles et reste, pour ainsi dire, hors de lui-même, l’homme atteint la véritable connaissance de Dieu, « cette inconnaissance qui est au-dessus de toute connaissance. En comparaison de cette inconnaissance, toute notre philosophie et toutes nos connaissances ordinaires, à partir de la compréhension du monde créé, se révèlent insuffisantes et partielles. » Il écrit. « Il est véritablement impossible d’être uni à Dieu (Θεῷ συγγενέσθαι), à moins que, après nous être purifiés, nous nous trouvions hors — ou plutôt au-dessus — de nous-mêmes, ayant abandonné tout ce qui appartient au monde sensible, et nous être élevés au-dessus des idées, des raisonnements et même de toute connaissance, et même au-dessus de la raison elle-même. Nous serions alors entièrement sous l’influence de l’intellect, ayant alors atteint cette ignorance qui est au-dessus de toute connaissance et, ce qui revient au même, au-dessus de toute espèce de philosophie (72). » Cet état spirituel supérieur, lorsqu’un homme se sépare de tout ce qui est créé et changeant, et, s’unissant à la divinité, est illuminé par la lumière de Dieu, est appelé par saint Grégoire « silence » ou hésychia. Il écrit. « Le silence signifie l’arrêt [des activités] de l’esprit et [le détachement] du monde, l’oubli de ce qui est au-dessous, la connaissance secrète de ce qui est au-dessus, le remplacement des pensées par ce qui est meilleur qu’elles ; c’est cela l’activité véritable, l’élévation à la vraie contemplation et à la vision de Dieu […], cela seul est le signe d’une âme saine, car toute autre vertu n’est qu’un remède pour guérir l’infirmité de l’âme […], alors que la contemplation est le fruit de l’âme saine […], par elle l’homme est déifié, non en s’élevant à partir de la raison ou du monde visible ou par le jeu des conjectures de l’analogie, […] mais en s’élevant par le silence […], car par ce moyen on entre dans un certain sens en relation avec la nature inaccessible et bénie [de Dieu]. Et ainsi, ayant purifié nos cœurs par le saint silence et étant mêlés de manière ineffable à la lumière qui dépasse toute sensation et toute pensée, nous voyons Dieu en nous-mêmes comme dans un miroir (73). »
Cet enseignement sur le saint silence, en tant qu’état le plus élevé de l’âme et que moyen pour atteindre la connaissance de Dieu et l’union avec lui, a été exposé de la façon la plus éclatante par saint Grégoire dans sa remarquable « Homélie sur la Présentation de la sainte Mère de Dieu au temple (74) », que nous avons déjà citée à plusieurs reprises. Selon Grégoire, la toute bénie Vierge Marie, demeurant dès l’âge de trois ans seule avec Dieu dans le temple, se consacrant à la prière perpétuelle et à la méditation, séparée de l’humanité et du monde, réalisa en elle-même le saint silence et la prière mentale de la manière la plus haute et la plus parfaite. Il écrit. « L’esprit de la Mère de Dieu s’unit à Dieu par le recueillement, l’attention et la prière divine incessante […]. En s’élevant au-dessus des pensées multiformes et au-dessus de toute image. Elle ouvre une voie nouvelle, inouïe, vers le ciel […], le silence mental [νοητὴν σιγήν] […]. Elle voit la gloire de Dieu et contemple la grâce divine sans être le moins du monde soumise au pouvoir des sensations, tout en étant elle-même un objet sacré digne d’amour pour les esprits et les âmes non corrompus (75). » En outre, saint Grégoire lie l’incarnation elle-même au fait que la Mère de Dieu est ainsi entrée dans la voie de la prière silencieuse dès la tendre enfance. « Elle seule de toute l’humanité fut ainsi surnaturellement silencieuse dès la petite enfance ; elle seule a mérité de concevoir de manière immaculée l’humanité divine du Verbe (76) » En la personne de la Mère de Dieu donc, le silence non seulement trouve sa réalisation et sa justification les plus saintes, mais manifeste la grandeur de son pouvoir à unir l’homme à Dieu (77).
En conclusion de notre exposé sur l’enseignement ascético-gnoséologique de saint Grégoire Palamas, nous voudrions souligner les points suivants. Premièrement, l’importance qu’il accorde au rôle du corps dans l’œuvre nécessaire pour conduire l’homme à la connaissance de Dieu et l’union avec lui. Cette conception de l’homme comme un tout s’exprime de façon frappante dans l’enseignement de saint Grégoire sur la ressemblance divine que, plus que les anges, l’homme possède et qui se reflète dans tout son être psycho-physique. Dans le domaine de l’ascétisme, cette idée se trouve exprimée dans la doctrine sur la coopération du corps dans la vie spirituelle, son aptitude à être illuminé par la divinité et être uni à elle en une seule opération contemplative qui englobe l’homme tout entier. Du point de vue gnoséologique, saint Grégoire oppose la cognition intellectuelle partielle, qui est inutile pour connaître Dieu, à une connaissance supra-rationnelle accessible à l’homme lorsque tout son être a été illuminé et a atteint l’union avec Dieu. Cette idée que l’être humain tout entier participe à la connaissance divine est caractéristique de l’enseignement de Grégoire. Un autre trait typique est l’association qu’il fait entre l’idée d’une divinité incompréhensible et inaccessible et celle de la possibilité d’union avec Dieu par la grâce et la vision directe de lui. Nous trouvons ici, pour la première fois dans le domaine de l’ascétisme et de la gnoséologie, l’antinomisme qui est si caractéristique de Grégoire Palamas. Nous tenterons de faire une analyse plus poussée de cet aspect de son enseignement dans les chapitres suivants consacrés à ses conceptions plus purement théologiques. Nous nous contenterons de signaler ici que la contradiction apparente chez Grégoire entre son idée de Dieu et les moyens de le connaître n’est pas un cas isolé dans la littérature patristique orientale. Celui qui est le plus proche de lui à cet égard est saint Grégoire de Nysse. rares sont les saints Pères qui ont insisté autant que lui sur la nature incompréhensible et inexprimable de Dieu, et cependant fort peu nombreux sont ceux qui ont étudié théologiquement, avec une telle profondeur, sa nature incompréhensible…
- Publié originellement (en russe) dans Seminarium Kondakovianum. Recueil d’études. Archéologie, Histoire de l’Art. Études byzantines, t. VIII (1936), Prague, p. 99-154, et repris dans le Messager de l’exarchat du patriarche russe en Europe occidentale, n° 115 (1987), p. 109-174 — trad. fr. dans le Messager de l’exarchat, ibid., p. 45-108 (texte de référence).
- Dans l’édition originelle, cette Notice constituait la note 1 (NdR).
- L’enseignement ascétique et théologique de saint Grégoire Palamas est, en un certain sens, relié au courant spirituel du monachisme oriental connu comme « hésychasme ». Nous pensons qu’il est donc nécessaire d’en dire quelques mots. Par hésychasme, ou silence, on désigne généralement le courant de vie spirituelle parmi les moines orthodoxes orientaux entièrement dirigé vers la pure contemplation et l’union avec Dieu dans la prière. Ce courant, qui atteignit son développement le plus élevé durant le cours de la vie de saint Grégoire Palamas, était alors centré sur le mont Athos et ses moines. Il ne faut toutefois pas penser que l’hésychasme du mont Athos au XIVe s. représentait un phénomène tout à fait nouveau dans l’histoire du monachisme oriental, car depuis les temps les plus anciens (depuis les origines mêmes du monachisme en Égypte au III-IVe s.) il avait existé, parallèlement aux communautés monastiques qui étaient alors florissantes (et dont l’idéal s’exprime de la manière la plus frappante dans la Règle de saint Basile le Grand et dans les œuvres de saint Théodore Studite), une tendance, plus contemplative, à la prière pure et au silence. Cela est attesté non seulement par les nombreuses Vies de saints dans toute l’histoire de l’Église, mais aussi par des écrits ascétiques de tendance hésychaste qui sont parvenus jusqu’à nous comme ceux des saints Antoine le Grand, Évagre le Pontique, Macaire d’Égypte (IVe s.), Nil du Sinaï, Marc l’Ascète et le bienheureux Diadoque (Ve s.), Isaac le Syrien (VIe s.), Hésychius et Philothée du Sinaï (VII-IXe s.). En outre, par saint Syméon le Nouveau Théologien, Nicétas Stétathos (XIe s.) et Nicéphore le Moine (XIIIe s.), cette tradition conduit aux hésychastes du mont Athos (XIVe s.), saint Grégoire le Sinaïte († 1346) et saint Grégoire Palamas. Mais il serait faux de penser que les traditions cénobitiques et érémitiques sont opposées les unes aux autres et représentent des voies tout à fait différentes dans la vie spirituelle. Ce point de vue est exprimé par le P. Irénée HAUSHERR, s. j., dans La Méthode de l’oraison hésychaste (Orientalia christiana, t. IX-2, 1927) et Un grand mystique byzantin. Vie de Syméon le Nouveau Théologien (Orient. christ., t. XII, 1928). La vie communautaire et le « silence » ne s’excluent pas mutuellement, cela est attesté par les écrits de l’auteur ascétique saint Jean Climaque (VI-VIIe s.) chez lequel nous trouvons une combinaison harmonieuse des deux idéaux ; on le sait, certains chapitres de son Échelle du Paradis décrivent une vie communautaire fondée sur l’obéissance et l’abandon de la volonté propre, alors qu’une autre partie (les plus hauts degrés) traite de la voie du silence et de la contemplation. L’unité du livre n’en souffre nullement. On peut dire la même chose de l’œuvre des saints Barsanuphe et Jean de Gaza (VIe s.). Généralement parlant, la vie communautaire et le silence sont considérés dans la littérature ascétique (comme dans les écrits hagiographiques) non comme opposés l’un à l’autre et mutuellement exclusifs, mais comme des degrés qui correspondent au progrès spirituel du moine ou à son tempérament. Le silence a presque toujours été considéré comme le type de vie le plus élevé. Finalement, la vie érémitique est habituellement comprise plus comme un détachement intérieur que comme un habitat purement « géographique » hors du territoire du monastère dans le désert. Rappelons que le plus éminent représentant de la vie contemplative et mystique de l’Église byzantine — Syméon le Nouveau Théologien (949-1022) — passa presque toute sa vie dans des communautés monastiques. La plus grande partie de ses écrits ascétiques est adressée à des moines vivant en communauté, elle a cependant été rédigée dans un esprit « hésychaste ». La combinaison harmonieuse des tendances communautaires et hésychastes est le résultat naturel de l’unité organique de la vie spirituelle de l’orthodoxie, dont l’enseignement ascétique est très étroitement lié au dogme et possède une très forte unité intérieure, en dépit de la diversité de l’expression extérieure. Cependant dans l’histoire du monachisme orthodoxe, il y a eu des périodes où l’une ou l’autre tendance a prédominé. On peut dire, en général, que lorsqu’un esprit de communauté s’est développé aux dépens de l’hésychasme (en raison surtout du développement des grands monastères) cela a amené un affaiblissement de la vie spirituelle du monachisme et à l’absorption dans des intérêts extérieurs souvent purement domestiques. Un renouveau spirituel se manifestait habituellement avec le retour à la vie intérieure, à l’esprit de silence et de contemplation, le rétablissement de l’ « hésychasme ». Au mont Athos, un tel retour vers la vie contemplative (qui fut pendant un certain temps presque entièrement perdue) fut l’œuvre de Grégoire le Sinaïte, bien qu’avant lui il y ait eu des contemplatifs éminents comme Nicéphore le Moine. La vie de Grégoire le Sinaïte contient une description magnifique de ses activités au mont Athos (voir I. POMIALOVSKI (éd.), Βίος καὶ πολιτεία τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Γρηγορίου τοῦ Σιναίτου [Vie et Œuvre de notre père parmi les saints Grégoire le Sinaïte], Saint-Pétersbourg, 1894).
- Naturellement, dans la plupart des cas ces éléments gnoséologiques se trouvent un peu partout dans les œuvres des saints Pères (dans ce cas celles de saint Grégoire Palamas). Ceci est dû au fait que les auteurs religieux avaient généralement un but pratique d’édification et s’ils entraient dans des discussions purement abstraites, ce n’était que pour réfuter tes attaques des hérétiques. En conséquence, toute tentative pour systématiser leur « gnoséologie » devient en quelque sorte « stylisation ». Finalement, le terme de « gnoséologie » est utilisé par nous de manière assez lâche (il désigne pour nous tout ce qui est en relation avec la connaissance, plus exactement la connaissance de Dieu et de ses voies).
- « ἄβυσσος χρηστότητος », Περὶ προσευχῆς, PG 150, col. 1117 B.
- Ibid.
- Ὁμιλ. Σοφ. σελ., 169, 170.
- Ibid.
- Ὁμιλ. Σοφ. σελ., 172.
- Κεφ., PG 150, col. 1152 BC (κεφ. 43).
- Κεφ., PG 150, col. 1152 C (κεφ. 44).
- Nous pensions à ses « Προσωποποιϊαι… τίνας ἄν εἷποι λόγους ἡ μὲν, ψυχὴ κατὰ σώματος, δικαζομένη μετ’ αὐτοῦ ἐν δικασταῖς, τὸ δέ σῶμα κατ’ αὐτῆς καὶ τῶν δικαστῶν ὀπόφασις » (PG 150, col. 1347-1372). L’authenticité de cet ouvrage est contestée par le P. Jugie à cause de l’article paru en 1915 dans la Revue Byzantine (vol. 1, p. 103, 109). Ne disposant pas de cet article, nous ne pouvons nous former une opinion concluante. Ce qui est certain, toutefois, c’est que les idées contenues dans le dialogue (en dépit de certaines particularités verbales) sont en accord avec l’enseignement de saint Grégoire sur l’homme, l’âme et te corps, la nature du mal, etc. Voir M. JUGIE, Palamas, col. 1749.
- PG 150, col. 1361 C.
- Ibid., PG 150, col. 1370 B.
- Κεφ., PG 150, col. 1145 D-1148 B (κεφ. 38-39).
- Κεφ., PG 150, col. 1148 B (κεφ. 39).
- Ὑπὲρ τῶν ἱερῶς ἡσυχαζόντων (PG 150, col. 1104 B).
- Ibid., PG 150, col. 1104 AB.
- Ἁγ. Τομ., PG 150, col. 1233 BD.
- Dans le même Tomos de la Sainte Montagne, on trouve une discussion sur l’opinion de Barlaam qui comprenait l’impassibilité uniquement comme la mise à mort des passions. « τὴν τοῦ παθητικού καθ’ ἕξιν νέκρωσιν ἀπάθειαν φησί, ἀλλά μὴ τὴν ἐπί τὰ κρείττω καθ’ ἕξιν ἐνέργειαν » (Ἁγ. Τομ., PG 150, col. 1233 B).
- Ἁγ. Τομ., PG 150, col. 1233 C.
- Ὑπὲρ τῶν ἱερῶς ἡσυχαζόντων (PG 150, col. 1105 C).
- Ibid., PG 150, col. 1105 D.
- Ibid., PG 150, col. 1108 A. En ce qui concerne le cœur comme centre, voir B. VYCHESLAVTSEV, Serdtse v hristianskoy i indijskoy mistike [Le cœur dans la mystique chrétienne et hindoue], Paris, 1929, p. 12-14 s.
- « Δεκάλογος τῆς κατὰ Χριστὸν νομοθεσίας ἢτοι τῆς Νέας Διαθήκης », PG 150, col. 1089-1101. Dans cette œuvre, saint Grégoire parle des commandements de l’Ancien Testament à la lumière de la révélation évangélique.
- Κεφ., PG 150, col. 1161 D (κεφ., 57).
- « τῇ κοινωνία τῶν ὁμοίων ἀρετῶν », Περὶ προσευχῆς, PG 150, col. 1117 B.
- « τῇ κοινωνίᾳ τῆς κατὰ τῆν εὐχὴν πρὸς τὸν Θεὸν δεήσεώς τε καὶ ἐνώσεώς », ibid.
- Ibid.
- Περὶ προσευχῆς, PG 150, col. 1117 C.
- Περὶ προσευχῆς, PG 150, col. 1120 A.
- Ibid.
- Ibid.
- Ibid.
- Περὶ προσευχῆς, PG 150, col. 1121 A.
- Ibid.
- PG 150, col. 1120 A.
- « ἡσυχαστῆς ἐστιν ὁ τὸ ἀσώματον ἐν σώματι περιορίζειν σπέυδων », Ὑπὲρ τῶν ἱερῶς ἡσυχαζόντων (PG 150, col. 1109 B). Cette citation, prise dans le 27e degré de L’Échelle de Jean Climaque, n’est pas donnée littéralement, mais correctement quant à la signification (voir PG 88, col. 1097 B).
- Ὑπὲρ τῶν ἱερῶς ἡσυχαζόντων, PG 150, col. 1108 C.
- « ἀγνοοῦσί … ὅτι ἄλλο μέν οὐσία νόος, ἄλλο δὲ ἐνέργεια », PG 150, col. 1108 CD.
- PG 150, col. 1180 CB.
- De telles opinions sur la prière hésychaste peuvent se trouver chez M. JUGIE, « Les origines de la méthode d’oraison des hésychastes », dans Échos d’Orient, t. XXX, 1931, p. 179-185, et chez I. HAUSHERR, « La Méthode d’oraison hésychaste », dans Orient. christ., vol. 9-2, 1927. M. Jugie appelle la méthode de prière hésychaste « un procédé mécanique [pour arriver] à bon compte [à l’enthousiasme] » (loc. cit., p. 179).
- PG 150, col. 1056 A.
- « Ἐπιστημονική », qu’Hausherr traduit par. « scientifique » (loc. cit., p. 110). En fait, ce mot signifie bien « scientifique » en grec moderne, mais il nous semble que le terme accepté dans les traductions en slavon d’église (et, de là, en russe). « artistique », exprime mieux le sens que les auteurs ascétiques y ont mis.
- « Λόγος, 27. Περὶ τῆς ἱερᾶς σώματος καὶ ψυχῆς ἡσυχίας », PG 88, col. 1096-1117; « Λόγος 28. Περὶ τῆς ἱερᾶς προσευχῆς », PG 88, col. 1129-1140.
- « Λόγος πρὸς Θεόδουλον… περὶ νήψεως καὶ ἀρετῆς », PG 93, col. 1480-1544.
- Μέθοδος τῆς ἱερᾶς προσευχῆς καὶ προσοχῆς. Le texte grec authentique de cet ouvrage, qui occupe une place très importante dans la littérature ascétique orthodoxe, a été publié en premier lieu par Hausherr dans sa Méthode, p. 150-172. Jusque-là seule la version en grec moderne était connue (voir Φιλοκαλία, Venise, 1782, p. 1178-1185).
- « Τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Νικηφόρου Μοναχοῦ λόγος περὶ νήψεως καὶ φυλακῆς καρδίας », PG 147, col. 945-966. En ce qui concerne les dates de la vie de l’évêque Nicéphore, il existe diverses versions. selon certains (Φιλοκαλία, p. 867), il aurait été le maître de saint Grégoire Palamas (sa Vie ne le confirme pas), selon d’autres, il serait du XIIe ou du XIIIe s. (M. JUGIE, « Les origines de la méthode… », p. 179-185). Nous le plaçons dans la seconde moitié du XIIIes. Dans le cinquième traité contre Barlaam, Grégoire Palamas mentionne que Nicéphore le Moine a souffert pour la foi orthodoxe pendant les persécutions après la clôture de l’Union de Lyon par Michel Paléologue (1274) (voir P. USPENSKIJ, Istorija Afona [Histoire du mont Athos], Saint-Pétersbourg, 1892, 3e partie, chap. II, p. 111 et 634). Par conséquent, Nicéphore n’aurait guère pu être le maître de Grégoire Palamas, ce que l’on peut d’ailleurs conclure également du second traité contre Barlaam par Grégoire Palamas, dans lequel il cite Nicéphore parmi les saints anciens et non parmi les Pères qu’il avait personnellement connus. voir Ὑπὲρ τῶν ἱερῶς ἡσυχαζόντων (PG 150, col. 1116 C), voir à ce propos M. JUGIE, op. cit.
- Περὶ τῆς ἀναπνοῆς, PG 150, col. 1316 C-1317 A ; Περὶ τοῦ πῶς δεῖ καθέζεσθαι, PG 150, col. 1329 A-1333 A.
- L’évêque Ignace (Briantchaninov) partage cette opinion dans ses ouvrages ascétiques remarquables ; ils sont inestimables pour la compréhension de l’enseignement des saints Pères sur la prière mentale (voir les premier, cinquième et surtout le second volume de ses œuvres).
- C’est ce que soutient Hausherr dans La Méthode, et surtout dans son article « Note sur l’inventeur de la méthode d’oraison hésychaste » (Orient. chr., t. XX, 1930, p. 179-182). Hausherr prétend (et cela, sans preuves suffisantes, pensons-nous) que Syméon le Nouveau Théologien n’est pas l’auteur du Traité sur les trois méthodes de prière, qu’il attribue à Nicéphore le Moine, le situant à l’époque de Grégoire Palamas et le considérant comme « l’inventeur » de la prière artistique. Jugie critique ces déclarations non fondées dans « Les origines… ». Le P. Jugie prouve de façon convaincante que le Traité sur les trois méthodes, même s’il n’a pas été écrit par Syméon lui-même, lui est en tout cas certainement contemporain (et non à Grégoire Palamas).
- Un exemple en est fourni par l’article de Grégoire NEDETOVSKIJ, « Varlaamitskaia erez’ [L’hérésie barlaamite] », Travaux de l’Académie de théologie de Kiev, 1872, p. 317-357. Voici comment il décrit la prière artistique mentale. « Des formes d’exercices religieux existaient en Orient, tellement hideuses qu’il est triste de penser que l’homme peut à ce point être induit en erreur par une imagination désordonnée. Ainsi un certain Syméon, supérieur du monastère de Xérocercos, a inventé une méthode de prière très étrange » (p. 329-330, note). Suit une citation sur les méthodes de prière (selon Léo Allatius). Nedetovsky ne soupçonnait même pas que le Syméon de (Saint-Mamas de) Xérocercos qu’il mentionne n’est autre que saint Syméon le Nouveau Théologien qui est si hautement honoré dans l’Église orthodoxe et qui est l’un des plus grands mystiques orientaux. L’évêque Alexis (Dobrynitsine), suivant Nedetovsky dans cette affaire, considère que Syméon de Xérocercos était un ancien — dont Barlaam fut le disciple lorsqu’il séjourna au mont Athos pour étudier la vie monastique ! (voir son article « Vizantijskie tserkovnye mistiki XIV veka [Les mystiques de l’Église byzantine au XIVe s.] », dans Pravoslavni Sobesednik, Kazan, 1906, p. 105, note). Il est curieux que Nedetovsky présente la prière artistique comme le fruit d’une imagination désordonnée, alors qu’en réalité ce qui distingue cette prière est son rejet des images, des fantaisies et, en général, de toute « envolée de l’esprit ».
- Cette erreur est faite par Hausherr. Dans La Méthode, il confond souvent les méthodes de la prière mentale avec son essence. Il écrit, au sujet de la prière mentale. « En résumé donc, deux exercices composent la méthode. la recherche du lieu du cœur, qui a valu aux hésychastes le nom d’ « omphalo-psychiques » et la répétition ininterrompue de la « prière de Jésus ». Moyennant quoi on arrivera à voir « ce qu’on ne savait pas », c’est-à-dire en termes théologiques, selon Palamas, « la lumière du Thabor »… » (op. cit., III). Ailleurs, dans le même ouvrage, examinant les méthodes extérieures plus en détail — l’omphaloscopie, le rythme de respiration, etc. —, il maintient que selon les hésychastes « moyennant persévérance dans cette oraison mentale, on finira par trouver ce qu’on cherchait, le lieu du cœur et, avec lui et en lui, toutes sortes de merveilles et de connaissances » (ibid., p. 102). En bref, arriver à des états spirituels élevés semble pour Hausherr (dans son interprétation de la « prière hésychaste ») être le résultat inévitable (« on finira par trouver ») de la persévérance dans l’exercice de la prière mentale, et non pas fruit de l’union intérieure de l’homme avec Dieu et la libre action de la grâce divine, ainsi que cela était en réalité enseigné par tous ceux qui pratiquaient cette prière.
- À notre avis, c’est parce qu’ils n’ont pas réussi à voir la prière artistique comme une partie organique de l’enseignement ascétique général de l’Église que Jugie, Hausherr et les autres croyaient que les hésychastes substituaient à la voie difficile de la garde des commandements, la voie facile, et « mécanique », de la prière. En réalité cependant, la prière n’avait jamais été séparée des commandements, la mettre en opposition avec les commandements est, en soi, une erreur puisqu’elle n’est pas autre chose que l’accomplissement des lois fondamentales de l’amour envers Dieu et les hommes.
- Ὑπὲρ τῶν ἱερῶς ἡσυχαζόντων, PG 150, col. 1112 B.
- Ibid., PG 150, col. 1112 C.
- Saint Grégoire parle des méthodes de respiration dans le même traité Ὑπὲρ τῶν ἱερῶς ἡσυχαζόντων. Cette question a indirectement été examinée par le concile de 1341.
- Ὑπὲρ τῶν ἱερῶς ἡσυχαζόντων, PG 150, col. 1112 B.
- PG 150, col. 1109 B.
- PG 150, col. 1109 D.
- PG 150, col. 1112 A.
- Ibid.
- L’appellation ὀμφαλοψύχοι ou umbilicanimi est utilisée à l’égard des hésychastes par Léo ALLATIUS dans son De Ecclesia Occidentatis et Orientalis perpetua concensione (PG 150, col. 898 D).
- HAUSHERR, La Méthode, p. 164; voir aussi PG 150, col. 899 AB (chez ALLATIUS).
- PG 150, col. 1112 B.
- PG 150, col. 1113 CD.
- PG 150, col. 1109 A.
- PG 150, col. 1113 C.
- PG 150, col. 1116 A.
- « πνευματικὴ… ἄϋλος προσευχὴ… ὁμιλία ἐστι νοῦ πρὸς Θεὸν… συνομιλεῖν μηδενὸς μεσιτεύοντος… ἀνάβασις νοῦ πρὸς Θεὸν… » (PG 79, col. 1169 CD-1173 D-1181 AD). Ces remarquables définitions de l’essence de la prière mentale sont empruntées au traité sur la prière de l’un des plus grands auteurs ascétiques de l’Antiquité, saint Nil le Sinaïte (Ve s.) ; elles conviennent très bien pour exprimer l’enseignement de Grégoire Palamas.
- Ὁμιλ. Σοφ., p. 114.
- Homélie sur l’entrée au Temple de la sainte Mère de Dieu, Ὁμιλ. Σοφ. σελ., p. 169-170.
- Ὁμιλ. Σοφ. σελ., p. 170-171.
- Cette homélie est publiée dans Ὁμιλ. Σοφ., p. 131-180.
- Ὁμιλ. Σοφ. σελ., p. 176.
- Ὁμιλ. Σοφ. σελ., p. 171.
- Un thème semblable se retrouve dans le Discours sur la vie admirable de saint Pierre l’Athonite de Grégoire Palamas. Ce texte est une apologie vivante et brillante de la voie « hésychaste » du salut. Que cette voie soit agréable à Dieu est prouvé par les miracles accomplis par saint Pierre du mont Athos — un hésychaste par excellence. Selon ce traité, toute condamnation de l’hésychasme en faveur d’une vie plus active est inspirée par l’ennemi de notre salut. On sait que Grégoire Palamas n’est pas l’auteur de la Vie de saint Pierre l’Athonite, qui a vécu bien ayant lui. Il n’a fait que lui donner une forme plus littéraire et lui donner aussi un « style » hésychaste (sans toutefois apporter de changements notables). Voir le texte original de la Vie (composé probablement au IXe s.) chez Kirsopp LAKE, The Early Days of Monasticism of Mount Athos, Oxford, 1909, p. 18-39.
Suite « Dieu, l’homme, l’Église » Lecture des Pères Par Basile Krivochéine Les Éditions du « CERF » Paru en. Décembre 2010, 302 pages
Préface du Métropolite Hilarion (Alfeyev) de Volokolamsk, président du département des relations extérieures du patriarcat de Moscou — Traduction du russe de Nikita Krivochéine, Paula et Jacques Minet, Serge Model, Lydia Obolensky — Présentation, révision et notes de Serge Model
C’est en 1936 que le jeune frère Basile, du monastère Saint-Pantéléimon au mont Athos, se fait connaître de la communauté scientifique en publiant « La doctrine ascétique et théologique de saint Grégoire Palamas », premier d’une longue série d’articles et de recherches. Après être passé par l’étude de Grégoire de Nysse, de Basile le Grand et de tant d’autres, Mgr Krivochéine édite ainsi successivement les « Catéchèses » de saint Syméon le Nouveau Théologien, dans la collection des « Sources chrétiennes », puis une biographie fondamentale du mystique byzantin. À une époque où l’on commence à peine à redécouvrir les trésors du patrimoine des Pères de l’Église, il bénéficie du fonds exceptionnel que met à sa disposition la « république monastique ». Le présent volume regroupe la majeure partie des études patristiques et spirituelles de l’« évêque cultivé idéal » (l’expression est d’Alexandre Schmemann), dont on a pu dire que la « vraie patrie, ici sur terre, était la foi des Pères »…

C’est dans les écrits de saint Diadoque de Photicé (110), évêque du Ve siècle, que l’on trouvera un enseignement qui se situe dans la continuité du thème qui nous occupe, avec toutefois une distinction plus fine entre les différents états spirituels, et une précision accrue dans leur formulation théologique. Dans son œuvre Cent chapitres gnostiques sur la perfection spirituelle (111), saint Diadoque traite tout particulièrement de deux questions. la première porte sur le discernement de l’action de la grâce de celle de Satan, la deuxième donne une description théologique de l’action de la grâce ou de Satan sur le chrétien, par opposition à leur action sur le non-baptisé. C’est ainsi que saint Diadoque caractérise l’œuvre de Satan quand celui-ci tente de reproduire la sensation que procure la grâce divine, dans le but de nous tromper par une fausse douceur. « Quand notre intellect commence à sentir la consolation du Saint Esprit, alors aussi Satan console l’âme par un sentiment d’une feinte douceur dans le repos de la nuit, quand on succombe à l’influence d’un sommeil très léger. Si alors l’intellect se trouve en train de s’attacher fortement, dans un souvenir fervent, au saint nom du Seigneur Jésus, et qu’il se serve de ce nom saint et glorieux comme d’une arme contre l’illusion, l’imposteur renonce à la ruse et désormais s’en prend à l’âme pour une guerre ouverte. En conséquence, reconnaissant exactement l’illusion du malin, l’esprit progresse davantage dans l’expérience du discernement (112). »
Nous accordons une attention toute particulière au « souvenir du saint nom du Seigneur Jésus » considéré comme une arme puissante contre les tentations de Satan. À notre connaissance, il s’agit là de la première mention de la « prière de Jésus » dans la chronologie de la tradition spirituelle écrite (113). Dans le chapitre suivant, saint Diadoque conseille à nouveau de recourir à elle. « Si donc l’épreuve trouve l’intellect, comme je l’ai dit, uni au souvenir attentif du Seigneur Jésus, il dissipe ce souffle faussement agréable de l’ennemi (114). » Saint Diadoque fait une distinction entre consolation mensongère et authentique consolation du Saint Esprit, qui éveille en nous un brûlant amour de Dieu. Elle comporte en soi la certitude de son authenticité. Elle survient de façon franche, et non pas « subrepticement » comme la consolation de Satan, qui agit toujours comme un voleur. « Si, par un mouvement non équivoque et exempt d’imaginations, l’âme s’enflamme pour l’amour de Dieu, […] quand l’âme ne conçoit absolument plus rien que ce vers quoi elle est mue, il faut savoir que c’est l’action du Saint Esprit. Car pénétrée tout entière de cette douceur indicible, elle ne peut plus penser à rien d’autre, parce qu’une joie sans défaillance la transporte. Mais si lorsqu’il est sous cette influence, l’intellect conçoit un doute quelconque ou une pensée malpropre, […] il faut se dire que cette consolation vient du séducteur sous apparence de joie ; et cette joie, tout indéterminée et désordonnée, vient de quelqu’un qui veut entraîner l’âme à l’adultère. Quand celui-ci, en effet, voit l’intellect fier de l’expérience de son propre sens, alors, je le répète, par des consolations de bonne apparence, il sollicite l’âme, afin que celle-ci, divisée par cette vaine et molle douceur, ne se rende pas compte que le malin s’unit à elle. À cela donc nous reconnaîtrons l’esprit de vérité et l’esprit d’illusion (115). »
On remarquera que saint Diadoque souligne le fait que nous sommes conscients de l’action de la grâce en nous. Il évoque tout aussi souvent la joie et la douceur que nous apporte l’action du Saint Esprit. En cela il est très proche de saint Macaire (il en va de même pour sa vision du péché comme fornication avec Satan). Cependant, il ne faut pas confondre cette « sensation spirituelle » avec une vision sensible. Saint Diadoque, comme tous les Pères orientaux de l’Église (116), ne reconnaît pas les visions sensibles du divin. Dans de telles visions, il discerne une tromperie de l’ennemi. « Que personne, en entendant parler de sens de l’intellect, n’aille espérer que la gloire de Dieu lui apparaisse visiblement. Nous disons bien, en effet, que lorsqu’on a l’âme pure, on sent, dans un goût indicible, la divine consolation mais non pas que rien d’invisible lui apparaisse. […] Si donc il apparaît à quelqu’un des athlètes une lumière ou une figure ignée, qu’il se garde d’accueillir pareille vision. C’est en effet une illusion manifeste envoyée par l’ennemi. Beaucoup, pour en avoir été victimes, se sont fourvoyés par ignorance hors de la vérité. Mais nous, nous savons que tant que nous habitons ce corps périssable, nous restons en exil loin de Dieu, c’est-à-dire que nous ne pouvons le voir visiblement, ni lui ni aucune de ses merveilles célestes (117). »
Saint Diadoque ne nie pas la possibilité, pour notre esprit, d’une vision non sensible de la lumière divine. Il considère même ce type de vision comme une partie significative de l’expérience mystique, mais à plusieurs reprises, il nous met en garde contre toute apparition ayant une apparence charnelle comme venant de Satan. « Que l’intellect, quand il commence à être fréquemment sous l’influence de la divine lumière, devienne tout entier transparent, au point de voir lui-même l’opulence de sa lumière, il ne faut pas le contester. On dit que cela se produit quand le pouvoir de l’âme s’impose aux passions. Mais tout ce qui lui apparaît [à l’esprit] en figure, soit comme lumière, soit comme feu, vien[t] des maléfices de l’ennemi. […] Il ne faut donc pas que l’on aborde dans cet espoir la vie ascétique, de peur que Satan ne trouve l’âme prête désormais à se laisser enlever ; mais le but unique est d’arriver à aimer Dieu un sentiment total de certitude du cœur (118), ce qui veut dire de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée (119). »
Saint Diadoque nous met particulièrement en garde contre les actions de Satan pendant notre sommeil. Il admet l’existence de rêves divins, et tente de distinguer les vrais rêves divins des rêves mensongers. Les rêves divins sont stables par leurs images. Ils nous emplissent d’une joie spirituelle. Les visions démoniaques, au contraire, changent continuellement de contenu. Elles nous terrifient, et l’âme se réjouit quand elle se réveille. Il est cependant difficile d’appliquer de telles distinctions dans la pratique. C’est pourquoi il vaut mieux ne pas croire aux rêves, pour éviter d’être trompé par Satan (120). Par sa méfiance envers les rêves, saint Diadoque est fidèle à la tradition spirituelle orientale.
Il fait preuve de plus d’originalité dans sa distinction des moyens d’action de la grâce ou de Satan sur l’âme humaine selon que l’on est avant ou après le baptême. Sa contribution à rendre plus clair le rôle du baptême dans la vie spirituelle est un de ses grands mérites théologiques. Selon Diadoque, les puissances des ténèbres qui étaient tapies dans le cœur de l’homme avant son baptême disparaissent du cœur du chrétien après son baptême. Elles ne peuvent plus le tenter que de l’extérieur. « Avant le saint baptême, la grâce exhorte du dehors l’âme au bien, alors que Satan se tapit dans ses profondeurs, cherchant à barrer toutes les issues de l’esprit vers la droite. Mais dès l’heure de notre régénération, c’est le démon qui passe au dehors, et la grâce au-dedans (121). » « Nous croyons […] que par le bain d’incorruption le serpent multiforme est chassé des trésors de l’âme (122). » Cependant Satan ne renonce pas à nous tenter, même après le baptême ; il peut même obtenir un certain succès dans son entreprise à cause de la liberté de notre volonté. « Le bain de sainteté nous enlève la souillure du péché, mais il ne change pas maintenant la dualité de notre vouloir et n’empêche pas les démons de nous faire la guerre ni de nous adresser des paroles trompeuses (123). » « Le Seigneur permet que l’âme soit davantage importunée par les démons, pour lui apprendre comme il faut le discernement du bien du mal, et la rendre plus humble (124). » Satan agit maintenant principalement au moyen des sensations charnelles ainsi que par le souvenir et l’imagination. « Satan continue d’agir sur l’âme comme auparavant, et même pis le plus souvent ; non qu’il coexiste avec la grâce, loin de moi cette pensée ! Mais par les humeurs du corps on dirait qu’il obnubile l’esprit la douceur des plaisirs irrationnels ; et cela arrive par la permission de Dieu (125). » Ailleurs on lit. « Quand la grâce n’habite pas l’homme, [les démons] se faufilent tout comme des serpents dans les profondeurs du cœur et ne laissent absolument pas l’âme porter ses regards sur le désir du bien. Mais quand la grâce s’est venue cacher dans l’intellect, ils circulent désormais à travers les parties du cœur comme des nuages sombres, prenant la forme des passions du péché et de dissipations multiples, pour dissiper la mémoire intellectuelle et l’arracher à sa familiarité avec la grâce (126). » Satan est même capable de nous donner de mauvaises pensées que notre intellect s’approprie et que nous croyons alors être le produit de notre propre cœur (127). Dans la réalité cependant Satan agit de l’extérieur, car il ne peut être présent dans notre esprit en même temps que la grâce du Saint Esprit. « Comment celui [Satan] qui n’est pas jugé digne de la société des bons serviteurs [les anges] peut-il partager avec Dieu le domicile de l’esprit humain (128) ? » Théologiquement, c’est une absurdité. Pour saint Diadoque, pourtant, la conscience de cela a une grande importance pratique dans la vie spirituelle. « Il est impossible, vraiment, ou de goûter dans le sens intérieur la divine bonté, ou d’éprouver sensiblement l’amertume des démons, si l’on ne se convainc pas pleinement que la grâce a fixé sa demeure dans le fond de l’âme, tandis que les esprits mauvais séjournent autour des membres du cœur (129). »
Voilà ainsi résumées les idées de saint Diadoque. En les comparant à l’enseignement de saint Macaire, on note plusieurs points de divergence. Ainsi, saint Macaire évoque surtout l’action de Satan au plus profond de notre être alors que saint Diadoque est persuadé qu’après le baptême, Satan est chassé de notre cœur et de notre intellect et ne peut plus nous tenter que de l’extérieur au moyen de notre chair, de nos pensées, de notre mémoire. Il serait inutile et vain de nier l’existence de certaines divergences entre ces deux grands Pères spirituels. De telles divergences d’opinion sont tout à fait naturelles et même inévitables dans une tradition spirituelle dynamique qui se trouve en cours de développement et de formulation. Il faut cependant admettre qu’en l’occurrence, les divergences sont souvent plus apparentes que réelles. On peut les expliquer principalement par le fait que saint Macaire s’exprime le plus souvent d’un point de vue spirituel, alors que saint Diadoque semble surtout rechercher la précision théologique. Il convient de ne pas oublier qu’il était évêque et que son œuvre a été écrite un demi-siècle environ après les Homélies spirituelles. Son intention était de souligner l’importance du baptême par lequel l’homme se libère de l’emprise de Satan. Mais, dans la pratique, il est fondamentalement d’accord avec saint Macaire sur le fait que nous nous voyons obligés de combattre les tentations des démons même après le baptême. Saint Diadoque admet même que ces attaques peuvent devenir plus violentes après le baptême et que cette guerre est menée à l’intérieur de nous, où Satan nous combat au moyen de nos propres pensées et de notre imagination. L’unique point de désaccord entre les deux Pères réside dans la façon dont ils comprennent le mode d’action de Satan. Satan agit-il de l’intérieur ou de l’extérieur ? Cette divergence est formulée par saint Diadoque. Et ce point n’est pas très clair, car Satan étant un esprit, il est impossible de le « localiser » aussi simplement. Nous soulignerons cependant que saint Macaire ne parle pas « d’installation » du serpent dans notre intellect ou notre cœur, mais de la façon dont il « se glisse » jusqu’aux profondeurs de notre subconscient. Sur ce point, il n’y a pas de contradiction avec saint Diadoque qui insiste sur le fait que les démons sont chassés de l’intellect après le baptême, mais admet qu’ils restent « près des membres du cœur ». Spirituellement, saint Macaire voyait en quelque sorte plus profondément. Ses écrits reposent plus souvent sur une expérience réelle. Son grand mérite réside dans le fait qu’il a compris la signification du subconscient comme lieu où Satan nous inspire des pensées mauvaises. Les remarques théologiques de saint Diadoque sur le baptême ont une grande valeur et peuvent être considérées comme un complément à l’enseignement des Homélies spirituelles. On n’a pas pu prouver historiquement que saint Diadoque dans sa polémique se soit adressé à saint Macaire. Et si on prend leur pensée dans son ensemble, saint Macaire et saint Diadoque ont beaucoup plus de points communs que de divergences. Il arrive fréquemment qu’ils dénoncent de concert la même erreur spirituelle (comme par exemple l’idée messalienne du salut par la seule prière, etc.).
Je voudrais terminer cet article par une description charmante du rôle des anges dans la vie des saints anachorètes. Cette description est prise dans les écrits de saint Isaac de Ninive, et comme j’ai beaucoup parlé des démons, cette évocation devrait contrebalancer la vision unilatérale et tronquée du lecteur qui aura probablement conclu de ce qui précède que les saints Pères attribuent dans leurs écrits une place prépondérante à l’élément démoniaque.
Que dirons-nous de cette multitude d’anachorètes, errants et moines véritables qui ont transformé le désert en terre habitée et fréquentée par les anges qui leur rendaient visite en raison de leur vie méritante ? Tels de vrais camarades au service du même Seigneur, les puissances célestes venaient à l’endroit où habitaient les anachorètes pour se mêler à eux. Et comme ceux-ci avaient abandonné la terre pour aimer le ciel comme des anges, les anges ne se dissimulaient pas à leur regard. Parfois, ils leurs donnaient des conseils sur leur comportement. Et ils répondaient aussi à leurs questions sur d’autres sujets. Parfois, les anges leur montraient le chemin, quand ils erraient dans le désert. Parfois, ils les délivraient des tentations. Parfois, ils les libéraient des filets du danger qui, soudain, sans qu’ils aient pu le prévoir, les menaçait (un serpent par exemple, une chute du haut d’un rocher ou une pierre qui se détachait et tombait soudain d’une falaise). Parfois aussi, lors d’une attaque suivie d’une lutte déclarée contre Satan, les anges se manifestaient ouvertement à eux et leur annonçaient clairement qu’ils avaient été envoyés dans le but de les aider et les encourager par leur parole. Parfois, ils soignaient leurs maladies ou guérissaient par imposition des mains leurs blessures d’origines diverses. Parfois, d’un mot ou d’une caresse soudaine de la main, ils insufflaient à leurs corps affaiblis par le jeûne une puissance surnaturelle, ajoutant par un procédé mystérieux de la force à leur nature affaiblie. Parfois, ils leur apportaient de la nourriture, du pain chaud et des olives et, à certains d’entre eux, des fruits divers. D’autres étaient informés du moment de leur mort. Combien longue serait la liste de toutes les actions montrant l’amour des saints anges envers notre espèce et détaillant les attentions qu’ils prodiguent aux justes, tels des frères aînés protégeant et secourant leurs jeunes frères. Tout cela indique clairement à chacun combien Dieu est proche de ses amis, et quel soin il prend de ceux qui remettent leur vie entre ses mains et le suivent avec un cœur pur (130).
- Voir F. DÖRR, « Diadochus von Photike und die Messalianer », Freiburg in Breisgau, 1937.
- Le texte grec en a été publié pour la première fois dans la Philocalie (Venise, 1782, Athènes 18932, 1re partie, p. 140-164). Il a été réédité par K. Popov dans Blazennyj Diadoh, episkop Fotiki drevnego Epira […] i ego tvorenija [Le bienheureux Diadoque, évêque de Photicé dans l’Épire ancienne […] et son œuvre], Kazan, 1903. Voir enfin une édition qui ne prend pas en compte les précédentes. J. E. Weiss-Liebersdorf, Biblioteca Teubneriana, Leipzig, 1912.
- DIADOQUE DE PHOTICE, Cent chapitres gnostiques (Cent chapitres sur la perfection spirituelle), XXXI, Paris, Éd. du Cerf, coll. « Sources chrétiennes » n° 5bis, 1955 (19973), p. 101.
- Voir K. POPOV, « Blazhennogo Diadoha […] utchenie o « molitve Iisusovoj » [L’enseignement… du bienheureux Diadoque sur la « prière de Jésus »] », Trudy Kievskoj Doukhovnoj Akademii, [Travaux de l’Académie de théologie de Kiev], 1902, p. 651-676. Il existe cependant une mention encore plus ancienne de la « prière de Jésus » chez saint Nil du Sinaï (ou plus exactement d’Ancyre, † 439). voir lettre III, 33, « Au moine Thaumatie » (PG 79, col. 388 B-400 D).
- DIADOQUE, Cent chapitres gnostiques, XXXII, p. 102.
- Ibid., XXXIII, p. 102-103.
- Sous le pseudonyme de J. Lemaître, le père Hausherr dans son passionnant article « Contemplation chez les Grecs et autres Orientaux chrétiens » (Dictionnaire de Spiritualité, t. II, Paris, Beauchesne, 1952, p. 1762-1872), énonce certaines limites à ce rejet, commun parmi les Pères orientaux, de l’imagination dans la vie spirituelle en général, et dans la prière et la contemplation en particulier. Selon lui, les représentants de l’école d’Antioche, contrairement à ceux d’Alexandrie, ne rejetaient pas l’imagination pendant la contemplation (se reporter au chapitre « Contemplation imaginative », ibid., p. 1859-1860). Cependant, il faut bien dire que les exemples cités par le père Hausherr me semblent peu convaincants. Ainsi, par exemple, l’évêque Théodoret de Cyr auquel il fait référence était certes un savant théologien dogmatiste exégète et historien de l’Église, mais il n’était pas un écrivain spirituel à proprement parler, la terminologie ascétique ne lui était manifestement pas familière et ses descriptions de la vie spirituelle des anachorètes confinent parfois à l’amateurisme. Aussi, si dans son Histoire ecclésiastique, il fait allusion à tel ermite qui imagine la divinité, il ne faut pas lui accorder trop de crédit (se reporter aux exemples donnés par le père Hausherr).
- DIADOQUE, Cent chapitres gnostiques, XXXVI, p. 105.
- L’expression « en un sentiment total de certitude du cœur » se retrouve souvent chez saint Macaire et sert souvent d’argument aux partisans de l’hypothèse messalianique pour prouver l’origine messalienne des Homélies spirituelles. Mais comme on le constate avec l’exemple que je cite, on rencontre la même expression chez saint Diadoque alors que les mêmes chercheurs (voir DORR, op. cit.) le considèrent comme l’un des opposants les plus farouches au messalianisme.
- DIADOQUE, Cent chapitres gnostiques, XL, p. 108.
- Ibid., XXXVII-XXXIX, p. 106-108.
- Ibid., LXXVI, p. 134.
- Ibid., LXXVIII, p. 136.
- Ibid.
- Ibid., LXXVII, p. 135.
- Ibid., LXXVI, p. 134.
- Ibid., LXXXI, p. 139.
- Ibid., LXXXII, p. 143.
- Ibid., LXXXVI, p. 145.
- Ibid., XXXIII, p. 103.
- ISAAC DE NINIVE, Mystic Treatises, V, p. 45-46.

Je passe maintenant à une œuvre extrêmement importante de la spiritualité ancienne, les Homélies spirituelles de saint Macaire l’Égyptien (67). Certains savants modernes contestent l’authenticité de l’attribution de ces écrits à saint Macaire. Sur ce point particulier, ils ont peut-être raison. Mais ils se trompent sans aucun doute quand ils nient le caractère ecclésial et orthodoxe des Homélies spirituelles et voient dans ces écrits l’enseignement spirituel condamné des messaliens (hérésie bien connue des IV-VIIe siècles) (68). Aucun chercheur ne peut objectivement nier le caractère orthodoxe des Homélies spirituelles. On y trouve peut-être quelques inexactitudes d’un point de vue théologique, mais cela n’a rien d’étonnant, puisque leur rédaction remonte à une période antérieure au moment où l’Église a fixé définitivement la formulation de son enseignement. Les Homélies spirituelles sont cependant indéniablement représentatives des tendances spirituelles de l’Église des premiers temps, et expriment une expérience religieuse authentique et profondément chrétienne. Moins théoriques que les écrits d’Évagre, les Homélies surpassent ces derniers par la vivacité du sentiment religieux qu’elles reflètent, par une relation plus intérieure au Christ, une meilleure compréhension de la nature humaine et une connaissance fondée sur l’expérience des effets de la grâce et de l’activité démoniaque. Je commencerai par le dernier point. Saint Macaire (69) utilise des couleurs vives pour dépeindre la façon dont Satan a réduit la nature humaine en esclavage après la chute d’Adam. « Le royaume des ténèbres, le prince pervers, a, dès le commencement, réduit l’homme en captivité ; il a enveloppé et revêtu son âme de la puissance des ténèbres […] comme on couvre [un homme] de vêtements (70). » Pour évoquer les actions des puissances des ténèbres, saint Macaire a souvent recours à l’image du vent nocturne. « Comme un vent sauvage qui souffle dans une nuit obscure et ténébreuse, ébranle, agite et secoue toutes les plantes et toutes les graines, ainsi l’homme qui est tombé au pouvoir de la nuit, des ténèbres et de Satan, et qui vit dans cette nuit ténébreuse, est violemment secoué, agité et ébranlé par le vent terrible du péché (71). » Ou encore. « De même en effet qu’un unique vent trouble et agite toutes les plantes et toutes les graines, et que l’unique obscurité de la nuit s’étend sur tout l’univers, ainsi le prince du mal, qui est lui-même l’obscurité spirituelle de la malice et de la mort, ainsi qu’un vent mystérieux et sauvage, agite sur la terre toute la race des hommes, la trouble par des pensées toujours en mouvement et séduit par les désirs du monde les cœurs des hommes ; il remplit des ténèbres de l’ignorance, de l’aveuglement et de l’oubli toute âme qui n’est pas née d’en-haut (72). » Saint Macaire évoque aussi les « ténèbres des passions, dans lesquelles les puissances mauvaises retiennent [l’âme] (73) »; il généralise tout cela en parlant du « levain de la malice, c’est à dire le péché » qui « est une certaine force spirituelle et incorporelle de Satan [et qui s’]introduit dans [l’homme] (74) ». Il ajoute à cela encore d’autre images fortes de l’esclavage dans lequel se trouve l’homme pécheur vis-à-vis des puissances du mal. « Ton cœur en effet est un sépulcre et un tombeau. De fait, quand le prince du mal et ses anges s’y nichent, quand il y établit des sentiers et des passages, par lesquels les puissances de Satan circulent dans ton intellect et dans tes pensées, n’es-tu pas en enfer, au tombeau et au sépulcre ? N’es-tu pas alors mort pour Dieu (75) ? » Saint Macaire représente même Satan comme une sorte de serpent qui se glisse dans notre âme. « Le terrible serpent du péché cohabite avec l’âme, la flatte et l’excite ; si elle cède à ses sollicitations, l’âme incorporelle s’unit à la malice incorporelle de l’esprit, autrement dit un esprit s’unit à un autre esprit ; ainsi, celui qui accepte et accueille la pensée venant du malin commet un adultère dans son cœur (76). »
Ces images fortes ne doivent cependant pas être interprétées comme attribuant aux puissances des ténèbres une force invincible. Une telle idée, de même que le dualisme manichéen, quelles qu’en soient les manifestations, sont totalement étrangers à l’enseignement spirituel de saint Macaire. En accord avec toute la tradition patristique, il nie la substantialité du mal. « Ceux qui affirment que le mal a une substance propre [ἐνυπόστατον] ne savent rien. Car en Dieu le mal ne peut avoir aucune subsistance […], en nous, au contraire, [le mal] opère avec toute sa puissance et d’une façon très sensible, inspirant tous les désirs mauvais (77). » Ailleurs, il écrit. « Mais pour nous, le mal existe, car il habite dans le cœur ; il suggère des pensées mauvaises et souillées, il ne permet pas de pratiquer une prière pure, et il réduit l’intellect en captivité en l’enchaînant au siècle present (78). » Néanmoins c’est de notre volonté qu’il dépendra finalement de repousser ou de céder à ces propositions du mal. « [L’] âme, quand elle le demande, obtient secours et appui [de Dieu], et […] la lutte et le combat sont à égalité de forces (79). » Et même quand l’âme, par un grand péché se mêle à Satan, elle ne perd pas sa personnalité propre. « [Le mal] ne nous est pas mélangé […] tel un mélange d’eau et de vin ; mais chacun existe à part, comme l’ivraie et le blé dans un champ (80). » L’emprise du mal n’est pas permanente. « Quand (l’âme) est agitée, elle est souillée par le mal […] mais à d’autres moments, l’âme subsiste à part, gardant une existence indépendante. Elle regrette alors ses mauvaises actions, elle pleure, prie et se souvient de Dieu. Comment pourrait-elle le faire, si elle était toujours abîmée dans le mal (81) ? »
C’est pour cela que tout chrétien doit lutter contre Satan. Il a la liberté de la faire, même si la victoire définitive ne peut venir que de Dieu. Et avant tout, nous devons comprendre qu’il nous faut lutter non seulement contre nos penchants naturels, mais aussi contre de bien réelles puissances démoniaques. « Le péché qui s’est ainsi introduit, et qui est une certaine puissance spirituelle de Satan et une réalité, a semé tous les maux. Sans être détecté, il agit sur l’homme intérieur et sur l’intellect, et il met la guerre dans les pensées. Mais l’homme ignore qu’il agit à l’instigation d’une force étrangère. Il s’imagine que tout cela est naturel et qu’il agit selon ses propres réflexions. Mais ceux qui ont dans leur intellect la paix du Christ [Col 3, 15] et son illumination, savent d’où viennent ces mouvements (82). » C’est avec la plus grande des déterminations que nous devons dans nos cœurs entrer en guerre contre Satan. « L’arme la plus appropriée pour l’athlète et le combattant est celle-ci. rentrer dans son cœur, lutter contre Satan, se haïr soi-même, renier sa propre âme, s’irriter contre soi-même et se faire des remontrances, résister aux convoitises qui nous habitent, combattre les pensées et lutter contre soi-même (83). » Comme à l’accoutumée, c’est en termes très imagés que saint Macaire décrit cette lutte interne du cœur. « De même qu’il existe des hommes qui attellent des chevaux, conduisent des chars et se lancent les uns contre les autres, […] ainsi y a-t-il aussi dans le cœur des combattants [spirituels] un théâtre où les esprits mauvais luttent contre l’âme, tandis que Dieu et les anges contemplent le combat […]. Mais l’intellect est le conducteur qui attèle le char de l’âme et tient les rênes des pensées ; il s’élance ainsi contre le char de Satan qui, de son côté, s’est équipé contre l’âme (84). » Cette lutte exige une vigilance de chaque instant, et une permanente mise à l’épreuve de soi-même. « Aussi, frères, examinez votre intellect ; avec qui êtes-vous en communion, avec les anges ou avec les démons ? De qui êtes-vous le temple et la demeure, de Dieu ou du diable ? Quel trésor remplit vos cœurs, celui de la grâce divine ou celui de Satan ? De même qu’une maison remplie de puanteur et d’ordures doit être entièrement nettoyée, ornée, remplie de parfums et de trésors, ainsi l’Esprit Saint doit-il venir à la place de Satan dans les âmes des chrétiens et s’y reposer (85). » Cette lutte avec le mal n’est pas seulement une lutte morale, c’est une véritable guerre spirituelle contre Satan. Ce n’est pas seulement l’abstinence du mal, c’est la destruction jusqu’aux racines du mal. « Éviter le mal n’est pas encore la perfection ; il faut en outre pénétrer dans ton intellect souillé et tuer le serpent, ton meurtrier, qui s’y cache, en-dessous même de l’intellect et plus profondément que les pensées, dans ce qu’on appelle les chambres et les retraites de l’âme […], [si tu as] rejet[é] toutes les impuretés qui sont en toi [alors tu as atteint la perfection] (86). »
Tout seul, l’homme ne peut pas réussir dans son entreprise d’éradication définitive des puissances du mal si profondément tapies dans notre nature. Seul le Christ ou la grâce du Saint Esprit qui nous est envoyée par le Christ nous accordent la victoire. Cette idée est constamment soulignée par saint Macaire dans les Homélies spirituelles. C’est là un aspect fondamental de son enseignement. « Il faut donc rechercher comment et par quel moyen on peut obtenir la pureté du cœur. » Il répond. « Ce ne sera pas autrement qu’en passant par celui qui a été crucifié pour nous ; il est en effet la voie, la vie et la vérité, la porte, la perle précieuse, le pain vivant et celeste (87). » « Il est donc impossible de séparer l’âme du péché, si Dieu ne calme et n’arrête ce mauvais vent qui habite dans l’âme et dans le corps. […] L’homme voudrait bien s’envoler dans l’atmosphère divine et dans la liberté du Saint Esprit, mais aussi longtemps qu’il ne reçoit pas d’ailes, il ne peut le faire (88). »
« L’âme, écrit encore saint Macaire, a été plongée dans l’abîme des ténèbres et dans les profondeurs de la mort. Elle s’y est noyée et y gît, morte à l’égard de Dieu, au milieu de monstres redoutables. Qui pourra descendre dans ces retraites lointaines, dans les profondeurs de l’enfer et de la mort, si ce n’est l’artisan qui a formé le corps (89) ? » C’est le Christ lui-même qui dépêche ses saints anges et démolit le règne des ténèbres. « Le roi, qui est le Christ, envoie des hommes pour délivrer la cité, il enchaîne les tyrans et il y établit un corps d’armée céleste et une garnison de saints esprits, qui y sont comme dans leur propre patrie. Dès lors, le soleil brille dans les cœurs, et ses rayons pénètrent dans tous les membres (90). »
Nous devons fermement croire que le Christ est toujours auprès de nous, prêt à nous aider si seulement nous le lui demandons. « Si le corps est proche de l’âme, le Seigneur en est encore plus proche, disposé à venir, à ouvrir les portes fermées de nos cœurs et à nous donner les richesses célestes. Car il est bon et ami des hommes, et il tient toujours ses promesses, si seulement nous persévérons jusqu’à la fin dans sa recherché (91). » Et en même temps que le Christ, survient la grâce du Saint Esprit, qui chasse toutes les ténèbres de l’âme. « Quand l’homme a transgressé le commandement, le diable a recouvert l’âme tout entière d’un sombre voile. Quand donc vient la grâce, elle enlève complètement le voile. Alors l’âme, purifiée et rentrée en possession de sa propre nature, […] contemple sans cesse en toute pureté, avec des yeux purifiés, la gloire de la vraie lumière et le vrai soleil de justice, qui brille dans le cœur lui-même (92). »
Concernant la grâce, il faut noter chez saint Macaire deux idées importantes. La première est que la grâce peut toujours se retirer et dissimuler son action, nous sommes alors, à nouveau, victimes des attaques des puissances obscures. Nous ressentons parfois cela comme une action simultanée de la grâce et de l’ennemi dans notre âme. C’est pour cela que nous devons savoir distinguer les esprits, afin de savoir distinguer la révélation vraie de la révélation mensongère. Saint Macaire insiste sur ce caractère mitigé de nombreux états spirituels. L’homme qui n’a pas encore atteint la perfection « doit encore combattre intérieurement. À certains moments, il se repose dans la prière, mais à d’autres, il est dans la tribulation et la guerre […] deux choses abondent au-dedans de lui. la lumière et les ténèbres, le repos et la tribulation (93). » La révélation de la grâce se fait d’une façon progressive, et notre libre volonté peut donc être soumise à la tentation. « Lorsque l’énergie de la grâce divine couvre l’âme de son ombre en proportion de la foi de chacun, c’est partiellement seulement que la grâce la couvre. Que personne donc ne croie que l’âme tout entière est illuminée. Il reste au-dedans bien des espaces occupés par la malice, et beaucoup de peine et de labeur sont nécessaires à l’homme pour qu’il s’accorde avec la grâce recue (94). » Même suite à de grandes révélations, il peut parfois sembler que la grâce ait été temporairement retirée, pour laisser le champ libre aux puissances ennemies. « La grâce accompagne l’homme sans cesse ; elle est enracinée en lui, […] elle use envers lui de diverses économies, comme elle le veut et selon qu’il est utile. Tantôt en effet, le feu brûle et s’enflamme davantage, et tantôt il est plus calme et plus paisible […]. À un autre moment, la lumière elle-même qui brille dans le cœur lui découvrit la lumière plus intérieure, la plus profonde et la plus cachée, de telle sorte que cet homme, comme submergé tout entier dans cette douceur et cette contemplation, ne se possédait plus lui-même, mais devenait comme un fou et un barbare pour ce monde, en raison de cet amour et de cette douceur surabondante, et de tous les mystères cachés […]. Mais dans la suite, la grâce s’est retirée et le voile de la puissance ennemie l’a enveloppé. Néanmoins, elle brille encore en quelque mesure (95). »
Le discernement entre les actions de la grâce et les actions de Satan repose principalement sur les effets de ces actions. « Puisque le péché se transforme en ange de lumière [2 Co 11, 14] et ressemble à la grâce, comment l’homme connaît-il les embûches du démon ? Et comment reçoit-il et discerne-t-il les effets de la grâce ? Les effets de la grâce sont la joie, la paix, l’amour et la vérité. C’est la vérité elle-même qui force l’homme à chercher la vérité. Les manifestations du péché sont pleines de trouble ; il ne contient ni amour ni joie à l’égard de Dieu (96). » Saint Macaire ajoute. « La salade sauvage ressemble à la laitue, mais celle-ci est douce et l’autre amère (97). » Quoi qu’il en soit, le signe le plus sûr qui distingue la grâce divine de l’action démoniaque quelle qu’elle soit, c’est le sentiment d’humilité que provoque la grâce. « Si quelqu’un dit. « Je suis riche, cela me suffit ; ma fortune est faite, je n’ai plus besoin de rien », ce n’est pas un chrétien, dit saint Macaire, mais un homme dans l’illusion et un suppôt du diable. Car la jouissance de Dieu est insatiable, plus on y goûte et en mange, plus on en est affamé. De tels hommes sont brûlés d’un amour passionné et incoercible envers Dieu. Plus ils s’efforcent de progresser et d’avancer, plus ils se tiennent pour pauvres, indigents et dénués de tout. Ils disent. « Je ne suis pas digne de ce que ce soleil brille pour moi ». La marque du chrétien, c’est l’humilité. Si quelqu’un dit. « Cela me suffit », et. « Je suis comblé », c’est un homme dans l’illusion et un menteur (98). »
L’autre point important qu’il convient de garder à l’esprit, c’est que tant que l’homme vit, il peut à tout moment chuter. Il suffit d’un moment d’inattention, d’autosatisfaction, d’orgueil, et aucun état de sainteté, aucune richesse spirituelle ne pourra plus le garantir contre le retour de la tentation, des passions ou même du péché. Même l’impassibilité totale, cet état de liberté vis-à-vis des passions, peut être à nouveau remis en cause par notre faute. Là est la différence fondamentale entre les Homélies spirituelles et l’enseignement hérétique du messalianisme qui affirmait qu’ayant atteint l’impassibilité, l’homme ne pouvait plus jamais chuter (99). Il y a, chez saint Macaire, de nombreuses descriptions pittoresques de ce type de chute à partir de l’état de grâce. « L’un [des frères], tandis qu’il priait avec un autre, fut saisi par la puissance divine, et, pendant son ravissement, il vit la cité céleste, la Jérusalem d’en-haut, des images lumineuses et une lumière sans limites. Et il entendit une voix qui disait. « Voici le lieu du repos des justes. » Mais peu après, il s’enorgueillit et pensa que cette vision le concernait. Après quoi, on le vit tomber dans le gouffre sans fond du péché et dans des fautes innombrables (100). » La liberté de l’homme reste intacte, même dans les états de grâce les plus intenses. « L’homme […] a aussi le pouvoir, même s’il a été étroitement lié au Saint Esprit et enivré des réalités célestes, de se tourner vers le mal […]. Ceux qui ont goûté à la grâce divine de Dieu et sont devenus participants de l’Esprit [He 6, 4], risquent eux aussi, s’ils ne se tiennent pas en garde, de voir s’éteindre leur ardeur et de devenir pires qu’ils ne l’étaient dans le monde (101). »
Ailleurs cependant, saint Macaire semble admettre qu’un homme qui a atteint l’amour absolu ne soit plus soumis aux tentations. Il dit. « Celui qui est arrivé à la charité parfaite est désormais lié étroitement et captif de la grâce (102). » Mais il ajoute immédiatement qu’il s’agit là d’un état tout à fait exceptionnel, et qu’il est très facile de se tromper dans l’évaluation de sa nature. « Celui qui ne fait qu’approcher quelque peu de la mesure de la charité, sans arriver à lui être complètement attaché, est encore exposé à la crainte, à la guerre et à la défaite, et, s’il ne se tient pas sur ses gardes, il sera terrassé par Satan (103). » Et saint Macaire dit qu’il n’a jamais rencontré d’homme parfait. « Je n’ai pas encore vu de chrétien parfait ni vraiment libéré. Même si quelqu’un a connu le repos que procure la grâce, a pénétré dans les mystères et les révélations et a connu l’immense suavité de la grâce, le péché cependant habite encore au-dedans de lui (104). » C’est pour cela, que nous devons, tant que nous sommes en vie, nous tenir prêts à nous battre contre les puissances des ténèbres. « Satan ne cesse jamais la lutte. Aussi longtemps qu’un homme vit dans ce monde, revêtu de la chair, il est en guerre (105). » Même quand quelqu’un « goûte la suavité du Seigneur, quand il se délecte des fruits de l’Esprit, quand se dissipe le voile de ténèbres qui l’entoure et quand la lumière du Christ resplendit […] dans une joie ineffable […], il connaît encore les combats, ainsi que la crainte des voleurs et des esprits malins ; car il redoute de se relâcher et de perdre le fruit de sa peine, jusqu’à ce qu’il ait été jugé digne du royaume des cieux (106). »
Pour voir ce monde invisible d’esprits amis ou ennemis, qui nous entourent et se mêlent de notre vie intérieure, il est indispensable d’avoir une bonne vue spirituelle. Ce monde n’est visible qu’aux yeux de l’esprit. « Il existe aussi la contrée et la patrie de Satan, où les puissances des ténèbres et les esprits malins habitent, se promènent et trouvent leur repos. Et il existe la contrée lumineuse de la divinité, où les armées angéliques circulent et les saints esprits circulent et trouvent leur repos. Mais ni la contrée des ténèbres, ni la contrée lumineuse de la divinité ne peuvent être touchées de nos mains ni vues par nos yeux de la chair. Les hommes spirituels perçoivent cependant, grâce à l’œil du cœur, et la contrée satanique des ténèbres, et la contrée lumineuse de la divinité (107). » L’homme est libre, il peut entrer en contact avec les deux royaumes, le royaume de la lumière et le royaume des ténèbres. « L’âme en effet est compagne et sœur soit des démons, soit de Dieu et des anges. Si elle commet l’adultère avec le diable, elle ne convient plus à l’Époux celeste (108). »
Tel est, dans les grandes lignes, l’enseignement des Homélies spirituelles pour ce qui est des puissances invisibles dans la vie spirituelle.
Tirant les conclusions de ce que nous venons de dire, nous remarquons que saint Macaire ne passe certes pas sous silence l’action des anges (Dieu les envoie pour combattre les démons, ils assistent à notre lutte, nous prêtent main-forte, entrent en contact avec notre âme, etc.), mais ne les mentionne cependant que de façon quasi fortuite. En cela, saint Macaire ne se distingue pas de ses prédécesseurs, mais il s’attarde de façon plus détaillée à décrire les actions des puissances des ténèbres. Il évite de parler de leurs actions physiques ou de leurs apparitions visibles, évoquant principalement la puissance spirituelle dissimulée de Satan qui agit en nous, sur notre âme plutôt que sur notre intellect ou notre cœur, quelque part très loin, « plus bas que l’intellect, plus profond que la pensée », comme il le dit, ou encore — pour reprendre un terme de la psychologie contemporaine — sur notre subconscient. Dans les écrits de saint Macaire, cette puissance satanique prend la forme effrayante d’un serpent spirituel « qui fait son nid dans les « réserves » et les « entrepôts » de l’âme ». Nous voyons là, sans aucun doute, un important apport novateur aux enseignements antérieurs, même à celui d’Évagre le Pontique, qui avait essayé d’expliquer la tentation comme résultant d’une pression physique exercée par les démons sur le cerveau de l’homme. Saint Macaire, lui, relie en général et identifie parfois les œuvres de Satan à la puissance du péché, ou à « l’homme ancien » qui a habillé Adam après la chute. La grâce et le Christ sont opposés à ce « ferment satanique » qui agit en nous. Notre libération de la servitude des ténèbres ne se conçoit que par des images christiques. Le Christ sur la croix détruit le pouvoir de Satan. Le Christ descend dans l’enfer de nos âmes et nous libère de la captivité des démons. Le Christ nous élève à une vie nouvelle et nous envoie le Saint Esprit. C’est pourquoi notre combat contre le mal n’est pas, pour saint Macaire, un simple combat moral. ce combat est fondé sur l’existence d’un « monde satanique des ténèbres » visible aux yeux de l’esprit, ainsi que d’un monde qui lui est opposé, le lumineux « monde du divin ».
Dans l’enseignement des Homélies spirituelles, il y a de nombreuses antinomies, qui en rendent parfois la juste compréhension très difficile. la liberté de l’homme et le pouvoir de Satan ; l’action simultanée dans l’âme de la grâce et des puissances des ténèbres ; notre libération par le Christ et la possibilité que nous gardons de chuter à nouveau ; notre captivité dans l’amour absolu (et non dans l’impassibilité) et l’instabilité des états de sainteté les plus parfaits — tout cela, malgré une expression parfois théologiquement complexe, nous fournit autant de preuves d’une expérience spirituelle véritable et profonde, d’une connaissance très perspicace de la nature humaine. Quoi qu’il en soit, les Homélies spirituelles rejettent les erreurs fondamentales du messalianisme, telles que l’existence du mal en soi, l’union personnelle de l’âme avec Satan, l’impossibilité de la chute une fois atteinte « l’impassibilité », etc. (109). Il est légitime de considérer les Homélies spirituelles comme une œuvre d’une importance capitale parmi les écrits spirituels de l’Orient chrétien. Ce texte renferme en effet des matériaux d’une valeur inappréciable sur la lutte des chrétiens contre les puissances des ténèbres.
- Le texte grec de cinquante des Homélies spirituelles est publié en PG 34, col. 449-821. L’édition critique est celle de l’Académie des sciences de Berlin, publiée par H. Dörries, E. Klostermann, M. Kroeger, Die Fünfzig Geistlichen Homilien des Makarios. Patristische Texte und Studien, Band 4, Berlin, 1964. Sept autres « homélies » ont été publiées par G. L. Marriott. Macarii Anecdota. Seven unpublished Homilies of Macarius, Cambridge, Harvard University Press, 1918; trad. fr.. Les Homélies spirituelles de saint Macaire. Le Saint Esprit et le chrétien, Éd. de l’Abbaye de Bellefontaine, coll. « Spiritualité orientale », n° 40, 1984.
- L’étude du « problème de saint Macaire », n’entre pas dans le cadre de mon article. J’expliquerai seulement, à l’intention du lecteur peu au fait des courants actuels des études patristiques (surtout en ce qui concerne les auteurs ascétiques), que c’est en 1920 que l’hypothèse d’une origine messalienne des Homélies spirituelles a été évoquée pour la première fois par deux moines bénédictins, Villecourt et Wilmart. Ce dernier est allé jusqu’à affirmer qu’il avait reconnu dans les Homélies spirituelles l’ « Ascéticon » messalien, œuvre condamnée par l’Église, et qui n’est pas parvenue jusqu’à nous (se reporter à l’article de cet auteur dans la Revue d’ascétique et de mystique, n° 1[1920], p. 361-377). Voir aussi l’article d’E. AMANN, « Messaliens » dans le Dictionnaire de théologie catholique, Paris, Letouzey & Ané, t. X, 1928, p. 792-795. À la lecture de tels textes, le lecteur orthodoxe ne peut s’empêcher de penser que ce type de « thèses » ne sont pas le produit d’une étude scientifique objective, mais le résultat d’une polémique confessionnelle dirigée contre l’orthodoxie, dans laquelle l’enseignement de saint Macaire a occupé et occupe toujours une place si importante. Cette théorie extrême n’ayant pu être bien longtemps considérée comme sérieuse, elle a été remplacée par une autre (très largement diffusée) qui parle du « messalianisme mitigé » des Homélies spirituelles. Voir J. HAUSHERR, « L’erreur fondamentale et la logique du messalianisme », Orientalia Christiana Periodica, n° 1 (1935), p. 328-360 (voir aussi p. 343-345), ainsi que l’ouvrage de H. Dörries. Symeon von Mesopotamien. Die Uberlieferung der messalianischen ‘Makarios’ Schriften, Texte und Untersuchungen, 55, 1, Leipzig, 1941. Cet ouvrage consiste en un mélange très particulier d’assurance voire de pédantisme purement allemand avec une fantaisie débridée et une tendance à formuler des hypothèses non fondées. Dörries a notamment pour spécialité de redécouper à sa façon les œuvres manuscrites de saint Macaire et d’en faire des collages qui correspondent à ses théories personnelles. Dans son article « Neue Urkunden des Messalianismus ? », Theologische Litteraturzeitung, n° 68 (1943), p. 129-136, W. Völker, un chercheur protestant allemand, propose une critique brillante des méthodes et des idées de Dörries. Le « problème macarien » a pris une tournure nouvelle et très intéressante dans les travaux de W. Jaeger, rédacteur d’une nouvelle édition de saint Grégoire de Nysse. Le professeur Jaeger relève une grande ressemblance entre les enseignements ascétiques de saint Macaire et ceux de saint Grégoire. Voir Two Rediscovered Works of Ancient Christian Literature. Gregory of Nyssa and Macarius, Leiden, Éd. J. Brill, 1954.
- C’est par souci de concision que j’écris ici communément « saint Macaire » et non Homélies spirituelles. Il ne s’agit en aucun cas d’exprimer une opinion particulière quant à l’auteur véritable des Homélies spirituelles.
- Homélies spirituelles, II, 1, dans Les Homélies spirituelles de saint Macaire, op. cit., p. 98.
- Ibid., II, 4, p. 99-100.
- Ibid., V, 3, p. 122-123.
- Ibid., IX, 12, p. 152.
- Ibid., XXIV, 3, p. 239.
- Ibid., XI, 11, p. 162.
- Ibid., XV, 28, p. 191.
- Ibid., XVI, 1, p. 203.
- Ibid., XVI, 6, p. 205.
- Ibid., III, 6, p. 105.
- Ibid., XVI, 1, p. 203.
- Ibid., XVI, 2, p. 204.
- Ibid., XV, 49, p. 200.
- Ibid., XXVI, 12, p. 253.
- Ibid., XL, 5, p. 317.
- Ibid., XXVII, 19, p. 269.
- Ibid., XVII, 15, p. 216.
- Ibid.
- Ibid., II, 3, p. 99.
- Ibid., XI, 12, p. 163.
- Ibid., XVI, 13, p. 209.
- Ibid., XI, 15, p. 164.
- Ibid., XVII, 3, p. 211.
- Ibid., XXVI, 15, p. 254.
- Ibid., XLI, 2, p. 319.
- Ibid., VIII, 2-3, p. 144-145.
- Ibid., VII, 3, p. 141.
- Ibid.
- Ibid., XV, 37-38, p. 195.
- Timothée, presbytre de Constantinople (première moitié du VIe siècle), dans son œuvre Des nouveaux-venus à la sainte Église, donne la formulation suivante de l’enseignement messalien sur l’impossibilité de chuter une fois atteinte l’impassibilité. « Ils disent qu’il n’y a plus ni faute ni danger pour un homme qui, ayant atteint la soi-disant impassibilité, s’adonnerait à la luxure et à la débauche, car il n’est plus a la merci d’aucune passion, et il lui est permis de s’adonner à n’importe quelle passion interdite », voir Des Marcionites (messaliens), chap. 16 (PG 86, col. 52 AB). Voir aussi chap. 10, 11 et 14 (col. 49 BD) et passim. Il est difficile d’imaginer quelque chose qui soit plus en contradiction avec les Homélies spirituelles, aussi bien dans l’esprit que dans la lettre.
- Homélies spirituelles, XVII, 14, p. 216.
- Ibid., XV, 36, p. 194.
- Ibid., XXVI, 16, p. 255.
- Ibid.
- Ibid., VIII, 5, p. 146.
- Ibid., XXVI, 14, p. 254.
- Ibid., XIV, 2, p. 177.
- Ibid., XIV, 4, p. 177-178.
- Ibid., XXVI, 13, p. 253.
- Saint Jean Damascène, dans son inventaire des erreurs messaliennes (§ 13) formule ainsi l’enseignement manichéen-messalien sur la substantialité du mal. « [Les messaliens disent :] que le mal est naturel », dans Des hérésies, 80 (PG 94, col. 732 A). Cet enseignement est catégoriquement rejeté dans les Homélies spirituelles (se reporter aux textes dont les références figurent dans les n. 77 et 78 du présent article). C’est de la façon suivante que Timothée, presbytre de Constantinople, rend compte de la principale erreur des messaliens sur l’union personnelle (hypostatique) et la fusion de l’âme avec Satan. « Ils disent que dès la naissance, un démon vient immédiatement s’unir à chaque homme » (PG 86, col. 48 B), et aussi. « [Selon les Messaliens], Satan cohabite personnellement avec l’homme et le domine en tout », Saint JEAN DAMASCÈNE, Des hérésies, chap. 80, p. 1 (PG 94, col. 729 A). Cette erreur est dénoncée avec vigueur par les Homélies spirituelles (se reporter aux citations indiquées plus haut dans les n. 80 et 81).

Les écrits d’Évagre le Pontique sont très importants pour notre thème. c’est lui en effet qui, le premier, a énoncé une théorie et un système de la vie contemplative, il est aussi l’un des fondateurs de la tradition spirituelle de l’Église d’Orient (42). Il est intéressant de constater la place importante qu’occupe, dans les écrits de cet homme extrêmement cultivé et lettré, la lutte contre les démons. On connaît bien les descriptions qu’il donne des différents types de démons qui sont directement liés à nos différents types de passions (comme l’esprit du découragement ou l’affaiblissement spirituel) (43). Évagre révèle là une connaissance profonde de l’âme humaine et de l’activité des démons. Cependant, nous nous intéresserons plus particulièrement à ses observations concernant la participation des anges et des démons à l’oraison mentale et à la contemplation. Selon Évagre, c’est là que se situe pour les démons le principal enjeu de leur lutte. « Au sujet de la contemplation des êtres et au sujet de la science de la Sainte Trinité, les démons et nous, nous suscitons un grand combat les uns avec les autres, ceux-là, en voulant nous empêcher de connaître, et nous, en nous appliquant à apprendre (44). » Les démons portent une haine particulière à l’oraison mentale. « Si tu t’appliques à la prière, attends-toi à affronter les assauts hostiles des démons, dit-il dans son Traité de l’oraison […]. ils vont se ruer sur toi comme des fauves et malmèneront ton corps tout entire (45). » « L’esprit mauvais voit d’un œil excessivement jaloux l’homme qui prie, et met en œuvre toute sa ruse pour le faire échouer […] pour pouvoir mettre obstacle à […] cette envolée vers Dieu (46). » « La lutte qui s’est engagée entre nous et les esprits impurs n’a pas d’autre enjeu que la prière spirituelle (47). »
Les démons ont recours à de nombreux procédés pour faire obstacle à notre prière. Pendant la prière, ils nous suggèrent des pensées matérielles, ils nous inspirent des passions, des sensations charnelles, etc., pour affaiblir notre esprit et le rendre inapte à la véritable prière (48). Les images et apparitions fabriquées par les démons dans notre intellect pendant la prière sont encore plus dangereuses, car elles ont pour conséquence que le divin se trouve limité dans l’espace. « Évite les pièges des adversaires. Il peut arriver, quand tu pries dans la paix et la pureté, que surgisse une forme inconnue et qui t’est étrangère ; c’est pour te pousser à la prétention de te figurer le divin, et t’abuser soudainement sur la possibilité d’évaluer le divin. Or le divin échappe à toute évaluation, à toute figuration (49). » Une imagination de cette sorte fait toujours appel aux sens et est toujours reliée au corps… « Quand le démon jaloux ne peut éveiller ta mémoire, pendant la prière, il s’en prend à la constitution du corps pour faire naître dans l’esprit quelque fantasme étranger et lui donner une forme. Or l’esprit n’est habitué qu’aux concepts ; il est donc plus facilement impressionné. Lui qui tendait à la connaissance immatérielle et dépouillée de figuration, il est abusé et prend la fumée pour la lumière (50). » Ces tentations surviennent principalement pendant l’oraison mentale. « Il reste que, lorsque l’esprit parvient enfin à la prière pure, sans feinte ni déviation, surviennent alors les démons, non plus par la gauche, mais par la droite […]. Ils lui suggèrent une représentation fantaisiste de Dieu, une de ces images qui flattent les sens, de sorte qu’il se figure avoir enfin atteint le but de sa prière (51). » Les démons, par ce procédé, tentent de soumettre l’intellect à la passion de l’orgueil.
Il est particulièrement intéressant de noter que, selon Évagre, les images de l’intellect sont produites par les démons au moyen de sensations physiques. Évagre donne à cela une explication très étonnante. les démons, pour arriver à leurs fins, touchent un certain endroit du cerveau « où pulsent les vaisseaux sanguins (52) ». « Je suis d’avis que le démon, lorsqu’il atteint ce point dont je parle, modifie à son gré la lumière de l’esprit, de sorte que la passion de la vaine gloire s’oriente vers des élucubrations qui façonnent l’esprit pour lui faire se représenter la connaissance divine et essentielle. Et comme il était parvenu à se libérer des passions charnelles et corrompues, qu’il avait atteint un certain état de pureté, il se croit à l’abri désormais de toute intrusion ennemie en lui. C’est pourquoi il est porté à croire d’origine cette vision suscitée par le démon qui le façonne (53). »
Pendant la contemplation aussi, les démons tentent de nous troubler. « Comme un brouillard, l’obscurité se tient devant la pensée, et chasse la contemplation loin de nous (54). » Comment pouvons-nous combattre ces tentations démoniaques ? Nous devons être prudents et demander conseil à Dieu. « Fais bien attention ! Ces démons pervers peuvent t’abuser par quelque vision. Et c’est là qu’il convient d’être circonspect, de te tourner vers la prière et d’en appeler à Dieu pour que, si la pensée vient de lui, ce soit lui qui t’illumine et, dans le cas contraire, qu’il éloigne promptement le fourbe de toi (55). » L’humilité nous protège aussi contre les vexations des demons (56). « Le mur spirituel est l’impassibilité de l’âme raisonnable, laquelle la protège des demons (57). » La prière est cependant une des armes les plus efficaces contre les démons, en particulier une prière courte et intense. Elle les consume comme le feu (58). « Lors de pareilles épreuves, use d’une prière brève et intense (59). » Notre intellect ne doit jamais se laisser distraire de la prière par les activités du démon. Cette idée est illustrée par l’exemple des anachorètes. Aucune des attaques des démons « n’arrach[a] pour autant son esprit à la ferveur de la prière (60). »
Évagre n’omet pas de mentionner l’aide que nous apportent les anges pendant cette lutte spirituelle. « L’intervention de l’ange de Dieu, suffit à mettre fin, d’un seul mot, à l’action ennemie en nous et rend à l’esprit cette lumière qui le conduit de façon infaillible (61). » Les anges nous aident dans nos prières. La bénédiction de la prière nous est révélée par un ange. Il nous induit dans la connaissance de la véritable prière, grâce à quoi nous pouvons prier sans aucun trouble de l’âme, ni paresse, ni laisser-aller (62). « Sache-le bien, dit-il ailleurs, les saints anges nous poussent à la prière, ils nous assistent alors, pleins de joie, et prient aussi pour nous. Au contraire, si nous nous montrons négligents et accueillons avec complaisance des pensées étrangères, nous suscitons alors grandement leur colère. eux luttent vaillamment pour nous et voilà que, de notre côté, nous ne consentons même pas à prier Dieu pour nous-mêmes, nous méprisons leur office, faisant peu de cas de leur Dieu et maître, pour avoir commerce avec d’impurs demons (63). » Les anges nous aident également pour la contemplation. Ils nous éclairent de telle façon que nous devenons capables de voir les fondements idéaux des choses de la création, dont le fondement est Dieu. C’est là une des étapes de la contemplation dans l’enseignement spirituel d’Évagre. « Si tu pries en vérité, tu acquerras une pleine confiance. Les anges accourront vers toi et mettront pour toi en lumière les raisons des êtres (64). » « Par la contemplation des commandements de Dieu, les puissances saintes nous purifient de la malice et nous rendent impassibles. Par la contemplation des natures et par les logoi qui concernent la divinité, elles nous libèrent de l’ignorance et nous rendent sages et gnostiques (65). »
Selon Évagre, les anges en eux-même ne peuvent cependant pas être pris pour objet de contemplation. En dernière instance, c’est toujours Dieu, la Sainte Trinité, qui fait l’objet de la contemplation. Les actions divines, telles que les prophéties, la sagesse, le jugement, mais aussi le reflet du divin dans la création ou dans les fondements idéaux des créatures, tout cela constitue les étapes inférieures de la contemplation. C’est pourquoi, la contemplation des « [choses] non incarnées », si caractéristique de l’enseignement d’Évagre, doit être comprise comme faisant partie de cette contemplation des composantes immatérielles de la création, et non pas comme la vision des anges. Ce qui, cependant, ne signifie pas que ces visions soient dépréciées de façon univoque. Évagre donne de nombreux exemple d’apparitions d’anges. Mais nous ne devons pas désirer voir des anges, pas plus que nous ne devons, en général, désirer voir la moindre apparition sous une forme sensible, pas même celle du Christ. Cela représente en effet un grand danger, car les démons peuvent prendre la forme des anges. « Ne désire pas la vision sensible des anges, ni des puissances, ni même du Christ, pour ne pas sombrer dans la déraison, et ne pas introduire le loup à la place du berger, et te mettre à adorer les démons ennemis (66). » Afin de bien comprendre ce que dit Évagre sur le rôle des anges et des démons dans la vie spirituelle, nous devons toujours garder à l’esprit ce fondement de l’oraison mentale qui rejette toute manifestation de l’imagination, et qui mène à l’union directe de l’intellect avec Dieu. Bien que très fortement intellectuel, Évagre, selon toute évidence, était un homme spirituellement très expérimenté. Cela lui donne de l’autorité pour parler en connaissance de cause de l’action des puissances du mal et de l’aide que nous accordent les anges de lumière dans notre prière. Quant à ses explications physiologiques, bien que non dépourvues d’intérêt, elles sont influencées par les connaissances scientifiques de son époque.
- Au cours des trente ou quarante dernières années, on a beaucoup écrit, en Occident, sur l’influence de l’œuvre d’Évagre le Pontique sur le développement et la formulation de l’enseignement ascétique des Pères orientaux (principalement en ce qui concerne l’oraison mentale et la contemplation). Se reporter à l’ouvrage de Hausherr (voir la n. 7). Voir aussi. M. VILLER, « Aux sources de la spiritualité de saint Maxime », Revue d’ascétique et de mystique, n° 11 (1930). Les nombreuses rééditions des travaux d’Évagre (l’original grec de ces écrits n’a pas été conservé, et nous ne disposons que des traductions syriaques et arméniennes) ont beaucoup contribué à l’éclaircissement de cette question. Cependant, il me semble que l’importance d’Évagre a été un peu surévaluée en raison même de cette vogue éditoriale. En aucun cas, je ne veux amoindrir son enseignement spirituel, mais je considère que le courant spirituel que représentent les Homélies spirituelles de saint Macaire (voir notes ultérieures) ainsi que les écrits de saint Diadoque ont exercé une influence plus grande, et sont plus significatifs par leur dimension mystique. Syméon le Nouveau Théologien (942-1022), l’un des plus grands saints de l’Église byzantine, descend de Diadoque en droite ligne. Par ailleurs, la mystique de la « prière de Jésus », que l’on trouve déjà chez Nil d’Ancyre (?-430) et qui n’apparaît pas chez Évagre, a laissé des traces beaucoup plus profondes et persistantes que toutes les « contemplations » d’Évagre, avec leurs multiples subdivisions. On ne peut pas non plus considérer saint Maxime le Confesseur comme un simple imitateur d’Évagre, ainsi que tend à le faire M. Viller (voir op. cit.). Voir aussi. Hans URS VON BALTHASAR, Liturgie cosmique. Maxime le Confesseur, Paris, Éd. Aubier, 1947.
- ÉVAGRE, Sur les huit pensées, XII, dans Traité pratique, SC 171, p. 521-529.
- ÉVAGRE, IIIe Centurie, 41, dans Les six centuries des Kephalaia gnostica, éd. A. Guillaumont, Patrologia Orientalis, t. XXVIII/1, Paris, 1958, p. 115. Cet écrit d’Évagre est parvenu jusqu’à nous (à l’exception de quelques fragments de faible importance) en traduction syriaque uniquement. W. Frankenberg a édité (dans Evagrius Ponticus, Berlin, Abhandlungen der K. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, Philol.-Hist. Klasse, 1912, Neue Folke, Band 12) le texte syriaque et l’a lui-même traduit en grec. Il faut dire que cette tentative de reconstituer l’original grec à partir de la traduction syriaque s’est révélée insatisfaisante. Le grec de Frankenberg est très maladroit, pesant, et par le style, se distingue fortement des quelques œuvres d’Évagre qui sont parvenues jusqu’à nous dans leur version grecque originale. La version syriaque était en outre déjà une sorte de reconstruction (parfois tendancieuse) de l’original grec. Cela apparaît clairement lorsqu’on compare cette traduction avec les rares fragments grecs de ce texte dont nous disposons. De plus, il existe deux versions différentes de la traduction syriaque. La plus ancienne est la plus fidèle à l’original (il n’en existe qu’un manuscrit), la seconde est plus adaptée aux goûts du lecteur (en sont systématiquement exclues les expression et idées d’Origène, etc.) et a donc été diffusée plus largement que la première. À ce sujet, on pourra consulter le très intéressant travail d’A. Guillaumont. « Le texte véritable des Gnostica d’Évagre le Pontique », Revue de l’histoire des religions, n° 142 (1952), p. 156-205.
- ÉVAGRE, Sur la prière, en 153 chapitres, 91, p. 92.
- Ibid., 46, p. 81.
- Ibid., 49, p. 82.
- Ibid., 46 et 50, p. 81 et 82.
- Ibid., 67, p. 86.
- Ibid., 68, p. 87.
- Ibid., 72, p. 87-88.
- Voir Ibid., 72, n. 32, p. 88.
- Ibid., 73, p. 88.
- ÉVAGRE, IIIe Centurie, 39, dans Les six centuries des « Kephalaia Gnostica », op. cit., p. 134.
- ÉVAGRE, Sur la prière, en 153 chapitres, 94, p. 93.
- Ibid., 96, p. 93.
- ÉVAGRE, Ve Centurie, 80, dans Les six centuries des « Kephalaia Gnostica », op. cit., p. 210.
- ÉVAGRE, Sur la prière, en 153 chapitres, 94.
- Ibid., 98, p. 94.
- Ibid., 111, p. 97.
- Ibid., 74, p. 88.
- Ibid., 75, p. 89.
- Ibid., 81, p. 90.
- Ibid., 80, p. 90.
- ÉVAGRE, VIe Centurie, 35, dans Les six centuries des « Kephalaia Gnostica », op. cit., p. 230.
- ÉVAGRE, Sur la prière, en 153 chapitres, 115, p. 98.

Des indications sur le rôle des anges et des démons dans la vie spirituelle apparaissent dans les textes de l’Église dès les tous premiers temps du christianisme. Ce n’est cependant qu’avec l’apparition du monachisme et l’élaboration de l’enseignement ascétique du IVe siècle que cette question a été abordée de façon cohérente et systématique. La première œuvre où l’on trouve cette question traitée de façon conséquente est sans aucun doute la Vie de saint Antoine le Grand, par saint Athanase d’Alexandrie (8).
La Vie de saint Antoine le Grand peut être considérée comme un modèle caractéristique de la pensée orthodoxe sur le rôle joué par les puissances des ténèbres dans la lutte spirituelle de l’homme. Cette Vie conserve jusqu’à nos jours sa valeur d’enseignement, même si des auteurs ultérieurs ont parfois approfondi notablement l’étude de la question. Saint Athanase, à l’instar de ses contemporains, concevait le monachisme non seulement comme une voie vers le salut et la sanctification personnelle, mais aussi et avant tout comme une lutte contre les puissances démoniaques des ténèbres. Bien sûr, chaque chrétien est appelé à s’engager dans cette guerre spirituelle, mais les moines en constituent les avant-postes, les troupes d’élite qui vont débusquer l’ennemi directement dans son repaire, c’est-à-dire dans le désert, qui était considéré comme lieu de prédilection des démons, le christianisme s’étant largement répandu dans les régions peuplées. L’éloignement hors du monde n’était pas considéré comme une tentative d’échapper à la lutte contre le mal, mais au contraire comme un moyen d’engager contre lui un combat encore plus actif et héroïque. C’est pourquoi les moines sont entourés de démons. « Car nous avons des ennemis terribles et fourbes, dit saint Antoine à ses élèves, les mauvais démons. Et c’est contre eux que nous avons à lutter (9). […] Nombreuse est leur troupe dans l’air qui nous entoure, et ils ne sont pas loin de nous (10). »
Dans la Vie de saint Antoine le Grand, nombreuses sont les descriptions des différentes façons dont les démons nous tentent. Premièrement, ils font tout pour écarter le moine de la voie ascétique, ils essaient de le faire renoncer à la vie monastique (11). Puis ils l’assaillent de toutes sortes de pensées mauvaises et de désirs obscènes (12). Ils tentent ensuite de terroriser le moine par des apparitions fantastiques effrayantes (13). Mais si l’ascète résiste à toutes ces tentations et le diable se voit « chassé de son cœur (14) », ce dernier lui apparaît alors sous l’apparence d’un humain (15). Toute cette lutte se situe principalement sur un terrain spirituel, mais les démons sont des créatures vivantes bien réelles, capables de se manifester par des actions concrètes, en produisant, par exemple, des sons audibles même par une tierce personne (16). Ils sont aussi capables d’infliger aux personnes qu’ils prennent pour cible de leurs tentations de sérieux dommages physiques, des blessures par exemple. Ainsi, saint Antoine fut si cruellement battu par les démons au tout début de sa vie monastique, qu’il fut par eux laissé « comme mort » sur le sol (17). C’est dans cet état qu’il fut retrouvé le lendemain matin. Il assurait que la douleur de ses blessures était d’une intensité qu’aucun coup des hommes ne saurait jamais provoquer (18). Les démons ont enfin recours à divers procédés pour obtenir insidieusement la confiance de leur victime. Ils chantent, lisent les psaumes, ils la réveillent pour la prière, la poussent à jeûner, etc. (19).
Il serait cependant parfaitement faux de conclure, au vu de la place qu’occupent les tentations et les apparitions démoniaques dans la Vie de saint Antoine le Grand, que les moines de cette époque craignaient la force des puissances des ténèbres. Ils avaient certes de la réalité des démons une sensation très vive, fondée sur l’expérience personnelle, mais dans le même temps ils croyaient fermement que la puissance de Satan avait été anéantie par l’incarnation et sur la croix, et que les chrétiens avec l’aide de Dieu étaient donc capables d’en venir à bout. Cette pensée revient à plusieurs reprises dans la Vie de saint Antoine le Grand. « Depuis la venue du Seigneur, l’Ennemi est déchu et ses pouvoirs se sont affaiblis. Ainsi donc, il ne peut rien, mais comme un tyran, même déchu, il ne se tient pas tranquille et menace, ne serait-ce qu’en parole. Que chacun de vous réfléchisse à cela. il peut alors mépriser les demons (20). » La réaction véritablement chrétienne face aux démons n’est donc pas la peur, mais le mépris. « Il ne faut pas les craindre, puisque, par la grâce du Seigneur, toutes leurs machinations se réduisent à rien (21). » Nous disposons de nombreuses armes pour lutter contre les démons. la foi, une vie bonne, le souvenir de la damnation éternelle, les prières et, surtout, le signe de croix. Les démons, dit saint Antoine, « redoutent fort le signe de la croix du Seigneur, puisque par elle le Sauveur les a dépouillés et donnés en spectacle (22). » Le Christ en personne peut nous venir en aide, comme c’est arrivé à saint Antoine (23). Et si nous n’oublions jamais que Dieu est toujours avec nous, les démons disparaîtront en fume (24).
Cependant, cette incapacité des démons à attaquer les chrétiens de front, les incite à recourir à la ruse, aux moyens détournés. Ainsi, ils nous apparaissent sous l’aspect d’anges de lumière et nous trompent par des visions mensongères. Saint Antoine passe alors au problème du discernement des esprits, et c’est là un des moments particulièrement intéressants de son enseignement (25). Saint Antoine explique à ses disciples que les démons nous apparaissent souvent sous forme d’anges. Ils nous disent même. « Nous sommes les anges (26). » Les chrétiens, cependant, n’auront aucun mal, avec l’aide de Dieu, à discerner le bon esprit du mauvais, d’après l’effet qu’il aura sur leur âme. « Il est facile et possible de distinguer la présence des mauvais et des bons, si Dieu l’accorde », dit saint Antoine. « La vue des saints n’est pas accompagnée de troubles […]. Elle se produit tranquillement et doucement, de sorte qu’aussitôt la joie, l’allégresse et le courage s’insinuent dans l’âme. Car avec eux est le Seigneur, qui est notre joie et la force de Dieu le Père. Les pensées de l’âme demeurent sans trouble et sans agitation, si bien qu’illuminée, elle voit par elle-même ceux qui apparaissent. Un désir des biens divins à venir l’envahit, et elle voudrait absolument s’unir à eux, si elle pouvait s’en aller avec eux (27). » « S’il s’en trouve pourtant qui […] craignent la vue des bons esprits » qui s’offre à eux, « ceux qui apparaissent les délivrent aussitôt de cette crainte par l’amour (28). » « Lors donc que, […] à la vue de quelques esprits, vous craignez, si la crainte est aussitôt enlevée et si, à sa place se produisent joie ineffable, alacrité […] et tranquillité des pensées, […] force d’âme et amour de Dieu, ayez courage, et priez. Car la joie et le calme de l’âme témoignent de la sainteté de celui qui se rend present (29). » Les puissances des ténèbres, elles, ont un effet tout à fait opposé. Leur apparition s’accompagne de « trouble, de bruit provenant de l’extérieur » et d’effroi. Elles engendrent les mauvais sentiments, le désordre des pensées et le mépris des vertus (30). Et le sentiment de peur ne s’estompe pas, comme en présence d’une vision bonne (31). Cependant, en aucun cas, nous ne devons perdre notre bravoure quand nous voyons une apparition. « Lorsqu’une apparition se produit, qu’on ne succombe pas à la crainte mais qu’on commence par l’interroger avec courage sur sa nature. « Qui es-tu ? D’où viens-tu ? » Si c’est une vision de saints, ils te rassureront et changeront ta crainte en joie. Mais si c’est une vision diabolique, aussitôt elle s’affaiblit en voyant un esprit affermi. En effet, le simple fait de demander. « Qui es-tu ? D’où viens-tu ? » est un signe d’imperturbabilité (32). »
La distinction entre les visions de la lumière divine et leurs imitations sataniques n’occupe pas une place importante dans la Vie de saint Antoine le Grand, mais on y trouve tout de même quelques indications à ce sujet. Ainsi, raconte saint Antoine, « ils vinrent une autre fois dans les ténèbres. Ils paraissaient porter des lumières et disaient. « Nous sommes venus t’éclairer, Antoine. » Mais moi, fermant les yeux, je priais et aussitôt la lumière des impies s’éteignait (33). » Le fait qu’Antoine ait fermé les yeux pour éviter les lueurs de la lumière démoniaque, nous permet de conclure que cette lumière, selon toute vraisemblance, était matérielle. La même Vie de saint Antoine nous raconte comment le Seigneur en personne vint un jour à l’aide de saint Antoine alors que ce dernier livrait un rude combat aux démons. « [Antoine], levant les yeux, vit le toit qui semblait s’ouvrir et un rayon de lumière descendre vers lui (34). » Cette description rappelle, de façon frappante, certaines visions de la lumière divine de saint Syméon le Nouveau Théologien, grand mystique du XIe siècle (35). « Les démons avaient subitement disparu, la douleur de son corps avait aussitôt cessé […] Antoine […], soulagé de ses peines […] demandait à la vision […]. « Où étais-tu ? Pourquoi ne t’es-tu pas manifesté dès le début pour faire cesser mes douleurs ? » Alors une voix parvint jusqu’à lui. « J’étais là, Antoine, mais j’attendais, pour te voir combattre » (36). »
Nous ne devons cependant pas considérer que reconnaître les démons soit chose facile. Ainsi qu’il a été dit plus haut, c’est facile et réalisable « quand Dieu nous l’accorde ». En d’autres termes, il ne s’agit pas là d’un talent naturel, mais avant tout d’un don de Dieu. Antoine lui-même dit. « Il faut prier […] pour recevoir la grâce du discernement des esprits, afin que […] nous ne nous fiions pas à tout esprit (37). » Une question peut alors survenir. quel mal peuvent nous faire les mauvais esprits, si leur puissance a été vaincue par le Christ sur la croix ? Ce n’est bien sûr qu’avec la volonté de Dieu qu’il leur est possible de nous tenter, pour notre propre bien. Et s’ils réussissent à nous atteindre, c’est toujours par notre faute. Nous leur donnons des forces par la faiblesse de notre foi. Dans la Vie de saint Antoine le Grand, Satan lui-même admet cela. Il apparaît à saint Antoine et lui avoue sa faiblesse. Mais il se défend de l’accusation selon laquelle ce serait lui qui viendrait tenter les moines. « Ce n’est pas moi, dit-il, ce sont eux qui se troublent eux-mêmes, puisque moi, je suis devenu faible (38). »
Tel est, en résumé, l’enseignement d’Athanase dans la Vie de saint Antoine le Grand sur la participation des puissances invisibles à notre vie spirituelle. Saint Antoine a une sensation très vivante de la réalité des puissances des ténèbres et de leurs efforts constants pour se mêler de notre vie. Ils tentent l’homme plutôt de l’extérieur, par des apparitions de toute sorte, mais ils sont aussi capables de lui donner de mauvaises pensées et des sentiments coupables. Cependant un coup fatal a été porté à leur puissance sur la croix, et le chrétien ne doit absolument pas les craindre. Dans ces écrits datant de l’aube d’un christianisme alors triomphant, il y a beaucoup d’optimisme juvénile, qui ne peut pas toujours être partagé par les générations ultérieures de chrétiens.
Pour ce qui est des bons anges, ils ne sont que fugitivement évoqués dans la Vie de saint Antoine le Grand (39).
Il convient encore de citer les multiples versions de la Vie de saint Pacôme (40), témoignage très important de la vie spirituelle et du monachisme du IVe siècle. Ce livre constitue une riche et intéressante source d’informations sur les puissances démoniaques. Ces informations se distinguent cependant assez peu de celles que nous tirons de la Vie de saint Antoine le Grand. C’est pourquoi nous ne citerons de la Vie de saint Pacôme qu’un seul passage, qui donne des précisions sur la façon de distinguer les visions vraies des mensongères. Selon saint Pacôme, les apparitions vraies captivent entièrement la conscience par leur sainteté, ce qui élimine toute possibilité de doute. Le moindre doute sur la nature de cette vision est déjà en soi un signe de ce que la vision est l’œuvre du diable. « Un jour, lit-on dans la Vie de saint Pacôme, un démon lui apparut sous l’apparence du Christ, et prétendit être le Christ […]. Mais le saint homme possédait le talent de discerner les esprits […] il pensa immédiatement. « Les pensées de l’homme qui voit des forces saintes disparaissent entièrement. Elles ne considèrent plus rien d’autre que la sainteté de ce qui est en train de leur apparaître ; mais moi, je vois cela, et je continue à penser et à réfléchir. Il est clair que l’apparition ment. Elle n’est pas une vision de forces saintes ». Pendant qu’il réfléchissait ainsi, la vision mensongère disparut (41). » L’apparition d’un démon sous l’apparence du Christ est ici un épisode intéressant.
- La Vie de saint Antoine le Grand, Paris, Éd. du Cerf, coll. « Sources chrétiennes » n° 400, 20042. Parmi les études récentes consacrées à la vie de saint Antoine le Grand, nous citerons Louis BOUYER, La Vie de saint Antoine. Essai sur la spiritualité du monachisme primitif, Éd. de l’Abbaye de Bellefontaine, coll. « Spiritualité orientale » n° 22, 1978.
- La vie de saint Antoine le Grand, XXI, SC 400, p. 193.
- Ibid., XXI, p. 195.
- Ibid., V, p. 143-145.
- Ibid., V, p. 145.
- Ibid., V, p. 145, et XXIII, p. 199.
- Ibid., VI, p. 147.
- Ibid.
- Ibid., IX, p. 161, et XIII, p. 169-171.
- Ibid., VIII, p. 157.
- Ibid.
- Ibid., XXV, p. 205-207.
- Ibid., XXVIII, p. 211-213.
- Ibid., XXIV, p. 205.
- Ibid., XXXV, p. 231, et XXX, p. 219.
- Ibid., X, p. 163-165.
- Ibid., XLII, p. 251.
- Ibid., XXXV-XXXVII, p. 231-237.
- Ibid., XXXV, p. 231.
- Ibid., XXXV, p. 231-233.
- Ibid., XXXV, p. 233.
- Ibid., XXXVI, p. 235.
- Ibid.
- Ibid.
- Ibid., XLIII, p. 253.
- Ibid., XXXIX, p. 241-243.
- Ibid., X, p. 163.
- Se reporter notamment au chapitre 22 de ses Catéchèses autobiographiques. Voir aussi ARCHEVEQUE BASILE (KRIVOCHEINE), Dans la lumière du Christ. Saint Syméon le Nouveau Théologien, 949-1022. Vie, spiritualité, doctrine, Chevetogne, éd. de Chevetogne, coll. « Témoins de l’Église indivise », n° 1), 1980, chap. 1: « Un pauvre rempli d’amour fraternel », p. 13-25.
- La Vie de saint Antoine le Grand, X, p. 163-165.
- Ibid., XXXVIII, p. 239.
- Ibid., XLI, p. 247.
- Voir l’annexe au livre du P. Bouyer, La Vie de saint Antoine. « Cosmologie et démonologie dans le christianisme antique ».
- Édition critique des versions grecques de la Vie de saint Pacôme. « Sancti Pachome Vitae Graecae », éd. F. HALKIN, coll. « Subsidia hagiographica », n° 19, Bruxelles, 1932. Trad. fr. dans A.-J. FESTUGIERE, Les Moines d’Orient, t. IV. La première vie grecque de saint Pacôme, Paris, Éd. du Cerf, 1962.
- Sancti Pachome Vitae Graecae, éd. F. HALKIN, chap. 87, p. 58-59.

« Dieu, l’homme , l’Église » Lecture des Pères Par Basile Krivochéine Les Éditions du « CERF »
Préface du Métropolite Hilarion (Alfeyev) de Volokolamsk, président du département des relations extérieures du patriarcat de Moscou — Traduction du russe de Nikita Krivochéine, Paula et Jacques Minet, Serge Model, Lydia Obolensky — Présentation, révision et notes de Serge Model
Dans le présent article, je vais tenter de donner au lecteur une vision d’ensemble du rôle des anges de lumière et des esprits des ténèbres dans la vie spirituelle, selon les écrits des principaux Pères ascétiques et mystiques de l’Orient chrétien. Le manque de place me contraint à limiter mon étude presque exclusivement à la période ancienne (IVe et Ve siècles), ce qui ne signifie aucunement que j’accorde moins d’intérêt ou de valeur aux écrits ultérieurs à cette période. Le thème de mon étude étant avant tout spirituel, je ne me préoccuperai pas directement de l’aspect théologique de la question des anges et des démons, même s’il s’avère souvent impossible de séparer le théologique du spiritual (2).
Je commencerai par une remarque préliminaire. Toute personne qui déciderait de rassembler les passages des écrits des Pères ascétiques traitant du rôle des anges et des démons dans la vie spirituelle, serait frappée par la place importante qui y est faite aux descriptions de l’action multiforme des puissances sataniques et, à l’opposé, par la rareté, la dispersion et le caractère peu explicite des remarques concernant le rôle des anges. Parmi les très rares exceptions à cette règle. le pseudo-Denys l’Aréopagite avec son enseignement sur l’accès à la connaissance par la hiérarchie des puissances célestes et, dans une certaine mesure, saint Isaac de Ninive (3), grand mystique syrien des VIIe-VIIIe siècles. Les écrits du Pseudo-Denys étant très théoriques et assez peu fondés sur l’expérience, je ne les commenterai pas dans le présent article. Ils représentent un courant quelque peu marginal de la spiritualité orientale.
Ce n’est pas par hasard que les Pères ont généralement accordé une attention privilégiée aux puissances démoniaques et cela peut s’expliquer de différentes façons. On retrouve notamment cette caractéristique dans les Saintes Écritures, et tout particulièrement dans les Évangiles, où de nombreux récits sont consacrés à des possédés et à leur guérison par le Christ. Il n’est guère surprenant que les Pères ascétiques, en général si fidèles à l’esprit du Nouveau Testament, aient également suivi l’exemple des Évangélistes sur la question qui nous occupe.
Des considérations ascétiques pratiques ont aussi eu ici leur rôle à jouer. Les démons sont nos ennemis, et il nous est donc vital de connaître et d’identifier leurs moyens de lutte, alors que les anges sont nos amis et nous aideront même à notre insu. « Il faut aussi apprendre à connaître les différences existant entre les démons et remarquer les circonstances de leur venue, écrit Évagre […] car il est nécessaire de le savoir, pour que, au moment où les pensées commencent à déclencher ce qui constitue leur matière et avant que nous soyons chassés trop loin de l’état qui est le nôtre, nous prononcions quelques paroles à leur adresse et dénoncions celui qui est là. De cette façon, nous progresserons facilement avec l’aide de Dieu ; quant à eux, nous les ferons s’envoler, pleins d’admiration pour nous et consternés (4). »
« Meilleur est celui à qui il a été donné de se voir lui-même, que celui à qui il a été donné de voir les anges, écrit Isaac de Ninive, car on voit ces derniers avec les yeux du corps, alors que l’on se voit avec les yeux de l’âme (5). » Le texte de l’apôtre Paul sur les métamorphoses de Satan en ange de lumière (2 Co 11, 4) renforce la méfiance envers les visions trompeuses et explique aussi le peu de confiance témoigné par les Pères ascétiques aux apparitions des anges et la place réduite qu’elles occupent selon eux dans la vie spirituelle.
Il est remarquable que les Pères représentent rarement notre lutte spirituelle comme un combat entre les anges et les démons, mais bien plus souvent comme une guerre de l’homme contre Satan. Les anges, bien sûr, nous aident et nous protègent dans cette bataille, mais ce ne sont pas les anges qui s’opposent à Satan ; c’est le Christ lui-même ainsi que la grâce du Saint Esprit, qui par sa présence détruit les tentations démoniaques et dissipe dans nos âmes les ténèbres sataniques. Ainsi par exemple, saint Cyrille de Jérusalem, évoquant, dans une de ses Catéchèses, les ténèbres introduites dans notre esprit par les puissances impures, parle immédiatement du Saint Esprit qui se mêle à la lutte, nous instruit et nous emplit de son odeur suave (6). Cependant la principale raison pour laquelle, d’après ces écrits, les anges occupent dans la vie spirituelle une place limitée voire « secrète » est à chercher dans le christocentrisme et le théocentrisme fortement marqués de la spiritualité orientale, spiritualité où les moments de mysticisme les plus intenses sont toujours envisagés comme un état de fusion directe du cœur et de l’intellect avec le Christ, ou comme la connaissance révélée de la Sainte Trinité. À ce degré de vie spirituelle, tout détournement de l’attention vers les anges, quand il ne sera pas considéré comme une véritable erreur, sera du moins perçu comme étant de moindre valeur. Même le Pseudo-Denys cesse de mentionner les anges une fois qu’il passe à sa Théologie mystique. Un merveilleux récit conservé par Évagre dans son Traité de l’oraison illustre parfaitement une telle conception des choses.
Un saint homme aimant Dieu cultivait l’esprit de prière. Il cheminait dans le désert lorsque survinrent deux anges qui se placèrent à ses côtés et firent route avec lui. Mais il ne leur accorda aucune attention, pour ne pas se disperser au meilleur de la prière. Il avait en effet en mémoire cette leçon de l’apôtre. « Ni les anges même, ni les puissances, ni les dominations ne pourront nous distraire de l’amour du Christ » (Rm 8, 38) (7).
- Exposé présenté (en condensé) au congrès annuel de la Fraternité Saint-Serge et Saint-Alban (Abingdon, Grande-Bretagne, 1952) et publié dans le Messager de l’exarchat du patriarche russe en Europe occidentale, n° 22 (1955), p. 132-157.
- Il n’existe, à ma connaissance, aucune étude un tant soit peu exhaustive du rôle et de la signification des anges et des démons dans la vie spirituelle d’après les écrits des Pères orientaux. L’article de Joseph Duhr. « Les Anges gardiens », dans le Dictionnaire de spiritualité, Paris, Beauchesne, t. I, 1932, p. 580-625, ne traite notre thème de réflexion que de façon incomplète ; voir aussi J. DANIELOU, Les Anges et leur Mission d’après les Pères de l’Église, Éd. de Chevetogne, coll. « Irénikon », n° 5, 1952. Le recueil Satan (Paris, DDB, coll. « Études carmélitaines », 1948) contient beaucoup d’informations intéressantes, mais l’expérience et l’enseignement des Pères orientaux y sont quasi totalement ignorés, comme c’est souvent le cas dans les travaux des théologiens occidentaux.
- Également connu sous le nom de saint Isaac le Syrien. D’après les données historiques qui nous sont parvenues, saint Isaac fut, pendant une courte période, évêque de la ville de Ninive, qui faisait partie de la juridiction nestorienne de l’Église au sein de l’empire perse. Toute sa vie et ses activités semblent par ailleurs s’être déroulées au sein de cette Église. L’Église orthodoxe l’a néanmoins toujours vénéré comme saint et a toujours considéré avec beaucoup de respect ses écrits spirituels que l’on ne saurait en aucun cas accuser de « nestorianisme ». Quant à moi, en aucun cas je n’oserais lui contester sa sainteté, bien que le simple fait de son appartenance (fut-elle formelle) à l’Église nestorienne pose à la pensée théologique orthodoxe de sérieuses questions quant à la nature de l’Église et à la possibilité d’une vie bienheureuse et de la sainteté hors des cadres temporels de cette Église. Dans cet article je me réfère à l’édition anglaise des écrits de saint Isaac de Ninive, traduits directement de leur original syriaque à l’anglais. Mystic Treatises by Isaac of Nineveh, traduit du texte syriaque de Bedjan par A. J. Wensinck, Amsterdam, Éd. Koninklijke Akademie van Wetenschappen, 1923, 23, 1. La traduction grecque, faite au Xe siècle au monastère de Saint-Sabbas, est en de nombreux points inexacte, voire tendancieuse (1re éd. de Nikiforos Théotokos, Leipzig, 1770; 2e éd. 1895). Les traductions slavonnes et russes, quant à elles, ont été faites à partir de la traduction grecque, et non directement du syriaque. Une traduction française (de la version grecque) a été publiée. ISAAC LE SYRIEN, Œuvres spirituelles, DDB, coll. « Théophanie », 1981.
- ÉVAGRE LE PONTIQUE, Sur les huit pensées, II, dans Traité pratique ou Le Moine, Paris, Éd. du Cerf, coll. « Sources chrétiennes » n° 171, 1971, p. 599-601.
- ISAAC DE NINIVE, Mystic treatises, chap. 65, p. 311.
- CYRILLE DE JERUSALEM, Catéchèses mystagogiques, III passim, Paris, Éd. du Cerf, coll. « Sources chrétiennes » n° 126bis, 1988, p. 121-133.
- ÉVAGRE, Sur la prière, en 153 chapitres, 112, dans De la prière à la perfection, Paris, Éd. Migne, coll. « Les pères dans la foi », 1992, p. 97. Le lecteur orthodoxe a l’habitude de voir ce récit attribué à saint Nil du Sinaï, c’est sous ce nom qu’il est publié dans les versions grecque et russe de la Philocalie, ainsi que dans la patrologie de Migne (PG 79, col. 1165-1200). À l’heure actuelle il est prouvé sans aucun doute possible qu’Évagre est bien l’auteur de ces paroles (Évagre lui-même cite ces chapitres comme étant son œuvre, et c’est sous son nom qu’ils apparaissent dans toutes les traductions syriaques anciennes). À ce sujet, se reporter à l’étude de J. HAUSHERR. « Le traité de l’oraison d’Évagre le Pontique (Pseudo-Nil) », Revue d’ascétique et de mystique, n° 15 (1934), p. 34-93 et p. 113-170. La disparition du nom d’Évagre dans les manuscrits grecs (et son remplacement par celui de Nil du Sinaï) s’explique par le fait que certaines œuvres d’Évagre (dont le Traité de l’oraison ne fait pas partie) ont été condamnées par le VIe Concile œcuménique de 553 pour tendances origénistes ; à la suite de quoi, le nom d’Évagre devient suspect aux orthodoxes ; c’est sous le nom de Nil du Sinaï que son Traité de l’oraison a pu rester une des œuvres fondamentales de la patristique orientale en ce qui concerne l’« oraison mentale ». Le fait qu’Évagre soit l’auteur véritable de ce traité ne fait que conférer plus d’ancienneté encore à ce texte admirable.