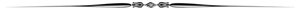Les gardiens rient, les diables
Aux hallebardes ensanglantées.
V. J. Brioussov
La milice du district de Snagost était installée dans une grande maison paysanne. Nous entrâmes dans une pièce de bonnes dimensions, et le milicien, sans me poser la moindre question, s’assit derrière son bureau et se mit à rédiger le procès-verbal de mon arrestation. Je m’assis sur une chaise. Le procès-verbal l’occupa un temps assez long, on voyait bien que c’était là une tâche difficile pour lui, qu’il manquait d’éducation. Il parvint enfin à bout de son travail, et me le montra pour que je le lise avant de le signer. Le contenu de ce rapport était le suivant (je ne reproduis pas les nombreuses fautes qu’il contenait). « Le 15 septembre 1919, à trois heures de l’après-midi, au hameau de Snagost, Vsévolod Alexandrovitch Krivochéiev, soupçonné d’espionnage, a été interpellé par les soldats du 1er régiment koubanais rouge. Il a été transféré à la milice du district de Snagost, ainsi que les documents et l’argent qui ont été trouvés sur lui, pour enquête. » Je ne trouvai rien à redire au contenu de ce procès-verbal. Je dirais même que l’expression malhabile du milicien contribuait à donner à ce procès-verbal un ton qui m’était plutôt favorable. Ainsi, il y était indiqué que j’avais été arrêté à Snagost, sans préciser que j’étais alors en route pour Glouchkovo, c’est-à-dire pour le front même. Mon arrestation n’était pas justifiée par des raisons concrètes, « soupçonné d’espionnage » était une formulation vague. La perte puis la réapparition de mes papiers n’était pas mentionnée, ce qui renforçait l’impression que mon arrestation était sans fondement. Il ne parlait pas du sel non plus. Je signai le rapport. À ce moment, probablement en raison des émotions que je venais de vivre, je ressentis une forte envie de boire (je n’avais d’ailleurs rien mangé ni bu depuis le matin). Je demandai un verre d’eau au milicien. Il appela la maîtresse de maison, une Ukrainienne d’une trentaine d’années et lui demanda de me donner de quoi me désaltérer. Elle me fit passer dans la pièce voisine, si spacieuse, que nous nous trouvâmes suffisamment loin du milicien pour qu’il ne puisse pas nous entendre. Elle m’apporta une jatte de lait froid et d’une voix compréhensive et pleine de compassion me demanda. « Alors monsieur, comment avez-vous pu vous faire attraper ? » Touché, je répondis. « Ça va aller, ne vous inquiétez pas, je vais sans doute m’en sortir. » L’Ukrainienne hocha la tête, d’un air sceptique et triste, et dit doucement. « Avec eux, ce n’est pas si facile de s’en sortir. » Ayant bu tout mon saoul, je retournai vers le milicien qui m’emmena à la prison du district, non loin du bâtiment de la milice.
C’était une cellule située en entresol, assez étroite et longue, probablement héritée de l’ « ancien régime ». Elle ne contenait aucun meuble, le sol était de pierre, une unique porte du côté le plus étroit de la cellule dans laquelle était découpée une lucarne. La lucarne était sans vitre, mais avec des barreaux. Il est possible que cette cellule ait servi par le passé à dessoûler les ivrognes. On m’y enferma pour la nuit (qui commençait à tomber quand nous y arrivâmes), et on me désigna comme geôlier un paysan en pelisse, qui arborait en guise d’arme une hache glissée à la ceinture. On m’apporta un morceau de pain noir et de l’eau. Le paysan me les fit passer par la lucarne. J’essayai d’engager la conversation avec lui, mais il ne répondait pas. « Eh bien, lui dis-je, tu as donc même peur de parler ! » Il avait manifestement reçu l’ordre de se taire. Il ne me restait qu’à m’allonger sur le sol de pierre et dormir. Il faisait froid, mais j’étais si fatigué que je m’endormis rapidement et profondément.
Lorsque je me réveillais, il faisait déjà clair, et c’était, comme la veille, une belle journée ensoleillée. Vers huit heures, le milicien vint me chercher. On me fit asseoir sur un break, le cocher à l’avant, un milicien armé à l’arrière et moi au milieu. Je fus emmené à Korenevo, où on me remit entre les mains de la milice du district. On m’installa dans une pièce d’une maison de ville. Cette maison, réquisitionnée par la milice, avait dû être l’hôtel particulier de quelqu’un d’assez aisé. Une porte ouverte donnait sur le couloir, il n’y avait aucun gardien en vue. Un instant, j’éprouvais une tentation. fuir ! Mais c’était trop risqué. je ne savais pas où menait le couloir, et la sortie serait forcément gardée. À quoi bon courir un tel risque, pensai-je, puisque étant à nouveau en possession de mes papiers, je n’étais pas dans une situation désespérée ? Deux ou trois heures plus tard, on me fit sortir sous la garde d’un soldat armé, et monter dans un wagon de marchandises découvert qui se trouvait sur la ligne à voie unique Korenevo-Rylsk (outre la ligne principale vers Kiev et Koursk, il existait aussi à Korenevo une ligne est-ouest à voie unique d’une trentaine de verstes qui atteignait Rylsk, chef-lieu de district dans la province de Koursk). C’est cette ligne que nous empruntâmes.
Le soldat, fusil à l’épaule, s’assit près de la porte ouverte du wagon laissant pendre ses deux jambes à l’extérieur et sembla contempler le paysage. De nouveau, la même idée. et si je poussais le soldat hors du train et m’enfuyais ? Mais non, c’était impossible. Premièrement, j’étais incapable de faire une chose pareille (je ne me déciderais jamais à le pousser et ne saurais pas le faire), et de plus, le soldat avait mes papiers et sans eux, je n’irais pas bien loin. Une demi-heure plus tard, nous étions à Rylsk. Cette fois on m’emmena dans une grande bâtisse de pierre, pleine de monde. Je ne savais pas quelle administration abritait cette maison, probablement le commandement de la ville de Rylsk.
On me fit passer à travers la foule dans une pièce séparée, où se trouvait un chef bolchevik, assis à un bureau. Les cheveux ébouriffés, le col de sa chemise dégrafé, il avait l’air à moitié fou. Il avait devant lui un autre militaire, debout dans une attitude décontractée. Apparemment, il était en train de solliciter une permission pour se rendre au chevet de sa mère gravement malade. Son supérieur lui faisait des reproches en hurlant et en gesticulant. « Qu’est-ce qu’une mère ? Tu dois servir la Révolution et oublier tout le reste, tout sacrifier, y compris ta mère. Qu’elle meure ! La Révolution passe avant tout ! » Le militaire regardait son supérieur comme s’il avait affaire à un fou et, avec un sourire plein de mépris et d’ironie, répondit entre ses dents. « Comment ça. sacrifier ma mère ? Qu’elle meure ? Jamais de la vie ! » Ils continuèrent leur dispute. L’un hurlait, l’autre lui répondait calmement, d’un air de dérision. Finalement, le chef s’aperçut de notre présence, prit les papiers des mains de mon gardien, les examina. « Une affaire d’espionnage ! », s’exclama-t-il. « Ha ! ha ! ha ! », et il éclata d’un rire bruyant. « C’est une belle activité, il n’y a rien à dire ! Je vous félicite ! » — « Ce n’est pas du tout de l’espionnage » rétorquai-je. — « Qu’est-ce que c’est alors ? » — « Eh bien, j’étais allé chercher du sel … » commençai-je à raconter. — « Chercher du sel ? », cria le fou, « C’est donc de la spéculation ! Ce n’est pas mieux ! Tu es donc soit un espion soit un spéculateur ? » Mais je savais qu’une affaire de spéculation était moins grave qu’une affaire d’espionnage, et continuai à parler de sel. L’officier signa un papier et le remit à mon gardien. Je m’adressai à lui. « Je n’ai rien mangé depuis hier. Pourriez-vous me faire donner un peu de pain ? » — « Il n’y a pas de pain ici » me répondit sèchement l’officier.
On me fit passer dans la salle attenante. Nous attendîmes un certain temps dans la foule. Un soldat rouge me fit signe d’approcher (il avait probablement entendu ma conversation avec le chef) et je le suivis dans une petite pièce vide. Là, il sortit d’un sac une grande miche de pain et en coupa un gros morceau. « Prends-la, mais ne le dis à personne, sinon je serai sévèrement puni. » Je le remerciai du fond du cœur. Qui était-il ? Un brave homme, tout simplement, ou un sympathisant secret des Blancs ? (Peut-être avait-il deviné qui j’étais.)
Environ quarante minutes après, on me fit traverser la ville jusqu’au bâtiment de la milice du district. C’était un grand bâtiment de pierre qui ressemblait à une prison. Apparemment, cela avait été le bâtiment de la police avant la Révolution. On m’enferma seul dans une grande cellule. À une certaine hauteur, il y a une petite fenêtre, percée dans un mur tellement épais que ses barreaux étaient hors de portée. Tout indiquait qu’il s’agissait là d’une prison de l’ « ancien régime », les bolcheviks étaient bien incapables de construire des bâtiments aussi solides. Je ne me souviens plus s’il y avait une couchette dans ma cellule, il me semble que c’était un lit de planches. J’examinai la cellule. Sur les murs, de nombreuses inscriptions, laissées par les détenus. Parfois juste un nom et une date. Par exemple. « Ça fait vingt-six jours que je suis là, sans savoir pourquoi. » Ou. « J’ai passé ici dix-sept jours pour rien. » Ou encore. « Je suis ici, et je ne sais pas quand on me laissera sortir. Peut-être serai-je tué… » C’était peu encourageant. Apparemment, on restait longtemps ici.
Le premier jour, on ne me donna rien à manger, puis on commença à me donner un morceau de pain par jour. Deux fois par jour, le gardien venait vérifier que j’étais toujours là. Je me plaignais à lui de ce que l’on me gardât sans me nourrir ni procéder à la moindre enquête. « T’as qu’à écrire une réclamation », me dit-il. J’étais un peu étonné d’un tel conseil, mais c’est ce que je fis, et je transmis ma plainte écrite au troisième jour de ma détention à la prison de Rylsk.
Le quatrième jour après mon arrivée, on amena un deuxième prisonnier dans ma cellule. C’était un jeune homme, portant l’uniforme militaire, le visage déplaisant. Il avait l’air à la fois maladif et dégénéré. Très pâle. Nous nous mîmes à bavarder. C’était un tchékiste, un employé de l’administration locale de la Tcheka. D’après lui, on l’avait arrêté pour être rentré de permission avec un jour de retard, mais je suppose qu’il devait y avoir d’autres chefs d’accusation. « Que faisais-tu à la Tcheka ? » lui demandai-je. — « Oh, surtout des fouilles et des arrestations. J’en faisais très souvent, presque chaque nuit. Parfois plusieurs fois par nuit. » — « Et tu en as déjà fusillé ? » — « Non, il y en a dont c’est le travail. » — « Est-ce qu’on pouvait, pendant les fouilles, se mettre quelques petites choses dans la poche ? » — « Ça, non ! Pour ça, ils sont très sévères. Ils vous fusillent. » Le tchékiste était très inquiet pour son sort et disait qu’il ne sortirait jamais d’ici, qu’on allait le fusiller.
C’est ainsi que je passai près de quatre jours à la prison de Rylsk. Je réfléchis beaucoup en faisant les cent pas dans ma cellule. J’avais sans cesse en tête un poème de Brioussov, qui semblait être en résonance avec mon emprisonnement dans les geôles bolchéviques. Je ne pus me retenir d’écrire sur le mur deux vers de Brioussov (que j’ai placés en exergue du présent chapitre). « Les gardiens rient, les diables aux hallebardes ensanglantées. » C’est ainsi que je ressentais alors ma détention.
Le 6 septembre, on me transféra de la prison de Rylsk dans une institution autrement plus importante du (jeune !) appareil répressif soviétique de ce temps-là. le Point de contrôle militaire de la 41e division soviétique (42).
C’était une institution ambulante, qui se déplaçait en fonction de l’évolution de la ligne de front, et dont l’objectif était la lutte contre les crimes militaires (espionnage, spéculation, etc.) en zone de front. En cela, il se distinguait des établissements de la Tcheka, qui fonctionnaient en permanence sur des lieux fixes et dont l’objectif était la lutte contre la « contre-révolution ». En réalité, cependant, comme nous allons le voir, les points de contrôle militaire s’occupaient souvent d’affaires à caractère purement « contre-révolutionnaire » et n’ayant qu’un très vague rapport avec les affaires militaires ; il était donc difficile de tracer une limite bien définie entre leurs compétences et celles de la Tcheka. Il semble d’ailleurs assez illusoire de parler de compétence dans le contexte de chaos et d’arbitraire qui prédominait dans les institutions soviétiques en 1919, et en particulier dans la zone de front. En principe, les points de contrôle militaire ne faisaient que mener l’enquête avant de transmettre les dossiers aux tribunaux militaires et révolutionnaires. Dans les faits cependant, ils pouvaient prononcer eux-mêmes leur verdict, c’est-à-dire exécuter le prisonnier ou le remettre en liberté. La troisième solution, celle d’une peine de prison, était très rarement appliquée en cette période de guerre civile.
Le Point de contrôle militaire de la 41e division soviétique, où l’on m’avait transféré, occupait à Rylsk un hôtel particulier réquisitionné. À l’accueil, un marin au pantalon déchiré nota les renseignements me concernant (nom, prénom, etc.). À ses côtés, un autre marin, élégamment habillé, très brun, au beau visage, mais à l’expression cruelle. Sa casquette de marin, au lieu d’un nom de bateau, portait l’inscription « Terreur rouge ». Il était aisé de comprendre dans quel genre d’établissement je me trouvais. On me fit entrer dans une pièce située au centre de la maison, dépourvue de fenêtres mais comportant une seconde porte qui donnait sur une autre pièce, plus grande, avec des fenêtres sur la cour par lesquelles on apercevait des arbres. Sur une chaise près de la porte ouverte, était assis un gardien. un soldat rouge, tenant un fusil dans les mains. Ces gardiens se succédaient fréquemment les uns aux autres, mais il y avait toujours quelqu’un à la porte.
Il y avait beaucoup de prisonniers dans la pièce. Certains étaient debout, d’autres assis sur le sol. On en amenait, on en reprenait, mais il y en avait toujours quinze ou vingt dans la pièce. Je les observai et compris que la majorité d’entre eux était des habitants de Rylsk, ou des environs, que l’on accusait de sympathies pour les Blancs qui avaient occupé Rylsk pendant un temps avant de se replier vers le sud. Mais il y avait aussi des soldats de l’Armée rouge, coupables de quelque méfait. Dans l’ensemble, c’étaient surtout des petites gens, et il me sembla qu’il n’y avait parmi eux aucun autre véritable contre-révolutionnaire ou intellectuel que moi-même. Il y avait bien deux ou trois personnes, des fonctionnaires de l’armée, qui avaient l’air éduqué, mais ils furent vite emmenés ailleurs.
On nous apporta un bortsch (43) chaud. J’étais affamé, et il me parut succulent. Je ne me souviens plus si je dus passer la nuit dans cette pièce ou si nous fûmes transférés ailleurs le jour même. Quoi qu’il en soit, le 6 septembre vers midi, nos gardiens donnèrent des signes d’inquiétude. Je compris immédiatement ce que cela signifiait. les Blancs avançaient et menaçaient de prendre Rylsk ! Cela signifiait que les Blancs avaient avancé vite, puisque jusque là la ligne de front passait à trente ou quarante verstes au sud de Rylsk. En écoutant les conversations de nos gardiens, nous apprîmes que la ville était en cours d’évacuation. Les rues étaient encombrées de longues files de chariots, les institutions soviétiques déménageaient en hâte, emportant des monceaux d’affaires.
Nos gardiens étaient nerveux. L’un d’eux, un jeune gars un peu voyou, s’acharnait à briser les vitres des fenêtres qui donnaient sur la cour. « Ça de moins pour les Blancs ! » Un autre, plus âgé, tenta de l’en empêcher. « Mais qu’est-ce que tu fais, idiot, peut-être qu’on reviendra, et qu’est-ce qu’on fera, en hiver, avec des vitres cassées ? » On vint nous dire de nous tenir prêts à partir. Notre gardien disparut. À ce moment-là, plus fort que jamais, je fus pris de l’envie de fuir. Profiter de la panique et de l’absence de gardien, et m’évader. Me cacher en ville dans l’un des nombreux jardins ou potagers pour y attendre la venue des Blancs. Ils allaient arriver d’un moment à l’autre (44). Je m’approchai de la porte et regardai dans le couloir, par lequel les gens allaient et venaient régulièrement. Il menait certainement à la sortie principale. Il suffisait de sortir rapidement, de prendre à gauche, et je serais hors de vue. Mais si on me voyait ? Ou si, en chemin, il y avait un garde ? Ou s’il n’y avait pas de sortie par-là ? On me rattraperait, et on me fusillerait sur-le-champ. C’était trop risqué, d’autant plus qu’il n’y avait pas d’absolue nécessité de s’évader. Mes documents pouvaient me tirer d’affaire. Je restai près de la porte, sans pouvoir me décider.
Au dernier moment, on amena un nouveau groupe de prisonniers. C’étaient cinq personnes du hameau de Snagost où j’avais moi-même été arrêté par les Koubanais rouges. Parmi eux, Cyrille Dioubine, le président du soviet de district de Snagost qui avait assisté à mon arrestation. « Mais que faites-vous là ? », dis-je, étonné. — « C’est à cause de vous », me répondit-il. « Les Koubanais sont revenus, vous ont cherché, ils voulaient vous fusiller. Mais vous n’étiez plus là. Ils m’ont accusé de vous avoir fait transférer rapidement exprès pour vous sauver la vie. C’est pour ça qu’on m’a arrêté. » Plus tard, j’appris qu’il y avait une seconde charge contre lui. la première fois que les Blancs avaient commencé à approcher de Snagost, il aurait dû être évacué en tant que fonctionnaire soviétique occupant un poste à responsabilités. Mais Dioubine n’obéit pas à la règle et resta à Snagost sous l’occupation blanche. Quand les Rouges revinrent, cela constitua un chef d’accusation. Il invoquait comme explication le fait que la venue des Blancs avait été très soudaine, qu’il n’avait pas eu le temps de partir.
Parmi les autres prisonniers de Snagost, il y avait un prêtre, le père Paul. On l’avait arrêté parce que son fils était officier dans l’Armée blanche. Je ne sais pas comment cela avait été découvert, soit son fils était venu lui rendre visite pendant l’occupation de Snagost par les Blancs, soit c’est pendant cette occupation qu’il était entré dans l’armée. En tout cas, les Rouges ayant repris Snagost, arrêtèrent le père Paul. Ils arrêtèrent aussi l’ancien doyen administratif du hameau, un vieux de soixante-dix ans, pour avoir remis sa médaille au moment où les Blancs étaient là (j’appris à cette occasion que les doyens administratifs, avant la Révolution, possédaient une médaille qu’ils portaient comme signe distinctif de leur fonction). Il y avait encore deux paysans de Snagost, eux aussi coupable d’avoir exprimé de la sympathie pour les Blancs. Tout ce groupe avait été arrêté à Snagost par les Koubanais rouges. À la dernière minute, on amena encore une femme d’une soixantaine d’années, de Rylsk. C’était une petite-bourgeoise, propriétaire de sa maison, très peu éduquée, que l’on accusait d’avoir offert un bouquet de fleurs aux Blancs.
La nuit tombait quand nous nous mîmes en route. Dans le chaos de l’évacuation, notre administration n’avait pas réussi à se procurer de chariots, elle n’en avait que deux, sur lesquelles nous chargeâmes nos affaires. Nos dix gardiens allaient à pied, comme nous, et en étaient fort mécontents. Un jeune officier rouge, habillé de noir, vint s’ajouter au groupe des prisonniers. Comme les bolchéviques avaient réussi à la découvrir, c’était un ancien officier de l’armée impériale. Sa femme et sa belle-mère l’attendaient à la lisière de la ville et lui remirent des baluchons contenant de la nourriture et des vêtements pour la route. Les gardiens n’intervinrent pas. Ils le traitaient différemment de nous. Peut-être était-ce dû au fait qu’il était natif de Rylsk, comme beaucoup d’entre eux. En tout cas, il bénéficiait d’un régime de faveur. Avec lui, nous étions dix-huit à quitter Rylsk. Surtout des paysans, habitants de Rylsk et des villages situés à l’intérieur de la zone de front. Les Koubanais avaient bien travaillé !
Nous avancions à marche forcée, constamment houspillés par notre escorte. Vers dix heures du soir, nous entendîmes derrière nous, en provenance du sud-ouest, un bruit éloigné de tirs d’artillerie. Le ciel s’enflamma des lueurs d’un incendie. D’après les commentaires des gardiens, c’étaient des entrepôts bolcheviques qui brûlaient. Au matin, nous entrâmes dans un village. Nous nous installâmes en plein air pour nous reposer. Il faisait froid, nous somnolions. Les gardiens réussirent à se procurer des chariots et nous n’eûmes plus à marcher à pied. En général notre avancée se faisait de la façon suivante. notre « commandement » ouvrait la marche sur des chariots à part, c’était l’ « État-major » du Point de contrôle militaire, composé de cinq ou six personnes. Nous les voyions peu. Puis les prisonniers, deux par chariot, chacun conduit par un paysan, avec un gardien armé à l’arrière.
Apparemment, il était impossible de nous évacuer par le chemin de fer vers le sud par Korenevo et Lgov, la voie étant barrée par les Blancs. La nuit, nous nous arrêtions dans des villages où on essayait de nous trouver un local vide et facile à garder. Je me souviens de notre halte pour la nuit au village de Bereza, à mi-chemin. Il y avait là un grand domaine. On voyait de beaux bâtiments. On nous enferma pour la nuit dans un grand hangar. Conversation de notre gardien, le marin « Terreur rouge », avec le jeune paysan qui nous ouvre le hangar. « C’est à qui ce domaine ? » — « Aux Voljyne (45) » — « Et alors, vous les avez tués ? » — « Non », répond le paysan. « Eh bien, vous avez eu tort », dit le marin, d’un ton haineux, « il faut tous les tuer. Et tous leurs enfants avec. Sinon, quand ils seront grands, ils voudront récupérer leurs biens. Pourquoi ne les avez-vous pas tués ? » — « Mais ils sont partis, se sont cachés. » Sur ces entrefaites, on nous enferma dans le hangar, à l’aide d’un cadenas bien solide.
Le jour, nous nous déplacions en chariot, comme je l’ai dit. Grâce à Dieu, le temps restait clair, ensoleillé, les journées étaient même chaudes, mais les nuits avaient fraîchi. Soudain, deux cavaliers apparurent aux côtés de notre convoi, qui semblaient être des officiers rouges, ou des tchékistes. Ils n’avaient aucun maintien et ressemblaient à des voyous. Ils s’amusaient à se déguiser en Blancs. L’un d’eux se mit des epaulettes (46), l’autre déploya un drapeau jaune ukrainien et le porta ainsi, flottant, un bon bout de chemin à côté de nous. L’un d’eux s’adressa à moi sur un ton de moquerie. « Lieutenant, comment ces misérables vous ont-ils attrapé ? » Je ne répondis pas tout de suite, puis je dis. « J’ai été interpellé par des soldats de l’Armée rouge. » Le cavalier poursuivit ses bouffonneries. « Ah, les scélérats ! Comment ont-ils osé ? Il faut les fusiller ! » Notre gardien finit par se fatiguer de ces plaisanteries et chassa les voyous. « Allez-vous-en ! Déguerpissez ! Assez de bêtises ! » Les cavaliers disparurent. Pourquoi s’étaient-ils adressés à moi en particulier, pourquoi m’avaient-ils appelé « lieutenant » ? Apparemment, ils m’avaient distingué des autres. Un autre jour, alors que j’étais dans la charrette, on me donna un léger coup dans le dos. Je me retournai et aperçus un de nos marins-convoyeurs (mais pas « Terreur rouge », sur la casquette de celui-ci était brodée l’inscription « Flotte de la mer noire »). Sans un mot, il me tendit une miche de pain blanc. Cela tombait on ne peut mieux, car cela faisait deux jours qu’on ne nous avait rien donné à manger (ce qui n’était pas le cas de notre escorte).
Les soldats de notre escorte nous racontaient les « exploits » de l’Armée rouge (dont j’allais par la suite entendre de nombreuses variantes). « Il y a quelques jours, les nôtres ont décidé de vérifier qui est pour les Rouges, et qui est pour les Blancs. Ils ont mis des épaulettes, des cocardes. Ils ont composé un détachement, et se sont présentés dans cette tenue à Poutivl. Ils déclaraient. « Nous sommes Blancs, nous venons vous libérer. » Les habitants ont commencé par être sceptiques, puis les ont crus. Ils se sont mis à sortir de leurs maisons, et leur ont souhaité la bienvenue, les remerciaient, leur offraient des fleurs. Alors, les nôtres leur proposent de s’enrôler dans l’Armée des Volontaires. Cent cinquante personnes s’inscrivent. Arrive le pope, et le voilà qui célèbre un Te Deum sur la place. Il y a foule. Au beau milieu du Te Deum, les nôtres, sur un signe, ouvrent le feu. Les victimes sont très nombreuses. Toutes les nouvelles recrues sont fusillées. » Ce récit soulevait immanquablement l’enthousiasme et l’approbation des Rouges qui considéraient ce stratagème comme un modèle de l’art de la guerre, cela les faisait rire aux éclats. Mais je me demande aujourd’hui si tout cela s’était réellement passé, ou si cela relevait du simple folklore de l’Armée rouge. Je suppose que c’est une histoire vraie, mais fortement embellie dans ses details (47).
La majorité de mes codétenus, je l’ai dit, étaient des paysans. J’étais impressionné par leur foi, leur religiosité profondément ancrée. Dès qu’ils le pouvaient, ils priaient, se signaient, se prosternaient. Ils ne juraient pas, ils parlaient de Dieu. Bien sûr, « il faut que le tonnerre gronde pour que le paysan se signe (48) », mais il est tout de même indéniable que le paysan russe de cette époque était profondément croyant et religieux.
Après trois de jours de voyage, ayant parcouru une distance d’environ cent verstes à pied ou en chariot, nous atteignîmes la ville de Dmitriev, point de départ de mon épopée en zone de front. Le 9 septembre en fin d’après-midi, on nous amena jusqu’à la gare et on nous fit monter dans des wagons de marchandises. Cette fois-ci, la répartition était la suivante. la « hiérarchie » s’installa confortablement dans le premier wagon. Ils dormaient dans des draps et des couvertures (et probablement sur des matelas). Le deuxième wagon était celui de nos gardiens. Le troisième était occupé par nous, les détenus, en tout dix-huit personnes. Il y avait en permanence dans notre wagon un gardien armé (les gardiens, bien entendu, changeaient à tour de rôle). Pour la nuit, on bloquait de l’extérieur la porte de notre wagon à l’aide d’une barre de fer.
Bien qu’on nous ait éloignés de la ligne de front, le front lui-même s’était considérablement rapproché de nous. Cette impression nous fut immédiatement confirmée par les récits de nos gardiens. Lgov venait de tomber. Bien plus, ils venaient d’apprendre que les Blancs avaient pris Koursk (49). « Et ce qui est encore pire, dit un jeune gardien un peu nigaud, c’est qu’ils ont capturé tous les travailleurs de la Tcheka de Koursk. Tous. » — « Mais qu’est-ce qu’ils vont devenir ? », demanda l’un des paysans avec naïveté, ou peut-être avec malice. — « Comment ça, qu’est-ce qu’ils vont devenir ? s’exclama le gardien, pourquoi tu poses cette question ? Tu ne vas pas me dire que tu ne le sais pas ? » Les paysans chuchotaient entre eux. « Et si les Blancs finissaient par l’emporter ? » Un convoi de soldats rouges entra en gare en provenance du nord, de Briansk. On les envoyait au front. Ils étaient bruyants, ils chantaient, n’étaient pas démoralisés. Nos gardiens entrèrent en conversation avec eux (leur train était juste en face du nôtre). « D’où venez-vous ? » — « Du front de Sibérie. On vient d’écraser Koltchak, et maintenant on arrive pour achever Denikine. Et vous, qui êtes-vous ? » — « On escorte des détenus. » — « Des Blancs ? Pourquoi les escorter ? Autant les tuer tout de suite ! » Tard le soir, notre train se mit en route vers le nord, en direction de Briansk, qu’il nous fallut deux jours pour atteindre.
Ce délai me permit de faire connaissance aussi bien de mes « compagnons de détention » dans mon wagon, que de nos gardiens et même — dans une moindre mesure, il est vrai — de la « hiérarchie ». Je vais donc maintenant essayer d’en faire une description. La « hiérarchie » se tenait à l’écart, et nous les voyions rarement de près. Ils étaient cinq ou six, mais je ne saurais dire quelles étaient leurs fonctions exactes. À leur tête, deux hommes très bruns, de type méridional, plutôt des caucasiens que des juifs, me sembla-t-il, pour l’un d’entre eux tout au moins. Dans leur groupe, je me souviens d’un Arménien d’une cinquantaine d’années qui était très bavard et que cette caractéristique distinguait des autres. Pendant les arrêts du train, il venait souvent bavarder longuement avec les gardiens de notre wagon. Il était respecté de ces derniers, qui nous apprirent que c’était un vieux révolutionnaire et un érudit. Il évitait de nous parler.
Nos gardiens étaient une dizaine. Ils étaient sous les ordres d’un gardien-chef qui ressemblait à un sous-officier ou adjudant-chef de l’armée impériale qui se serait rallié aux bolcheviks. Il était d’une raideur militaire, ses gestes étaient retenus, son visage indiquait une certaine rigidité. Parmi les autres, on remarquait surtout les deux marins mentionnés plus hauts. Le premier, « Flotte de la mer Noire », silencieux et plutôt bon, m’avait donné une miche de pain. Le second, « Terreur rouge », était le type même du communiste fanatique, du pervers cruel. Il n’était pas agité comme le commandant de Rylsk, bien au contraire, il était très calme, son uniforme de marin était impeccable. « Ça fait longtemps que je n’ai pas eu affaire à un officier », disait-il à un autre gardien, alors qu’ils étaient en faction à la porte de notre wagon lors d’un arrêt du train, « s’il m’en tombait un sous la main, je lui montrerais de quel bois je me chauffe. » L’un des paysans, en un mélange typique de naïveté et de malice, posa une question au marin. « Qu’est-ce que c’est cette l’inscription brodée sur ta casquette ? Le nom d’un bateau ? » — « Non, c’est un programme », répond l’autre d’une voix condescendante. Les gardiens restants étaient tous de jeunes soldats rouges, des paysans illettrés, qui n’étaient probablement pas mauvais bougres, mais que leur travail dans des « points de contrôle militaire » et autres institutions de ce type avait pervertis. Certains se conduisaient de manière dissolue, abrutis par la propagande soviétique, ou peut-être étaient-ils niais de nature. Leurs visages étaient en quelque sorte marqués du « sceau de Caïn ». On ne pouvait pas confondre ces visages avec ceux, simples, russes, des soldats appelés dans l’Armée rouge qu’il m’avait été donné de rencontrer. L’un des gardiens jurait particulièrement souvent et grossièrement. Voulant le raisonner, l’un des paysans lui dit. « Tu sais, c’est pour que les gens cessent de jurer qu’on a fait la Révolution. » — « C’est pas vrai, s’indigne le gardien, si c’était vrai, on se ferait fusiller pour avoir juré, alors que là, on n’est pas fusillé. » À un autre jeune gardien qui déjeunait une fois sous nos yeux, avec sa gamelle (nous, on ne nous donnait rien à manger), les paysans dirent sur un ton de reproche. « Pourquoi tu ne fais pas ton signe de croix avant de manger ? » Il grommela quelque chose d’inintelligible, mais le jour suivant, bien que gêné et mal à l’aise, il fit de lui-même son signe de croix, à la satisfaction de tous les paysans.
Parmi les détenus, je commencerai bien entendu par parler du prêtre, le père Paul. Je l’ai déjà mentionné. C’était un homme gentil, tranquille, discret et humble. Un homme persécuté. il devait endurer quolibets et moqueries, on l’appelait « le chevelu (50) ». Nous eûmes quelques conversations amicales, lui et moi, mais par précaution nous n’abordions aucun thème brûlant, je ne lui avouai pas mes plans « blancs », il ne me dit rien de son fils. Et je ne lui posai aucune question. Les autres détenus étaient des paysans, je l’ai déjà dit. Ils se prosternaient dans le wagon, se signaient, disaient des prières. Au début, les gardiens se moquaient d’eux, puis cela sembla avoir un effet sur eux. Ils se mirent à jurer moins. Parmi les paysans, il y en avait un qui était un peu particulier. D’âge moyen, barbe châtain, les cheveux coupés au bol, les yeux bleu transparent. Il parlait sans discontinuer de la Bible, il en possédait une chez lui qu’il avait coutume de lire souvent. « C’est dommage que vous ne l’ayez pas prise avec vous », lui dis-je. — « Je voulais, mais je n’ai pas osé. J’avais peur qu’ils me la prennent, qu’ils la profanent, qu’ils blasphèment. » Je me demandai si cet expert de la Bible n’était pas membre d’une secte. Une autre fois il me dit. « Je n’ai pas tellement peur de ce qu’ils peuvent me faire, ils peuvent me fusiller ou me faire mourir en prison, peu m’importe. Mais cela m’ennuie pour mes enfants, ils seront marqués à vie du sceau de l’infamie. Tout le monde dira que leur père était contre-révolutionnaire. »
Deux des détenus se tenaient ensemble à l’écart, apparemment ils se connaissaient déjà auparavant. Le premier, un paysan ukrainien de dix-huit ans, était fils de koulak. Il avait essayé de se cacher dans un champ de chanvre, mais les bolcheviks l’avaient retrouvé. Il parlait peu, mais ne faisait pas mystère de son antipathie pour tout ce qui était soviétique. Les gardiens lui rendaient la pareille. Ils l’appelaient le « nocif ». Le second venait de Soumy, devait avoir trente-cinq ans, il portait une fine moustache, des vêtements de citadin, il ressemblait en tout point à un commis de l’ancien régime. Il était très bavard. Il se trouvait à Soumy lorsque les Blancs avaient pris la ville, mais s’était ensuite rendu, je ne sais pourquoi, dans une région tenue par les Rouges. C’est là qu’on l’avait arrêté, le considérant comme un agent des Blancs. Il répondait volontiers aux questions, et racontait sa vie à Soumy sous l’occupation blanche, sur un ton, il faut l’avouer, qui leur était favorable. « Et les ouvriers, ils ne sont pas humiliés chez les Blancs ? », demanda quelqu’un, un des gardiens probablement. — « Humiliés ? En quoi ? Ils se promènent au parc, avec les officiers. » On lui demanda si les officiers se font appeler « Votre Noblesse (51) ». Il répondit par la négative. Commença alors une discussion, quelqu’un soutint qu’il n’y avait que chez les Rouges qu’on ne disait plus. « Votre Noblesse », alors que chez les Blancs on le disait toujours. — « Non, c’est faux, il n’y a plus aucun « Votre Noblesse » nulle part », répondit le « commis », « les loups l’ont mangé. » N’y tenant plus, le garde intervint. « Qu’est-ce que tu as à dire du bien des Blancs ? Tu as l’air de beaucoup les aimer. » Cela fit immédiatement taire le « commis ».
Parmi les détenus, il y avait aussi un soldat rouge letton. Cocaïnomane, vagabond, il avait traîné ses guêtres absolument partout, même chez les Blancs. C’était un homme en pleine déchéance et un peu fou. Son russe était assez bon, il le parlait avec beaucoup d’assurance. Il portait une capote de soldat. Il avait été arrêté comme déserteur. On voulait sans doute aussi faire une enquête sur ce personnage.
L’officier arrêté à Rylsk restait un mystère pour moi. Nos gardiens semblaient le tenir en haute estime. Il était constamment en conversation avec eux, il s’adaptait parfaitement à leur façon d’être. Les soldats étaient flattés de voir un officier, ancien lieutenant de l’armée impériale qui plus est, bavarder avec eux d’égal à égal. Il leur racontait son service dans l’Armée rouge. « C’est un bolchevik, me dis-je, il est avec eux. Mais pourquoi l’a-t-on arrêté ? » L’avenir allait donner une réponse partielle à mon étonnement (52).
Je me souviens aussi d’un jeune homme qui avait dû nous rejoindre en route. Il avait l’air éduqué, un physique de « poète », probablement un étudiant. Je ne sais pas ce qu’on lui reprochait. Il vivait sa détention dans un état second, semblait accablé, angoissé à l’idée d’être fusillé. Cela lui provoquait des crises d’épilepsie plusieurs fois par jour. Il était pris de convulsions et perdait connaissance. Et plus le temps passait, plus les crises se faisaient fréquentes. Ces crises nous pesaient, à nous aussi bien qu’aux gardiens. Je ressentais un sentiment d’impuissance assez avilissant et étais indigné que l’on puisse traiter un malade de cette façon. « Voilà le vrai visage du bolchevisme », pensais-je tout bas. On ne lui dispensait aucun soin médical. Mais les gardiens se mirent à exprimer leur mécontentement, et quelques jours plus tard, alors que le malade traversait à nouveau une de ses crises, un des hommes de la « hiérarchie » vint y « jeter un coup d’œil ». À la suite de cela, on le fit descendre du train dans une petite gare avant même d’arriver à Briansk, pour l’emmener à l’hôpital, nous dit-on.
Enfin, le dernier spécimen dont je me souvienne parmi mes codétenus du Point de contrôle militaire. la propriétaire petite-bourgeoise de Rylsk. C’était un être malheureux, pitoyable, à bout de nerfs, et en même temps insupportable, voire répugnant. Elle racontait inlassablement qu’on l’avait arrêtée suite à la dénonciation de sa nièce qui l’avait calomniée auprès des Rouges à leur retour à Rylsk, en prétendant qu’elle avait offert un bouquet de fleurs aux Blancs. « Et tout ça pour avoir ma maison. Elle m’avait demandé de me prendre chez elle avec son mari, mais j’ai refusé. Elle s’est vengée. » Et elle se mettait à prier à haute voix. « Seigneur, punis-la, foudroie-la ! Qu’elle devienne aveugle ! Qu’elle crève ! » Sur ces paroles, elle faisait des signes de croix, elle se prosternait. Les paysans lui disaient. « On ne peut pas prier comme ça, contre autrui. C’est un péché ! » Les gardiens, eux, riaient d’elle. C’était une femme d’une soixantaine d’années, que la vie n’avait pas accoutumée aux privations, et elle supportait mal les contraintes de la détention, les longues marches à pied, le bivouac à même le sol. Mais plus que tout, elle était tourmentée par l’idée qu’on allait la fusiller. Elle avait peur de la mort. Les gardiens la traitaient avec cruauté. Ils lui jouaient des tours, se moquaient d’elle, lui faisaient peur. Sur la fin du voyage, elle se mit très nettement à perdre la raison.
Nous étions entre Dmitriev et Briansk. Notre train marquait de longs arrêts dans les gares. Sentiment triste de nous éloigner de plus en plus du front. Nous avions faim. Au fur et à mesure de notre progression vers Briansk, le temps changeait. Il faisait froid, sombre, il pleuvait. C’était vraiment l’automne. De jour en jour, il devenait de plus en plus évident que j’étais mal vu de la « hiérarchie ». On me traitait différemment des autres. Il est vrai qu’il m’arrivait de commettre des imprudences. Un jour par exemple, j’entendis un de nos gardiens, un « nigaud », lors d’une conversation avec l’officier, raconter des arrestations. L’officier aussi raconta comment il avait fait la chasse aux espions sur le front de Gomel. « Et alors, vous les avez tous fusillés ? », dis-je. Le nigaud explosa. « Je vois bien que tu es le plus nocif de tous. Tu n’as que le mot « fusiller » à la bouche. On voit que tu as commis quelque chose, et maintenant tu as peur. » Je me tus, et ne me mêlai plus à la conversation. Il ne fallait pas narguer les fauves, c’était suffisamment pénible comme ça.
Un incident beaucoup plus sérieux se produisit dans une gare sur la route de Briansk. Il s’agissait d’aller chercher deux seaux d’eau pour notre wagon. Le gardien demanda des volontaires. Un paysan se proposa, moi aussi. Nous prîmes chacun un seau. Le robinet se trouvait à quelques sagènes de nous, derrière les wagons. Mon unique intention était de me détendre les jambes, mais comme je longeais le wagon de la « hiérarchie » un des gradés en jaillit littéralement, me saisit par l’épaule et m’ordonna d’un ton sec. « Au wagon ! » Puis, s’adressant au gardien. « Je vous avais pourtant donné l’ordre de ne pas laisser sortir celui-là ! Il doit être spécialement surveillé. » Je retournai à mon wagon, un paysan me remplaça. La nuit, le Letton cocaïnomane vint s’asseoir à coté de moi et me chuchota à l’oreille. « Aujourd’hui, le gardien-chef nous a dit qu’il ne fallait pas qu’on s’en fasse trop, que parmi nous il y n’y aurait que deux ou trois fusillés. Il a dit que le premier sur la liste, c’était vous, car vous aviez été pris en possession d’une carte, et étiez manifestement un espion. Vous risquez d’être fusillé. Je sais que vous êtes un officier. Évadons-nous cette nuit, ensemble. On casse la porte, et on s’enfuit. » — « Mais comment casser la porte ? Et que ferons-nous sans papiers ? Si l’on nous arrête, on nous fusillera sur place », répondis-je dans un souffle. — « Je sais comment casser la porte, il n’en restera que de la sciure. Quant aux papiers, ne vous en faites pas, j’en trouverai de nouveaux. Ce ne sera pas la première fois. » Je réfléchis. Dans une situation comme la mienne, la perspective d’une évasion était séduisante. Mais le plan d’une telle évasion était trop risqué, d’ailleurs, ma situation ne me semblait pas sans espoir. Il me semblait que je réussirais à me justifier ; alors pourquoi m’exposer à de tels risques ? Et puis ce Letton était tout de même vraiment un personnage douteux. C’était peut-être un provocateur, un dénonciateur et, en tout cas, il était manifestement dérangé. Je répondis donc. « Je ne suis pas officier, d’où tenez-vous cela ? Je suis étudiant. Mes papiers sont en règle, je serai innocenté, et on me relâchera. Je n’ai pas de raisons de m’évader. » — « Eh bien, c’est vous qui voyez, dit le Letton, mais n’en parlez à personne. » — « N’ayez pas peur, je ne dirai rien. » Le Letton s’écarta. Jusqu’à présent, je me demande qui il était. Il voulait probablement s’évader lui-même, et avait besoin de moi pour l’introduire auprès des Blancs.
Le lendemain matin, autre incident pénible. lors d’un arrêt en gare, la « propriétaire » de Rylsk demanda à sortir du wagon pour satisfaire un besoin naturel. On l’emmena à l’écart, sur les voies. Un gardien armé (un des « nigauds ») l’accompagna, comme cela se faisait toujours en pareil cas. Il resta à une certaine distance. Soudain, la « propriétaire » partit en courant. C’était de la pure folie, il n’y avait nulle part où se cacher. En un instant, le gardien la rattrapa, la frappa à coup de crosse, et l’entraîna vers le wagon. Elle était en pleine crise de nerfs. Un des chefs, un Caucasien, sortit de son wagon, se mit à crier au gardien. « Qu’est-ce qui t’a pris de ne pas lui tirer dessus ? » On agonit la « propriétaire » d’injures. On l’emmena. Les soldats discutaient entre eux. « Bon, c’est fini ! Une tentative d’évasion, c’est une balle dans la tête. » Pourtant, une demi-heure plus tard, on la ramena dans notre wagon. Ils avaient dû se dire que ce n’était pas la peine de fusiller une vieille folle. On lui avait probablement donné une correction, et la voilà de retour. « Elle a eu de la chance que ce ne soit pas le marin « Terreur rouge ». Lui, il l’aurait abattue sur place », remarqua notre gardien.
Le 12 septembre au matin, nous arrivâmes enfin à Briansk. Dix jours étaient déjà passés depuis mon arrestation à Snagost par les Koubanais, et personne ne m’avait encore interrogé, l’enquête n’avait pas commencé. À Briansk, on nous sépara. Ceux — la majorité d’entre nous, soit treize personnes — dont le cas avait été étudié par le Point de contrôle militaire furent remis au tribunal militaire et révolutionnaire. Les cinq restants, à savoir les trois paysans de Snagost, avec à leur tête Dioubine, le père Paul et moi, fûmes remis à la Section spéciale auprès de l’État-major de la 14e armée soviétique.
On nous fit entrer dans un grand bâtiment de briques de quatre étages, les locaux de la Section spéciale. C’était un ancien lycée de filles. À l’accueil, au rez-de-chaussée, nous fûmes inscrits dans un gros registre par un homme corpulent en uniforme militaire, qui avait aussi le type du sous-officier tsariste qu’il m’avait déjà souvent été donné d’observer parmi les Rouges. J’entendis que, lors de l’inscription au registre, outre les questions habituelles (nom, profession, etc.), on demandait notre appartenance de classe, ce qui semblait contradictoire, puisque les bolcheviks avaient aboli les classes. En attendant mon tour, je me demandai ce qu’il fallait répondre. la vérité, c’est-à-dire « aristocrate » ? C’était dangereux. « Paysan » ? J’avais peur qu’on ne me croie pas. Je dirais quelque chose entre les deux, « petit-bourgeois », par exemple. Mais le gardien, m’ayant dévisagé avec ironie — me sembla-t-il —, me demanda directement. « Paysan ? » — « Oui », répondis-je, puisqu’il le suggérait lui-même. Il poursuivit en me demandant de quelle province, région, district, village je venais. J’inventai une réponse sans la moindre difficulté. Je nommai un village qui se trouvait près de Vesyegonsk, l’endroit où j’avais travaillé.
Puis, on nous fit monter à l’étage, dans une gigantesque salle rectangulaire, dont l’un des murs était percé de fenêtres qui donnaient sur la ville. On nous laissa là avec d’autres détenus. Dès qu’ils remarquèrent parmi nous la présence du père Paul, ils se mirent à crier. « Un pope ! Un pope ! Regardez. un chevelu ! » Quelques détenus entonnèrent une chanson irrévérencieuse. « Le pope avait un chien, il l’aimait bien. Un morceau de viande il avala, le pope le tua. En terre, il le mit, et sur la tombe inscrivit. le pope avait un chien, etc. » Ils répétèrent cette chanson en boucle jusqu’à s’en lasser. Le père Paul ne prêtait pas attention à ces moqueries. Les chanteurs ne formaient, il faut le dire, qu’un tout petit groupe. Les autres détenus ne disaient rien. Les gardiens non plus ne réagirent pas.
Le nombre des détenus dans cette pièce oscillait entre quarante-cinq et cinquante. Certains étaient emmenés, ils étaient remplacés par d’autres. Dans la pièce, à part deux pupitres sur lesquels s’étaient installés deux « privilégiés » (ou plutôt des débrouillards), il n’y avait aucun meuble, et nous nous asseyions et dormions sur le sol poussiéreux. Grâce à Dieu, nous n’étions pas trop serrés. Vers midi, on nous distribua à chacun un bout de pain noir, puis on nous apporta un repas chaud qui, selon les normes de l’époque, était tout à fait décent. une soupe de semoule avec des petits cubes de viande. Le soir, on ne nous donna rien, car nous étions arrivés trop tard dans la matinée. En payant (on nous avait confisqué notre argent, mais nous pouvions le dépenser pour des achats), on pouvait commander, par l’intermédiaire d’un gardien, du pain et d’autres denrées au marché, mais seulement à partir du lendemain.
À Briansk, la Section spéciale fonctionnait de pair avec la Tcheka et le tribunal militaire révolutionnaire. Cette institution était bien plus importante hiérarchiquement que le Point de contrôle militaire, même si les champs de leurs compétences respectives étaient similaires, puisqu’il s’agissait dans les deux cas de lutte contre l’espionnage et autres crimes du même acabit à l’arrière du front rouge. En réalité, à la Section spéciale, il y avait une plus grande diversité chez les détenus, parmi lesquels on comptait très peu de véritables contre-révolutionnaires ou espions mais un assez grand nombre de bolcheviks de gros calibre (bien plus qu’au point de contrôle militaire). Mais je reparlerai de cela plus tard.
Le lendemain de mon arrivée, vers onze heures du matin, on vint me chercher pour un interrogatoire. Un gardien me fit passer par de nombreux couloirs et escaliers pour me faire entrer dans une grande pièce où deux hommes étaient assis à deux tables différentes dans deux coins opposés. L’un d’eux était le juge d’instruction. C’était un homme de trente-cinq ans environ, brun, le visage creux, portant une tunique noire. Je pense qu’il était russe. À ses premiers mots, je compris qu’il n’était pas très éduqué, en fait d’études je pense qu’il avait dû aller jusqu’en fin d’école municipale. L’autre homme, plus jeune et qui avait l’air plus cultivé, semblait plongé dans son travail, ce qui — comme cela s’avèrerait plus tard — ne l’empêchait nullement d’écouter mon interrogatoire avec la plus grande attention. Le juge d’instruction m’indiqua une chaise en face de lui et commença à m’interroger.
Je dois ici préciser que je m’étais beaucoup préparé à cet interrogatoire, cherchant à deviner à l’avance les questions que l’on allait me poser et réfléchissant à mes réponses. Je me souvenais des interrogatoires de Raskolnikov par le juge d’instruction Porphyre Pétrovitch dans Crime et Châtiment. Comme un joueur d’échec, j’avais cherché à anticiper le jeu de l’adversaire et à élaborer des réponses utiles et convaincantes. Surtout qu’il y avait dans mon dossier bien des points faibles ou délicats. Par exemple, le laissez-passer que m’avait donné à Lgov le « camarade Kahn » portait la date du 10 septembre, alors que j’avais été arrêté à Snagost, près de Korenevo, le 15 septembre. On allait me demander ce que j’avais fait pendant ces cinq jours. Il était hors de question d’expliquer que j’étais retourné de Korenevo à Dmitriev (plus de cent verstes aller-retour) ; c’était insensé et injustifiable de la part de quelqu’un en mission. Et je ne pouvais pas non plus cacher ces déplacements. que se passerait-il si le juge, m’ayant laissé débiter mes explications et l’histoire du « sel », vérifiait la date de mon laissez-passer, et, comme Porphyre Petrovitch sur Raskolnikov, me tombait dessus en demandant. « Mais qu’avez vous fait pendant ces cinq jours ? Pourquoi m’avez-vous caché vos déplacements ? » Ne valait-il mieux pas tout avouer spontanément ? Cependant, cela risquait de compliquer inutilement mon dossier. Pour un juge voulant m’accuser d’espionnage, la direction que j’avais prise et mes déplacements n’étaient pas une énigme ; je me dirigeais vers le front. À cela, je n’avais qu’une réponse à donner. le sel. Mais ce n’était guère convaincant.
Je cherchai en vain à élaborer une tactique pour contourner ces questions délicates. Mais quand mon véritable interrogatoire commença enfin, je me rendis compte que mon enquêteur était bien loin de Porphyre Petrovitch ! Globalement, la première partie de mon interrogatoire consista à me faire raconter en détail les étapes de mon voyage, à nommer les endroits que j’avais traversés et ce que j’y avais fait. Le juge essayait parfois de me troubler ou de me prendre en contradiction, mais de façon assez primitive. Ainsi, alors que j’expliquais que j’étais passé par Vologda et que j’y avais obtenu de l’État-major de la 6e armée l’autorisation de me rendre à Moscou, le juge dit. « La 6e armée ne se trouve absolument pas sur le front septentrional. » J’allais le contredire, quand l’homme qui était assis à l’autre table se mêla à la conversation. « Non, il a raison, l’État-major de la 6e armée se trouve bien à Vologda. » Le juge se vit contraint d’admettre son ignorance. Plus tard, il essaya de me confondre à propos des menuisiers. « Racontez-moi comment vous vous y seriez pris pour embaucher des menuisiers ? Par quoi auriez-vous commencé ? » Cette question me mettait dans une situation difficile, car je n’avais pas la moindre idée de la façon dont on embauche un menuisier. « Eh bien, je me serais rendu au Soviet local, répondis-je néanmoins avec assurance, et je leurs aurais demandé les noms des menuisiers disponibles. Et puis, j’aurais été aidé par mon camarade de mission, il est plus au fait des aspects techniques de la chose. » À ma grande chance, le juge n’avait pas plus que moi idée de la marche à suivre pour embaucher des menuisiers, il n’était donc pas en mesure de pousser plus avant son interrogatoire.
Nous en étions arrivés au moment le plus délicat de mon récit. D’une voix sourde, sans préciser les dates, je dis. « De Lgov, je suis allé à Korenevo… » Je m’attendais à ce que le juge voie la date inscrite sur mon laissez-passer et demande. « Qu’avez-vous fait pendant ces cinq jours ? » « Où avez-vous été ? », mais, grâce à Dieu, cela ne lui vint même pas à l’esprit, et je me gardai bien de mentionner mon aller-retour Dmitriev-Lgov-Korenevo, puis le hameau de Selino et Snagost. Il me fallut tout de même bien mentionner l’expédition pour le sel mais, bien que la fameuse carte se trouvât sur sa table, le juge était incapable de déterminer la distance entre Selino et Korenevo. Pour cette raison, le récit de mes détours lui sembla insignifiant.
Ma carte fut l’objet de quelques questions (pour des gens incultes, la simple possession d’une carte était un sérieux chef d’accusation qui pouvait avoir de sérieuses conséquences, positives ou négatives). J’insistai sur le fait que la carte était d’édition soviétique, rédigée selon la nouvelle orthographe, que je l’avais achetée à Dmitriev, et que si j’avais eu la moindre arrière-pensée (« hostile », « d’espionnage »), je me serais procuré une autre carte à l’avance. Était-ce convaincant ? Cela semblait plutôt naïf, mais le juge fut satisfait de mes réponses.
Il tomba ensuite sur une note de mon camarade de mission demandant à un paysan d’un hameau près de Korenevo de m’aider. Il resta un moment à déchiffrer ces pattes de mouches puis. « C’est vraiment écrit par quelqu’un de peu éduqué ! » Cette circonstance sembla apaiser ses soupçons. Il ne prit même pas la peine de me demander où se trouvait ce hameau en question.
Puis il passa à la deuxième partie de l’interrogatoire, à propos de mes origines sociales. J’avais préparé mes réponses. « Profession du père avant la Révolution ? » — « Il travaillait à la manufacture Morozov d’Orekhovo-Zouïevo », dis-je, ce qui n’était qu’un mensonge partiel, puisque mon père avait effectivement été l’un des directeurs de cette manufacture après la Révolution. — « Il travaillait ? Il la dirigeait, voulez-vous dire ? », demanda l’enquêteur d’un ton moqueur (c’était incroyable qu’il ait vu aussi juste) — « Non, il était comptable. » — « Et maintenant ? » — « Il est décédé », répondis-je. C’était faux, mais il me sembla plus raisonnable de mentir pour éviter des questions complémentaires. « Et vous, que faisiez-vous ? » — « J’étais étudiant à l’université. » Le juge s’était radouci, et, l’air narquois, me dit. « Bon, l’affaire me semble claire. on vous envoie en mission, vous laissez votre compagnon faire tout le travail, et vous, vous partez chercher du sel ! » — « Ce n’est pas tout à fait vrai », répondis-je, sans chercher toutefois à trop le contredire. L’interrogatoire était fini, et le juge se mit à en rédiger le procès-verbal. Il y passa un certain temps, se relut, puis me le donna à lire. Il était rédigé d’une façon beaucoup plus correcte que celui de la milice de Snagost mais comportait tout de même des fautes de grammaire. Ce texte reprenait en gros ce que j’avais déclaré, de manière brève et elliptique. Il n’y était fait mention ni du sel ni de la question à propos de mes origines sociales. Au contraire, tout paraissait en ma faveur et la vérité semblait de mon côté. « Vous acceptez de le signer ? », me demanda l’enquêteur. — « Oui », dis-je, et je le signai sans hésitations. « Mais de quoi suis-je accusé ? », demandai-je toutefois. Le juge émit encore un petit rire et me répondit d’un air entendu. « D’avoir l’air suspect. » — « Et maintenant ? Qu’allez-vous faire de moi ? » — « C’est la commission d’instruction qui va en décider. » Il se leva, appela le soldat qui me ramena par les longs corridors dans la salle des détenus. J’étais plein de sentiments contradictoires. Cela aurait pu être bien pire, pensai-je, on ne m’accuse de rien de précis. Mais il est impossible qu’ils accordent ainsi foi à mes paroles. C’est certainement un stratagème de leur part. Un Porphyre Petrovitch soviétique va certainement faire son apparition et dire. « Et ceci ? Et cela ? Pourquoi nous l’avez-vous caché ? »
Deux ou trois journées de détention passèrent ainsi, pleines de pensées pénibles et de sentiments d’inquiétude. J’eus aussi l’occasion de faire la connaissance de mes codétenus. C’est étonnant mais, pour la majorité d’entre eux, ils étaient eux-mêmes bolcheviks. C’était une curieuse collection de spécimens humains.
Le plus remarquable d’entre eux était probablement le camarade Azartchenko. Quarante-cinq ans environ, petit, roux, la poitrine et les bras couverts de tatouages. Sous le tsar, il avait connu le bagne de Sakhaline, après la Révolution, pendant la guerre civile, il avait été partisan sur le Don contre les Blancs. Il avait été fait prisonnier par ces derniers avec tout un groupe de partisans. Quand les Blancs les fusillèrent, il se laissa tomber sur le sol bien que n’ayant pas été blessé. À côté de lui, il y avait un mort dont le sommet du crâne avait été arraché. Il se couvrit le visage du crâne ensanglanté, et quand les Blancs vinrent achever les blessés, ils le prirent pour mort et ne le touchèrent pas. Ces derniers temps, il dirigeait une section de la Tcheka près de Kiev. « J’étais très bien organisé, racontait-il, j’avais des agents dans les cafés et dans les tavernes, ils liaient conversation avec tous les nouveaux venus, les faisaient boire et repéraient les contre-révolutionnaires. » Quand Kiev avait été prise par les Blancs, il avait décidé de se rendre au bureau central de la Tcheka, pour dénoncer les traîtres, des gens haut placés. Mais ces derniers l’avaient intercepté alors qu’il était en route, et c’est eux qui le gardaient ainsi en détention depuis plus de trois semaines. « On ne me laissera jamais sortir, disait-il, j’en sais trop sur les gens importants, sur leurs affaires. » Il s’installa à l’un des pupitres de notre salle, mais lorsqu’un jeune gars accusé d’être déserteur s’installa à l’autre pupitre, il se mit à hurler. « Tu n’es là que depuis hier, et déjà tu prends la meilleure place ! Tu es un déserteur ! Si j’étais libre, je t’aurais descendu ! Pourquoi est-ce qu’ils te gardent là ? » Je liai conversation avec lui, aussi bien par curiosité que pour passer le temps. « Je repère immédiatement les contre-révolutionnaires », me dit-il. Apparemment, grâce à Dieu, il ne m’avait pas repéré. En tout cas, quand je lui racontai qu’on m’avait envoyé en mission, que tous mes papiers étaient en ordre et que malgré cela, on m’avait arrêté, il dit. « C’est incroyable, ce manque de coordination qui subsiste entre nos différentes administrations. »
Il y avait un autre groupe intéressant parmi les détenus. c’était l’équipe de commandement d’un train blindé, six personnes en tout, dont deux juifs en civil, des commissaires probablement, les autres étant des officiers rouges. Les deux juifs étaient les plus cultivés et d’allure convenable. Le jour de mon arrivée, quand, n’ayant pas été nourri, j’avais vu que l’un des deux juifs s’était fait apporter du marché beaucoup de pain et divers aliments, je m’étais approché de lui et lui avais demandé du pain. Immédiatement, sans dire un mot, il m’avait coupé une grosse tranche de pain noir. Les officiers du train blindé avaient visiblement été des militaires de l’ancienne armée russe. Mais je compris pourquoi ils étaient passés chez les Rouges. C’étaient des gens au comportement de voyous, débauchés et imbibés d’alcool. Ils ne se laissaient pas abattre, surtout deux d’entre eux qui portaient des pantalons bouffants, ils chantaient des chansonnettes de l’époque, comme par exemple. « Vova s’est bien débrouillé », qu’ils accompagnaient de claquettes et d’autres danses de cabaret. Je demandai à l’un d’eux. « Pourquoi vous a-t-on arrêté, vous, des officiers rouges ? » — « Oh, eh bien, en état d’ivresse, nous avons fait des ricochets. » — « C’est-à-dire que vous aviez bu, et c’est pour cela qu’on vous a mis en prison ? » — « Oh non, on ne nous aurait pas arrêté pour si peu. Ce qu’il y a, c’est qu’ayant bu, nous avons fait des ricochets, et ça c’est mauvais. » Mais ils ne me dirent pas en quoi consistaient les « ricochets ». Cela devait être du sérieux. Au début, quand ils apprirent qu’on m’avait arrêté « en possession d’une carte », ils me prirent pour un espion, mais quand je leur racontai comment s’était passé mon interrogatoire, ils me dirent. « Eh bien, tu vas être libéré, mais pas nous. » J’ajouterai que ces deux officiers rouges étaient les instigateurs des moqueries envers le père Paul, c’était eux qui avaient commencé à chanter. « Le pope avait un chien. » Ces moqueries devaient d’ailleurs cesser au bout de quelques jours. était-ce par lassitude, ou avaient-ils eu honte ?
Je me rappelle aussi d’un officier de cavalerie rouge, dont le pantalon était réduit en lambeaux par ses continuels déplacements à cheval. « J’ai fait à cheval toute la retraite, plus de mille verstes, et à peine étions-nous arrivés au repos que je fus arrêté sur dénonciation, je ne sais pas du tout pour quel motif. » Il était difficile de savoir qui il était en réalité.
Parmi ceux que l’on pouvait désigner du terme convenu de « contre-révolutionnaire », je citerai, avant tout, deux ex-sergents de ville de Briansk. L’un d’eux était détenu depuis plus de huit mois, l’autre depuis plus longtemps encore. C’étaient deux hommes profondément malheureux, affamés, terrorisés, exténués par leurs transferts de prison en prison. Ils étaient sales, sentaient mauvais et avaient perdu toute dignité ; ils n’avaient plus apparence humaine. De plus, ils étaient pieds nus et en sous-vêtements déchirés. Ils étaient si sales qu’on les maintenait à l’écart, près du mur et il leur était interdit d’approcher les autres détenus, mais ils essayaient pourtant de le faire, et venaient quémander, mendier des mégots de cigarette ou des croûtons de pain. Ils se plantaient devant un détenu en train de manger et le regardaient sans dire un mot. Parfois on leur donnait quelque chose, parfois on les faisait déguerpir en les frappant. En manière de plaisanterie, on les avait surnommés « Denikine », et « Chkouro (53) », et on se moquait beaucoup d’eux, on les couvrait de quolibets. On les forçait à accomplir les tâches les plus sales. Pour reprendre la terminologie moderne du monde concentrationnaire, on peut dire que c’étaient des « crevards (54) ». On disait d’eux qu’ils avaient été arrêtés parce qu’ils avaient collé des affiches de Denikine, mais j’ai du mal à y croire, ils en semblaient bien incapables. On les avait tout simplement arrêtés en tant qu’anciens sergents de ville. Un matin, l’un d’eux se mit à uriner directement sur le sol de notre salle (on ne laissait personne aller aux toilettes la nuit, et il n’y avait pas de « tinette » dans la salle même). Voyant cela, l’un des officiers du train blindé s’approcha de lui d’un bond et se mit à le gifler. « Je t’ai pourtant interdit de le faire ! », criait-il. Mais l’autre, sans réagir aux coups, continuait à uriner.
Dans notre salle (cellule), il y avait aussi un groupe de cinq ou six personnes, arrêtées à Gloukhov et accusées d’appartenir à une organisation contre-révolutionnaire (55). Il y avait dans ce groupe une institutrice assez jeune, plutôt jolie, habillée convenablement, mais qui avait l’allure d’une déséquilibrée. Elle était très bavarde. « J’étais institutrice à Soumy. Je buvais beaucoup, j’ai commencé à consommer de la cocaïne, j’ai perdu ma place, j’étais dans la misère. Quand les Blancs sont arrivés, je suis allée voir leur commandement, et je leur ai demandé du travail. Un lieutenant m’a dit. « Nous n’avons pas de travail à vous proposer, mais si vous voulez, nous pouvons vous engager comme espionne. » Je n’ai pas réfléchi, j’ai dit oui. On m’a donné des faux papiers, de l’argent et on m’a envoyée à Gloukhov qui est ma ville natale. Ils m’ont aidée à franchir la ligne de front. Je suis arrivée à Gloukhov sans le moindre problème, mais là j’ai pris peur, et de moi-même je suis allée voir la police pour leur dire qu’on m’avait envoyée là pour espionner. Je pensais qu’on enquêterait et qu’on me relâcherait, mais ils m’ont arrêtée et beaucoup frappée, pour que j’avoue les noms de ceux que je devais contacter. J’ai fini par donner des noms de gens que je connaissais à Gloukhov. Et on les a arrêtés eux aussi. » Ceux qui avaient ainsi été arrêtés par sa faute étaient ici même et, bien entendu, lui en voulaient. D’après eux, l’institutrice avait tout inventé. Ils me disaient même. « Ne lui parlez pas, elle est folle, c’est une mythomane. Elle va s’inspirer de sa conversation avec vous pour vous faire dire des choses que vous n’avez pas dites. Et alors, malheur à vous ! » Aussi, me méfiais-je d’elle, même s’il m’arrivait parfois de lui parler. Je la plaignais. Elle était persuadée qu’on allait la fusiller.
« Ah, si je pouvais faire la fête un petit coup, pour finir en beauté ! », disait-elle souvent. Mais on ne lui rendait pas l’argent qu’on lui avait confisqué, ce qu’elle déplorait car elle ne pouvait pas faire d’achats ni, surtout, « faire la fête » avec cet argent.
Il y avait encore un drôle de type parmi les détenus, avec qui je conversai. Il était très gros et plus très jeune. Il me raconta qu’il avait été envoyé en mission et que, lors d’un contrôle d’identité au cours de son voyage, on avait découvert sur lui une liasse de formulaires vierges signés et portant un cachet de l’administration qui lui avait délivré son ordre de mission. Les autorités soviétiques punissaient sévèrement de tels agissements qui étaient assimilés à de l’espionnage ou de la spéculation. L’homme niait avoir eu des intentions de ce genre. « Vous savez bien qu’il y a pénurie de papier en ce moment ! J’ai pris ces feuilles en guise de papier à lettres, ou encore, pardonnez-moi d’avoir à le dire, de papier hygiénique. Évidemment, c’est facile d’être intelligent a posteriori. Si j’avais su qu’on m’arrêterait pour ces formulaires, je ne les aurais pas pris. » Il racontait cette histoire à tout le monde, et s’y tint pendant l’interrogatoire. C’était peut-être la vérité, qui sait ? Je doute fort que les enquêteurs fussent satisfaits d’une telle explication, mais je pense que le prévenu n’était pas un contre-révolutionnaire. c’était plutôt un spéculateur. Mais allez prouver aux organes soviétiques que vous n’êtes pas un agent double !
Dans notre groupe, il y avait un cas d’arrestation tout à fait stupide. On n’aurait pas pu l’inventer ! Un homme avait été arrêté à cause d’une lettre qui était arrivée en poste restante à la poste centrale de Briansk, portant son nom de famille, sans initiales de prénom toutefois. Elle était restée six mois sans être réclamée, puis les autorités bolcheviques l’avaient ouverte. Le contenu en était bref, mais ne plut pas à la Tcheka, car on pouvait l’interpréter comme un code. Les autorités s’étaient mises en quête à Briansk d’une personne répondant au nom du destinataire. Elles avaient trouvé cet homme, l’avaient arrêté et amené à la Section spéciale. La lettre servait de pièce à conviction pour une accusation d’espionnage. Il tentait d’objecter que si la lettre lui avait réellement été adressée, il serait passé la prendre à la poste centrale, qu’il ignorait tout de cette lettre, et que d’ailleurs le nom n’était pas accompagné d’initiales. Mais les bolcheviks ne le crurent pas. Je ne connais pas la fin de cette histoire.
Un seul de nos codétenus était vraiment soldat de l’Armée blanche (d’après ce que je sais, bien évidemment). C’était un jeune homme de dix-neuf ans, je crois, qui avait servi dans l’un des régiments de cavalerie de l’Armée des Volontaires. Lors d’une charge de cavalerie, il avait été assommé d’un coup de sabre sur la tête, avait perdu connaissance, était tombé de cheval et avait été retrouvé ainsi, inanimé, par les bolcheviks. Les Rouges comprirent que ce n’était pas un appelé, mais un engagé volontaire, et l’envoyèrent à la Section spéciale pour enquête. J’eus avec lui de véritables conversations amicales et relativement sincères, même si ne nous ne nous disions pas tout. Il me racontait, à voix basse, pour que personne n’entende, de nombreuses choses intéressantes sur les Blancs, mais jamais il ne me dit s’il était engagé volontaire, ce que d’ailleurs je ne cherchai pas à savoir, pas plus que je ne lui avouai mon intention de rejoindre les Blancs, mais nous nous comprenions parfaitement à demi-mots. Il me parlait de l’Armée blanche longuement et avec amour, sans jamais franchir toutefois les limites de la prudence.
Tous les jours, deux d’entre nous devaient balayer le palier devant notre salle. Ce fut au tour du père Paul. Les voyous se mirent à scander. « Prenez le barbu ! Le chevelu ! Ça lui fera du bien de travailler ! » Humble, sans un mot, le prêtre sortit balayer le palier. Nous avions eu le temps de nous rapprocher lors de notre détention à Briansk, et nous bavardions souvent. Si on le libérait, il rêvait de rentrer à Snagost, à pied s’il le fallait. « Seulement, comment pourrai-je traverser la ligne de front ? », s’inquiétait-il. « Peut-être que, d’ici là, le front sera arrivé jusqu’ici », dis-je.
Le jour suivant, après le père Paul, ce fut mon tour de balayer le palier. On me donna un balai. Je me mis au travail avec énergie, mais je soulevais plus la poussière que je ne la balayais. Le soldat qui me surveillait s’en aperçut et tenta de me montrer comment faire, mais je n’étais pas très doué. « On voit que tu n’as jamais touché un balai de ta vie, dit-il, irrité. Tu aurais mieux fait de te tenir tranquille, au lieu de te fourrer là où il ne fallait pas. » Une autre fois, j’entendis le même gardien raconter à son camarde rouge. « On emmenait un général pour le fusiller. Un monarchiste, on l’avait pris avec trois livres de propagande antisémite. Il ne disait rien, il ne faisait que répéter. « Ce que vous faites, faites-le vite. » On passe devant une église, il fait un signe de croix. A quoi cela lui servait son signe de croix ? De toute façon il allait mourir, Dieu n’allait pas le sauver. C’est incroyable qu’il ne comprenne pas cela de lui-même. »
Alors que je balayais, on amena sur le palier vingt à trente prisonniers blancs. C’étaient d’anciens soldats rouges qui avaient été capturés par les Blancs et enrôlés par ces derniers dans l’Armée blanche, puis refaits prisonniers par les Rouges. « On est mal traité chez les Blancs, me dit l’un d’eux. Pour un oui ou pour un non, on vous frappe à coup de baguette. Alors on est repassés chez les Rouges. » — « Mais comment aviez-vous fait pour passer chez les Blancs ? », demandai-je. — « On n’est pas passés chez les Blancs, ce sont eux qui nous ont fait prisonniers », me répondit le prisonnier, que ma question avait alarmé. Il était difficile, dans son récit, de distinguer ce qui était vérité de ce qui était adaptation aux circonstances. Ils avaient passé trois semaines chez les Blancs. On ne les laissa pas dans notre salle, contrairement au cavalier blanc. Bien que sous le coup d’une arrestation, ils bénéficiaient d’un régime plus libre que le nôtre. Je bavardai sans succès avec Cyrille Dioubine. C’était un homme impénétrable. Il racontait qu’il avait participé au congrès des Soviets d’Ukraine, mais il n’y avait pas moyen de comprendre vers qui allaient ses sympathies.
Durant ma détention, j’appris que les règles de conduite des Rouges envers les prisonniers blancs étaient les suivantes. On distinguait trois catégories de prisonniers. les appelés, qu’on enrôlait rapidement dans l’Armée rouge ; les anciens soldats rouges, capturés et enrôlés par les Blancs, puis repris par les Rouges. Ils étaient traités avec plus de sévérité, ils étaient soumis à une enquête qui visait à établir les circonstances de leur capture par les Blancs, pour s’assurer qu’ils n’étaient pas passés aux Blancs de leur plein gré ; et, enfin, les Blancs invétérés que l’on envoyait dans les Sections spéciales et que l’on finissait par liquider, lorsque l’on ne les avait pas fusillés sur place.
J’appris que nos paysans de Snagost avaient été battus lors de leurs interrogatoires, qu’on les avait menacé de les fusiller. Tout le monde n’était donc pas traité de façon aussi « correcte » que moi. on m’avait vouvoyé, pas une fois on ne m’avait appelé « camarade ».
Au troisième jour de ma détention à Briansk, on amena un groupe de détenus de la Tcheka de Briansk. La nuit passée, la Tcheka avait fusillé quarante-cinq otages qui se trouvaient dans la même prison qu’eux. Ces jours-là, une vague d’exécutions d’otages déferla sur la Russie. Ce qui s’était passé, c’est qu’une bombe avait été placée au siège du Comité central du parti communiste à Moscou. L’explosion avait fait plusieurs dizaines de morts. Les journaux soviétiques en parlaient (56). En guise de représailles, les bolcheviks avaient procédé à des exécutions en masse d’otages sur tout le territoire russe.
À Briansk, c’étaient des « bourgeois » locaux qui tenaient lieu d’otages, des marchands, et autres notables. Certains d’entre eux avaient déjà passé de nombreux mois en détention et ne s’attendaient en aucune manière à ce qui allait leur arriver. « Parmi les fusillés, il y avait un homme riche de la région, il était tellement plein d’énergie, de joie de vivre », nous racontait, choqué, l’un des détenus transférés de la Tcheka. « Il nous consolait, nous rassurait, en disant qu’on allait tous rentrer à la maison. Le soir, il ne savait rien encore, et soudain, la nuit, on l’a emmené, lui et un de ses amis, et on les a fusillés. C’est tellement affreux de penser qu’un homme avec qui on a parlé la veille est aujourd’hui mort, fusillé. » La nouvelle de ces exécutions nous impressionna, nous aussi. Je me mis à redouter que la vague de terreur rouge ne nous engloutisse, nous qui étions dans cette salle, qu’on ne nous exécute de la même façon arbitraire. Je fis part de mes craintes à l’un des détenus. Sa réaction fut tout à fait inattendue. « Mais enfin, cela n’a rien à voir ! Ceux-là sont des bourgeois, des contre-révolutionnaires, alors que nous, on est des fonctionnaires soviétiques. C’est normal qu’on ait fusillé les autres, ils le méritaient, mais nous ça ne risque pas de nous arriver. Nous, on ne nous accuse pas de contre-révolution. »
Trois jours passèrent. Je lisais les journaux de Moscou, on pouvait en commander en même temps que les produits du marché. J’y appris que les Blancs étaient en train de remporter victoire sur victoire sur le front Lgov-Dmitriev. Ils avançaient. S’ils continuaient ainsi, ils prendraient bientôt Dmitriev ainsi que Selino, ce qui risquait de compliquer mes affaires. Les autorités allaient se renseigner, vérifier mes papiers, s’adresser à Moscou. Plutôt que de passer chez les Blancs, comme je l’espérais, je serais vraisemblablement fusillé ici même, et dans un futur très proche.
Tel était alors mon état d’esprit, aussi ne fus-je pas peu surpris quand le lendemain matin, le 16 septembre, cinquième jour de ma détention, je fus convoqué à un interrogatoire. Une fois de plus, on me fit prendre toute sorte d’escaliers et de couloirs pour me faire entrer dans une pièce où se trouvait, assis à un bureau, un homme de quarante-cinq ans environ, au visage sanguin, aux traits bouffis. Il portait une tunique militaire. Il était d’un grade nettement plus élevé que mon interlocuteur précédent. Je m’assis face à lui. Sur sa table, je vis mes papiers et ma carte qu’il semblait étudier attentivement. Je tentai de lui expliquer où j’avais acheté cette carte, mais il me coupa immédiatement la parole. « Ne dites rien, cette carte n’a aucune importance. Nous avons examiné votre cas, et sommes parvenus à la conclusion que vous avez été arrêté sans fondement, à tort. Je vous prie de ne pas nous en vouloir. Vous savez, nos soldats sont en ébullition sur le front, ils sont inquiets, irascibles. Il faut les comprendre, mais ne nous en tenez pas rigueur, à nous ! Comme dit le proverbe, « on n’échappe pas à son destin. » Aujourd’hui, vous serez libéré. » Je n’en crus pas mes oreilles. N’étais-je pas en train de rêver ? Je restai digne, et dis. « Puisque tout est bien qui finit bien, je ne vous en voudrai pas, mais il est vrai que les soldats sur le front dépassent les bornes. » Je le saluai et quittai la pièce, escorté par mon gardien. Comme on dit, je me sentais pousser des ailes.
Je regagnai la salle de détention et commençai par ne rien dire de ce qui venait de m’arriver. Peu après, on m’envoya à nouveau balayer le palier. « On me libère aujourd’hui », dis-je en guise de protestation. — « Et alors ? » répondit le gardien, « c’est ce soir qu’on te libère, tu as encore le temps de balayer. » Je dus obtempérer. L’annonce de ma libération avait fait sensation. Certains se réjouissaient, exprimaient leur sympathie. D’autres m’enviaient, et s’étonnaient. « Comment se fait-il qu’on libère un espion avéré, avec sa carte, alors que nous-mêmes restons enfermés pour rien ? » J’appris que certains avaient même l’intention d’écrire à l’administration pénitentiaire pour exprimer leur indignation. Je faisais les cent pas dans la salle et me demandai comment une chose pareille avait pu se produire. Il est vrai qu’il n’y avait contre moi aucune preuve formelle, mais ils auraient dû se renseigner à Moscou ! En cette période totalement chaotique, ils m’avaient cru sur parole. Bien plus, ni l’enquêteur, ni les Koubanais rouges n’avaient deviné que je m’apprêtais à passer chez les Blancs. Une seule explication possible à toute cette confusion et cet arbitraire. la section de Briansk était infiltrée par des sympathisants des Blancs, et c’est eux qui m’avaient fait libérer. J’avais lu dans un journal soviétique, peu auparavant, un cas similaire où la Tcheka de Koursk avait été infiltrée par des Blancs qui y avaient aidé les contre-révolutionnaires, avant d’être démasqués. Peut-être était-ce le cas de la Section spéciale de Briansk ? Car, même en camouflant mon projet sous l’histoire de l’ordre de mission, puis du sel, il était incroyable qu’on puisse me relâcher ainsi, sans vérifications. En effet, tant par ma manière de m’exprimer que par mon apparence, je semblais suspect. À une verste, on pouvait voir mon air de « ci-devant », de bourgeois.
Les heures passaient, et personne ne venait me chercher. Je commençai à me sentir nerveux. Se pouvait-il qu’on m’ait trompé ? À cinq heures, enfin, on m’appela. À la hâte, je fis mes adieux au père Paul. Le gardien me fit à nouveau traverser le bâtiment, nous entrâmes dans une pièce qui n’était pas celle où j’avais été interrogé. On m’y laissa seul un long moment. Il commençait à faire sombre. Puis entra un employé qui alluma la lumière et s’appliqua de longues minutes à rayer quelque chose de l’épais registre. « Je voudrais une attestation indiquant que j’ai été arrêté sans fondement, que l’on m’a libéré après deux semaines de détention, et que je suis autorisé à poursuivre ma mission », dis-je. L’employé tapa à la machine le texte suivant. « Le dénommé Untel, arrêté à telle date, a été remis en liberté par la Section spéciale de la 14e Armée, l’accusation étant jugée sans fondement. Il est autorisé à se rendre à Dmitriev pour raisons de service. » On me restitua mes papiers, y compris la carte. Je refusai de la prendre. « Je n’en ai pas besoin », dis-je. — « Elle est à vous. Prenez-la ! », me répondit l’employé. Je cédai pour éviter toute discussion. On me rendit aussi l’argent qui m’avait été confisqué, mais au lieu des cinq cents roubles-Kerenski que j’avais au départ, on me donna une obligation d’emprunt du même montant, émise par le Gouvernement provisoire et dépourvue de toute valeur. C’était une véritable escroquerie ! J’aurais pu protester, mais je gardai le silence, redoutant de retarder ne serait-ce que d’une minute ma sortie de prison.
Le gardien me fit traverser la cour de la prison en direction de la sortie. Là, je vis l’un des officiers du train blindé (celui qui dansait des claquettes), en train de couper du bois. Me voyant, il se redressa et dit d’une voix plutôt triste. « Eh bien, il y en a qui ont de la chance ! » Je fus escorté jusqu’aux portes, le gardien n’alla pas plus loin. Je passai devant le soldat en faction qui ne sembla pas me remarquer. J’étais libre…
- Cette division faisait partie de la 14e armée soviétique. La 41e division était placée sous le commandement d’Eideman, letton de nationalité, qui devait par la suite devenir commandant de corps. Il fut fusillé en 1937 avec Toukhatchevski (voir R. CONQUEST, op. cit., p. 604 et 627).
- Soupe à la betterave. Plat traditionnel russe (NdR).
- Rylsk ne devait être occupé par les Blancs que le 10 septembre, soit quatre jours plus tard.
- Il s’agissait du domaine d’A. N. Voljyne, haut-procureur du Saint-Synode en 1915-1916. Je le rencontrai en 1922 à Munich, et lui racontai cet épisode.
- Les épaulettes dorées, signe du grade des officiers dans l’ancienne armée russe, avaient été supprimées dans l’Armée rouge. Durant la guerre civile, la chasse aux épaulettes — devenues un signe distinctif des Blancs — fut une pratique courante des Rouges (NdR).
- Le général Tourkoul vient confirmer la véracité de tels incidents. Il donne la description de la façon dont les « Écarlates », affublés d’épaulettes et imitant les Blancs, occupèrent un lieu-dit près de Vorojba et y fusillèrent plus de 200 paisibles citoyens qui, les ayant pris pour des Blancs, les avaient bien accueillis (A. V. TOURKOUL, op. cit., p. 119-120).
- Vieux proverbe russe (NdT).
- Koursk a été pris par les unités de Kornilov le 7 septembre.
- Traditionnellement, en signe de consécration à Dieu, les prêtres orthodoxes portent la barbe et — du moins à l’époque — les cheveux longs (NdR).
- Voir « Chapitre 1. Les journées de février 1917 à Petrograd », n. 31.
- Voir p. 130.
- André Grigorievitch Chkouro (1887-1947), général russe, combattant dans les armées blanches durant la guerre civile russe (NdR).
- En argot concentrationnaire, un « crevard » est un détenu parvenu au terme de la déchéance physique, et dont on attend seulement qu’il « crève » (NdR).
- Gloukhov avait été prise par les Blancs le 14 septembre, c’est-à-dire précisément dans le courant de ces journées.
- Voir la Pravda du 26 septembre. Il y est écrit que la bombe a été placée le 12/25 septembre. Parmi les communistes tués, il y avait le vieux bolchévik Zagorov, en l’ « honneur » de qui la Laure de la Trinité-saint-Serge a été rebaptisée « Zagorsk ». Selon les journaux soviétiques, plus de soixante « contre-révolutionnaires » furent fusillés en liaison avec l’affaire, principalement des cadets (les frères Astrov, et bien d’autres), des militaires, et même quelques femmes, des « espionnes ».
SUITE : « Mémoire des deux mondes » De la révolution à l’Église captive, 528 pages
Par Basile Krivochéine Les Éditions du CERF — 2010
Préface du Métropolite Hilarion (Alfeyev) de Volokolamsk, président du département des relations extérieures du patriarcat de Moscou — Traduction du russe de Nikita Krivochéine, Serge Model, Lydia Obolensky — Présentation, révision et notes de Serge Model
La première partie, consacrée aux années de jeunesse, relate de l’intérieur et avec une sincérité rare la période de la Révolution et de la guerre civile. son sens de l’observation fait merveille, et Soljenitsyne ne s’y est pas trompé, qui a repris presque sans changement plusieurs de ses pages sur les événements de 1917. En ressort un tableau peut-être plus véridique que celui présenté dans bien des livres d’historiens.