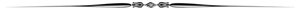Dans la Révolution et la guerre civile
Avant-propos de l’auteur (1)
Il n’est pas facile de raconter des événements vieux de plus d’un demi-siècle. Et si tout ce que j’ai vécu, vu et entendu à l’époque cruelle de la révolution et de la guerre civile en Russie a laissé une trace indélébile dans ma mémoire, le temps en a estompé certains éléments, noms et dates en particulier. Parfois aussi les expériences ultérieures d’une longue vie ont comme déteint sur les émotions et les sensations de cette lointaine époque. J’en suis très conscient, et cependant j’écris ces mémoires, même si le passé que j’y décris peut sembler très lointain, voire totalement étranger à ma vie actuelle, à mes domaines d’intérêt spirituels et intellectuels. J’écris car je ne peux pas ne pas écrire. J’ai besoin de dire ce que j’ai sur le cœur, car le passé — quoi qu’on en dise — reste vivant. Il m’a été donné de vivre bien des choses, et j’en ai à raconter. Ces choses ne relèvent pas, bien sûr, de la grande histoire ; j’étais bien jeune alors, et ma position était par trop insignifiante pour pouvoir prendre part aux événements historiques. Mais ce que j’ai vu, entendu et vécu, je vais essayer de le relater, si ce n’est objectivement, du moins de façon véridique et sincère, sans rien cacher, même si ce ne sera pas du goût de tous. Je vais raconter le mois de février (2) 1917 à Petrograd (3), les débuts de la révolution et un moment crucial de la guerre civile en Russie à l’automne 1919, des deux côtés du front. Je veux aussi révéler comment Dieu m’a — plus d’une fois — sauvé d’une mort qui semblait certaine.
Le seul ajout qu’il m’a paru opportun de faire à ces « Mémoires », ce sont des notes à caractère historique qui viennent apporter des éclaircissements sur les conditions dans lesquelles se sont déroulés les événements décrits, et facilitent la compréhension de mon récit (4).
Les journées de février 1917 à Petrograd (5)
Le jeudi 23 février (6) 1917, je rentrai de l’université vers quatre heures de l’après-midi. Notre appartement était situé au 36 de la rue Serguievskaya, presque au coin de la perspective Voskressenski. Malgré mon jeune âge, j’étais étudiant en première année à la faculté d’histoire et de philologie de l’université de Petrograd (7). D’après mes souvenirs, j’étais rentré ce jour-là à pied, ce que j’aimais faire de temps en temps, d’autant que les tramways étaient généralement bondés au point d’en devenir impraticables. C’était une journée ensoleillée, il ne faisait que quelques degrés au-dessous de zéro (8) et je ne remarquai rien de particulier en ville. De l’université à notre maison, il y en avait environ pour une heure de marche, cela m’avait fatigué, et je m’allongeai sur mon lit dans la chambre que je partageais avec mon frère aîné Igor (9), lieutenant dans l’artillerie montée de la Garde impériale. Il servait alors dans la batterie de réserve de Pavlovsk, mais ces jours-là, se trouvait en permission à Petrograd. Au moment dont je parle, il était sorti. J’étais allongé depuis une demi-heure, une heure peut-être (je ne saurais le dire avec certitude), quand ma tante Olga Vassilievna Krivochéine (10) fit irruption dans la pièce avec toute l’énergie qui la caractérisait, et s’écria. « Tu dors ? Comment peux-tu traîner au lit ? Tu ne sais donc pas ce qui se passe ? En ville, c’est la révolte, la révolution, et monsieur est au lit ! »
Ma tante avait coutume d’ironiser et de persifler. Et c’est exactement ce qu’elle était en train de faire à mes dépens. on se considère comme un grand « révolutionnaire » (c’est vrai que j’avais de tels sentiments à cette époque), mais le jour où la révolution se produit, on paresse, on se repose. En ce qui concernait ma tante, ses convictions n’étaient certes pas de gauche, mais elle ne me prenait pas au sérieux, et ne prêtait d’ailleurs pas grande importance aux désordres qui étaient en train de se produire en ville.
« Comment ? Quelle révolution ?, demandai-je, en bondissant hors de mon lit. J’étais en ville à l’instant, et je n’ai rien vu. » — « Mais c’est que tu ne remarques jamais rien, dit ma tante sur le même ton moqueur, en ville, c’est la révolte. Les cosaques (11) sont en train de se déployer sur la perspective Liteïny. Je viens de les voir de mes propres yeux. » Je m’habillai en hâte, et me dirigeai vers la porte. — « Dis-donc ! Où vas-tu ? Reste là ! Tu ne vas nulle part ! », s’écria ma tante en me voyant faire, et elle tenta de me retenir, mais je désobéis et sortis de la maison d’un pas rapide.
Je pris la rue Serguievskaya vers la droite en direction de la perspective Liteïny qui la croisait à environ dix minutes à pied [depuis ma maison]. La rue Serguievskaya n’était pas une rue particulièrement passante, mais elle semblait encore plus déserte que la normale. Je débouchai sur la Liteïny. Contrairement à ce qu’avait dit ma tante, je ne vis pas l’ombre d’un cosaque. Mais la perspective Liteïny, toujours si animée, semblait totalement abandonnée. Je fus surtout frappé par l’absence de tramways. Pas le moindre policier en vue, non plus. en principe il y en avait toujours un au coin de la perspective et de la rue Serguievskaya, mais maintenant il n’y avait personne. Tout cela suscitait un sentiment trouble et inquiétant, même s’il n’y avait pas d’autre signe évident de révolte ou de révolution ; j’étais déçu. « Je me suis déplacé pour rien », me dis-je. Je restai planté là quelques minutes, et m’apprêtais à rentrer chez moi, mais décidai finalement de remonter un peu plus la rue Serguievskaya pour voir ce qui se passait dans le quartier. Au coin de cette rue et de la perspective, en direction du Jardin d’Été, se dressait à l’époque l’usine Liteïny, une grosse fabrique d’armement. J’en longeai le mur par la rue Serguievskaya, sur laquelle donnaient les grandes portes en bois de l’usine. Et juste à ce moment-là, les battants s’ouvrirent et déversèrent une foule dense d’ouvriers, parmi lesquels beaucoup d’hommes barbus d’âge moyen ou d’âge mûr. Ils avançaient en silence, sans échanger le moindre mot. Ils avaient l’air sérieux, décidé et presque sombre, me sembla-t-il. Ils sortaient de l’usine en un flot constant, puis se dispersaient dans les rues avoisinantes, sans s’attarder. Qu’était-ce ? La fin de leur journée de travail ? La relève ? Ou le début d’une grève (12) ? — me demandai-je. Je rebroussai chemin vers la Liteïny. Toujours aussi déserte, toujours pas de policier. Soudain, je remarquai, le long de la perspective Liteïny, un détachement de cosaques à cheval, une quinzaine d’hommes qui s’avançaient depuis la perspective Nevski. Ils marchaient au pas, et lorsqu’ils eurent atteint la rue Serguievskaya, ils tournèrent, puis s’arrêtèrent. Le soir tombait. Les cosaques descendirent de cheval, déposèrent leurs fusils et entreprirent d’allumer un feu de camp au beau milieu de la rue. Apparemment, ils s’apprêtaient à bivouaquer. Je rentrai chez moi.
Le jour suivant, vendredi 24 février (13), je quittai la maison vers neuf heures du matin en déclarant que j’allais à l’université comme d’habitude. C’était la vérité et j’avais bien l’intention d’y aller, mais avant tout je voulais voir ce qui se passait en ville, et peut-être même participer d’une façon ou l’autre aux événements. Je pensais qu’à l’université j’apprendrais du nouveau, qu’il y aurait certainement un meeting d’étudiants auquel il serait intéressant d’assister. Comme beaucoup d’autres, sans doute, je ne me rendais pas compte du sérieux des événements qui se préparaient en Russie. Il s’avéra cependant impossible d’atteindre l’université. Arrivé à la Liteïny, je constatai qu’il n’y avait pas plus de policiers ni de tramways en circulation que la veille. Il y avait beaucoup de monde sur la perspective, les gens marchaient en direction de la perspective Nevski. Ils allaient en grands groupes, silencieux, marchant sur les trottoirs, mais débordant de plus en plus sur la chaussée. En travers de celle-ci, j’aperçus bientôt des détachements de cosaques à cheval de plusieurs dizaines d’hommes chacun, ainsi que des détachements, moins nombreux, de police montée en capotes grises. À la vue des cosaques, la foule tressaillit et hésita, mais constatant que les cosaques restaient au milieu de la rue et ne s’en prenaient à personne, s’enhardit et reprit sa marche.
Une sorte de procession continue s’était formée, il y avait des milliers de personnes, ouvriers pour la plupart, mais aussi beaucoup d’étudiants. On entendait çà et là des chants révolutionnaires. Les cosaques avaient, manifestement, reçu l’ordre de disperser la foule. Ils partirent au galop sur la large perspective Liteïny, en brandissant leurs fouets. La foule eut à nouveau un mouvement de recul, mais voyant que les cosaques ne les touchaient pas, se contentant de passer au galop sur la chaussée, les gens reprirent à nouveau courage. On entendit des cris joyeux. « Les cosaques avec nous ! » et même. « Vivent les cosaques ! ». Aux policiers, on criait par contre. « Pharaons (14) ! Pharaons ! À bas les pharaons ! »
Ces cris devinrent en quelque sorte les slogans de la révolution. Il semblait cependant que la route vers la perspective Nevski était coupée par des barrages de cosaques ou de policiers à la hauteur de la rue Basseïnaya, et la foule (ou du moins le groupe dans lequel je me trouvais) tourna à droite, et reprit son avancée vers la perspective en direction de la cathédrale Notre-Dame-de-Kazan. Soudain, avec des cris et des hululements, les cosaques nous chargèrent. La foule se mit à courir et fut acculée aux pieds des maisons, mais on comprit rapidement que les cosaques ne fouettaient pas vraiment les gens, se contentant de faire claquer leurs fouets en l’air. De nouveau, la panique céda la place à un sentiment de victoire. « Vivent les cosaques ! » criait la foule.
Puis il y eut cette autre scène. Cette fois, c’est un détachement de policiers montés qui fondit sur une foule de plusieurs centaines de personnes. Les policiers étaient très peu nombreux, cinq à dix personnes tout au plus, mais la foule néanmoins s’enfuit, et acculée aux murs, se recroquevilla pour ne se présenter que de dos aux policiers qui cravachaient ceux qui se trouvaient à leur portée. Je me souviens d’un petit étudiant, couché non loin de moi. Un policier fouettait son dos avec zèle, le visage de l’étudiant exprimait clairement la panique et la peur, mais certainement pas la douleur. Et en effet, il me confirma par la suite que le policier avait retenu ses coups.
La répression policière fut cependant de courte durée. Surgis d’on ne sait où, les cosaques que nous avions vus auparavant se mirent à fouetter les policiers ! Et ceux-ci disparurent aussitôt. Nouveaux cris de victoire, les jeunes cosaques souriaient, contents d’eux-mêmes. La foule parvint finalement à atteindre la perspective Nevski, où elle se joignit à une autre foule qui avait envahi toute la perspective. On commença les meetings, les discours d’orateurs, mais les émeutiers ne purent, ce jour-là, arriver jusqu’à la place de la cathédrale Notre-Dame-de-Kazan. Il faut avouer cependant que les événements de cette journée chargée se mêlent quelque peu dans ma mémoire à ceux qui eurent lieu le lendemain sur la même perspective Nevski. Essayer d’atteindre l’université à travers la cohue de la perspective Nevski semblait insensé, et de toute façon il m’avait fallu de longues heures pour arriver jusqu’à la perspective, où j’étais resté assez longtemps. Fatigué, affamé (je n’avais rien mangé de la journée), je rentrai à la maison en fin d’après-midi. La perspective Liteïny que je pris pour rentrer était maintenant quasi déserte. Apparemment, tout le monde était massé sur la perspective Nevski, mais on peut aussi supposer que certains étaient rentrés chez eux. J’étais troublé, accablé, mais plus que tout je me sentais épuisé.
Le jour suivant, samedi 25 février (15), je quittai de nouveau la maison dès le matin en direction de la perspective Nevski, pour ensuite, si possible, continuer de là jusqu’à l’université. Je ne me rappelle pas des détails, mais globalement la situation était pareille à celle de la veille. Personne dans la rue Serguievskaya, mais une multitude de gens sur la Liteïny, se dirigeant vers la perspective Nevski. Ni tramways, ni policiers, de nombreux magasins et échoppes fermés, aucun journal en vente (ils avaient cessé de paraître depuis les premiers incidents). De plus, contrairement à la veille, il n’y avait pas trace des cosaques ni de la police montée. Ils avaient vraisemblablement été redéployés autour de la perspective Nevski, et la foule avançait donc sans obstacles. Sur la perspective même, près de la cathédrale Notre-Dame-de-Kazan, était rassemblée une quantité innombrable de gens. Il y avait plusieurs dizaines de milliers de personnes, je ne saurais être plus précis. Des drapeaux rouges firent leur apparition pour la première fois (ou alors ne les avais-je pas remarqués la veille ?). Ils étaient étranges, de petite taille, « portatifs », on pouvait facilement les cacher dans sa poche. Certains étaient fixés sur des petits bâtons. Ils étaient brandis au-dessus de la foule par des personnes qui criaient des slogans révolutionnaires. « À bas le gouvernement ! À bas l’autocratie ! À bas les pharaons ! » Ces cris étaient parfois accompagnés d’un autre, moins assuré. « À bas la guerre ! »
Il était évident que, contrairement à la veille, il y avait aujourd’hui dans la foule des agitateurs et révolutionnaires « professionnels », qui cherchaient à canaliser à leurs propres fins les masses révoltées. Dans leur très large majorité, ces masses étaient composées du petit peuple citadin, des ouvriers principalement, d’âges divers. Mais on voyait aussi de nombreux étudiants, reconnaissables à la casquette de leur uniforme. La foule était presque exclusivement masculine, il n’y avait quasiment pas de femmes du peuple, mais il y avait un certain nombre d’étudiantes. Les étudiants se mirent à « fraterniser » démonstrativement avec les ouvriers (ce qui, malgré mes convictions « de gauche », me sembla du sentimentalisme artificiel). Un ouvrier par exemple prit la casquette d’un étudiant, la mit sur sa tête, et lui donna en échange sa casquette d’ouvrier. « Vivent les étudiants, ils sont toujours avec le peuple ! » cria une voix dans la foule. Plus loin, un jeune gars, probablement un apprenti, beau garçon à l’air vulgaire, ayant pris le bras d’une jeune étudiante bien en chair, au visage agréable, qui portait une pelisse et des vêtements bien coupés, marchait ainsi avec elle en clamant à la cantonade. « Vous ne pouvez pas vous imaginer comme je me sens plein de force. Si on m’en donnait la possibilité, par le diable, j’en ferais des choses ! Mais je ne peux pas ! L’autocratie et les capitalistes nous étouffent, nous écrasent. Nous sommes les esclaves du capital. Sinon, par le diable, je serais capable de faire de ces choses ! ». Il répéta ainsi de nombreuses fois son invocation « diabolique ». Je voyais que l’étudiante écoutait ces déclarations avec une certaine gêne (il n’était visiblement pas dans ses habitudes de se promener dans les rues au bras d’un apprenti), mais elle était fière de servir ainsi la révolution.
Puis un meeting s’organisa, grandiose, une véritable mer de têtes. Un orateur se hissa sur un support en hauteur et se lança dans un discours. c’était un homme d’une quarantaine d’années en manteau brunâtre, la barbe ébouriffée, l’air plutôt russe quoique très brun. Il parlait sans hésitation, ses paroles semblaient couler d’elles-mêmes, c’était manifestement un orateur confirmé. Son discours était haineux, maussade, au début sans passion ni flamme particulière, mais à la fin, il parvint habilement à galvaniser la foule. La première partie de son discours avait pour thème. « À bas l’autocratie ! », la deuxième. « À bas la guerre ! » Il répéta ces slogans durant tout son discours. La foule lui répondait par des hurlements d’approbation, des applaudissements, mais il faut souligner que le slogan. « À bas l’autocratie ! » rencontrait un succès bien supérieur à celui de. « À bas la guerre ! » Ce dernier slogan était trop inhabituel, on sentait qu’il ne correspondait pas exactement aux aspirations de la majorité.
Soudain, il y eut comme un moment de confusion, un mouvement dans la foule. On entendit des cris. « Un provocateur ! Un provocateur ! On a attrapé un provocateur ! » En fait, d’après la foule du moins — personnellement, je n’avais rien pu voir en raison du monde —, quelqu’un avait essayé de photographier l’orateur avec un appareil photographique miniature. On l’avait surpris, on lui avait arraché l’appareil des mains pour le réduire en morceaux ; quant au « provocateur », il succomba à la justice populaire. Il fut tué ! « Ça fait longtemps qu’on le connaît, il est connu », criait-on dans la foule. Peu après, nouvelle scène de meurtre. Non loin de moi, je vois une mêlée, un homme est en train de se faire rouer de coups, mais d’autres crient. « Ne le tuez pas ! Ne le tuez pas ! Il ne faut tuer personne ! » Les opinions se divisent. Je m’approche. Sur le sol, je vois un officier de police en capote d’uniforme, mort. Un commissaire ou un inspecteur, je ne connais pas grand-chose à ces grades. Son visage est jeune, blême et verdâtre. Il a les yeux clos. De sa tempe coule un filet de sang, de son nez aussi, de sa bouche ouverte, de la salive. Ses traits expriment la souffrance et la douleur. On voit qu’il a été battu à mort. C’est la première fois que je vois un tué. Mais comment a-t-il pu se trouver ainsi en uniforme, seul, dans une foule révoltée de plusieurs milliers de personnes ? On me dit qu’il avait l’intention d’arrêter l’orateur. C’est assez difficile à croire. On emporta le corps.
La foule avance sur la perspective Nevski, en direction de la gare Nicolaïevski (16). Cette fois personne ne lui barre la route. Il y a de plus en plus de drapeaux rouges. On voit apparaître de grandes banderoles rouges, portant les slogans habituels. « À bas l’autocratie ! », « À bas la guerre ! » La foule recouvre presque toute la largeur de la perspective Nevski, et s’étend loin à l’horizon. Mais toutes les personnes présentes ne marchent pas avec la procession. Il y a beaucoup de monde sur les trottoirs. Surtout des gens de l’intelligentsia, « correctement » habillés, mais pas seulement. il y a aussi des gens simples, de petites gens de Petrograd, des employés, des commerçants… Ils se tiennent immobiles, silencieux, le visage tourné vers la foule. L’air attentif, sérieux, ils la regardent passer mais n’expriment aucune opinion, ni approbation, ni réprobation. Ce qui irrite les manifestants. « Qu’est-ce que vous faites sur le trottoir, leur crie-t-on de la foule, descendez, venez nous rejoindre ! » Mais les gens du trottoir ne réagissent en aucune manière. Les cris dans la foule reprennent de plus belle. « Descendez des trottoirs, bourgeois ! Descendez des trottoirs ! » Mais les gens des trottoirs ne bougent pas et, l’air maussade, continuent à regarder les manifestants. Manifestement, les exhortations ne les impressionnent pas.
La foule poursuit son chemin. Nous passons devant le siège du Jour, journal de Petrograd le plus à gauche, parmi les périodiques autorisés. Les employés du journal, une quinzaine de personnes, sont massés sur le balcon du premier étage. Ils agitent des mouchoirs, des chiffons noirs ; apparemment, ils n’avaient pas prévu de drapeaux rouges. Ils acclament les manifestants. En réponse, quelques rares. « Vive le journal Le Jour ! » (le journal n’avait pas les faveurs des bolcheviks. Il était de tendance menchevik).
J’entends des conversations absurdes, je suis frappé par l’ignorance qu’elles dénotent (et ce, malgré ma sympathie pour les événements en cours). « Maintenant, aucun bourgeois ne sortira dans la rue sans un revolver en poche. » Ou alors. « La guerre, ça ne fait qu’enrichir les bourgeois. Le moindre épicier empoche plus de 800% de bénéfice sur sa marchandise. » Mais on entend aussi des remarques plus sensées. Un vieil ouvrier au visage intelligent, un type bien — cela se voit tout de suite — dit. « À mon avis, les Allemands avec leur Guillaume doivent être bien contents de ce qui se passe ici. Cela les arrange bien. Ce n’est pas bien d’organiser des manifestations pendant la guerre. Mais on n’y peut rien. C’est la faute de tous ces Stürmer (17) si on en est là. On ne peut leur confier la conduite de cette guerre (18) ! » Nous approchons de la place Znamenski en face de la gare Nicolaïevski. Du côté de la perspective Ligovka passe une unité d’infanterie, fusil en bandoulière, équipement de campagne au dos. Ils marchent en rang vers la gare. À leurs côtés, des officiers. Ce sont des recrues sur le point d’embarquer pour le front. Tous sont d’âge mûr, beaucoup portent la barbe. Des agitateurs dans la foule essaient sur eux leur propagande, les interpellent. « À bas la guerre ! », mais les soldats ne leur prêtent aucune attention. En silence, toujours en rang, ils poursuivent leur chemin.
Il était environ trois heures de l’après-midi. La foule s’était arrêtée sur la place Znamenski. Un nouveau meeting commença. Les orateurs se juchèrent sur le piédestal du monument à Alexandre III, et de là par des discours enflammés s’efforcèrent de galvaniser la population. Je les entendais à peine, mais il s’agissait apparemment des thèmes révolutionnaires habituels. Soudain, sans crier gare, sortis de Dieu sait où (probablement de la rue Znamenskaya), surgirent cinq ou six policiers à cheval brandissant des sabres dénudés et chargèrent au galop les orateurs qui se tenaient près du monument. Je revois encore clairement l’un des policiers, probablement leur chef, son sabre levé très haut au-dessus de sa tête. Une panique indescriptible s’empara de la foule. « Ils sabrent ! Ils sabrent ! », entendit-on. On courut se réfugier dans les rues attenantes à la place et à la perspective Nevski, la rue Znamenskaya entre autres. C’est là que je courus également.
Je dois dire que je partageais tout à fait la panique générale. Ce n’était pas tant la peur de mourir que la conscience de l’absurdité et de l’inutilité de mourir ainsi sans trop savoir pourquoi. Ou plutôt pour rien ! Il n’y avait là rien qui justifie le sacrifice d’une vie, une mort héroïque. Je ressentais cela de tout mon être — consciemment ou inconsciemment, je n’en sais trop rien — mais avec une force invincible. C’est pourquoi je courus avec les autres et me retrouvai dans la rue Znamenskaya. Là je m’arrêtai, et vis que les autres s’arrêtaient aussi. À ce moment là (ou peut-être pendant que je courais), nous entendîmes, provenant de la place, une clameur de triomphe, puis les cris d’une foule en liesse. Il s’était produit quelque chose d’imprévu. Nous rebroussâmes chemin vers la place, d’abord timidement, puis d’un pas plus assuré. On me dit (je n’avais rien vu), qu’un cosaque avait bondi vers l’un des policiers à cheval, et l’avait abattu d’un coup de feu. Les autres policiers s’étaient enfuis. C’était une victoire pour la révolution !
Peu après, fatigué, je rentrai chez moi par la rue Znamenskaya, ce qui faisait une demi-heure de marche. Ce jour là, je ne ressortis plus. La situation en ville semblait toujours aussi confuse, il n’y avait encore eu aucun affrontement sérieux avec les forces armées gouvernementales, à l’exception des cosaques qui ne manifestaient pas un grand désir d’en découdre, que du contraire. Les événements étaient impressionnants par leur ampleur et par leur tournure, chaque jour plus menaçante, mais il était difficile d’imaginer une victoire des masses révoltées. Cela paraissait invraisemblable. La foule était bien trop timorée, elle cédait trop facilement à la panique.
Le jour suivant, le 26 février (19), était un dimanche. Mon père Alexandre Vassilievitch Krivochéine (20) était alors rentré de Minsk, car le lundi 27 février (21), était prévue une session de la Douma et du Conseil d’État (22). Après son départ du poste de ministre de l’Agriculture, mon père servait sur le front occidental en tant que représentant de la Croix-Rouge, et était membre ex officio du Conseil d’État. Un dimanche matin, je ne pouvais sortir de la maison en invoquant le prétexte de l’université, et je dus rester à la maison jusqu’au déjeuner, vers une heure. Nous déjeunâmes en famille, dans une atmosphère tendue, nous parlions très peu, mais je pense qu’aucun de nous n’avait encore compris que nous étions à la veille d’événements qui allaient bouleverser toute la Russie. Vers deux heures, je sortis néanmoins de chez moi et me dirigeai comme les jours précédents vers la Liteïny et la perspective Nevski. C’était toujours le même tableau. Ni police, ni tramways, ni armée (23). Seul élément nouveau, des affiches étaient placardées sur les maisons, portant la signature de Khabalov (24), le commandant militaire, qui informaient la population qu’ « en raison de la persistance des troubles à l’ordre public, l’état d’urgence est déclaré à Petrograd (ou était-ce l’état de siège ? — je ne me rappelle plus exactement). Manifestations et attroupements sont interdits ; en cas de désobéissance, l’armée a l’ordre d’ouvrir le feu. »
Je ne me souviens pas bien de mon trajet jusqu’à la perspective Nevski, n’ayant rien remarqué de particulier, ni manifestation ni cortège. Mais sur la perspective, la population était à nouveau en train d’affluer en masse, même si cette foule me sembla plus clairsemée que les jours précédents.
Peut-être le décret de général Khabalov en avait-il dissuadé quelques-uns. Un cortège assez imposant se forma néanmoins qui s’ébranla de la cathédrale Notre-Dame-de-Kazan en direction de la gare Nicolaïevski. Il devait être trois heures de l’après-midi. Soudain, de façon tout à fait inattendue (en tous cas pour moi et pour ceux qui se trouvaient autour de moi), on entendit, près de la place Alexandrovski et du monument à Catherine II, une fusillade assez nourrie. L’on ne voyait pas les tireurs, et j’ignore qui ils étaient. Le bruit courut par la suite qu’il s’agissait des soldats du régiment Pavlovski (25). Aux premiers coups de feu, la foule reflua depuis la perspective Nevski vers la petite rue qui longe le jardin où se dresse le monument à Catherine, en direction du théâtre Aleksandrinski. La fusillade dura cinq à dix minutes, et j’avais l’impression qu’on tirait sur les manifestants en fuite. Mais bizarrement, non seulement on ne voyait ni tués ni blessés, mais on n’entendait pas non plus de balles siffler ou percuter la chaussée, ce qui semblait indiquer que l’on tirait à blanc. Ou peut-être en l’air. La foule finit par s’en apercevoir. Jusque-là tout le monde courait et, quand la fusillade devenait plus nourrie, se couchait sur le trottoir le long des grilles du jardin avant de reprendre sa course. Mais voyant qu’il n’y avait pas de morts, les gens se redressèrent et cessèrent de courir, pressés seulement de se disperser et se mettre à l’abri. La petite rue se trouva soudainement désertée.
À cet instant, je fus abordé par un étudiant juif que je ne connaissais pas. « Collègue, dit-il, voyant mon émotion, ces gredins vous ont fait peur. Ils tirent sur la foule ! Vous habitez loin, peut-être ? » Je répondis que j’habitais rue Serguievskaya. « C’est loin, dit l’étudiant, venez chez moi, j’habite tout près. Nous attendrons que les choses se calment, et si vous le voulez, vous pourrez passer la nuit chez moi. » — « Non, je dois être chez moi ce soir », répondis-je, mais j’acceptai finalement son offre de nous rendre chez lui, sans grand enthousiasme, il est vrai, car la fusillade ayant cessé, je ne voyais pas la nécessité d’une telle invitation.
L’étudiant habitait dans le quartier, dans une rue près de la Sadovaya. Nous pénétrâmes dans une grande pièce au premier étage, pleine d’un fouillis de meubles et d’objets. Je crois me souvenir qu’il y avait une table au milieu. D’autres gens arrivaient et nous fûmes bientôt une dizaine de personnes, tous étudiants, dont trois femmes. Tous étaient juifs, cela se voyait autant à leur physique qu’à leur façon de parler. Ils étaient tous de tendance révolutionnaire, mais néanmoins assez oppressés par les événements. Il y avait parmi eux deux ou trois personnes d’une trentaine d’années, les autres étaient plus jeunes. Mon compagnon me présenta : « Je viens avec un camarade, il a bien failli se faire fusiller dans la rue. »Je fus accueilli aimablement, quoiqu’avec retenue. La conversation se concentra naturellement sur les événements du jour, et le fait que l’on venait de tirer sur la foule. L’un d’eux dit. « Il paraît que Nicolas II a pris peur et a filé au quartier général (26). » « Oui, reprit un autre, mais avant de partir, il a donné l’ordre de tirer (27), et regardez le résultat ! Il a suffi de quelques coups de feu pour disperser tout le monde ! » Quelqu’un essaya de protester. « Oui, mais demain tout peut recommencer. »
« Non, non ! », dirent-ils tous. « La révolution est vaincue. Demain, tout sera rentré dans l’ordre, personne ne descendra plus dans la rue. » — « Personne n’aurait cru que Nicolas oserait tirer sur le peuple. Eh bien il a osé, et tout le monde s’est enfui ! » — « Il ne fallait pas se lancer dans cette aventure, puisque le peuple est incapable de faire une révolution. L’autocratie n’en sortira que renforcée. »
On se mit à parler des sionistes. L’on en disait le plus grand mal, les traitait de traîtres, s’indignant de leur refus de participer au mouvement révolutionnaire. « J’ai rencontré Gricha (28), racontait l’un des juifs, vous savez, le fils à sa maman, le sioniste. Il me dit. « Cette révolution ne nous concerne pas, nous les juifs, puisque nous ne sommes pas Russes. » Le misérable ! » En dépit de la présence des femmes, quelqu’un se mit à raconter des histoires grivoises. Mais on le fit taire, peut-être à cause de ma présence. Ils sentaient que je n’étais pas de leur milieu. Quant à moi, j’étais frappé par le faible niveau culturel de ces étudiants, par leur manque d’information.
Ayant passé quelques heures en leur compagnie, fatigué par ces conversations et la tête alourdie par la fumée de leurs cigarettes, je décidai de rentrer chez moi. L’étudiant qui m’avait amené ici, le plus sympathique de tous, essaya de m’en dissuader, mais je ne me laissai pas convaincre, et après l’avoir remercié pour son hospitalité, je me retrouvai dans la rue. Il devait être neuf heures du soir. Le temps avait changé. Les jours précédents, il avait fait plutôt bon, autour de zéro degrés, avec un ciel couvert, sans neige. Mais soudain, il avait gelé. Par des rues totalement désertes, j’atteignis rapidement la perspective Nevski à la hauteur de la rue Nadejdinskaya. Là, je tombai sur un obstacle. Disposée en deux rangs au beau milieu de la perspective, se tenait une troupe. Les rangs étaient si serrés qu’il était impossible de les traverser. Des feux de camp flambaient à intervalles réguliers, leurs flammes rougeoyantes éclairant les rangs de soldats. Des officiers passaient devant les rangs. Des civils étaient rassemblés en petits groupes sur le trottoir, et on les entendait crier. « À bas l’officier ! » Je me souviens d’un officier qui faisait les cent pas sans prêter la moindre attention à ces cris. Mais un autre, en entendant les mêmes cris, se retourna brusquement. Le petit groupe de civils sursauta et eut un mouvement de recul.
Pour rentrer chez moi, il me fallait traverser la perspective Nevski, et je tentai de passer à travers les rangs de soldats, mais on ne me laissa pas faire, exigeant une autorisation. Je m’adressai à l’officier le plus proche, lui expliquant que je désirais rentrer chez moi. Il me donna l’autorisation nécessaire, je passai entre les soldats, ce qui ne fut pas aisé. Je dus me faufiler à travers leurs rangs, tant ils étaient serrés. Une demi-heure plus tard, j’étais rentré chez moi, sans avoir rencontré âme qui vive sur mon chemin. À la maison, j’appris qu’un bataillon du régiment Pavlovski s’était révolté (29), mais que la mutinerie avait été écrasée par d’autres unités du même régiment, que les instigateurs de la révolte avaient été arrêtés et qu’ils allaient passer en cour martiale.
Le lendemain, lundi 27 février (30), je sortis de chez moi vers neuf ou dix heures du matin. Igor, mon frère officier qui se trouvait à ce moment-là en permission, sortit avec moi. Je ne sais pas pourquoi il était sorti, mais nous prîmes ensemble la rue Serguievskaya en direction du jardin de Tauride. Ayant traversé la rue Serguievskaya, nous parvînmes au coin tout proche de la perspective Voskressenski. Et là, au coin de la rue Serguievskaya et de la perspective Voskressenski, nous entendîmes des hurlements ou plutôt une clameur insistante provenant apparemment de la rue Kirotchnaya. On entendait de loin des cris émis — à ce qu’il semblait — par des centaines ou des milliers de gorges. C’était une clameur prolongée, ininterrompue, qui tantôt se renforçait tantôt faiblissait. C’était des hommes qui criaient, et pourtant leurs cris étaient aigus, éperdus, déchirants, pouvant aussi bien exprimer la joie que l’exaspération. Et cela durait, durait. « Qu’est-ce que cela peut être ? Qui crie ainsi et pourquoi ? », nous demandions-nous avec mon frère.
À ce moment-là, un jeune sous-officier, grand, le visage avenant, s’approcha de mon frère. Avec prestance, il se mit au garde-à-vous, claqua des talons et salua mon frère en disant. « N’allez pas là-bas, Votre Noblesse (31) ! C’est le régiment de Volhynie qui s’est révolté rue Kirotchnaya (32). On pourrait vous tuer ! » Sa voix était pleine de sollicitude et d’inquiétude pour la vie d’un officier qu’il ne connaissait pourtant pas personnellement. Nous savions maintenant ce que signifiaient les cris en provenance de la rue Kirotchnaya. Mon frère blêmit, mais conserva son sang-froid. Sur son visage apparut un mélange de tristesse et de douleur, comme s’il voyait périr sous ses yeux quelque chose qui lui était cher. Il remercia le sous-officier et rebroussa chemin. Je voulais, quant à moi, poursuivre ma route, mais mon frère exigea que je rentre à la maison. Ni lui ni moi ne nous attendions à une mutinerie dans l’armée, et avions peine à y croire ! Mais, contrairement à mon frère, j’en éprouvai de la joie. C’était enfin la vraie révolution russe qui commençait. Et cette perspective me semblait alors excitante, envoûtante. L’atmosphère à Petrograd avait réellement été cauchemardesque, ces derniers temps, et c’est avec impatience que l’on attendait un changement radical, une solution. C’est impossible à comprendre pour celui qui n’a pas connu Petrograd à ce moment-là. Arrivait ce qui devait arriver, et on ne change pas le passé ni ses conséquences, mais l’histoire se déroulait devant mes yeux.
Mon père m’interdit sévèrement de sortir de la maison. Quelques heures plus tard, je voulus sortir à nouveau, mais ma tante me surprit et alla en prévenir mon père. Aucun de nous n’aurait jamais envisagé de désobéir à mon père, je restai donc à la maison deux jours d’affilée et ne vis pas de mes propres yeux les développements ultérieurs de la révolution. Je pourrais terminer ici mon récit, mais j’y ajouterai néanmoins quelques petits faits dont je fus malgré tout témoin.
À un moment, par les fenêtres de notre appartement qui donnaient sur la rue Serguievskaya, nous entendîmes la rumeur de nombreuses voix. Nous nous précipitâmes aux fenêtres malgré les protestations de notre vieille femme de chambre qui me tirait en arrière en disant. « Ne regardez pas ! S’ils vous voient à la fenêtre, ils tireront, et vous tueront ! Ils sont capables de tout ! Ces émeutiers ont perdu tout sentiment humain ! »
Je vis en effet un groupe de cent cinquante à deux cents soldats qui marchaient en désordre en direction du Liteïny. C’était apparemment le régiment révolté de Volhynie, ou du moins une partie de celui-ci. Fusil en bandoulière, en désordre et sans officiers, les soldats marchaient en foule au beau milieu de la rue, parlant fort et s’arrêtant de temps à autre. Enfin, quelqu’un cria. « En avant ! » et ils se mirent en route dans la rue Serguievskaya. Mais très vite, on cria. « Demi-tour ! » et la horde de soldats reflua pour disparaître au coin de la perspective Voskressenski.
Le plus frappant dans tout cela était l’absence totale de réaction de la part des forces gouvernementales. « Je vois la révolution, mais je ne vois pas de contre-révolution », fit remarquer mon père, alors qu’il regardait par la fenêtre les soldats mutins.
Ces jours-là, il se mit à neiger de petits flocons serrés sur Petrograd. Arriva alors le ministre de l’Agriculture Rittich (33), un proche de mon père et l’un de ses anciens collaborateurs. Il n’avait pas pu atteindre son ministère, et venait chez nous dans l’espoir de joindre les institutions gouvernementales par téléphone pour obtenir des éclaircissements sur la situation et tenter, d’une façon ou l’autre, d’organiser une résistance. Malgré la révolution, le téléphone fonctionnait quasi normalement, mais toutes ses tentatives demeurèrent vaines. Selon les endroits, on lui répondait qu’il n’y avait personne, ailleurs le téléphone sonnait sans réponse, ailleurs encore des « comités (34) » avaient déjà été formés. Bredouille, Rittich ne tarda pas à s’en aller. Il était indigné de la déliquescence si rapide du gouvernement, de l’incompétence et la veulerie des dirigeants tant civils que militaires.
Bientôt, nous vîmes arriver des réfugiés d’un genre particulier, qui pensaient trouver dans notre appartement un refuge sûr. En réalité, cela faisait plus d’un an et demi que mon père avait quitté son poste de ministre de l’Agriculture et n’était plus au pouvoir, mais on avait regretté son départ car l’opinion publique l’appréciait. Et comme il ne faisait pas figure d’ « odieux personnage », de nombreuses personnes se sentaient en sécurité chez nous. Bien sûr, c’était là pure illusion de leur part.
Le premier à venir ainsi fut le baron Romain Disterlo (35), ami de mon père, membre du Conseil d’État aux opinions résolument conservatrices. Mon père l’accueillit volontiers, mais, pointant du doigt la rue où déambulaient des soldats en armes, lui dit. « Voyez à quoi nous ont mené vos mesures insensées et votre opposition aux réformes nécessaires pour la Russie. Vous êtes responsables de ce qui est en train de se passer ! » Le baron Disterlo ne répondit pas. C’était un homme intelligent, et il comprenait que la remarque de mon père était fondée. Mais si la visite du baron Disterlo était compréhensible (malgré leurs divergences, mon père et lui étaient amis), celle de l’ancien Premier ministre A. Trepov (36) fut, en revanche, tout à fait inattendue. Il n’était absolument pas proche de mon père, et en politique, ils étaient même opposés. Cela révéla un intéressant trait de son caractère. Lorsqu’il était au pouvoir, et toute sa vie au demeurant, Trepov avait été partisan des mesures les plus brutales et définitives, mais à peine la révolution s’était-elle déclarée, qu’il prit terriblement peur, et n’envisagea pas une seconde d’y opposer la moindre résistance. Il était trop absorbé par le problème de sa sécurité personnelle et passa quelques jours chez nous !
Pendant cette journée, on n’entendit presque pas de coups de feu, et nous ne savions pas exactement ce qui se passait en ville. Dans l’après-midi, nous aperçûmes dans le ciel des nuages de fumée noire. Comme nous devions l’apprendre par la suite, c’était le tribunal municipal sur le Liteïny qui brûlait, non loin de chez nous. Le soir, on sonna à notre porte. Un détachement de soldats armés — composé de cinq à six personnes sous les ordres d’un civil — fit irruption dans notre appartement. « Il paraît qu’il y a un officier chez vous, nous dirent-ils, nous devons le voir, vérifier s’il est en possession d’une arme, car quelqu’un est en train de tirer à la mitrailleuse du toit de votre maison. » Bien sûr, c’était un pur mensonge, personne ne tirait à la mitrailleuse. Ils demandèrent à voir notre frère Igor. Notre mère Hélène Guennadievna (37) fut prise de panique. « Vous allez le tuer ! », s’exclama-t-elle. — « Mais non, ne vous inquiétez pas, répondit le civil, nous voulons seulement vérifier qu’il n’a pas d’arme. »
Mon frère était dans notre chambre. Nos visiteurs lui demandèrent de rendre ses armes. Mon frère blêmit, serra les dents, mais rendit son revolver. Il eût été insensé de résister. Il n’avait pas d’autre arme. Les soldats se mirent à discuter pour savoir s’ils devaient ou non emmener mon frère avec eux, mais l’avis qu’il fallait le laisser ici l’emporta. Les soldats repartirent. Il est probable qu’ils avaient été intimidés par la présence de ma mère.
J’atteins la fin de mon récit. Raconter des événements dont je n’ai pas été le témoin direct n’aurait aucun sens. D’ailleurs les journées de février étaient terminées, on était en mars (38).
- Rédigé en 1975 par l’auteur comme avant-propos au récit « L’année 1919 » dans ARCHEVEQUE BASILE (KRIVOCHEINE), Vospominaniya. Pis’ma [Mémoires. Correspondance], Nijni-Novgorod, Éd. de la Fraternité Saint-Alexandre-Nevski, 1998, p. 32-33, et repris comme avant-propos général dans ARCHEVEQUE BASILE (KRIVOCHEINE), Spasenniy Bogom [Sauvé par Dieu], Saint-Pétersbourg, Éd. Satis, 2007, p. 10-11 (texte de référence).
- Dans le récit « Les journées de février 1917 à Petrograd », les dates sont données en calendrier julien (utilisé par l’État russe jusqu’au 28 février 1918 et par l’Église orthodoxe russe jusqu’à nos jours), qui accuse un retard de treize jours sur le calendrier grégorien. Dans « L’année 1919 », elles sont indiquées selon les deux calendriers.
- Au début de la guerre de 1914, la capitale de l’empire russe avait été rebaptisée Petrograd, au lieu du nom — jugé trop allemand — de Saint-Pétersbourg.
- Ces notes rédigées par l’auteur ne concernent cependant que le chapitre « L’année 1919 », p. 29-152. Partout ailleurs, les notes ont été ajoutées par nous (NdR).
- Texte publié à compte d’auteur en 1976, puis édité dans. ARCHEVEQUE BASILE (KRIVOCHEINE), Vospominaniya. Pis’ma [Mémoires. Correspondance], Nijni-Novgorod, éd. de la Fraternité St Alexandre Nevski, 1998, p. 10-28 et dans. ARCHEVEQUE BASILE (KRIVOCHEINE), Spasenniy Bogom [Sauvé par Dieu], Saint-Pétersbourg, éd. Satis, 2007 (texte de référence), p. 12-30. Ces souvenirs furent repris, presque sans changement, par A. SOLJENITSYNE dans La Roue rouge, 3e nœud. Mars Dix-sept, Paris, Fayard, 1986, chapitres 47 et 85.
- Le 23 février 1917 correspond au 8 mars selon le calendrier grégorien. Voir « Avant-propos de l’auteur », n. 2. En fait, la révolution de février (mars) 1917 commença par des manifestations à l’occasion de la Journée internationale des femmes, qui dégénérèrent à la suite de la rumeur — fausse — d’une pénurie dans l’approvisionnement en pain de la capitale.
- Voir « Avant-propos de l’auteur », n. 3.
- Cette circonstance climatique — après un temps glacial qui avait retenu la population chez elle — allait également jouer un rôle non négligeable dans les événements ultérieurs.
- Igor Alexandrovitch Krivochéine (1899-1987). Frère de l’auteur. Ingénieur, officier dans l’artillerie montée de la Garde impériale, combattant de la première guerre mondiale et de la guerre civile russe. Émigré à Paris en 1920, résistant, prisonnier des camps nazis, retourne en URSS en 1947, prisonnier des camps soviétiques (1949-54). Rentre à Paris en 1974. Voir N. JALLOT, Piégés par Staline, Paris, Belfond, 2003.
- Olga Vassilievna Morozova, née Krivochéine (1866-1953). Sœur d’Alexandre Vassilievitch Krivochéine [père de l’auteur]. Émigre à Paris en 1920.
- Depuis la fin du XIXe siècle, les cosaques, cavaliers légers de l’armée russe, participaient aussi au maintien de l’ordre dans les villes.
- Le 20 février (5 mars), l’usine d’armement Poutilov (plus grande entreprise de Petrograd), en rupture d’approvisionnement, ferma ses portes, ce qui mit des dizaines de milliers d’ouvriers en chômage technique et les jeta dans la rue. D’autres ouvriers en grève se joignirent aux manifestations.
- Le 9 mars selon le calendrier grégorien. Ce jour-là, cent cinquante mille ouvriers grévistes convergent vers le centre-ville.
- Surnom méprisant des policiers ; le peuple orthodoxe était habitué à entendre, à l’église, maudire le « pharaon persécuteur » [d’Israël].
- Le 10 mars selon le calendrier grégorien.
- Aujourd’hui, gare de Moscou.
- Boris Vladimirovitch Stürmer (1848-1917), homme politique russe. Protégé de Raspoutine, président du Conseil des ministres (1916), fonction qu’il cumule avec celle de ministre de l’Intérieur, puis des Affaires étrangères. Après la Révolution de février, arrêté et emprisonné. Meurt en prison.
- En pleine guerre avec l’Allemagne, le nom de famille allemand du Premier ministre sonnait comme une provocation.
- Le 11 mars selon le calendrier grégorien.
- Alexandre Vassilievitch Krivochéine (1857-1921), juriste et homme d’État russe, père de Vassili, Oleg, Vsévolod [Basile], Cyrille et Igor Krivochéine. Proche collaborateur du Premier ministre Stolypine, il fut vice-ministre des Finances (1906), ministre de l’Agriculture (1908-1915), et Premier ministre du gouvernement « blanc » du général Wrangel en Crimée (1920). Émigre à Paris.
- Le 12 mars selon le calendrier grégorien.
- Cette réunion n’aura jamais lieu, le tsar ayant, le 25 février (10 mars), suspendu les travaux de la Douma et du Conseil d’État. La Douma refusera et constituera un Comité provisoire pour le maintien de l’ordre, qui se transformera en Gouvernement provisoire après l’abdication du tsar le 2(15) mars 1917.
- Face aux événements, l’autorité militaire avait lancé en aide à la police et aux cosaques les troupes de réserve des régiments de la Garde impériale, stationnées dans la ville ou ses environs.
- Serge Sémionovitch Khabalov (1858-1924), officier russe. Général commandant la Région militaire de Petrograd (1916-17). Arrêté après la Révolution de février, puis libéré, émigre.
- Régiment Paul Ier de la Garde impériale.
- Ce n’est pas vrai. c’est le 22 février (7 mars), soit avant le début des événements, que Nicolas II avait quitté la capitale pour rejoindre son quartier général à Moguilev.
- C’est aussi inexact ; ce n’est que le 25 février (10 mars) que le tsar envoya un télégramme au général Khabalov, lui ordonnant de « faire cesser dès [le len]demain les désordres dans la capitale ».
- Diminutif de Grégoire.
- Le 4e bataillon du régiment.
- Le 12 mars selon le calendrier grégorien.
- Titre donné à tous les officiers de l’armée russe.
- Ce matin-là, le détachement d’instruction du bataillon de réserve du régiment de Volhynie (de la Garde impériale) avait tué son commandant et s’était soulevé, entraînant le reste du régiment, ainsi que les régiments de Lituanie et Préobrajenski de la Garde. La mutinerie des régiments d’élite de l’armée russe, traumatisés d’avoir tiré sur leurs « frères ouvriers », fera basculer la situation. Le 27 février (12 mars), soldats et ouvriers fraterniseront, et occuperont les points stratégiques de la ville. À la fin de la journée, la capitale sera aux mains des insurgés.
- Alexandre Alexandrovitch Rittich (1868-1930), homme politique russe. Dernier ministre de l’Agriculture (1917) du tsar Nicolas II.
- Comités révolutionnaires.
- Romain Alexandrovitch Disterlo (1859-1919), homme politique russe. Fonctionnaire au ministère de la Justice (1886), sénateur (1912), membre du Conseil d’État (1914).
- Alexandre Féodorovitch Trepov (1862-1928), homme politique russe. Ministre des Transports (1917), puis président du Conseil des ministres (1917). Émigre en France.
- Hélène Guennadievna Krivochéine, née Karpova (1871-1942). Épouse d’Alexandre Vassilievitch Krivochéine et mère de Vassili, Oleg, Vsévolod [Basile], Cyrille et Igor Krivochéine. Émigre à Paris en 1919.
- Voir « Avant-propos de l’auteur », n. 2.
« Mémoire des deux mondes » De la révolution à l’Église captive
Par Basile Krivochéine
Les Éditions du CERF — 2010
Préface du Métropolite Hilarion (Alfeyev) de Volokolamsk, président du département des relations extérieures du patriarcat de Moscou — Traduction du russe de Nikita Krivochéine, Serge Model, Lydia Obolensky — Présentation, révision et notes de Serge Model