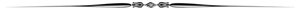La conférence panorthodoxe de Rhodes (24 septembre — 1er octobre 1961) inclut la section suivante au programme des travaux du préconcile panorthodoxe à venir :
1) textes faisant autorité dans l’Église orthodoxe ;
2) textes ayant une autorité relative ;
3) textes ayant une autorité auxiliaire ;
4) établissement et publication d’une Confession de foi orthodoxe unique.
La question des textes symboliques, celle de leur place et de leur importance dans la théologie et la conscience orthodoxes en général, n’est pas neuve dans notre Église. Habituellement, il est vrai, cette question portait sur ce qu’on appelle les « livres symboliques »: y a-t-il de tels « livres » dans l’Église orthodoxe et celle-ci leur reconnaît-elle une importance spéciale ? Or, les personnes ayant composé la section ci-dessus évitent, consciemment sans doute, le terme contesté de « livres ». À la place, ils emploient l’expression « textes symboliques ». Le choix de ce terme a été fait, on peut le supposer, non sans l’influence des travaux du professeur de théologie dogmatique et morale à la faculté théologique d’Athènes, Jean Karmiris (1903-1992), qui a beaucoup travaillé à l’étude des documents dogmatiques de l’Église orthodoxe, particulièrement de l’Église grecque, tant ancienne que moderne (après la chute de Byzance). L’attention du professeur Karmiris a été particulièrement attirée par les textes orthodoxes polémiques des XVIe-XVIIIe siècles dirigés contre les confessions occidentales. le catholicisme romain et le protestantisme, ainsi que par la question de l’influence exercée par ces confessions hétérodoxes sur la théologie orthodoxe .
Le fruit de ces longues recherches scientifiques fut un ouvrage important en deux volumes (plus de mille pages en tout) publié par J. Karmiris en grec sous le titre de Monuments dogmatiques et symboliques de l’Église orthodoxe catholique. Comme nous le voyons, le professeur Karmiris évite l’expression « livres symboliques » ; il la remplace par « mémoriaux (μνημεῖα) dogmatiques et symboliques », évitant ainsi les associations théologiques spécifiquement liées au terme de « livres symboliques » et élargissant du même coup l’objet de son étude. en plus des confessions polémiques des XVIe-XVIIIe siècles auxquelles on applique généralement le terme de « livres symboliques », le professeur Karmiris inclut dans son ouvrage une série d’autres documents de l’Église orthodoxe qui, d’une façon ou d’une autre, expriment sa foi et son enseignement — symboles de foi de l’Église ancienne, décisions dogmatiques des conciles œcuméniques et des conciles locaux entérinés par les conciles œcuméniques, les conciles hésychastes du XIVe siècle, des messages patriarcaux, etc.
Nous devons tenir compte de tout cela pour comprendre correctement la section du programme du préconcile sur les « textes symboliques », ainsi que sa terminologie. C’est la raison pour laquelle nous avons pensé indispensable de nous arrêter aussi longuement sur les travaux du professeur Karmiris au début de notre exposé.
I — C’est donc en accord avec la pensée des auteurs du programme du préconcile que nous entendrons par textes symboliques dans l’Église orthodoxe tous les monuments orthodoxes dogmatiques, exprimant, au nom de l’Église, sa foi et son enseignement théologique.
Au préconcile à venir et au concile œcuménique qui le suivra, s’il plaît à Dieu, incombera donc la tâche d’éclaircir ce qui, parmi les nombreux textes dogmatiques, peut être considéré comme un texte symbolique exprimant la foi et l’enseignement de l’Église, l’attitude que l’Église doit adopter envers ce texte, son degré d’autorité et son caractère obligatoire. Il va de soi qu’aucune question particulière ne se pose au sujet des monuments dogmatiques de l’Église ancienne. son Symbole de Foi (Credo), élaboré et confirmé par les Ier et IIe Conciles œcuméniques, fixé dans sa forme immuable par les conciles œcuméniques qui suivirent, les décisions dogmatiques des sept conciles œcuméniques en général et au sujet des décisions dogmatiques des conciles locaux antiques qui furent confirmées par le VIe Concile œcuménique (plus exactement par la deuxième règle du concile in Trullo de 691-692, considéré comme le prolongement des Ve et VIe Conciles). Il est hors de doute que les décisions dogmatiques (ὅροι) des conciles œcuméniques possèdent dans l’orthodoxie une autorité incontestable et irrévocable, bien qu’on puisse admettre que ces décisions pourront être complétées et explicitées davantage par des conciles œcuméniques à venir, s’ils sont convoqués, de même que jadis les conciles œcuméniques complétaient les décisions des conciles qui les avaient précédés. Ainsi, le IIe Concile compléta et modifia même le texte du Symbole de Foi du Ier Concile, les Ve et VIe Conciles complétèrent et précisèrent les décisions christologiques des IIIe et IVe Conciles. Mais la question se pose surtout sur le caractère et le degré d’autorité des décisions des conciles locaux et d’autres monuments dogmatiques qui ne furent pas confirmées par des conciles œcuméniques, qu’ils remontent à l’époque de ceux-ci ou à des temps plus récents, comme c’est le cas le plus souvent. Dans ce contexte, on pose parfois la question sur le droit même de l’Église orthodoxe d’élaborer et d’approuver des décisions dogmatiques après l’époque des conciles œcuméniques. Certains contestent ce droit, soit qu’ils nient tout développement dogmatique dans l’Église, soit qu’ils ne reconnaissent celui-ci que dans l’Église ancienne, considérant le nombre même de sept conciles œcuméniques comme sacré et définitif, soit enfin que l’Église orthodoxe catholique a soi-disant cessé d’être l’Église universelle après la défection du patriarcat de Rome et n’a pas le droit ni ne peut, seule, sans Rome, convoquer des conciles œcuméniques .
Nous ne pouvons partager ces opinions. L’Église orthodoxe nie, certes, l’idée du développement dogmatique dans le sens où l’entend la théologie catholique-romaine la plus récente (depuis le cardinal Newman) qui s’efforce de justifier les dogmes romains nouveaux qui ne sont contenus ni dans l’Écriture Sainte, ni dans les écrits des Pères anciens (comme par exemple le Filioque, l’infaillibilité du pape, l’Immaculée conception, etc.) en affirmant que le contenu même de la foi et de la révélation s’accroît dans le courant de l’histoire ecclésiastique ; ce qui au début n’aurait eu qu’une forme embryonnaire et n’aurait existé dans l’Écriture et la Tradition que sous forme d’allusions obscures, ce dont l’Église n’avait pas encore pris conscience, se révèle et se manifeste par la suite, se formulant dans la conscience ecclésiale. L’Église orthodoxe n’admet pas l’idée d’un tel développement ou évolution du contenu même de la foi et de la révélation. Elle reconnaît cependant que les vérités de la foi, immuables par leur contenu et leur « volume » — puisque « la foi [a été] transmise aux saints une fois pour toutes » (Jude 3) — sont formulées dans l’Église graduellement et précisées dans des concepts et des termes. C’est là un fait historique incontestable, reconnu même par les théologiens orthodoxes les plus conservateurs, tel que le métropolite Macaire (Boulgakov, 1816-1882). Il suffit, pour le confirmer, d’indiquer l’introduction graduelle dans l’usage ecclésial d’expressions théologiques fondamentales qui ne se rencontrent pas dans la Sainte Écriture. Ainsi le mot « catholique » (pour désigner l’Église — καθολικὴ Ἐκκλησία) se rencontre pour la première fois chez saint Ignace d’Antioche (Épître aux Smyrniotes, 8, 2) vers l’an 110, le mot « Trinité » (Τριάς) pour la première fois chez saint Théophile d’Antioche (Livre à Autolycus, 2, 15) vers l’an 180, l’expression Θεοτόκος (« Mère de Dieu ») pour la première fois dans les sources écrites chez Hippolyte de Rome et chez Origène dans la première moitié du IIIe siècle, quoique son emploi populaire soit plus ancien. Les mots « orthodoxe », « orthodoxie » (ὀρθόδοξος, ὀρθοδοξία) sont d’une origine encore plus tardive. on les rencontre pour la première fois chez Méthode d’Olympe au début du IVe siècle. Inutile de parler du terme ὁμοούσιος (« consubstantiel »), dont l’histoire est si intéressante. Figurant pour la première fois chez les gnostiques (Valentin et autres, au IIe siècle), ce terme fut rejeté par l’Église dans le sens que lui donnait l’hérétique Paul de Samosate, au concile d’Antioche en 270, mais admis et confirmé au concile de Nicée en 325, dans son sens orthodoxe. Généralement, une telle introduction dans l’usage théologique de termes nouveaux ou une façon nouvelle de formuler les dogmes était une réponse à l’apparition d’hérésies qui dénaturaient la foi et la tradition de l’Église. On ne peut, toutefois, y voir une règle. Des formules nouvelles étaient parfois provoquées par des besoins internes des orthodoxes eux-mêmes de préciser leur foi et leur piété. Ainsi, on peut penser que l’expression « Mère de Dieu » apparut dans des milieux populaires d’Alexandrie qui exprimaient ainsi leur vénération de la Vierge et leur foi dans l’incarnation.
De même est dépourvue de fondement l’opinion « pieuse » et très répandue selon laquelle seule l’Église ancienne des sept conciles œcuméniques possédait la puissance de la grâce de définir les vérités de la foi, alors que plus tard elle perdit ce don. Malgré son conservatisme apparent, cette opinion fait inconsciemment écho à l’enseignement protestant sur la « corruption » et la « chute » de l’Église historique « constantinienne », opposée dans le protestantisme à l’Église primitive, apostolique. Mais l’Église orthodoxe est consciente d’être la continuatrice authentique et non diminuée de l’ancienne Église des apôtres et des Pères, ou plus exactement d’être cette même Église apostolique et patristique à notre époque et de posséder toute la plénitude des dons du Saint Esprit jusqu’à la consommation des siècles. Rappelons ici avec quelle force cette plénitude des dons de l’Esprit Saint possédée par l’Église, même de nos jours, fut enseignée par le grand écrivain spirituel des Xe-XIe siècles, saint Syméon le Nouveau Théologien. Il allait jusqu’à considérer comme la plus grande de toutes les hérésies l’opinion répandue en son temps selon laquelle l’Église aurait perdu maintenant la plénitude de la grâce qu’elle avait possédée aux temps apostoliques. Il avait en vue, il est vrai, avant tout le don de la sainteté et de la contemplation ; mais la grâce est, selon l’enseignement de l’Église orthodoxe, une force divine unique, tous les dons de l’Esprit Saint sont liés les uns aux autres et demeurent sans altération dans l’Église selon la promesse du Christ. Et, d’ailleurs, comment fixer la limite historique à partir de laquelle la période de déclin commencerait dans l’Église ? Serait-ce le ΙIe siècle — moment où le canon néotestamentaire fut défini, comme le pensent les protestants ? Le Ve siècle — période post-chalcédonienne, ainsi que de nombreux anglicans semblent le croire ? Ou bien la fin de la période des conciles œcuméniques, comme le pensent de nombreux orthodoxes qui nient la possibilité de convoquer un nouveau concile œcuménique ? Ils croient qu’il ne peut y avoir que sept conciles parce que sept est un nombre sacré. À titre de preuve, ils citent certains passages de la liturgie consacrée au VIIe Concile œcuménique où ce nombre sept des conciles est comparé à celui des dons du Saint Esprit, etc. Mais une argumentation, pour ne pas dire une rhétorique semblable, avait déjà été appliquée autrefois pour défendre l’autorité du IVe Concile œcuménique contre les attaques des monophysites. On disait qu’il devait y avoir quatre conciles car ce nombre est sacré, étant celui des Évangiles, des fleuves du paradis, etc. Il y a eu sept conciles œcuméniques, mais l’Église n’a jamais décrété que ce nombre était définitif et qu’il n’y en aurait plus.
Moins acceptable encore est l’opinion selon laquelle l’Église orthodoxe catholique n’aurait pas le droit de convoquer des conciles œcuméniques seule, après la défection du patriarcat de Rome et sans la participation de celui-ci. L’Église du Christ ne s’est pas divisée parce que Rome l’a quittée. Quelque pénible, voire même tragique, qu’ait été cette défection, elle n’a pas amoindri la plénitude de la vérité et de la grâce dans l’Église, de même que la défection non moins pénible et tragique des nestoriens et des monophysites n’avait pas amoindri cette plénitude dans l’Église ancienne. L’Église orthodoxe a toujours conscience de son identité avec l’Église ancienne, l’Église une, sainte, catholique et apostolique dont parle le Credo. Elle conserve donc jusqu’à nos jours, dans sa plénitude, le droit de convoquer des conciles œcuméniques et d’y prendre des décisions dogmatiques. Ceci d’autant plus que même avant la défection de Rome, aucun des conciles œcuméniques n’a été convoqué par les papes de Rome ni même sur leur initiative ; aucun d’eux n’eut lieu à Rome et à aucun les légats du pape n’avaient assumé la présidence, tout en étant les premiers à signer les actes conciliaires, ayant la primauté d’honneur .
Il est donc incontestable qu’après la période des sept conciles œcuméniques, l’Église orthodoxe a conservé le droit d’énoncer des jugements dogmatiques et de promulguer des définitions en précisant et en formulant son enseignement théologique. L’histoire ecclésiastique nous montre, d’ailleurs, que c’est ainsi que l’Église orthodoxe agissait effectivement tout au long des siècles. Toutefois, puisqu’au cours de toute cette période historique, pour des raisons dont nous ne parlerons pas ici car cela nous entraînerait hors des cadres de cet exposé, aucun concile œcuménique ne fut convoqué ou, plutôt, aucun concile ne fut reconnu par l’ensemble de l’Église comme œcuménique, toutes ces définitions ecclésiastiques locales, ces confessions de foi, ces messages, etc., tous ces « textes symboliques » comme on les appelle, sont privés d’autorité indiscutable et d’une reconnaissance ecclésiastique générale, n’ayant pas été examinés ni approuvés par l’Église dans son ensemble à un concile œcuménique. En effet, seul un tel concile, étant une expression de toute l’Église catholique universelle, possède, de par les promesses faites par le Seigneur à son Église, en vertu de la grâce préservée dans l’épiscopat par la succession apostolique, le don d’énoncer dans le domaine de la foi des décisions infaillibles et autoritaires, le concile œcuménique pouvant conférer ce caractère d’infaillibilité et d’autorité à des définitions théologiques et des décisions d’instances ecclésiastiques moins élevées, celles des conciles locaux, des patriarches et des évêques. Une des tâches qui incombera au concile œcuménique à venir sera donc le choix parmi le grand nombre des décisions théologiques de la période « post-conciliaire », de celles qui peuvent être considérées comme exprimant entièrement l’enseignement orthodoxe à l’exemple des documents dogmatiques anciens, reconnus par les sept conciles œcuméniques. Si la conscience conciliaire reconnaît la nécessité d’un tel choix, le critère suivant lequel il pourrait être fait peut être envisagé à peu près comme suit :
1) L’identité (quant à leur fond) des textes dogmatiques examinés avec l’enseignement de l’Écriture, des conciles œcuméniques et des Saints Pères. L’Église est la gardienne de « la foi [qui a été] transmise aux saints une fois pour toutes » (Jude, 3). C’est par les paroles. « En marchant dans les traces des Saints Pères… » que les Pères du IVe Concile œcuménique (Chalcédoine) commencent leur célèbre définition sur la foi (ὅρος). C’est cette voie que devra suivre également la théologie orthodoxe authentique. La fidélité aux Pères est sa caractéristique essentielle. Ceci non seulement parce que ce sont les Pères anciens, bien que le témoignage de l’ancienneté ait toujours son prix, mais parce que leurs œuvres expriment réellement la foi de l’Église, qu’avaient prédite les prophètes, que le Christ avait enseignée par sa parole et par ses actes, que les apôtres avaient prêchée dans la force de l’Esprit Saint, que les conciles avaient définie, et les Pères explicitée. « Telle est la foi des apôtres, telle est la foi des Pères, telle est la foi orthodoxe, telle est la foi qui soutient l’univers . » C’est précisément cette foi que doit immanquablement exprimer toute confession ou définition orthodoxe.
2) Tout « texte symbolique » digne d’être confirmé en tant qu’expression de la foi de l’Église et revêtu de son autorité doit être orthodoxe, non seulement dans son fond, mais aussi dans la façon dont il est formulé ; par la manière dont il est exprimé et fondé, il doit être à la hauteur de la théologie patristique. En effet, les Saints Pères furent non seulement des confesseurs de la vraie foi, mais aussi de grands théologiens, de fins penseurs, des contemplateurs des profondeurs de l’Esprit et des mystères divins. Des textes décadents dont la forme est ratée, dont le contenu est exprimé en termes impropres pour la tradition orthodoxe, des textes pauvres quant à la pensée théologique ne sauraient prétendre à être reconnus en tant qu’expression de l’orthodoxie à l’égal des confessions anciennes qui exprimaient la haute théologie des Pères.
3) Enfin, les textes nouveaux, tout en exprimant la foi immuable de l’Église, « transmise une fois pour toutes aux saints », ne doivent pas être une simple répétition des définitions dogmatiques adoptées, car alors leur formulation et leur proclamation perdent leur raison d’être. Ces textes doivent fournir des réponses identiques en esprit mais nouvelles par leur forme, aux erreurs apparues récemment, aux questions spirituelles, aux difficultés ; ils doivent préciser et compléter ce qui jadis n’avait pas été dit suffisamment ou ce qui avait été exprimé avec une clarté insuffisante, les questions elles-mêmes n’étant pas encore, à cette époque, suffisamment mûres et éclaircies dans la conscience ecclésiale, ou bien les fausses doctrines auxquelles il s’agissait d’opposer l’enseignement ecclésial n’existant pas encore. Seuls des textes symboliques fidèles à l’esprit de l’orthodoxie, suffisamment parfaits dans leur forme et leur pensée théologique, traitant de questions nouvelles, peuvent être choisis et soumis à l’approbation du concile œcuménique à venir pour y être proclamés et revêtus de l’autorité de l’Église.
II — De ces considérations théologiques préliminaires d’un caractère général, nous pouvons passer maintenant à une étude concrète, par ordre historique, des plus importants documents symboliques de l’Église orthodoxe catholique.
Nous essaierons en même temps de définir notre attitude envers ces textes suivant le programme du préconcile qui propose de les classer dans l’ordre de leur degré d’autorité et leur caractère obligatoire (les textes faisant autorité, ceux ayant une autorité relative et ceux dont l’autorité est auxiliaire). Il va de soi que nous considérons uniquement les textes qui ne furent pas établis ni approuvés lors des sept conciles œcuméniques.
L’époque qui précéda les conciles œcuméniques nous a laissé le plus ancien monument dogmatique, le Symbole de saint Grégoire de Néocésarée que celui-ci composa vers 260-265. Incontestablement orthodoxe par son contenu, quoiqu’exprimé plutôt dans des termes philosophiques propres à un disciple d’Origène que dans des expressions bibliques propres aux symboles de l’Église, le Symbole en question exprime davantage la foi personnelle de saint Grégoire le Thaumaturge que l’enseignement de l’Église de Néocésarée. Il était bien connu des Pères du IVe siècle, en particulier de saint Athanase d’Alexandrie, et fut utilisé par eux dans leur polémique contre les ariens, car il exprimait clairement la foi dans l’incréé des Personnes de la Sainte Trinité. Néanmoins, les Pères des conciles œcuméniques ne crurent pas nécessaire de se référer à ce Symbole dans les actes conciliaires ni de l’inclure dans leurs décisions en le reconnaissant comme Symbole officiel de l’Église parallèlement à celui de Nicée-Constantinople.
On peut supposer que c’était en raison de son caractère personnel, mais surtout la conviction des Pères que le Symbole de Nicée-Constantinople était et devait demeurer unique dans l’Église, immuable et ne pouvant être remplacé par nul texte, même si ce texte ne devait rien contenir de contraire à l’orthodoxie. Telle doit être aussi, pensons-nous, notre attitude envers le Symbole de saint Grégoire le Thaumaturge, quoi qu’en pense le métropolite Macaire (Boulgakov) qui lui confère la même autorité qu’aux confessions de foi des conciles œcuméniques. Nous devons beaucoup apprécier et aimer le Symbole de saint Grégoire — monument ancien et remarquable par son contenu et sa forme, exprimant sa foi et la nôtre —, mais nous ne devons pas lui attribuer la valeur d’une confession de foi possédant une autorité ecclésiale générale qu’il n’a jamais eue.
Pour la période même des conciles œcuméniques, nous possédons deux monuments dogmatiques relativement anciens, inconnus toutefois de ces conciles. L’attitude de l’Église orthodoxe envers ces textes est comprise par beaucoup de façons différentes. Il s’agit du Symbole dit « des apôtres »et de celui de saint Athanase d’Alexandrie. En ce qui concerne le premier, même s’il contient des éléments anciens remontant à la prédication apostolique (comme d’ailleurs tous les symboles anciens), il n’est en réalité qu’une modification tardive du symbole baptismal de l’Église de Rome des IIIe-Ve siècles. À l’origine, sa langue était le latin. Son texte actuel, formé au plus tôt aux VIe-VIIe siècles en Occident, demeura tout à fait inconnu à l’Orient orthodoxe quoiqu’il ait été traduit en grec ultérieurement. Il a toujours été un symbole local, particulier, surtout baptismal et jamais les représentants de l’Occident n’avaient tenté de le citer ou de s’y référer au cours des conciles œcuméniques. Ce fut au pseudo-concile de Ferrare-Florence (en 1439-1440) que pour la première fois les Latins tentèrent de s’appuyer sur ce texte pour esquiver la question du Filioque. (Comme on le sait, l’article concernant l’Esprit Saint dans le Symbole des apôtres se borne aux paroles. Credo in Spiritum Sanctum, sans rien dire sur sa procession). Ils se heurtèrent à la résistance de saint Marc d’Éphèse qui déclara que ce symbole était inconnu de l’Église. En ce qui concerne le symbole dit de saint Athanase, connu également par les premières paroles de son texte original latin. Quicumque vult , le lieu et le moment de son apparition sont, sans doute, toujours discutés par les historiens de l’Église ; cependant il ne saurait certainement être question de son appartenance à saint Athanase. Tout est contre une telle attribution. le texte latin original, le fait que ce symbole était inconnu en Orient, que sa terminologie n’est pas athanasienne, que l’expression classique d’Athanase ὁμοούσιος ne s’y trouve pas, que sa christologie est plus tardive, qu’il n’y a aucune référence à ce symbole dans les œuvres d’Athanase et, enfin, le fait que lui-même était un adversaire résolu de la composition de tout symbole autre que celui de Nicée. Il ne se serait pas contredit lui-même en composant son propre symbole. Ce qu’il y a de plus probable, c’est que le symbole pseudo-athanasien a été composé en latin aux VIe-VIIe siècles, en Gaule méridionale ; son texte définitif ne fut établi que vers le IXe siècle. L’enseignement sur la Sainte Trinité y est exposé dans l’esprit de saint Augustin avec le primat de la nature sur les hypostases qui lui est propre. le « commencement » n’y est pas le Père, comme dans le Symbole de Nicée et les autres symboles anciens, selon la théologie de tous les Pères grecs, mais le Dieu un dans la Trinité, la « monarchie » du Père, source et cause unique, y étant manifestement diminuée. Toute cette théologie typiquement augustinienne donna naissance au Filioque pour aboutir ensuite chez Thomas d’Aquin à l’identification entre l’essence et l’énergie dans la divinité. En effet, le texte latin du symbole pseudo-athanasien qui existe actuellement contient l’enseignement sur la procession de l’Esprit Saint du Père et du Fils, quoique sans employer l’expression Filioque. « Spiritus Sanctus a Patre et Filio… procedens. » Ce Symbole, mentionné pour la première fois en Occident en 660 au concile d’Autun, finit par y être d’un emploi général vers le IXe siècle. Il demeura toutefois complètement inconnu à l’Orient orthodoxe. Pour la première fois, on l’y rencontre aux IXe-XIe siècles, lorsque les Latins s’appuyèrent sur ce texte dans leurs discussions avec les Grecs orthodoxes au sujet du Filioque. Ceci eut lieu dans la discussion bien connue entre les moines grecs et les bénédictins latins à propos du Filioque au mont des Oliviers, en 807-808, et à Constantinople, en 1054, au temps du cardinal Humbert. Ce furent aussi les Latins qui traduisirent au XIIIe siècle le Symbole pseudo-athanasien en langue grecque, à des fins polémiques. D’autres traductions grecques apparurent d’ailleurs peu après, faites par des orthodoxes, d’où les mots et Filio étaient exclus.
Ainsi « corrigé », ce symbole connut une certaine diffusion et autorité dans la théologie orthodoxe. Sa traduction slavonne (sans et Filio, bien entendu !) fut même introduite, depuis l’époque de Syméon de Polotsk, dans le texte imprimé du psautier liturgique (Slédovannaya Psaltyr) et le texte grec, à la fin du XIXe siècle, dans l’Horologion (ὡρολόγιον) grec. Les toute dernières éditions de celui-ci ne le retiennent d’ailleurs plus. L’opinion suivante, exprimée par le métropolite Macaire, illustre l’importance qu’avait le symbole pseudo-athanasien dans la théologie russe du XIXe siècle. « Vers cette même époque, apparut un symbole appelé Symbole d’Athanase… Quoi qu’il n’ait pas été composé lors des conciles œcuméniques, il était adopté et respecté par toute l’Église . » Un peu plus loin il recommande, parallèlement au Symbole de Nicée-Constantinople et aux confessions de foi des conciles œcuméniques, le Symbole « connu sous le nom de saint Athanase d’Alexandrie, accepté et respecté par toute l’Église », comme un fondement sûr de la théologie. Cette affirmation est inexacte matériellement. l’Église orthodoxe catholique n’a jamais nulle part exprimé son jugement sur le symbole pseudo-athanasien, ni accepté celui-ci. Le professeur J. Karmiris exprime son attitude envers ce symbole, de même qu’envers celui qu’on appelle « des apôtres », avec plus de circonspection. Sans défendre leur authenticité, et tout en reconnaissant entièrement leur origine occidentale, il considère utile cependant de reconnaître officiellement les deux symboles, sinon à l’égal de celui de Nicée-Constantinople, du moins comme des documents dogmatiques anciens et vénérés, ne contenant rien de contradictoire à la foi orthodoxe (une fois le et Filio exclu, évidemment). Une telle reconnaissance de ces documents, ne serait-ce qu’en qualité de sources secondaires de la doctrine de la foi, aurait, selon le professeur Karmiris, une signification positive œcuménique à notre époque, précisément en raison de leur provenance occidentale .
Il est difficile, toutefois, d’accepter l’utilité et le bien-fondé d’une telle reconnaissance. En effet, le Symbole dit « des apôtres », sans contenir d’éléments contraires à la foi, est manifestement insuffisant pour être reconnu comme un symbole officiel de l’Église. Sa reconnaissance, même partielle, nuirait au caractère unique et immuable du Symbole de Nicée-Constantinople, seul fondement de tous pourparlers œcuméniques. L’Église ne rejette pas le symbole « des apôtres ». Ainsi que l’a bien dit saint Marc d’Éphèse, elle ne le connaît simplement pas. Il n’y a aucune raison de modifier cette attitude. Ceci d’autant plus que de nos jours également, il existe une tendance à l’utiliser pour esquiver la question du Filioque (parmi les anglicans surtout où le symbole « apostolique » jouit d’une assez grande popularité). Il serait encore plus erroné de conférer, par quelque acte ecclésial, une importance officielle et générale au symbole pseudo-athanasien. Il est vrai qu’en éliminant et Filio (qui peut-être d’ailleurs ne figurait pas dans le texte original), ainsi que l’ont fait ses traducteurs grecs et slaves, on n’y trouverait plus rien qui contredise directement la foi orthodoxe. Sa partie christologique exprime même bien, et avec exactitude, l’enseignement orthodoxe post-chalcédonien. Toutefois, sa triadologie est marquée de caractères augustiniens qui, par la suite, devaient donner naissance à une série d’erreurs. C’est pourquoi le symbole pseudo-athanasien ne saurait aucunement être proclamé comme un modèle et une source de l’enseignement orthodoxe, ne serait-ce que secondaire. Il est donc souhaitable que ce symbole ne soit plus inclus dans les livres liturgiques russes, où il fut introduit sans aucune décision ecclésiastique à l’époque où les influences latines étaient très importantes. Nous devrions suivre l’exemple de nos frères grecs qui ont cessé d’inclure ce texte dans leur Horologion.
III — Passons maintenant à la période qui suivit celle des sept conciles œcuméniques.
Il nous faut, avant tout, nous arrêter au concile convoqué à Constantinople en 879-880 pendant le pontificat du patriarche Photius et du pape Jean VIII. Tant par sa composition que par le caractère de ses décisions, ce concile porte tous les caractères d’un concile œcuménique. Les cinq patriarcats composant l’Église de cette époque y étaient représentés, y compris le patriarcat de Rome, de sorte que ce concile fut le dernier qui ait été commun à l’Église d’Orient et à celle d’Occident. Ses participants étaient au nombre de 383, c’était donc le plus grand concile après celui de Chalcédoine. Il fut convoqué en tant que concile œcuménique et, dans ses actes, s’intitule « grand et œcuménique concile ». Il ne fut pas, il est vrai, reconnu officiellement par l’Église comme œcuménique parce qu’une telle reconnaissance avait lieu généralement au concile suivant et qu’il n’y en eut plus ensuite. Toutefois, une série de personnalités ecclésiastiques l’appelèrent « huitième concile œcuménique ». Ce furent, par exemple, le célèbre canoniste du XIIe siècle, Théodore Balsamon, Nil de Thessalonique (XIVe siècle), Nil de Rhodes (XIVe siècle), Syméon de Thessalonique (XVe siècle), saint Marc d’Éphèse, Gennade Scholarios, Dosithée de Jérusalem (XVIIe siècle), etc. Ainsi que l’a montré le professeur Dvornik dans son œuvre fameuse Le Schisme de Photius et ainsi que cela est admis à présent par la science historique, même catholique-romaine, le concile de 879-880 fut considéré également en Occident jusqu’au XIIe siècle comme le huitième concile œcuménique. Il n’y eut jamais de rejet de ce concile par le pape Jean VIII, ni aucun « second schisme photien » (c’est-à-dire aucune rupture entre Photius et Jean VIII). Tout cela, ce sont des légendes inventées par les ennemis de Photius ; elles ne furent admises en Occident qu’au XIIe siècle lorsque, les prétentions des papes à une juridiction universelle croissant constamment, les canonistes romains se mirent à considérer comme huitième concile œcuménique, non celui de 879-880, mais le conciliabule anti-photien de 870. Les travaux du concile de 879-880 sont aussi revêtus d’un caractère œcuménique. Tout comme les conciles œcuméniques, il adopta une série de décisions de caractère dogmatico-canonique.
1) Il proclama immuable le texte du Credo sans le Filioque et jeta l’anathème sur tous ceux qui y apporteraient des modifications. « Ainsi, décide le concile, quiconque, arrivé au degré extrême de la folie, aura l’audace d’exposer un autre symbole […] qui ajoutera ou qui enlèvera quoi que ce soit au Symbole qui nous a été transmis par le saint concile œcuménique de Nicée […] qu’il soit anathème . » Cette décision est d’autant plus significative que le Filioque était, à cette époque, déjà introduit dans le Symbole à maints endroits en Occident, et qu’en Bulgarie les missionnaires latins insistaient sur son insertion. Les légats du pape ne firent aucune objection à cette décision du concile.
2) Ce concile reconnut le second concile de Nicée (anti-iconoclaste) de 786-787 comme VIIe Concile œcuménique.
3) Il établit les relations avec l’Église de Rome et reconnut la légitimité du patriarcat de Photius, condamnant ainsi indirectement l’intervention anti-canonique des papes Nicolas Ier et Hadrien II dans les affaires de l’Église de Constantinople.
4) Ce concile délimita le pouvoir des patriarcats de Rome et de Constantinople ; il rejeta les prétentions de l’évêque de Rome à un pouvoir juridictionnel en Orient, ne lui ayant pas reconnu le droit de recevoir dans sa juridiction ni d’acquitter par son propre pouvoir les clercs condamnés en Orient (de même que, vice-versa, l’Orient ne devait pas recevoir les clercs condamnés en Occident). Ce qui est particulièrement important, le concile interdit en même temps toute modification future de la situation canonique de l’évêque de Rome.
Telles sont les décisions dogmatico-canoniques du concile de Constantinople de 879-880. Comme texte symbolique de l’Église orthodoxe, l’importance des décisions prises à ce concile est incontestable. Il apparaît très désirable que le concile œcuménique à venir proclame le concile constantinopolitain de 879-880 qui formula ces décisions — VIIIe Concile œcuménique. En effet, il l’était par sa composition et comme ayant exprimé la foi que l’Église tout entière gardait depuis toujours concernant le Credo ainsi que les droits de l’évêque de Rome, en rapport avec les questions de l’addition du Filioque et des prétentions des papes à une juridiction universelle qui apparurent alors. De cette façon, les décisions de ce concile, en tant qu’œcuménique, seraient revêtues d’une autorité incontestable et générale et le concile œcuménique à venir pourrait être appelé le IXe. La décision de proclamer œcuménique le concile de 879-880, bien comprise, pourrait avoir une signification œcuménique positive et même servir de base au dialogue avec les catholiques romains. Notre unité avec Rome dans les conciles œcuméniques ne serait-elle pas ainsi prolongée d’une centaine d’années (le temps séparant les VIIe et VIIIe Conciles) et n’aurions-nous pas en commun avec l’Occident non plus sept, mais huit conciles œcuméniques ? Ceci à condition que Rome consente à reconnaître à nouveau le concile de 879-880 comme œcuménique, comme elle l’avait déjà fait jadis en la personne du pape Jean VIII. Espérons que la science historique catholique-romaine contemporaine l’aidera à le faire. Parmi les conciles locaux ultérieurs ayant proclamé des décisions dogmatiques, notons ceux de Constantinople convoqués pendant le règne de Manuel Comnène en 1156 et 1157. Ils étudièrent des questions eucharistiques et les divergences dans la compréhension des dernières paroles de la prière précédant immédiatement le Cherubikon. « C’est toi qui offres et qui es offert », en s’intéressant notamment à qui était offert le sacrifice eucharistique. à Dieu le Père ou à toute la Sainte Trinité ? Deux patriarches, Constantin IV de Constantinople et Nicolas de Jérusalem, participèrent au premier de ces conciles avec vingt-quatre évêques ; au second, ce furent également deux patriarches, Luc Chrysobergès de Constantinople et Jean de Jérusalem, les archevêques de Bulgarie et de Chypre et trente-cinq évêques. C’était le premier concile de l’Église orthodoxe à étudier spécialement la doctrine de l’Eucharistie (si l’on ne compte pas le concile in Trullo qui la mentionne dans ses canons 23, 32 et 101, de manière néanmoins indirecte et sous un aspect plutôt rituel). Il enseigne d’une façon très précise que l’Eucharistie est non seulement un souvenir de sacrifice mais aussi un sacrifice, et que ce sacrifice est le même que celui offert sur la croix. Comme il est dit dans les anathèmes conciliaires. « À ceux qui ne comprennent pas correctement le mot « souvenir » et qui osent dire qu’il renouvelle le sacrifice de son corps et de son sang en idée et en image […] et qui, par conséquent, introduisent l’idée qu’il s’agit d’un autre sacrifice que celui qui a été accompli dès le commencement […], anathème. »
La décision du concile approfondit et précise notre compréhension de l’œuvre rédemptrice du Dieu-Homme Jésus Christ et son rapport avec les Personnes de la Sainte Trinité. Il est très important que la théologie du concile, fidèle à celle des Pères, mais ne craignant pas d’éclaircir des questions nouvelles, s’appuie aussi dans ses décisions sur des textes liturgiques ; elle affirme par là leur importance en tant que sources de la théologie ecclésiale. Le fait que ces décisions furent introduites dans les anathèmes et les proclamations de « mémoire éternelle » du dimanche de l’orthodoxie montre que l’Église a adopté les définitions dogmatiques de ce concile. Ces anathématisations étaient proclamées dans l’Église russe jusqu’en 1766, lorsque l’ancien « rite de l’orthodoxie » fut remplacé par un autre qui ne mentionnait plus le nom des différents hérétiques et hérésies, mais les remplaçait par d’autres anathèmes d’un caractère plus général. Dans l’Église grecque, ces anathèmes continuent d’être prononcés jusqu’à nos jours, ainsi que cela apparaît dans le texte du Triode grec. Néanmoins, la conscience de la grande importance des décisions dogmatiques des conciles de 1156-1157 s’est à peu près perdue dans notre théologie scolaire. les recueils des textes symboliques de l’Église orthodoxe les omettent ou ne les mentionnent qu’ « en passant ». Ceci s’explique en partie par le fait que les auteurs de ces recueils s’intéressent surtout aux textes dirigés contre les confessions occidentales. le catholicisme-romain et le protestantisme ; or, les décisions du concile de 1156-1157 sont dirigées contre des erreurs apparues au sein de l’Église byzantine, quoique non sans une certaine influence occidentale, peut-on croire. On ne peut toutefois considérer comme correcte cette attitude limitative envers les textes symboliques. Des décisions ecclésiastiques adoptées contre des erreurs « internes » peuvent avoir une importance non moindre et parfois plus grande que des décisions concernant les confessions occidentales. C’est pour cela que les décisions dogmatiques des conciles de 1156 et 1157 doivent avoir la place qu’elles méritent parmi les textes symboliques de l’Église orthodoxe, étant une expression authentique de sa foi et de son enseignement dans les questions eucharistiques.
On peut en dire autant et même plus concernant les conciles dits « hésychastes » qui eurent lieu à Constantinople en 1341, 1347 et 1351. Du point de vue formel, ces conciles (même le plus grand d’entre eux, celui de 1351) n’étaient pas œcuméniques. En fait, l’épiscopat de l’Église de Constantinople était presque seul à y être représenté ; ils comptaient en tout de vingt à cinquante évêques à en juger par le nombre des signatures sous les Actes conciliaires, certaines de ces signatures ayant même été ajoutées plus tard par les évêques locaux dans leur diocèse. Le patriarche de Jérusalem, Lazare, était, il est vrai, présent au concile de 1347; le représentant du patriarche d’Antioche, Ignace, et le métropolite Arsène de Tyr, au concile de 1351. Cependant il vaut mieux ne pas parler de ce dernier. il eut une conduite honteuse, se rangea du côté des adversaires de saint Grégoire Palamas et quitta le concile avant sa fin. Il fit même une déclaration écrite, contestant le droit du patriarcat de Constantinople de décider de questions dogmatiques seul, sans les autres patriarcats. Malgré cela, le patriarche Ignace d’Antioche signa bientôt les Actes de ce concile , de même que le patriarche de Jérusalem, Lazare. Les Églises de Bulgarie et de Serbie, déjà indépendantes à cette époque, ne participèrent pas à ces conciles. Mais, dès 1360, le concile de Trnovo de l’Église bulgare confirmait les décisions du concile constantinopolitain de 1351; le métropolite de Moscou, saint Alexis, en fit de même lorsqu’il fut confirmé dans sa qualité de métropolite à Constantinople en 1354. Le concile de 1351 finit bientôt par acquérir une telle autorité que le célèbre écrivain et canoniste du XIVe siècle, Nil, métropolite de Rhodes, alla jusqu’à l’appeler « IXe Concile œcuménique » dans son ouvrage Histoire brève des conciles œcuméniques (le VIIIe, pour lui, était celui de 879-880, comme nous l’avons vu). Du point de vue formel, il est difficile de partager son avis, puisque l’Église orthodoxe n’y fut pas représentée dans sa plénitude. Néanmoins, en substance, étant donné le caractère des décisions dogmatiques qui y furent prises, les conciles constantinopolitains du XIVe siècle, surtout celui de 1351, comptent parmi les plus importants dans l’Église orthodoxe ; ils ne le cèdent en importance qu’aux anciens conciles œcuméniques. Fidèles à la tradition orthodoxe, marchant dans les traces des Pères et étant en même temps à la hauteur de la théologie patristique, ils continuèrent, précisèrent sur de nombreux points et formulèrent, pour la première fois, conciliairement bien des aspects de l’enseignement théologique de l’Église, surtout dans les questions concernant la vie spirituelle, la grâce et la déification de l’homme. Ils donnèrent un fondement théologique à la possibilité de la participation de l’homme à la divinité, à son union à elle, sans aucunement tomber dans une confusion panthéiste du créateur et de la créature. (C’est le sens de leur doctrine sur la grâce incréée et sur le caractère incompréhensible et inaccessible de la nature divine.) Du point de vue théologique, le concile de 1351 est une continuation, par son enseignement sur les actions et les énergies divines, du VIe Concile œcuménique. C’est sur l’enseignement de celui-ci concernant les deux actions ou énergies du Christ, humaine et divine, créée et incréée, enseignement formulé dans les actes du VIe Concile , que le concile de 1351 fonde son enseignement sur le caractère incréé des énergies divines. La distinction « qui sied à Dieu » entre la nature et l’énergie divine ; la simplicité de Dieu qui demeure inviolée par cette distinction incompréhensible ; le nom de « divinité » appliqué également à l’énergie ; la doctrine sur Dieu comme source de ses actes et, dans ce sens, supérieur à ses énergies ; la participation à Dieu selon l’énergie, mais non selon l’essence. telles sont les thèses principales adoptées par le concile de 1351. Il convient d’ajouter que le concile de 1341 a donné une approbation et la reconnaissance ecclésiastique à la « Prière de Jésus » en tant qu’exprimant l’esprit authentique de la piété orthodoxe non pour les seuls moines, mais pour tous les chrétiens .
Parmi les documents approuvés par le concile de 1351, il faut mentionner tout particulièrement la Confession de foi de saint Grégoire Palamas qui exprime, sous une forme concise et parfaite, l’enseignement ecclésial sur toutes les questions théologiques fondamentales, tant anciennes (y compris celle de la procession du Saint Esprit) que celles qui étaient pour la première fois abordées au concile. La triadologie orthodoxe y est exprimée avec beaucoup de vigueur et d’une façon toute traditionnelle du point de vue biblique et patristique. En comparant cette profession de foi de saint Grégoire Palamas au Symbole pseudo-athanasien, la supériorité du premier document frappe toute conscience orthodoxe. Il convient d’ajouter aux textes théologiques de cette période le célèbre Tome hagioritique de 1339 composé par saint Grégoire Palamas et signé par les anciens et les higoumènes du mont Athos (parmi ces signatures, il y a des signatures serbes, géorgiennes et syriennes). À strictement parler, ce document ne peut être considéré comme un acte conciliaire, puisque aucun de ses signataires, sauf l’évêque de la petite ville de Hiérissos proche du mont Athos, n’était revêtu de la dignité épiscopale. Au moins trois d’entre eux, il est vrai, l’obtinrent par la suite. saint Grégoire Palamas, archevêque de Thessalonique, Calliste et Philothée, futurs patriarches de Constantinople. Mais quoi qu’il en soit, le concile de 1347 approuva le contenu du Tome hagioritique qui devint une source importante des décisions conciliaires qui suivirent ; ainsi ce document acquit la valeur d’un texte symbolique important. Les anathèmes et les proclamations de « mémoire éternelle » introduits dans le Triode par le patriarche Calliste en 1352 (c’est-à-dire un an après le concile) ont certainement aussi une importance dogmatique. On y formula sous une forme brève les thèses théologiques fondamentales des décisions des conciles « hésychastes » du XIVe siècle. Cela signifiait une reconnaissance liturgique par l’Église de ces conciles et leur conférait une haute autorité dogmatique. Malgré tout cela, ces décisions théologiques conciliaires, sans avoir, certes, été jamais reniées par l’Église orthodoxe (en dépit des insinuations de certains polémistes catholiques-romains), ont été en fait presque oubliées dans la théologie scolaire des siècles qui suivirent (XVIe-XVIIe, et en particulier au cours du XIXe siècle). Celle-ci tomba sous l’influence de la scholastique latine ou des idées protestantes et traversa une période de décadence. Si on s’intéressait tout de même aux « querelles hésychastes » et aux conciles du XIVe siècle, ce n’était pas pour leur essence, leur contenu théologique, mais surtout en tant qu’épisode de la lutte contre les Latins avec leurs tentatives de s’immiscer dans les affaires de l’Église byzantine. Cette attitude envers les « querelles hésychastes » est particulièrement propre aux théologiens grecs. Même le professeur Karmiris, qui a droit à notre reconnaissance puisqu’il a été le premier à insérer les actes des conciles de 1341-1351 dans son recueil de textes symboliques de l’Église orthodoxe, croit utile d’expliquer cette insertion non par leur portée essentielle, mais par le fait qu’ « indirectement ils sont dirigés contre l’Église latine ». Une telle attitude est certainement unilatérale et insuffisante. Il est certain qu’en définitive la doctrine de saint Grégoire Palamas sur la distinction entre l’essence et les énergies en Dieu est incompatible avec le système de Thomas d’Aquin qui identifie essence et action divines et considère la grâce non comme une énergie incréée de Dieu, mais comme un don créé. Puisque le système théologique et philosophique thomiste était, jusqu’à ces derniers temps au moins, élevé dans l’Église catholique-romaine presque à la dignité de dogme, les décisions conciliaires du XIVe siècle peuvent être considérées comme ayant un caractère anti-romain. Toutefois, elles n’étaient pas dirigées directement contre les Latins ; sauf en ce qui concerne la procession de l’Esprit Saint dans la Confession de saint Grégoire Palamas, elles ne touchaient pas aux questions litigieuses entre les Églises orthodoxe et catholique-romaine. Les discussions théologiques du XIVe siècle furent le résultat d’un choc entre divers courants au sein même de l’Église byzantine. Ce n’est qu’au cours de la seconde période des discussions que les adversaires de saint Grégoire Palamas utilisèrent des arguments provenant de l’arsenal philosophique du thomisme qui, vers cette époque, commençait à être connu à Byzance. Les décisions des conciles de 1341-1351 peuvent donc être considérées comme un fruit naturel du développement théologique de l’Église orthodoxe elle-même, et non comme le résultat de sa rencontre avec le monde hétérodoxe et ses problèmes étrangers à l’orthodoxie, comme ce fut le cas pour les Confessions du XVIIe siècle, notamment celles de Pierre (Moghila) et de Dosithée. Toutefois, étant donné que la théologie de saint Grégoire Palamas était provisoirement tombée dans l’oubli dans l’Église orthodoxe et qu’elle n’a commencé à éveiller l’intérêt qu’au XXe siècle, il est indispensable de définir, par un acte officiel du concile œcuménique à venir, l’attitude de l’Église dans son ensemble envers les décisions des conciles du XIVe siècle ; il faut confirmer leur importance et les reconnaître comme égales ou semblables aux décisions dogmatiques des conciles œcuméniques anciens.
Un autre texte symbolique important de la période byzantine tardive est la profession de foi de saint Marc d’Éphèse au pseudo-concile de Ferrare-Florence de 1439-1440. Saint Marc développa plus en détail son contenu dans son encyclique à tous les chrétiens orthodoxes qu’il écrivit après le concile, dans l’île de Lemnos en 1440-1441. L’Église orthodoxe catholique rejette, certes, avec raison, le concile de Ferrare-Florence et le compte au nombre des pseudo-conciles. Mais elle vénère profondément les paroles dignes d’un confesseur qu’y prononça saint Marc d’Éphèse et y voit une expression de sa foi et de sa doctrine, revêtue de son autorité. C’est l’orthodoxie elle-même qui parla par la bouche de saint Marc à Florence. D’ailleurs, par son contenu, cette profession de foi exprime, sous une forme brève, mais combien éclatante et précise, les croyances fondamentales de notre Église, surtout dans les questions qui nous séparent de Rome (la procession du Saint Esprit, le primat du pape, etc.).
Le tout sans polémique superflue, de sorte qu’un exposé positif des vérités de la foi occupe nettement la première place. Voici pourquoi donc, cette confession de foi doit être également comptée au nombre des textes symboliques fondamentaux de l’Église orthodoxe…
* Publié dans le Messager de l’exarchat du patriarche russe en Europe occidentale, n° 48 (1964), p. 197-217; n° 49 (1965), p. 10-23; n° 50 (1965), p. 71-82.
- Un exemple caractéristique. l’article du professeur P. P. PONOMAREV et de V. A. KÉRENSKY, « Les livres symboliques en général et, plus particulièrement, ceux de l’Église orthodoxe » (en russe) dans l’Encyclopédie théologique, Saint-Pétersbourg, 1911, t. XII, col. 1-107.
- Il étudie la question des influences hétérodoxes dans les Confessions du XVIIe siècle dans son ouvrage. Ἑτερόδοξοι ἐπιδράσεις ἐπὶ τὰς ὁμολογίας τοῦ ΙΖ’ αἰῶνος [Influences hétérodoxes sur les confessions du XVIIe siècle], paru dans la revue Νέα Σιὼν, n° 29 (1947), p. 40-49, 68-83, 175-186, 235-242; n° 30 (1948), p. 45-50, 111-120, 167-174, 226-231, 280-288; n° 31 (1949), p. 33-40; n° 32 (1950), p. 1-10.
- J. KARMIRIS, Τὰ Δογματικὰ καὶ Συμβολικὰ μνημεῖα τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας [Monuments dogmatiques et symboliques de l’Église orthodoxe catholique], Athènes, t. I, 1952 (19612) ; t. II, 1953. Voir la recension de cet ouvrage par le professeur archiprêtre Georges FLOROVSKY dans Saint-Vladimir’s Seminary Quarterly, n°1 (1953), p. 59-61.
- Cette opinion a été formulée par le théologien orthodoxe grec N. NISSIOTIS dans son article « Ιs the Vatican Council Really Ecumenical ? », paru dans The Ecumenical Review, n° 18 (1964), p. 378-394.
- Un tel enseignement sur le « développement des dogmes » fut, pour la première fois, exposé par le Cardinal J. H. NEWMAN (1801-1890) dans son traité Essay on the Development of Christian Doctrine paru en 1845 (18782), aussitôt après sa conversion de l’anglicanisme au catholicisme romain. Newman voulait, par sa théorie du développement dogmatique, expliquer comment certains dogmes catholiques romains inconnus de l’Église ancienne étaient devenus acceptables pour lui. La doctrine du « développement des dogmes » fut adoptée depuis par la théologie catholique romaine dans son ensemble, théologie qui était jusqu’alors restée fidèle, du moins en théorie, au principe de saint Vincent de Lérins selon lequel l’Église acceptait « quod semper, quod ubique, quod ab omnibus creditum est ». Ainsi que l’a remarqué avec justesse M. Henry Chadwick, théologien anglican contemporain bien connu, la doctrine du « développement des dogmes » a littéralement tiré la théologie catholique romaine de l’impasse où l’avait entraînée au XIXe siècle le conflit entre la science historique de l’Église et son système dogmatique dans les questions telles que la primauté romaine, l’infaillibilité du pape, etc. Il n’était plus nécessaire de prouver l’existence de ces croyances dans l’Église dès le début ; il suffisait désormais d’affirmer qu’il y avait à leur sujet des « allusions » dont l’Église prit ultérieurement conscience et qu’elle explicita dans le processus du « développement dogmatique ». Le point de vue orthodoxe sur cette doctrine est bien présenté dans l’article de l’archimandrite PIERRE (L’HUILLIER), « La conception orthodoxe du dogme », dans le Messager de l’exarchat du patriarche russe en Europe occidentale, n° 20 (1954), p. 238-245.
- « Cela ne veut pas dire toutefois, écrit-il après avoir rejeté la doctrine romaine sur le développement des dogmes, qu’après la fin des conciles œcuméniques l’explicitation des dogmes s’est terminée dans l’Église orthodoxe. Elle ne s’est pas terminée parce que ne se sont pas terminées non plus les erreurs et les hérésies » (Métropolite MACAIRE (BOULGAKOV), Théologie dogmatique orthodoxe [en russe]), Saint-Pétersbourg, 18683, t. I, p. 18).
- HIPPOLYTUS, De benedictione Jacobi, 1, TU 381 (1911), p. 13, 7; ORIGÈNE, Selecta in Dt 22, 23 (PG 13, col. 813 C). Voir également le mot « Θεοτόκος » dans G. W. H. LAMPE (éd.), A Patristic Greek Lexicon, Oxford, Clarendon Press, 1964, fascicule 3.
- Voir plus particulièrement sa Catéchèse 29 (SYMÉON LE NOUVEAU THÉOLOGIEN, Catéchèses, t. III, Paris, Éd. du Cerf, coll. « Sources chrétiennes », n° 113, 1965, p. 165-192).
- Le professeur Oscar Cullmann représente ces idées d’une façon quelque peu inattendue dans la théologie protestante contemporaine. Il considère qu’à partir du moment où l’Église avait fixé le canon des livres du Nouveau Testament, elle avait perdu la faculté de déterminer et de commenter le contenu de la tradition sacrée, qu’elle avait, autrement dit, commis une sorte de « suicide spirituel ». Voir O. CULLMANN, La Tradition. Problème exégétique, historique et théologique, coll. « Cahiers théologiques », n° 33, Neuchâtel et Paris, Éd. Delachaux, 1953. Voir également Y. CONGAR, La Tradition et les traditions, t. I. Essai historique, Paris, Fayard, 1960, p. 53-57.
- C’est cela sans doute qui explique le fait que, dans les collèges et les facultés de théologie anglicans, l’enseignement de l’histoire ecclésiastique s’interrompt après le concile de Chalcédoine. Ce qui suit est « évidemment » une période de décadence dont il ne vaut pas la peine de parler aux étudiants. L’histoire ecclésiastique est reprise par la période de la Réforme lorsque l’Église connut ce que l’anglicanisme considère comme une « renaissance ».
- Un exemple caractéristique de pareille comparaison entre quatre conciles et quatre Évangiles se trouve dans la vie des saints Théodose et Sabbas de Palestine. Cyrille de Scythopolis relate l’épisode suivant dans sa vie de saint Sabbas (la meilleure édition est celle d’Eduard Schwarz, Kyrillos von Skythopolis, TU 49 [1939], 2) en opposition à l’empereur Anastase, enclin au monophysisme, qui essayait de forcer l’Église de Jérusalem de renier le concile de Chalcédoine. Le patriarche Jean convoqua à Jérusalem à la fin de l’année 516 une « réunion de protestation » ; près de dix mille moines avec à leur tête saints Théodose et Sabbas, vinrent à cette réunion de tous les coins de la Palestine. Le patriarche Jean avec les saints Théodose et Sabbas s’adressèrent à l’assistance en l’exhortant à la fidélité au concile de Chalcédoine. Après cela, saint Théodose s’écria. « Celui qui n’accepte pas quatre conciles, de même que quatre Évangiles, qu’il soit anathème » (loc. cit., p. 152, 4-5). On peut rencontrer la même comparaison des quatre conciles aux quatre Évangiles dans la lettre adressée par les moines palestiniens à l’empereur Anastase au début de l’année 517. Ils écrivent que « tous les habitants de cette Terre Sainte vénèrent les quatre saints conciles honorés par le caractère évangélique [εὐαγγελικῷ χαρακτῆρι τετιμημένας] » (ibid., p. 155, 18-19). Ils poursuivent en expliquant que ces quatre conciles « ne se distinguent entre eux que par des paroles et non par leur puissance, parce qu’ils sont une image des Évangiles divinement inspirés » (ibid., p. 155, 22-24).
- Voir « L’autorité et l’infaillibilité des conciles œcuméniques », p. XX-XX (NdR).
- « Office du Synodikon » (dimanche de l’orthodoxie), Grand Euchologe et Arkhiératikon, Parme, Éd. Diaconie apostolique, 1992, p. 732 (NdR).
- PG 10, col. 983-988.
- Métropolite MACAIRE (BOULGAKOV), Théologie dogmatique orthodoxe, op. cit., p. 20.
- Le texte. KARMIRIS, op. cit., t. I, p. 46-47; DENZINGER, Symboles et Définitions de la foi catholique, Paris, Éd. du Cerf, 1996, § 10-30, p. 5-13.
- Voir J. QUASTEN, Initiation aux Pères de l’Église, vol. 1, Paris, Éd. du Cerf, 1955, p. 29-36; J. N. D. KELLY, Early Christian Creeds, Londres, 1963, p. 368-434; J. KARMIRIS, op. cit., p. 34-46.
- Sylvestre SYROPOULOS, Vera historia unionis non verae inter Graecos et Latinos, La Haye, Éd. Creyghton, 1660, p. 150; J. KARMIRIS, op. cit., p. 50; Métropolite MACAIRE (BOULGAKOV), op. cit., p. 15, n. 29.
- Texte (latin et grec) dans J. KARMIRIS, op. cit., p. 101-102; DENZINGER, loc. cit., § 46-47, p. 17.
- S’y réfèrent, par exemple, la Confession orthodoxe de Pierre (Moghila) (1, 10, 17) ; la Confession de Mitrophane Critopoulos (1) ; le concile de Constantinople de 1722, etc.
- Métropolite MACAIRE (BOULGAKOV), op. cit., p. 17.
- Ibid., p. 21.
- J. KARMIRIS, op. cit., p. 95-101.
- Sur ce concile, voir. J. KARMIRIS, op. cit., p. 261-267, qui donne également les décisions du concile.
- « Ὅρος τῆς μεγάλης καὶ οἰκουμενικῆς συνόδου », MANSI (CC 17, p. 516-517) ; J. KARMIRIS, op. cit., p. 268.
- Francis DVORNIK, Le Schisme de Photius. Histoire et légende, Paris, Éd. du Cerf, coll. « Unam Sanctam », n° 19, 1950.
- Ibid., p. 385-422.
- J. KARMIRIS, op. cit., p. 264.
- Sur ce concile, voir l’article du hiéromoine PAUL (TCHÉRÉMOUKHINE), « Le Concile constantinopolitain de 1157 et Nicolas, évêque de Méthone » (en russe), dans Bogoslovskie Trudy, n° 1, Moscou, 1959, p. 87-109.
- Voir Triode de carême, Parme, Éd. Diaconie apostolique, 19933, p. 173.
- Ainsi J. Karmiris omet de mentionner ce concile et ses décisions dans son édition des monuments symboliques ; il ne le mentionne que dans une note en parlant de l’édition du Synodikon du dimanche de l’orthodoxie (loc. cit., p. 414, n. 2).
- Les textes de leurs décisions dans J. KARMIRIS, op. cit., p. 354-416.
- Pour les détails concernant ces conciles, voir J. KARMIRIS, op. cit., p. 348-354 et J. MEYENDORFF, Introduction à l’étude de Grégoire Palamas, Paris, Éd. du Seuil, 1959, p. 77-94, p. 129-130 et p. 141-153.
- J. MEYENDORFF, op. cit., p. 146.
- Ibid., p. 151-152.
- Voir Métropolite NIL DE RHODES, Διήγησις συνοπτικὴ περὶ τῶν ἁγίων καὶ οἰκουμενικῶν συνόδον. Σύνταγμα τῶν θείων καὶ ἱερῶν κανόνων [Histoire brève des saints conciles œcuméniques. Ensemble des saints canons sacrés], Athènes, 1852, p. 389-395. Également. MANSI 25, p. 1148-1149.
- « Nous croyons en vérité que lui-même [Jésus Christ], étant un, possède deux énergies (ἐνεργείας) naturelles, divine et humaine, incréée et créée, en tant que Dieu véritable et parfait et homme véritable et parfait », dans J. KARMIRIS, op. cit., p. 382. Dans sa doctrine sur l’ « énergie » divine du Christ, le VIe Concile œcuménique suivait saint Maxime le Confesseur qui écrivait, dans sa polémique contre les monothélètes. « Il est impossible qu’une seule et même énergie soit simultanément divine et humaine, incréée et créée » (MAXIME LE CONFESSEUR, Opuscula théologica, PG 91, col. 117 A).
- Le concile de 1341 condamne Barlaam pour ses attaques « contre la prière habituelle des moines, ou plus exactement de tous les chrétiens. « Seigneur Jésus Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi » » (voir J. KARMIRIS, op. cit., p. 362; PG 150, col. 688 D). Ailleurs, ce même concile s’exprime ainsi. « Bienheureux celui qui, méditant constamment ce Nom glorieux, a Dieu qui habite en lui » (ibid., p. 365; PG 150, col. 691 B). Sont également condamnés les écrits de Barlaam « contre les moines et leur prière par laquelle ils méditent et qu’ils récitent souvent » (ibid., p. 365; PG 150, col. 691 D). Quant au concile de 1347, il confirme que « la piété de Palamas et des moines » est « infaillible et commune en vérité à tous les chrétiens » (ibid., p. 368).
- Voici ce qu’écrit à son sujet le métropolite Macaire (Boulgakov). « Nous ne pouvons passer sous silence ici quelques brefs essais apparus […] dans l’Église orthodoxe de faire un exposé général des dogmes » (op. cit., p. 51). Il mentionne plus loin la Confession de saint Grégoire Palamas (le métropolite Macaire ne l’appelle jamais « saint » !). Texte grec dans. PG 151, col. 763-768, trad. fr.. « Profession de la foi orthodoxe exposée par le saint métropolite de Thessalonique Grégoire Palamas », Messager de l’exarchat du patriarche russe en Europe occidentale, n°81-82, 1973, p. 3-7. Voir KARMIRIS, op. cit., p. 407-410. Voir H. SCHAEDER, « Das Glaubensbekenntnis des Gregor Palamas. Seine theologische und kirchenpolitische Bedeutung » dans Θεολογία, 27(1956), p. 283-294.
- PG 150, col. 1225-1236.
- Et non Philothée, comme l’affirmait par erreur Mercati ; voir J. MEYENDORFF, op. cit., p. 350-351.
- Voir les Actes du concile dans J. KARMIRIS, op. cit., p. 371.
- À titre d’exemple, on peut indiquer l’ouvrage bien connu de Grégoire PAPAMICHAÏL, Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, Ἀρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης [Saint Grégoire Palamas, archevêque de Thessalonique], Alexandrie, 1911, entièrement écrit de ce point de vue. Le professeur Papamichaïl, ainsi qu’il le dit lui-même, n’a pas l’intention d’approfondir l’aspect dogmatique des « querelles hésychastes » ; il se borne à une description historique des événements.
- J. KARMIRIS, op. cit., p. 26 et 30.
- Ce sont surtout les polémistes catholiques-romains de la vieille école, Jugie et Guichardon, qui s’efforçaient de prouver l’incompatibilité de la doctrine de saint Grégoire Palamas avec le thomisme et, par là, son « hérésie » manifeste. Ce sujet est traité en détail dans mon étude. « La doctrine ascétique et théologique de saint Grégoire Palamas », p. XX-XX.
- PG 160, col. 16-204; J. KARMIRIS, op. cit., p. 422-425.
- Patrologia Orientalis 17, col. 449-459; J. KARMIRIS, op. cit., p. 421-429.
Suite « Dieu, l’homme, l’Église » Lecture des Pères Par Basile Krivochéine Les Éditions du « CERF » Paru en. Décembre 2010, 302 pages